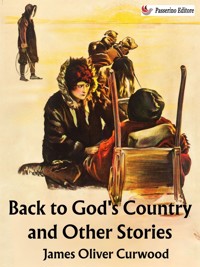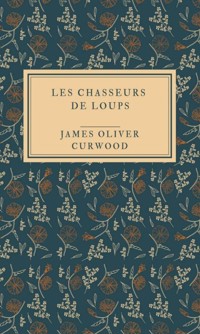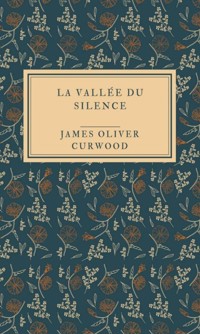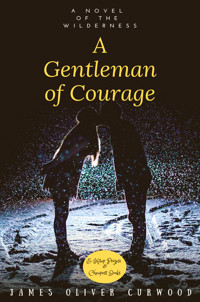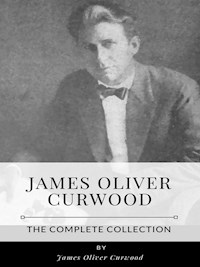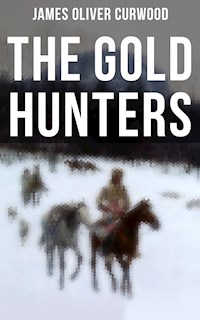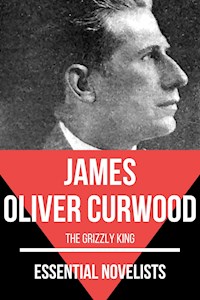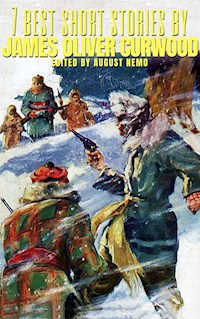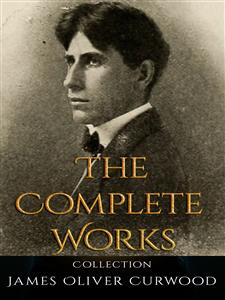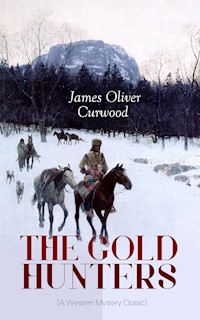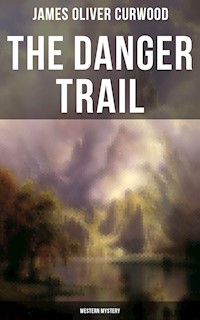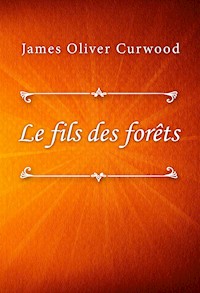
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Classica Libris
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Bien que terminée après la mort de J.-O. Curwood, l’histoire de sa vie, présentée ici, est en majeure partie l’œuvre du romancier.
James Oliver Curwood, dit Jim Curwood, né le 12 juin 1878 à Owosso, au Michigan (États-Unis), et mort dans la même ville le 13 août 1927, est un romancier américain. Avec Jack London, il est l’un des maîtres des récits du Grand Nord. On lui doit aussi des récits animaliers : Kazan (The Wolf Dog, 1914), Nomades du Nord (Nomads of the North, 1919), ou le célèbre Le Grizzly (Grizzly King, 1916) adapté au cinéma en 1988 par le réalisateur français Jean-Jacques Annaud sous le titre L’Ours, et dont le grand succès a suscité un regain d’intérêt pour l’auteur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Copyright
First published in 1930
Copyright © 2022 Classica Libris
Préface
Bien que terminée après la mort de J.-O. Curwood, l’histoire de sa vie, présentée ici, est en majeure partie l’œuvre du romancier.
Avant-propos
Cette nuit-là, je me trouvais avec un de mes amis dans ma cabane située en plein bois, au nord de l’État de Michigan. Au plus fort de l’hiver, je m’étais retiré dans cette solitude pour écrire un roman et vivre près de la nature, que j’aime en toute saison : elle me paraît aussi belle couverte de neige et de glace que parée des fleurs sauvages du printemps.
Par les fenêtres et la porte ouvertes de ma hutte de rondins l’air froid nous apportait le parfum des pins, des sapins et des cèdres exhalé par les vallées, les marécages et les montagnes environnantes. Dans mon humble demeure, cet encens se mêlait à la douce senteur de l’arbousier traînant, cueilli à pleines brassées.
Le firmament était criblé d’étoiles si étincelantes que la voûte céleste paraissait plus proche de nous ; et à leur aimable clarté nous avions vu, une heure auparavant, une daine et son faon traverser ma petite clairière.
Ces millions d’astres, qui depuis plusieurs nuits m’éclairaient de leur scintillement, me faisaient songer à autant de foyers pleins de lumière et de bonheur qu’aucun rideau n’interceptait à mes yeux ravis.
Une majestueuse forêt nous environnait de sa vie mystérieuse et nous invitait à pénétrer plus avant. Son énorme masse noire se dressait vers le ciel ; au-dessus de ma cabane, ses arbres se courbaient en murmurant, mais autour de nous régnait un profond silence.
Mon ami comprit, comme moi, que l’harmonie des grands bois contenait non seulement la poésie de l’espoir, mais la douce protestation du Maître suprême contre la folie et la barbarie des sectes fanatiques et des religions qui ont semé la discorde sur terre depuis la naissance de la pensée humaine. La voix divine conviait l’homme à rejeter loin de lui cet égoïsme aveugle qui le tient en esclavage et l’empêche de déchiffrer le mystère sublime de la vie et de la mort et de cette éternelle énigme que, faute d’un terme plus approprié, on appelle l’âme.
J’exprimai toutes ces pensées à mon ami et, au bout d’un instant, il posa sa main sur mon bras.
« Écrivez votre histoire, me dit-il. Vous faites vous-même partie de cette nature. Vous comprenez son langage. Son sang coule dans vos veines et votre cœur bat à l’unisson du sien. Maintes fois vous m’avez répété que si Dieu ne réservait aucune miséricorde pour les êtres qui adorent la Nature, vous désespéreriez de votre salut. Selon vous, les fleurs et les arbres eux-mêmes possèdent une âme, cette même flamme immortelle qui brûle en vous. Écrivez donc votre histoire pour nous tous. Des milliers d’êtres humains accueilleront vos paroles, Jim. Vous comptez, parmi vos amis, plus de jeunes gens que tout autre écrivain vivant. Dans vos romans d’amour, dans vos histoires d’aventures et d’animaux, vous avez montré à vos lecteurs – hommes et femmes – l’âme immaculée de la Nature. Il faut que les enfants, ainsi que leurs parents, connaissent vos propres aventures, sachent comment vous avez surmonté les obstacles et atteint le but – Ce sera l’histoire d’un homme très ordinaire, objectai-je ; cependant, je vous promets de l’écrire. »
Nous gravîmes le sommet de la montagne, et de là, nous observâmes la course de la lune dans le ciel. Les paroles nous semblaient vaines pour traduire notre simple joie de vivre dans ce monde merveilleux. La nuit elle-même paraissait légèrement lasse quand nous regagnâmes notre cabane.
J. O. C.
N. B. – Bien que terminée après la mort de J.-O. Curwood, l’histoire de sa vie, présentée ici, est en majeure partie l’œuvre du romancier. Lors de son décès, Madame Dorothea A. Bryant, sur la demande de Madame Curwood, prit connaissance de son manuscrit et de ses notes, qui indiquaient clairement les intentions de leur auteur. Elle en a supprimé une infime partie et ajouté au texte ce qui lui parut indispensable pour apporter plus de cohésion au récit. (N. d. T.)
1
Souvenirs de tendre jeunesse
L’hérédité n’exerce qu’une influence relative sur la destinée des hommes. Mes propres observations m’ont maintes fois démontré que le milieu joue dans la vie un rôle prépondérant. Dans les annales de ma famille figurent, parmi mes ancêtres, quantité de gens simples qui ont mené une existence dépourvue d’éclat, élevé des enfants ne sortant pas de l’ordinaire, et accompli des actes identiques à ceux de millions d’autres individus qui peuplent la planète. Cependant, je tiens à signaler dans ces souvenirs deux faits qui eurent sur moi une influence considérable.
À l’époque où la capitulation de lord Cornwallis à Yorktown subsistait encore dans la mémoire de tous mes compatriotes, un aventurier d’origine hollandaise, rompu depuis longtemps aux multiples dangers que présentent les pistes conduisant au pays des Indiens Mohawks et Onéidas, s’éprit follement d’une jolie fille d’un village mohawk situé à proximité des sources de la Canada River. Grande et svelte, elle parcourait, de ses pieds menus, les forêts du Nord avec la majestueuse démarche d’une princesse du sang. Ma mère se rappelait avoir vu dans sa jeunesse cette beauté indienne, alors âgée de quatre-vingts ans bien sonnés, et souvent je l’ai entendue dire que la chevelure de la vénérable femme conservait son lustre et une couleur noire comme des ailes de corbeau. Elle portait des chaussures si petites que ma mère, alors fillette de dix ans, ne pouvait les mettre. Jadis, cette jeune Mohawk avait dû posséder un charme ensorceleur, sans quoi mon flegmatique grand-père n’eût jamais songé à l’épouser. Les hommes qui, comme lui, hantaient les forêts en quête de fourrures, voyaient trop de femmes Peaux Rouges pour lier étourdiment leur existence avec l’une d’elles : cependant nos deux héros demeurèrent toute leur vie de fervents amoureux. Le sang indien que je tiens de mon aïeule m’a poussé continuellement à m’isoler dans le Wild et a exercé sur mes actes une influence indiscutable.
Vers l’époque où mon ancêtre blond, idolâtre des grands bois autant que les Indiens eux-mêmes, courtisait sa princesse des solitudes, naissait en la « Joyeuse Angleterre » un homme qui, par la suite, devint officier de marine et fameux conteur d’aventures palpitantes ayant pour théâtre la terre et la mer. J’ai nommé le capitaine Marryat, mon grand-oncle, dont les histoires, qu’il racontait lui-même à un adolescent appelé James, étaient si merveilleuses et évocatrices que cet intrépide garçon partit un jour sur mer et débarqua en Amérique, où il prit part à la guerre de Sécession. Plus tard, ce jeune homme fut mon père – le plus beau, le plus vaillant et le plus honorable papa qui existât au monde. Est-ce par le simple effet du hasard que, dès mon enfance, je fus tourmenté du désir d’écrire des histoires de galants chevaliers et de jolies femmes, pleins d’audace, s’aimant éperdument et mourant en braves ? Bien que je ne descende point en ligne directe du célèbre romancier anglais, je professe une opinion différente. Qui osera, sérieusement, me soutenir le contraire ?
J’ai toujours considéré Owosso, charmante petite ville de quinze mille habitants située au centre de l’État de Michigan, comme ma patrie. J’y suis né au mois de juin de l’année 1879, selon les archives municipales. Aussi loin que remontent mes souvenirs, je me vois encore en train de jouer, dans ce quartier appelé West Town, en compagnie de mon camarade Charley Miller, dont le père tenait un hôtel avec bar à quelque distance d’un vieux magasin de chaussures appartenant à mes parents. Des noyers poussaient au milieu des rues et les animaux de basse-cour s’y promenaient en toute liberté. En face de la boutique paternelle s’étendait un immense pré communal planté de sapins, et la rivière voisine offrait quelques coins d’ombre très poissonneux, ainsi que des endroits plus profonds où nous allions nous baigner.
Peu de faits saillants marquent cette époque de ma vie ou, s’il s’en produisit qui contribuèrent à ma formation actuelle, ils m’échappent pour l’instant. Je garde seulement l’impression d’avoir été un gamin turbulent comme les autres, un perpétuel tourment pour mon père, ce gentleman de la vieille école, et une source de réelle affliction pour ma mère, la plus douce et la plus exquise des femmes.
Le bon Dieu doit regarder d’un œil indulgent les gosses du type Huck Finns et Tom Sawyer, ces diablotins chers à Mark Twain, et les aimer malgré leurs visages barbouillés, leurs habits déchirés et leurs escapades. La plupart d’entre eux deviennent, en fin de compte, d’honorables citoyens chérissant des parents qu’ils ont tyrannisés jusqu’à la démence. L’amour pour les auteurs de nos jours ne s’épanouit à l’âge mûr que si, dès l’enfance, nous avons éprouvé envers eux une profonde affection basée sur l’admiration et le respect. Ayant aimé les miens avec ferveur, je crois que tout gamin animé des mêmes sentiments doit être foncièrement bon, malgré ses vêtements malpropres et son esprit d’insubordination.
À six ans, j’étais doué d’une ténacité et d’une imagination au-dessus de la moyenne. Deux de mes souhaits ambitieux demeurent fortement ancrés dans ma mémoire : je ne visais à rien de moins qu’à atteindre opulence afin d’acheter un régime entier de bananes ; puis je voulais à toute force monter à califourchon sur la superbe tournure que Kate Russell, la cuisinière de l’hôtel tenu par le père de mon ami Charley Miller, arborait les dimanches et jours de fête. Selon la mode d’alors, ma mère portait également une tournure, mais aucune dame du pays n’en possédait une aussi jolie que celle de Kate. Nul mustang impétueux des plaines n’exerça de plus puissants attraits sur un jeune aventurier. Aucune de ces ambitions ne se réalisa, et mon camarade Charley lui-même, lorsque je lui fis mes confidences, fut incapable de saisir l’originalité de mon idéal. Mon père et ma mère eussent été scandalisés de connaître les pensées qui tournoyaient dans le cerveau de leur petit va-nu-pieds. Ma figure, mes mains et mes habits ne restaient pas propres bien longtemps, et mon chapeau sans fond retenait tant bien que mal une tignasse pâlie au soleil à l’époque déjà lointaine – en 1885 pour être précis – où j’allais jouer sur les berges de la Shiawassee.
Lorsqu’à notre tour nous devenons de graves chefs de famille, trop souvent nous ne comprenons plus les fredaines de la jeunesse. Nous lavons et nettoyons nos enfants dans le vain espoir de les rendre présentables en toute circonstance ; nous les menaçons des pires châtiments et les secouons d’importance pour des peccadilles que nous avons nous-mêmes commises à leur âge. Mais qu’un père se trouve posséder un petit ange de vertu, aux vêtements impeccables et d’une conduite exemplaire, je crois dur comme fer que ce malheureux homme éprouvera, en son for intérieur, un sentiment de déception et de regret devant une telle perfection. Les parents sont de braves gens dont on ne saurait se passer ; n’empêche qu’ils sont parfois bien ennuyeux.
Eussé-je continué d’habiter Owosso, on aurait peut-être fait de moi un génie, mais le sort décréta qu’un changement d’existence s’imposait à mes six ans.
Après de mauvaises affaires, mon père, honnête homme s’il en fut, paya ses dettes et, avec le peu qu’il sauva du désastre, effectua le premier versement sur ce qu’il croyait être une ferme. En plein cœur de l’hiver, il nous emmena, moi et mon frère Ed, alors âgé de seize ans, dans l’Ohio, où il avait courtisé ma mère, et choisit un champ d’une quarantaine d’arpents. À la fonte des neiges seulement, mon père s’aperçut qu’il avait acquis une carrière et nous dûmes tous les trois ramasser des pierres durant les sept années suivantes. Dès que nous en avions débarrassé la surface, la charrue nous en mettait au jour une nouvelle récolte. Nous construisîmes des murs de clôture et sur toute la propriété s’élevèrent des pyramides de pierres aussi hautes que notre maison. La municipalité nous en acheta deux mille tombereaux, à raison de dix cents chacun, pour empierrer une partie marécageuse de la grand-route ; ce travail accompli, nous revîmes des pierres partout.
Que j’étais amoureux de cette ferme ! Aucune autre période de ma vie ne remplacerait les sept années qu’elle me servit de foyer. Non seulement ce fut une délicieuse époque, mais elle eut sur moi une influence considérable. Durant ces jours de félicité parfaite, j’ignorai les affres de la pauvreté et son cortège de vicissitudes et je développai en moi ce que je considère comme mon plus précieux héritage : l’amour de la Nature, qui éveilla ma soif d’aventures. Les nuits exerçaient une fascination particulière sur mon âme. Je me mis à admirer la lune et les étoiles, à frissonner au moindre murmure surpris dans la forêt voisine, lorsque tout le monde dormait. Les ombres épaisses, les formes entrelacées des arbres, les mares et les lacs d’argent déversés par le clair de lune représentaient à mes yeux une véritable féerie. Ces années passées sur ces champs caillouteux me firent participer en quelque sorte à la vie simple et rude du pionnier. Elles constituent une partie de mon existence qu’à présent je tiens pour mon âge heureux.
En ce temps-là, on ne connaissait ni l’automobile, ni le cinéma, ni la T.S.F., ni aucune de ces inventions que la jeunesse d’aujourd’hui estime indispensables. Nos routes étaient des pistes tortueuses, couvertes, l’été, d’une poussière molle et blanche et, l’hiver, d’une épaisse couche de neige. Dans notre hameau, l’achat d’une paire de chaussures était un événement local et une fillette qui venait à l’école vêtue d’une robe de calicot faisait l’envie et l’admiration de tous. Les cloches du dîner et les trompes répandaient une joyeuse musique dans la campagne et le bonheur de l’homme se résumait à manger à sa faim et à dormir au chaud.
Le « Mémorial Day », ou « Décoration Day », proche de Noël et du « Thanksgiving », amenait avec lui une des scènes les plus palpitantes de l’année. De plusieurs kilomètres à la ronde, nous nous réunissions au petit village de Berlin Heights et suivions, le cœur rempli d’émoi, les soldats de la grande armée de la République qui défilaient avec, sur l’épaule, d’authentiques mousquets. Notre enthousiasme ne connaissait plus de bornes lorsque rugissait leur salut par-dessus les tombes des héros morts à la guerre.
De petits riens bouleversaient tout le pays, témoin ce jour où passa sur la route communale la première bicyclette, véhicule que la plupart d’entre nous voyaient pour la première fois. Je me souviens que notre instituteur nous autorisa à quitter l’école pour nous permettre d’aller contempler ce miracle de mécanique.
Nous habitions une maison blanche et carrée que je considérais alors comme un palais, mais ce n’était en réalité – je le compris plus tard – qu’une humble demeure. Cependant nous y passâmes des jours délicieux, nos parents, mon frère Ed, ma sœur Cora et moi-même, en dépit du fait que nous buvions du café Lion à 25 cents les deux livres et que seulement à Pâques nos poules nous fournissaient des œufs en quantité suffisante pour répondre aux besoins de notre consommation. Quoi qu’il en fût, grâce à ma mère notre table était toujours abondamment pourvue et la joie régnait dans notre modeste foyer. Pas un jour ne s’écoulait sans que nous trouvions, à certains moments, ma jolie maman assise sur les genoux de mon père. Avec de semblables parents, nous ne pouvions qu’être heureux. Nos voisins nous aimaient et nous tenaient en haute estime, encore que mon père raccommodât leurs chaussures.
Je garde un souvenir très net des sapins qui entouraient notre ferme et j’entends encore le vent siffler entre leurs branches par les nuits froides et tempétueuses. Combien j’aimais l’hiver avec ses neiges épaisses, les étoiles brillantes dans le ciel pur, le clair de lune inondant ma chambre alors que la charpente même de la maison craquait sous l’effet de la froidure et que, de mon haleine, je faisais de merveilleux dessins sur les vitres !
Quand, par les matins glacés, je revenais de visiter mes trappes, j’apercevais parfois une colonne de fumée bleue qui s’élevait de la cheminée de notre cuisine et je trouvais ma mère en train de préparer des crêpes. Que ces crêpes d’autrefois étaient savoureuses ! On les mangeait accompagnées de lard et de sauce, ou de sirop fabriqué, au début du printemps, avec la sève des érables de nos forêts.
Cependant, le tableau qui hante ma mémoire se compose de pierres, dures et brûlantes en été au point de se fendre sous l’action du soleil ; de pierres qu’on employait à construire des clôtures ou qu’on ramassait en tas pour d’autres usages ; de jarres qui entravaient continuellement la culture de nos terres ; de pierres qui, maintes fois, meurtrirent mes muscles, car c’est à moi qu’incombait la tâche de les ramasser.
Les pierres m’apprirent à réfléchir et me montrèrent la nécessité de remplir sérieusement un devoir de tous les instants, en sorte que cette corvée ingrate devint pour moi éducatrice. Le fait d’empiler des pierres exigeait un effort qui contribua pour sa part à la formation de mon caractère. J’éprouvais une plus grande satisfaction lorsque j’avais empilé trois tas plutôt que deux, et ce sentiment se mua en fierté, la fierté d’un enfant constatant qu’il vient d’accomplir quelque chose d’utile en ce monde.
Je devais, dans la suite, écrire régulièrement et attendre dix années pour placer ma première nouvelle – qui, entre parenthèses, me rapporta cinq dollars – et le sort voulut que je poursuivisse ma carrière d’écrivain durant vingt années avant de pouvoir en tirer une existence confortable. Ce succès, je l’ai obtenu de haute lutte, grâce à un travail opiniâtre. Sans les pierres, ces inépuisables pierres relevées par moi dans notre propriété de l’Ohio, peut-être me serais-je avoué vaincu depuis longtemps.