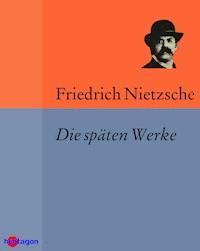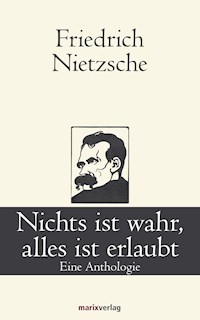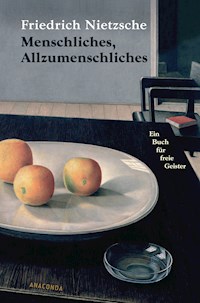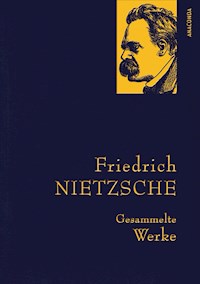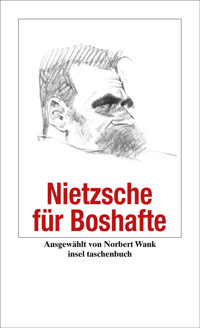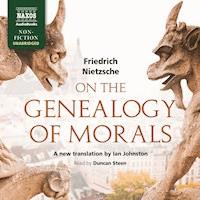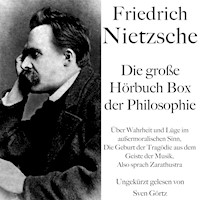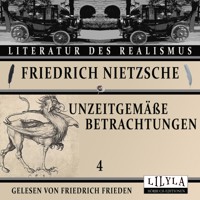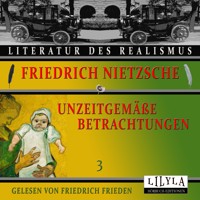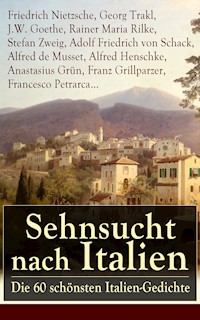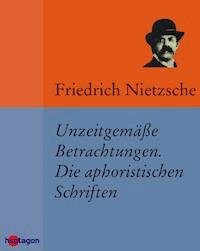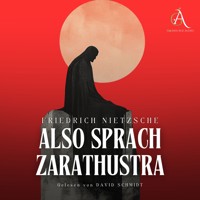1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Philaubooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Le Gai Savoir est un ouvrage de Friedrich Nietzsche, publié en 1882, sous le titre original Die fröhliche Wissenschaft, la gaya scienza. Le titre fait référence aux troubadours, l’expression Gai Saber de laquelle dérive la gaya scienza étant une façon de dénommer en occitan l’art de composer des poésies lyriques. Dans sa préface, Nietzsche contextualise son projet. Il parle de ses provenances, toutes des soupçons et des souffrances morales, faisant explicitement référence à une certaine appréhension de la psychologie en tant que libératrice des affres de la maladie. De l’antiquité grecque, qu’il affectionne particulièrement pour ce que les Grecs anciens auraient été, de son avis philologique, « superficiels… par profondeurs ! ». Il passe également par la conjecture que les personnes de sa trempe sont destinées à vivre une existence tragique, ressentie comme une délivrance, se mettant en opposition « au troupeau », qui se nourrirait de certitudes satisfaites. Les 5 livres forment un ensemble de 383 paragraphes. (Wikipédia)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Le gai savoir
Friedrich Nietzsche
Traduction parHenri Albert
Table des matières
Friedrich Nietzsche
Le Gai Savoir
Avant-propos
Prologue
Livre I
1. La doctrine du but de la vie
2. La conscience intellectuelle
3. Noble et vulgaire
4. Ce qui conserve l’espèce
5. Devoirs absolus
6. Dignité perdue
7. Pour les hommes actifs
8. Vertus inconscientes
9. Nos éruptions
10. Une espèce d’atavisme
11. La conscience
12. Du but de la science
13. Pour la doctrine du sentiment de puissance
14. Tout ce que l’on appelle amour
15. À distance
16. Sur le passage
17. Motiver sa pauvreté
18. Fierté antique
19. Le mal
20. Dignité de la folie
21. À ceux qui enseignent le désintéressement
22. L’ordre du jour pour le roi
23. Les symptômes de la corruption
24. Différents mécontentements
25. Ne pas être prédestiné à la connaissance
26. Que signifie vivre
27. Le renonciateur
28. Nuire avec ce que l’on a de meilleur
29. Ceux qui ajoutent un mensonge
30. Comédie des hommes célèbres
31. Commerce et noblesse
32. Disciples que l’on ne souhaitait point
33. Au dehors des salles de cours
34. Historia abscondita
35. Hérésie et sorcellerie
36. Dernières paroles
37. De trois erreurs
38. Les explosifs
39. Goût changé
40. De l’absence des formes nobles
41. Contre le remords
42. Travail et ennui
43. Ce que révèlent les lois
44. Les motifs que l’on croit
45. Épicure
46. Notre étonnement
47. De la répression des passions
48. Connaissance de la misère
49. La générosité et ce qui lui ressemble
50. L’argument de l’isolement
51. Véracité
52. Ce que les autres savent de nous
53. Où le bien commence
54. La conscience de l’apparence
55. La dernière noblesse de sentiment
56. Le désir de souffrance
Livre II
57. Pour les réalistes
58. Comme créateurs seulement
59. Nous autres artistes
60. Les femmes et leurs effets à distance
61. À l’honneur de l’amitié
62. Amour
63. La femme dans la musique
64. Femmes sceptiques
65. Don de soi-même
66. La force des faibles
67. Simuler sa propre nature
68. Volonté et soumission
69. Faculté de vengeance
70. Les dominatrices des maîtres
71. De la chasteté féminine
72. Les mères
73. Cruauté sacrée
74. Sans succès
75. Le troisième sexe
76. Le plus grand danger
77. L’animal avec la bonne conscience
78. Ce pour quoi nous devons être reconnaissants
79. Attrait de l’imperfection
80. Art et nature
81. Goût grec
82. L’« esprit » n’est pas grec
83. Traductions
84. De l’origine de la poésie
85. Le bien et le beau
86. Au théâtre
87. De la vanité des artistes
88. Prendre la vérité au sérieux
89. Maintenant et autrefois
90. Les lumières et les ombres
91. Précaution
92. Prose et poésie
93. Mais toi, pourquoi écris-tu donc ?
94. Croissance après la mort
95. Chamfort
96. Deux orateurs
97. De la loquacité des écrivains
98. À la gloire de Shakespeare
99. Les disciples de Schopenhauer
100. Apprendre à rendre hommage
101. Voltaire
102. Un mot pour les philologues
103. De la musique allemande
104. De l’intonation de la langue allemande
105. Les Allemands en tant qu’artistes
106. La musique qui intercède
107. Notre dernière reconnaissance envers l’art
Livre III
108. Luttes nouvelles
109. Gardons-nous
110. Origine de la connaissance
111. Origine du logique
112. Cause et effet
113. Pour la science des poisons
114. Limites du domaine moral
115. Les quatre erreurs
116. Instinct de troupeau
117. Remords de troupeau
118. Bienveillance
119. Pas d’altruisme
120. Santé de l’âme
121. La vie n’est pas un argument
122. Le scepticisme moral dans le christianisme
123. La connaissance est plus qu’un moyen
124. Dans l’horizon de l’infini
125. L’insensé
126. Explications mystiques
127. Effet de la plus ancienne religiosité
128. Valeur de la prière
129. Les conditions de Dieu
130. Une résolution dangereuse
131. Le christianisme et le suicide
132. Contre le christianisme
133. Principe
134. Les pessimistes comme victimes
135. Origine du péché
136. Le peuple élu
137. Pour parler en images
138. L’erreur du Christ
139. Couleur des passions
140. Trop juif.
141. Trop oriental
142. Fumigations
143. La plus grande utilité du polythéisme
144. Guerres de religion
145. Danger des végétariens
146. Espoirs allemands
147. Question et réponse
148. Où naissent les réformes
149. Insuccès des réformes
150. Pour la critique des saints
151. De l’origine des religions
152. Le plus grand changement
153. Homo poeta
154. La vie plus ou moins dangereuse
155. Ce qui nous manque
156. Le plus influent
157. Mentiri
158. Qualité gênante
159. Chaque vertu a son temps
160. Dans les rapports avec les vertus
161. Aux amoureux du temps
162. Egoïsme
163. Après une grande victoire
164. Ceux qui cherchent le repos
165. Bonheur du renoncement
166. Toujours en notre société
167. Misanthropie et amour
168. À propos d’un malade
169. Ennemis sincères
170. Avec la foule
171. Gloire
172. Le gâte-sauce
173. Être profond et sembler profond
174. À l’écart
175. De l’éloquence
176. Compassion
177. Pour le « système d’éducation »
178. Pour l’émancipation morale
179. Nos pensées
180. Le bon temps des esprits libres
181. Suivre et précéder
182. Dans la solitude
183. La musique du meilleur avenir
184. Justice
185. Pauvre
186. Mauvaise conscience
187. Ce qu’il y a d’offensant dans le débit
188. Travail
189. Le penseur
190. Contre les louangeurs
191. Contre certains défenseurs
192. Les êtres charitables
193. Malice de Kant
194. « À cœur ouvert »
195. A mourir de rire
196. Les bornes de notre faculté d’entendre
197. Attention !
198. Dépit de la fierté
199. Libéralité
200. Rire
201. Approbation
202. Un dissipateur
203. Hic niger est
204. Les mendiants et la politesse
205. Besoin
206. Pendant la pluie
207. L’envieux
208. Grand homme
209. Une façon de demander les raisons
210. Mesure dans l’activité
211. Ennemis secrets
212. Ne pas se laisser tromper
213. Le chemin du bonheur
214. La foi qui sauve
215. Idéal et matière
216. Danger dans la voix
217. Cause et effet
218. Mes antipodes
219. But du châtiment
220. Sacrifice
221. Ménagements
222. Poète et menteur
223. Vicariat des sens
224. Critique des animaux
225. Le naturel
226. Les méfiants et le style
227. Fausse conclusion
228. Contre les médiateurs
229. Entêtement et fidélité
230. Manque de discrétion
231. Les êtres « profonds »
232. Rêver
233. Le point de vue le plus dangereux
234. Paroles consolatrices d’un musicien
235. Esprit et caractère
236. Pour remuer la foule
237. « Il est si poli ! »
238. Sans envie
239. Sans joie
240. Au bord de la mer
241. L’œuvre et l’artiste
242. Suum cuique
243. Origine du bon et du mauvais
244. Pensées et paroles
245. Louanges dans le choix
246. Mathématique
247. Habitude
248. Livres
249. Le soupir de celui qui cherche la connaissance
250. Culpabilité
251. Souffrance méconnue
252. Plutôt devoir
253. Toujours chez soi
254. Contre l’embarras
255. Imitateurs
256. À fleur de peau
257. Par expérience
258. Les négateurs du hasard
259. Entendu au paradis
260. Une fois un
261. Originalité
262. Sub specie æterni
263. Sans vanité
264. Ce que nous faisons
265. Dernier scepticisme
266. Où la cruauté est nécessaire
267. Avec un but élevé
268. Qu’est-ce qui rend héroïque ?
269. En quoi as-tu foi ?
270. Que dit ta conscience ?
271. Où sont tes plus grands dangers ?
272. Qu’aimes-tu chez les autres ?
273. Qui appelles-tu mauvais ?
274. Que considères-tu comme ce qu’il y a de plus humain ?
275. Quel est le sceau de la liberté réalisée ?
Livre IV
276. Pour la nouvelle année
277. Providence personnelle
278. La pensée de la mort
279. Amitié d’étoiles
280. Architecture pour ceux qui cherchent la connaissance
281. Savoir trouver la fin
282. L’allure
283. Les hommes qui préparent
284. La foi en soi-même
285. Excelsior !
286. Digression
287. Joie de l’aveuglement
288. État d’âme élevé
289. Sur les vaisseaux !
290. Une seule chose est nécessaire
291. Gênes
292. Aux prédicateurs de la morale
293. Notre atmosphère
294. Contre les calomniateurs de la nature
295. Courtes habitudes
296. La réputation fixe
297. Savoir contredire
298. Soupir
299. Ce qu’il faut apprendre des artistes
300. Prélude de la science
301. Illusion des contemplatifs
302. Danger des plus heureux
303. Deux hommes heureux
304. En agissant nous omettons
305. L’empire sur soi-même
306. Stoïcien et épicurien
307. En faveur de la critique
308. L’histoire de chaque jour
309. De la septième solitude
310. Volonté et vague
311. Lumière brisée
312. Mon chien
313. Pas de tableau de martyr
314. Nouveaux animaux domestiques
315. De la dernière heure
316. Hommes prophétiques
317. Regard en arrière
318. Sagesse dans la douleur
319. Interprètes des événements de notre vie
320. En se revoyant
321. Nouvelle précaution
322. Symbole
323. Bonheur dans la destinée
324. In media vita
325. Ce qui fait partie de la grandeur
326. Les médecins de l’âme et la souffrance
327. Prendre au sérieux
328. Nuire à la bêtise
329. Loisirs et oisiveté
330. Approbation
331. Plutôt sourd qu’assourdi
332. La mauvaise heure
333. Qu’est-ce que c’est que connaître ?
334. Il faut apprendre à aimer
335. Vive la physique !
336. Avarice de la nature
337. L’« humanité » de l’avenir
338. La volonté de vie et les compatissants
339. Vita femina
340. Socrate mourant
341. Le poids formidable
342. Incipit tragœdia
Livre V
343. Notre sérénité
344. De quelle manière, nous aussi, nous sommes encore pieux
345. La morale en tant que problème
346. Notre point d’interrogation
347. Les croyants et leur besoin de croyance
348. De l’origine du savant
349. Encore l’origine des savants
350. À l’honneur des homines religiosi
351. À l’honneur des natures de prêtres
352. De quelle manière l’on peut à peine se passer de morale
353. De l’origine des religions
354. Du « génie de l’espèce »
355. L’origine de notre notion de la « connaissance »
356. De quelle manière l’Europe deviendra de plus en plus artistique
357. Sur le vieux problème : « qu’estce qui est allemand ? »
358. Le soulèvement des paysans dans le domaine de l’esprit
359. La vengeance sur l’esprit et autres arrière-plans de la morale
360. Deux espèces de causes que l’on confond
361. Le problème du comédien
362. Notre foi en une virilisation de l’Europe
363. Comment chacun des deux sexes a ses préjugés sur l’amour
364. L’ermite parle
365. L’ermite parle encore une fois
366. En regard d’un livre savant
367. Quelle est la première distinction à faire pour les œuvres d’art
368. Le cynique parle
369. Notre juxtaposition
370. Qu’est-ce que le Romantisme ?
371. Nous qui sommes incompréhensibles
372. Pourquoi nous ne sommes pas des idéalistes
373. La « science » en tant que préjugé
374. Notre nouvel « infini »
375. Pourquoi nous semblons être des épicuriens
376. Le ralentissement dans notre temps
377. Nous autres sans-patrie
378. « Et nous redevenons clairs »
379. Interruption du fou
380. « Le voyageur » parle
381. La question de la compréhension
382. La grande santé
383. Épilogue
Appendice
Notes
À propos de l’auteur
Couverture
Le Gai Savoir
traduction de l’édition de 1887 par Henri Albert
Friedrich Nietzsche
J’habite ma propre demeure,
Jamais je n’ai imité personne,
Et je me ris de tous les maîtres
Qui ne se moquent pas d’eux-mêmes.
Écrit au-dessus de ma porte
Avant-propos
1
Ce livre aurait peut-être besoin d’autre chose que d’un avant-propos, car en fin de compte un doute continuerait à subsister malgré tout, savoir si l’on pourrait rendre sensible par des préfaces, à quelqu’un qui n’a pas vécu quelque chose d’analogue, ce qu’il y a d’aventure personnelle dans ce livre. Il semble être écrit dans le langage d’un vent de dégel : on y trouve de la pétulance, de l’inquiétude, des contradictions et un temps d’avril, ce qui fait songer sans cesse au voisinage de l’hiver, tout autant qu’à la victoire sur l’hiver, à la victoire qui arrive, qui doit arriver, qui est peut-être déjà arrivée… La reconnaissance rayonne sans cesse, comme si la chose la plus inattendue s’était réalisée, c’est la reconnaissance d’un convalescent, — car cette chose inattendue, ce fut la guérison. « Gai Savoir » : qu’est-ce sinon les saturnales d’un esprit qui a résisté patiemment à une terrible et longue pression — patiemment, sévèrement, froidement, sans se soumettre, mais sans espoir, — et qui maintenant, tout à coup, est assailli par l’espoir, par l’espoir de guérison, par l’ivresse de la guérison ? Quoi d’étonnant si beaucoup de choses déraisonnables et folles sont amenées au jour, beaucoup de tendresse malicieuse gaspillée pour des problèmes hérissés d’aiguillons qui n’ont pas l’air de vouloir être caressés et attirés. C’est que ce livre tout entier n’est que fête après les privations et les faiblesses, il est la jubilation des forces renaissantes, la nouvelle foi en demain et en après-demain, le sentiment soudain et le pressentiment de l’avenir, des aventures prochaines et des mers nouvellement ouvertes, des buts permis de nouveau et auxquels il est de nouveau permis de croire. Et combien de choses avais-je derrière moi !… Cette espèce de désert d’épuisement, d’incrédulité, de congélation en pleine jeunesse, cette sénilité qui s’était introduite dans la vie, alors que je n’avais qu’en faire, cette tyrannie de la douleur, surpassée encore par la tyrannie de la fierté qui rejette les conséquences de la douleur — et c’est se consoler que de savoir accepter des conséquences, — cet isolement radical pour se garer contre un mépris des hommes, un mépris devenu clairvoyant jusqu’à la maladie, cette restriction par principe à tout ce que la connaissance a d’amer, d’âpre, de blessant, une restriction que prescrivait le dégoût né peu à peu d’une imprudente diète et d’une gâterie intellectuelles — on appelle cela du romantisme, — hélas ! qui donc pourrait sentir tout cela avec moi ! Mais celui qui le pourrait compterait certainement en ma faveur plus qu’un peu de folie, d’impétuosité et de « Gai Savoir », — il me compterait par exemple la poignée de chansons qui cette fois accompagneront le volume — des chansons où un poète se moque des poètes d’une façon difficilement pardonnable. Hélas ! ce n’est pas seulement sur les poètes et leurs « beaux sentiments lyriques » que ce ressuscité doit déverser sa méchanceté : qui sait de quelle sorte est la victime qu’il se cherche, quel monstre de sujet parodique le charmera dans peu de temps ? « Incipit tragœdia » — est-il dit à la fin de ce livre d’une simplicité inquiétante : que l’on soit sur ses gardes ! Quelque chose d’essentiellement malicieux et méchant se prépare : incipit parodia, cela ne laisse aucun doute…
2
— Mais laissons là M. Nietzsche : que nous importe que M. Nietzsche ait recouvré la santé ?… Un psychologue connaît peu de questions aussi attrayantes que celles du rapport de la santé avec la philosophie, et pour le cas où il tomberait lui-même malade, il apporterait à sa maladie toute sa curiosité scientifique. Car, en admettant que l’on soit une personne, on a nécessairement aussi la philosophie de sa personne : mais il existe là une différence sensible. Chez l’une ce sont les défauts qui font les raisonnements philosophiques, chez l’autre les richesses et les forces. Le premier a besoin de sa philosophie, soit comme soutien, tranquillisation, médicament, soit comme moyen de salut et d’édification, soit encore pour arriver à l’oubli de soi ; chez le second la philosophie n’est qu’un bel objet de luxe, dans le meilleur cas la volupté d’une reconnaissance triomphante qui finit par éprouver le besoin de s’inscrire en majuscules cosmiques dans le ciel des idées. Mais dans l’autre cas, plus habituel, lorsque la détresse se met à philosopher, comme chez tous les penseurs malades — et peut-être les penseurs malades dominent-ils dans l’histoire de la philosophie : — qu’adviendra-t-il de la pensée elle-même lorsqu’elle sera mise sous la pression de la maladie ? C’est là la question qui regarde le psychologue : et dans ce cas l’expérience est possible. Tout comme le voyageur qui se propose de s’éveiller à une heure déterminée, et qui s’abandonne alors tranquillement au sommeil : nous autres philosophes, en admettant que nous tombions malades, nous nous résignons, pour un temps, corps et âme, à la maladie — nous fermons en quelque sorte les yeux devant nous-mêmes. Et comme le voyageur sait que quelque chose ne dort pas, que quelque chose compte les heures et ne manquera pas de le réveiller, de même, nous aussi, nous savons que le moment décisif nous trouvera éveillés, — qu’alors quelque chose sortira de son repaire et surprendra l’esprit en flagrant délit, je veux dire en train de faiblir, ou bien de rétrograder, de se résigner, ou de s’endurcir, ou bien encore de s’épaissir, ou quelles que soient les maladies de l’esprit qui, pendant les jours de santé, ont contre elles la fierté de l’esprit (car ce dicton demeure vrai : « l’esprit fier, le paon, le cheval sont les trois animaux les plus fiers de la terre » —). Après une pareille interrogation de soi, une pareille tentation, on apprend à jeter un regard plus subtil vers tout ce qui a été jusqu’à présent philosophie ; on devine mieux qu’auparavant quels sont les détours involontaires, les rues détournées, les reposoirs, les places ensoleillées de l’idée où les penseurs souffrants, précisément parce qu’ils souffrent, sont conduits et transportés ; on sait maintenant où le corps malade et ses besoins poussent et attirent l’esprit — vers le soleil, le silence, la douceur, la patience, le remède, le cordial, sous quelque forme que ce soit. Toute philosophie qui place la paix plus haut que la guerre, toute éthique avec une conception négative de l’idée de bonheur, toute métaphysique et physique qui connaît un final, un état définitif d’une espèce quelconque, toute aspiration, surtout esthétique ou religieuse, à un à-côté, un au-delà, un en-dehors, un au-dessus autorisent à s’informer si ce ne fut pas la maladie qui a inspiré le philosophe. L’inconscient déguisement des besoins physiologiques sous le manteau de l’objectif, de l’idéal, de l’idée pure va si loin que l’on pourrait s’en effrayer, — et je me suis assez souvent demandé si, d’une façon générale, la philosophie n’a pas été jusqu’à présent surtout une interprétation du corps, et unmalentendu du corps. Derrière les plus hautes évaluations qui guidèrent jusqu’à présent l’histoire de la pensée se cachent des malentendus de conformation physique, soit d’individus, soit de castes, soit de races tout entières. On peut considérer toujours en première ligne toutes ces audacieuses folies de la métaphysique, surtout pour ce qui en est de la réponse à la question de la valeur de la vie, comme des symptômes de constitutions physiques déterminées ; et si de telles affirmations ou de telles négations de la vie n’ont, dans leur ensemble, pas la moindre importance au point de vue scientifique, elles n’en donnent pas moins à l’historien et au psychologue de précieux indices, étant des symptômes du corps, de sa réussite ou de sa non-réussite, de sa plénitude, de sa puissance, de sa souveraineté dans l’histoire, ou bien alors de ses arrêts, de ses fatigues, de ses appauvrissements, de son pressentiment de la fin, de sa volonté de la fin. J’attends toujours encore qu’un médecin philosophe, au sens exceptionnel du mot, — un de ceux qui poursuivent le problème de la santé générale du peuple, de l’époque, de la race, de l’humanité — ait une fois le courage de pousser à sa conséquence extrême ce que je ne fais que soupçonner et de hasarder cette idée : « Chez tous les philosophes, il ne s’est, jusqu’à présent, nullement agi de « vérité », mais d’autre chose, disons de santé, d’avenir, de croissance, de puissance, de vie… »
3
— On devine que je ne voudrais pas prendre congé avec ingratitude de cette époque de malaise profond, dont l’avantage persiste pour moi aujourd’hui encore : tout comme j’ai très bien conscience des avantages que me procure, en général, ma santé chancelante, sur tous les gens à l’esprit trapu. Un philosophe qui a parcouru le chemin à traversplusieurs santés, et qui le parcourt encore, a aussi traversé tout autant de philosophies : car il ne peut faire autrement que de transposer chaque fois son état dans la forme lointaine plus spirituelle, — cet art de la transfiguration c’est précisément la philosophie. Nous ne sommes pas libres, nous autres philosophes, de séparer le corps de l’âme, comme fait le peuple, et nous sommes moins libres encore de séparer l’âme de l’esprit. Nous ne sommes pas des grenouilles pensantes, nous ne sommes pas des appareils objectifs et enregistreurs avec des entrailles en réfrigération, — il faut sans cesse que nous enfantions nos pensées dans la douleur et que, maternellement, nous leur donnions ce que nous avons en nous de sang, de cœur, d’ardeur, de joie, de passion, de tourment, de conscience, de fatalité. La vie consiste, pour nous, à transformer sans cesse tout ce que nous sommes, en clarté et en flamme, et aussi tout ce qui nous touche. Nous ne pouvons faire autrement. Et pour ce qui en est de la maladie, ne serions-nous pas tentés de demander si, d’une façon générale, nous pouvons nous en passer ? La grande douleur seule est la dernière libératrice de l’esprit, c’est elle qui enseigne le grand soupçon, qui fait de chaque U un X, un X vrai et véritable, c’est-à-dire l’avant-dernière lettre avant la dernière… Ce n’est que la grande douleur, cette longue et lente douleur qui prend son temps, où nous nous consumons en quelque sorte comme brûlés au bois vert, cette douleur nous contraint, nous autres philosophes, à descendre dans nos dernières profondeurs et à nous débarrasser de tout bien-être, de toute demi-teinte, de toute douceur, de tout moyen-terme, où nous avions peut-être mis précédemment notre humanité. Je doute fort qu’une pareille douleur rende « meilleur » ; — mais je sais qu’elle nous rend plus profonds. Soit donc que nous apprenions à lui opposer notre fierté, notre moquerie, notre force de volonté et que nous fassions comme le peau rouge qui, quoique horriblement torturé, s’indemnise de son bourreau par la méchanceté de sa langue, soit que nous nous retirions, devant la douleur, dans le néant oriental — on l’appelle Nirvana, — dans la résignation muette, rigide et sourde, dans l’oubli et l’effacement de soi : toujours on revient comme un autre homme de ces dangereux exercices dans la domination de soi, avec quelques points d’interrogation en plus, avant tout avec la volonté d’interroger dorénavant plus qu’il n’a été interrogé jusqu’à présent, avec plus de profondeur, de sévérité, de dureté, de méchanceté et de silence. C’en est fait de la confiance en la vie : la vie elle-même est devenue un problème. — Mais que l’on ne s’imagine pas que tout ceci vous a nécessairement rendu misanthrope ! L’amour de la vie est même possible encore, — si ce n’est que l’on aime autrement. Notre amour est comme l’amour pour une femme sur qui nous avons des soupçons… Cependant le charme de tout ce qui est problématique, la joie causée par l’X sont trop grands, chez ces hommes plus spiritualisés et plus intellectuels, pour que ce plaisir ne passe pas toujours de nouveau comme une flamme claire sur toutes les misères de ce qui est problématique, sur tous les dangers de l’incertitude, même sur la jalousie de l’amoureux. Nous connaissons un bonheur nouveau…
4
Que je n’oublie pas, pour finir, de dire l’essentiel : on revient régénéré de pareils abîmes, de pareilles maladies graves, et aussi de la maladie du grave soupçon, on revient comme si l’on avait changé de peau, plus chatouilleux, plus méchant, avec un goût plus subtil pour la joie, avec une langue plus tendre pour toutes les choses bonnes, avec l’esprit plus gai, avec une seconde innocence, plus dangereuse, dans la joie ; on revient plus enfantin et, en même temps, cent fois plus raffiné qu’on ne le fut jamais auparavant. Ah ! combien la jouissance vous répugne maintenant, la jouissance grossière, sourde et grise comme l’entendent généralement les jouisseurs, nos gens « cultivés », nos riches et nos dirigeants ! Avec quelle malice nous écoutons maintenant le grand tintamarre de foire par lequel l’« homme instruit » des grandes villes se laisse imposer des jouissances spirituelles, par l’art, le livre et la musique, aidés de boissons spiritueuses ! Combien aujourd’hui le cri de passion du théâtre nous fait mal à l’oreille, combien est devenu étranger à notre goût tout ce désordre romantique, ce gâchis des sens qu’aime la populace cultivée, sans oublier ses aspirations au sublime, à l’élevé, au tortillé ! Non, s’il faut un art à nous autres convalescents, ce sera un art bien différent — un art malicieux, léger fluide, divinement artificiel, un art qui jaillit comme une flamme claire dans un ciel sans nuages ! Avant tout : un art pour les artistes, pour les artistes uniquement. Nous savons mieux à présent ce qui pour cela est nécessaire, en première ligne la sérénité, toute espèce de sérénité, mes amis ! aussi en tant qu’artistes : — je pourrais le démontrer. Il y a des choses que nous savons maintenant trop bien, nous, les initiés : il nous faut dès lors apprendre à bien oublier, à bien ignorer, en tant qu’artistes ! Et pour ce qui en est de notre avenir, on aura de la peine à nous retrouver sur les traces de ces jeunes Égyptiens qui la nuit rendent les temples peu sûrs, qui embrassent les statues et veulent absolument dévoiler, découvrir, mettre en pleine lumière ce qui, pour de bonnes raisons, est tenu caché. Non, nous ne trouvons plus de plaisir à cette chose de mauvais goût, la volonté de vérité, de la « vérité à tout prix », cette folie de jeune homme dans l’amour de la vérité : nous avons trop d’expérience pour cela, nous sommes trop sérieux, trop gais, trop éprouvés par le feu, trop profonds… Nous ne croyons plus que la vérité demeure vérité si on lui enlève son voile ; nous avons assez vécu pour écrire cela. C’est aujourd’hui pour nous affaire de convenance de ne pas vouloir tout voir nu, de ne pas vouloir assister à toutes choses, de ne pas vouloir tout comprendre et « savoir ». « Est-il vrai que le bon Dieu est présent partout, demanda une petite fille à sa mère, mais je trouve cela inconvenant. » — Une indication pour les philosophes ! On devrait honorer davantage la pudeur que met la nature à se cacher derrière les énigmes et les multiples incertitudes. Peut-être la vérité est-elle une femme qui a des raisons de ne pas vouloir montrer ses raisons ! Peut-être son nom est-il Baubô, pour parler grec !… Ah ! ces Grecs, ils s’entendaient à vivre : pour cela il importe de rester bravement à la surface, de s’en tenir à l’épiderme, d’adorer l’apparence, de croire à la forme, aux sons, aux paroles, à tout l’Olympe de l’apparence ! Ces Grecs étaient superficiels — par profondeur ! Et n’y revenons-nous pas, nous autres casse-cous de l’esprit, qui avons gravi le sommet le plus élevé et le plus dangereux des idées actuelles, pour, de là, regarder alentour, regarder en bas ? Ne sommes-nous pas, précisément en cela — des Grecs ? Adorateurs des formes, des sons, des paroles ? À cause de cela — artistes ?
Ruta près Gênes, automne 1886.
Prologue
Plaisanterie, ruse et vengeance
1. INVITATION
Goûtez donc mes mets, mangeurs !
Demain vous les trouverez meilleurs,
Excellents après-demain !
S’il vous en faut davantage — alors
Sept choses anciennes, pour sept nouvelles,
Vous donneront le courage.
2. MON BONHEUR
Depuis que je suis fatigué de chercher
J’ai appris à trouver.
Depuis qu’un vent s’est opposé à moi
Je navigue avec tous les vents.
3. INTRÉPIDITÉ
Où que tu sois, creuse profondément !
À tes pieds se trouve la source !
Laisse crier les obscurantistes :
« En bas est toujours — l’enfer ! »
A. Ai-je été malade ? suis-je guéri ?
Et qui donc fut mon médecin ?
Comment ai-je pu oublier tout cela !
B. Ce n’est que maintenant que je te crois guéri.
Car celui qui a oublié se porte bien.
5. AUX VERTUEUX
Nos vertus, elles aussi, doivent s’élever d’un pied léger :
Pareilles aux vers d’Homère, il faut qu’elles viennent et partent.
6. SAGESSE DU MONDE
Ne reste pas sur terrain plat !
Ne monte pas trop haut !
Le monde est le plus beau,
Vu à mi-hauteur.
7. VADEMECUM — VADETECUM
Mon allure et mon langage t’attirent,
Tu viens sur mes pas, tu veux me suivre ?
Suis-toi toi-même fidèlement : —
Et tu me suivras, moi ! — Tout doux ! Tout doux !
8. LORS DU TROISIÈME CHANGEMENT DE PEAU
Déjà ma peau se craquelle et se gerce,
Déjà mon désir de serpent,
Malgré la terre absorbée,
Convoite de la terre nouvelle ;
Déjà je rampe, parmi les pierres et l’herbe,
Affamé, sur ma piste tortueuse,
Pour manger, ce que j’ai toujours mangé,
La nourriture du serpent, la terre !
9. MES ROSES
Oui ! mon bonheur — veut rendre heureux !
Tout bonheur veut rendre heureux !
Voulez-vous cueillir mes roses ?
Il faut vous baisser, vous cacher,
Parmi les ronces, les rochers,
Souvent vous lécher les doigts !
Car mon bonheur est moqueur !
Car mon bonheur est perfide ! —
Voulez-vous cueillir mes roses ?
10. LE DÉDAIGNEUX
Puisque je répands au hasard
Vous me traitez de dédaigneux.
Celui qui boit dans les gobelets trop pleins
Les laisse déborder au hasard —
Ne pensez pas plus mal du vin.
11. LE PROVERBE PARLE
Sévère et doux, grossier et fin
Familier et étrange, malpropre et pur,
Rendez-vous des fous et des sages :
Je suis, je veux être tout cela,
En même temps colombe, serpent et cochon.
12. À UN AMI DE LA LUMIÈRE
Si tu ne veux pas que tes yeux et tes sens faiblissent
Cours après le soleil — à l’ombre !
13. POUR LES DANSEURS
Glace lisse,
Un paradis,
Pour celui qui sait bien danser.
14. LE BRAVE
Plutôt une inimitié de bon bois,
Qu’une amitié faite de bois recollés !
15. ROUILLE
Il faut la rouille aussi : l’arme aiguë ne suffit pas !
Autrement on dira toujours de toi : « il est trop jeune » !
16. VERS LES HAUTEURS
« Comment gravirais-je le mieux la montagne ? »
Monte toujours et n’y pense pas !
17. SENTENCE DE L’HOMME FORT
Ne demande jamais ! À quoi bon gémir !
Prends, je t’en prie, prends toujours !
18. ÂMES ÉTROITES
Je hais les âmes étroites :
Il n’y a là rien de bon et presque rien de mauvais.
19. LE SÉDUCTEUR INVOLONTAIRE
Pour passer le temps, il a lancé en l’air une parole vide,
Et pourtant à cause d’elle une femme est tombée.
20. À CONSIDÉRER
Une double peine est plus facile à porter
Qu’une seule peine : veux-tu t’y hasarder ?
21. CONTRE LA VANITÉ
Ne t’enfle pas, autrement
La moindre piqûre te fera crever.
22. HOMME ET FEMME
« Enlève la femme, celle pour qui bat ton cœur ! » —
Ainsi pense l’homme ; la femme n’enlève pas, elle vole.
23. INTERPRÉTATION
Si je vois clair en moi je me mets dedans,
Je ne puis pas être mon propre interprète.
Mais celui qui s’élève sur sa propre voie
Porte avec lui mon image à la lumière.
24. MÉDICAMENT POUR LE PESSIMISTE
Tu te plains de ne rien trouver à ton goût ?
Alors, ce sont toujours tes vieilles lubies ?
Je t’entends jurer, tapager, cracher —
J’en perds patience, mon cœur se brise.
Écoute, mon ami, décide-toi librement,
D’avaler un petit crapaud gras,
Vite, et sans y jeter un regard ! —
C’est souverain contre la dyspepsie !
25. PRIÈRE
Je connais l’esprit de beaucoup d’hommes
Et ne sais pas qui je suis moi-même !
Mon œil est bien trop près de moi —
Je ne suis pas ce que je contemple.
Je saurais m’être plus utile,
Si je me trouvais plus loin de moi.
Pas aussi loin, certes, que mon ennemi !
L’ami le plus proche est déjà trop loin —
Pourtant au milieu entre celui-ci et moi !
Devinez-vous ce que je demande ?
26. MA DURETÉ
Il faut que je passe sur cent degrés,
Il faut que je monte, je vous entends appeler :
« Tu es dur ! Sommes-nous donc de pierre ? » —
Il faut que je passe sur cent degrés,
Et personne ne voudrait me servir de degré.
27. LE VOYAGEUR
« Plus de sentier ! Abîme alentour et silence de mort ! »
Tu l’as voulu ! Pourquoi quittais-tu le sentier ?
Hardi ! c’est le moment ! Le regard froid et clair !
Tu es perdu si tu crois au danger.
28. CONSOLATION POUR LES DÉBUTANTS
Voyez l’enfant, les cochons grognent autour de lui,
Abandonné à lui-même, les orteils repliés !
Il ne sait que pleurer et pleurer encore —
Apprit-il jamais à se tenir droit et à marcher ?
Soyez sans crainte ! Bientôt, je pense,
Vous pourrez voir danser l’enfant !
Dès qu’il saura se tenir sur ses deux pieds
Vous le verrez se mettre sur la tête.
29. ÉGOÏSME DES ÉTOILES
Si je ne tournais sans cesse autour de moi-même,
Tel une tonne qu’on roule,
Comment supporterais-je sans prendre feu
De courir après le brûlant soleil ?
30. LE PROCHAIN
Je n’aime pas que mon prochain soit auprès de moi :
Qu’il s’en aille au loin et dans les hauteurs !
Comment ferait-il autrement pour devenir mon étoile ?
31. LE SAINT MASQUÉ
Pour que ton bonheur ne nous oppresse pas,
Tu te voiles de l’astuce du diable,
De l’esprit du diable, du costume du diable.
Mais en vain ! De ton regard
S’échappe la sainteté.
32. L’ASSUJETTI
A. Il s’arrête et écoute : qu’est-ce qui a pu le tromper ?
Qu’a-t-il entendu bourdonner à ses oreilles ?
Qu’est-ce qui a bien pu l’abattre ainsi ?
B. Comme tous ceux qui ont porté des chaînes,
Les bruits de chaînes le poursuivent partout.
33. LE SOLITAIRE
Je déteste autant de suivre que de conduire.
Obéir ? Non ! Et gouverner jamais !
Celui qui n’est pas terrible pour lui, n’inspire la terreur à personne :
Et celui seul qui inspire la terreur peut conduire les autres.
Je déteste déjà de me conduire moi-même !
J’aime, comme les animaux des forêts et des mers,
À me perdre pour un bon moment,
À m’accroupir ; rêveur, dans des déserts charmants,
À me rappeler enfin, moi-même, du lointain,
À me séduire moi-même — vers moi-même.
34. SENECA ET HOC GENUS OMNE
Ils écrivent et écrivent toujours leur insupportable
Et sage larifari
Comme s’il s’agissait de primum scribere,
Deinde philosophari.
35. GLACE
Oui parfois je fais de la glace :
Elle est utile pour digérer !
Si tu avais beaucoup à digérer,
Ah ! comme tu aimerais ma glace !
36. ÉCRIT POUR LA JEUNESSE
L’alpha et l’omega de ma sagesse
M’est apparu : qu’ai-je entendu ?…
Maintenant cela résonne tout autrement,
Je n’entends plus que Ah ! et Oh !
Vieilles scies de ma jeunesse.
37. ATTENTION !
Il ne fait pas bon voyager maintenant dans cette contrée ;
Et si tu as de l’esprit sois doublement sur tes gardes !
On t’attire et on t’aime, jusqu’à ce que l’on te déchire.
Esprits exaltés — : ils manquent toujours d’esprit !
38. L’HOMME PIEUX PARLE
Dieu nous aime parce qu’il nous a créés ! —
« L’homme a créé Dieu ! » — C’est votre réponse subtile.
Et il n’aimerait pas ce qu’il a créé ?
Parce qu’il l’a créé il devrait le nier ?
Ça boite, ça porte le sabot du diable.
39. EN ÉTÉ
Nous devrons manger notre pain
À la sueur de notre front ?
Il vaut mieux ne rien manger lorsqu’on est en sueur,
D’après le sage conseil des médecins.
Sous la canicule, que nous manque-t-il ?
Que veut ce signe enflammé ?
À la sueur de notre front
Nous devons boire notre vin.
40. SANS ENVIE
Son regard est sans envie et vous l’honorez pour cela ?
Il se soucie peu de vos honneurs ;
Il a l’œil de l’aigle pour le lointain,
Il ne vous voit pas ! – il ne voit que des étoiles !
41. HÉRACLITISME
Tout bonheur sur la terre,
Amis, est dans la lutte !
Oui, pour devenir amis
Il faut la fumée de la poudre !
Trois fois les amis sont unis :
Frères devant la misère,
Égaux devant l’ennemi,
Libres — devant la mort !
42. PRINCIPE DES TROP SUBTILS
Plutôt marcher sur la pointe des pieds
Qu’à quatre pattes !
Plutôt passer à travers le trou de la serrure,
Que par les portes ouvertes !
43. CONSEIL
Tu aspires à la gloire ?
Écoute donc un conseil :
Renonce à temps, librement,
À l’honneur !
44. À FOND
Un chercheur, moi ! — Garde-toi de ce mot ! —
Je suis lourd seulement — de tant de livres !
Je ne fais que tomber sans cesse
Pour tomber, enfin, jusqu’au fond !
45. POUR TOUJOURS
« Je viens aujourd’hui parce que cela me plaît » —
Ainsi pense chacun qui vient pour toujours.
Que lui importe ce que dit le monde :
« Tu viens trop tôt ! Tu viens trop tard ! »
46. JUGEMENTS DES HOMMES FATIGUÉS
Tous les épuisés maudissent le soleil :
Pour eux la valeur des arbres — c’est l’ombre !
47. DESCENTE
« Il baisse, il tombe » — vous écriez-vous moqueurs ;
La vérité c’est qu’il descend vers vous !
Son trop grand bonheur a été son malheur,
Sa trop grande lumière suit votre obscurité.
48. CONTRE LES LOIS
À partir d’aujourd’hui je suspens
À mon cou la montre qui marque les heures :
À partir d’aujourd’hui cessent le cours des étoiles.
Du soleil, le chant du coq, les ombres ;
Et tout ce que le temps a jamais proclamé,
Est maintenant muet, sourd et aveugle : —
Pour moi toute nature se tait,
Au tic tac de la loi et de l’heure.
49. LE SAGE PARLE
Étranger au peuple et pourtant utile au peuple,
Je suis mon chemin, tantôt soleil, tantôt nuage —
Et toujours au-dessus de ce peuple !
50. AVOIR PERDU LA TÊTE
Elle a de l’esprit maintenant — comment s’y est-elle prise ?
– Par elle un homme vient de perdre la raison,
Son esprit était riche avant ce mauvais passe-temps :
Il s’en est allé au diable — non ! chez la femme !
51. PIEUX SOUHAIT
« Que toutes les clefs
Aillent donc vite se perdre,
Et que dans toutes les serrures
Tourne un passe-partout ! »
Ainsi pense, à tout instant,
Celui qui est lui-même — un passe-partout.
52. ÉCRIRE AVEC LE PIED
Je n’écris pas qu’avec la main,
Le pied veut sans cesse écrire aussi.
Solide, libre et brave, il veut en être,
Tantôt à travers champs, tantôt sur le papier.
53. « HUMAIN, TROP HUMAIN », UN LIVRE
Mélancolique, timide, tant que tu regardes en arrière,
Confiant en l’avenir, partout où tu as confiance en toi-même :
Oiseau, dois-je te compter parmi les aigles ?
Es-tu le favori de Minerve, hibou ?
54. À MON LECTEUR
Bonne mâchoire et bon estomac —
C’est ce que je te souhaite !
Et quand tu auras digéré mon livre,
Tu t’entendras certes avec moi !
55. LE PEINTRE RÉALISTE
« Fidèle à la nature et complet ! » — Comment s’y prend-il :
Depuis quand la nature se soumet-elle à un tableau ?
Infinie est la plus petite parcelle du monde ! —
Finalement il en peint ce qui lui plaît.
Et qu’est-ce qui lui plait ? Ce qu’il sait peindre !
56. VANITÉ DE POÈTE
Donnez-moi de la colle, et je trouverai
Moi-même le bois à coller !
Mettre un sens dans quatre rimes insensées —
Ce n’est pas là petite fierté !
57. LE GOÛT QUI CHOISIT
Si l’on me laissait choisir librement
Je choisirais volontiers une petite place,
Pour moi, au milieu du paradis :
Et plus volontiers encore — devant sa porte !
58. LE NEZ CROCHU
Le nez s’avance insolent
Dans le monde. La narine se gonfle —
C’est pourquoi, rhinocéros sans corne,
Hautain bonhomme, tu tombes toujours en avant !
Et réunies toujours, on rencontre ces deux choses :
La fierté droite et le nez crochu.
59. LA PLUME GRIBOUILLE
La plume gribouille : quel enfer !
Suis-je condamné à gribouiller ?
Mais bravement je saisis l’encrier,
Et j’écris à grands flots d’encre.
Quelles belles coulées larges et pleines !
Comme tout ce que je fais me réussit !
L’écriture, il est vrai, manque de clarté —
Qu’importe ! Qui donc lit ce que j’écris ?
60. HOMMES SUPÉRIEURS
Celui-ci s’élève — il faut le louer !
Mais celui-là vient toujours d’en haut !
Il vit même au-dessus de la louange,
Il est d’en-haut !
61. LE SCEPTIQUE PARLE
La moitié de ta vie est passée,
L’aiguille tourne, ton âme frissonne !
Longtemps elle a erré déjà,
Elle cherche et n’a pas trouvé — et ici elle hésite ?
La moitié de ta vie est passée :
Elle fut douleur et erreur, d’heure en heure !
Que cherches-tu encore ? Pourquoi ? — —
C’est ce que je cherche — la raison de ma recherche !
62. ECCE HOMO
Oui, je sais bien d’où je viens !
Inassouvi, comme la flamme,
J’arde pour me consumer.
Ce que je tiens devient lumière,
Charbon ce que je délaisse :
Car je suis flamme assurément !
63. MORALE D’ÉTOILE
Prédestinée à ton orbite,
Que t’importe, étoile, l’obscurité ?
Roule, bienheureuse, à travers ce temps !
La misère te paraît étrangère et lointaine !
Au monde le plus éloigné tu destines ta clarté ;
La pitié doit être péché pour toi !
Tu n’admets qu’une seule loi : sois pur !
Livre I
1
La doctrine du but de la vie
J’ai beau regarder les hommes, soit avec un regard bienveillant, soit avec le mauvais œil, je les trouve toujours occupés, tous et chacun en particulier, à une même tâche : à faire ce qui est utile à la conservation de l’espèce humaine. Et ce n’est certes pas à cause d’un sentiment d’amour pour cette espèce, mais simplement puisque, en eux, rien n’est plus ancien, plus fort, plus inexorable, plus invincible que cet instinct, — puisque cet instinct est précisément l’essence de notre espèce et de notre troupeau. Quoique l’on arrive assez rapidement, avec la vue basse dont on est coutumier, à séparer nettement, selon l’usage, à une distance de cinq pas, ses prochains en hommes utiles et nuisibles, bons et méchants, lorsque l’on fait un décompte général, en réfléchissant plus longuement sur l’ensemble, on finit par se méfier de cette épuration et de cette distinction et l’on y renonce complètement. L’homme le plus nuisible est peut-être encore le plus utile au point de vue de la conservation de l’espèce ; car il entretient chez lui, ou par son influence sur les autres, des instincts sans lesquels l’humanité serait amollie ou corrompue depuis longtemps. La haine, la joie méchante, le désir de rapine et de domination, et tout ce qui, pour le reste, s’appelle le mal : cela fait partie de l’extraordinaire économie dans la conservation de l’espèce, une économie coûteuse, prodigue et, en somme, excessivement insensée : — mais qui, cela est prouvé, a conservé jusqu’à présent notre race. Je ne sais plus, mon cher frère en humanité, si, en somme, tu peux vivre au détriment de l’espèce, c’est-à-dire d’une façon « déraisonnable » et « mauvaise » ; ce qui aurait pu nuire à l’espèce s’est peut-être éteint déjà depuis des milliers d’années et fait maintenant partie de ces choses qui, même auprès de Dieu, ne sont plus possibles. Suis tes meilleurs ou tes plus mauvais penchants et, avant tout, va à ta perte ! — dans les deux cas tu seras probablement encore, d’une façon ou d’une autre, le bienfaiteur qui encourage l’humanité, et, à cause de cela, tu pourras avoir tes louangeurs — et de même tes railleurs ! Mais tu ne trouveras jamais celui qui saurait te railler, toi l’individu, entièrement, même dans ce que tu as de meilleur, celui qui saurait te faire apercevoir, suffisamment pour répondre à la vérité, ton incommensurable pauvreté de mouche et de grenouille ! Pour rire sur soi-même, comme il conviendrait de rire — comme si la vérité partait du cœur — les meilleurs n’ont pas encore eu jusqu’à présent assez de véracité, les plus doués assez de génie ! Peut-être y a-t-il encore un avenir pour le rire ! Ce sera lorsque, la maxime : « l’espèce est tout, l’individu n’est rien », se sera incorporée à l’humanité, et que chacun pourra, à chaque moment, pénétrer dans le domaine de cette délivrance dernière, de cette ultime irresponsabilité. Peut-être alors le rire se sera-t-il allié à la sagesse, peut-être ne restera-t-il plus que le « Gai Savoir ». En attendant il en est tout autrement, en attendant la comédie de l’existence n’est pas encore « devenue consciente » à elle-même, en attendant c’est encore le temps de la tragédie, le temps des morales et des religions. Que signifie cette apparition toujours nouvelle de ces fondateurs de morales et de religions, de ces instigateurs à la lutte pour les évaluations morales, de ces maîtres du remords et des guerres de religion ? Que signifient ces héros sur de pareilles planches ? Car jusqu’à présent, ce furent bien des héros ; et tout le reste qui, par moments, était seul visible et très proche de nous, n’a jamais fait que servir à la préparation de ces héros, soit comme machinerie et comme coulisse, soit dans le rôle de confident et de valet. (Les poètes, par exemple, furent toujours les valets d’une morale quelconque.) — Il va de soi que ces tragiques, eux aussi, travaillent dans l’intérêt de l’espèce, bien qu’ils s’imaginent peut-être travailler dans l’intérêt de Dieu et comme envoyés de Dieu. Eux aussi activent la vie de l’espèce, en activant la croyance en la vie. « Il vaut la peine de vivre — ainsi s’écrie chacun d’eux — la vie tire à conséquence, il y a quelque chose derrière et au-dessous d’elle, prenez garde ! » Cet instinct qui règne d’une façon égale chez les hommes supérieurs et vulgaires, l’instinct de conservation, se manifeste, de temps en temps, sous couleur de raison, ou de passion intellectuelle ; il se présente alors, entouré d’une suite nombreuse de motifs, et veut, à toute force, faire oublier qu’il n’est au fond qu’impulsion, instinct, folie et manque de raisons. Il faut aimer la vie, car… ! Il faut que l’homme active sa vie et celle de son prochain, car… ! Et quels que soient encore tous ces « il faut » et ces « car », maintenant et dans l’avenir. Afin que tout ce qui arrive, nécessairement et toujours par soi-même, sans aucune fin, apparaisse dorénavant comme ayant été fait en vue d’un but, plausible à l’homme comme raison et loi dernière, — le maître de Morale s’impose comme maître du but de la vie ; il invente pour cela une seconde et autre vie, et, au moyen de sa nouvelle mécanique, il fait sortir notre vie, ancienne et ordinaire, de ses gonds, anciens et ordinaires. Oui, il ne veut à aucun prix que nous nous mettions à rire de l’existence, ni de nous-même — ni de lui. Pour lui l’être est toujours l’être, quelque chose de premier, de dernier et d’immense ; pour lui il n’y a point d’espèce, de somme, de zéro. Ses inventions et ses appréciations auront beau être folles et fantasques, il aura beau méconnaître la marche de la nature et les conditions de la nature : — et toutes les éthiques furent jusqu’à présent insensées et contraires à la nature, au point que chacune d’elles aurait mené l’humanité à sa perte, si elle s’était emparée de l’humanité — quoi qu’il en soit, chaque fois que « le héros » montait sur les planches quelque chose de nouveau était atteint, l’opposé épouvantable du rire, cette profonde émotion de plusieurs à la pensée : « oui, il vaut la peine que je vive ! oui, je suis digne de vivre ! » — la vie, et moi et toi, et nous tous, tant que nous sommes, nous devînmes de nouveau intéressants pour nous. — Il ne faut pas nier qu’à la longue le rire, la raison et la nature ont fini par se rendre maîtres de chacun de ces grands maîtres en téléologie : la courte tragédie a toujours fini par revenir à l’éternelle comédie de l’existence, et la mer au « sourire innombrable » — pour parler avec Eschyle — finira par couvrir de ses flots la plus grande de ces tragédies. Mais malgré tout ce rire correcteur, somme toute, la nature humaine a été transformée par l’apparition toujours nouvelle de ces proclamateurs du but de la vie, — elle a maintenant un besoin de plus, précisément celui de voir apparaître toujours de nouveau de pareilles doctrines de la « fin ». L’homme est devenu peu à peu un animal fantasque qui aura à remplir une condition d’existence de plus que tout autre animale : il faut que, de temps en temps, l’homme se figure savoir pourquoi il existe, son espèce ne peut pas prospérer sans une confiance périodique en la vie ! Sans la foi à la raison dans la vie. Et, toujours de nouveau, l’espèce humaine décrétera de temps en temps : « Il y a quelque chose sur quoi l’on n’a absolument pas le droit de rire ! » Et le plus prévoyant des philanthropes ajoutera : « Non seulement le rire et la sagesse joyeuse, mais encore le tragique, avec toute sa sublime déraison, font partie des moyens et des nécessités pour conserver l’espèce ! » — Et par conséquent ! par conséquent ! par conséquent ! Me comprenez-vous, ô mes frères ? Comprenez-vous cette nouvelle loi du flux et du reflux ? Nous aussi nous aurons notre temps !
2
La conscience intellectuelle
Je refais toujours à nouveau la même expérience, et, toujours à nouveau, je regimbe contre mon expérience ; je ne veux pas y croire, malgré son évidence : la plupart des hommes manquent de conscience intellectuelle ; il m’a même semblé parfois qu’avec les revendications d’une telle conscience on se trouvait solitaire, comme dans un désert, dans les villes les plus populeuses. Chacun te regarde avec des yeux étrangers et continue à manier sa balance, appelant telle chose bonne, telle autre mauvaise ; personne ne rougit lorsque tu laisses entendre que les unités dont on se sert n’ont pas leur poids trébuchant, — on ne se révolte pas non plus contre toi : tout au plus rira-t-on de tes doutes. Je veux dire : la plupart des hommes ne trouvent pas méprisable de croire telle ou telle chose et de vivre conformément à ces choses, sans avoir au préalable pris conscience des raisons dernières et certaines, pour ou contre elles, et sans même s’être donné la peine de trouver ces raisons ; les hommes les plus doués et les femmes les plus nobles font encore partie de ce grand nombre. Mais que m’importent la bonté de cœur, la finesse et le génie, lorsque l’homme qui possède ces vertus tolère en lui des sentiments tièdes à l’égard de la foi et du jugement, si le besoin de certitude n’est pas en lui le désir le plus profond, la plus intime nécessité, — étant ce qui sépare les hommes supérieurs des hommes inférieurs ! Chez certains hommes pieux j’ai trouvé une haine de la raison dont je leur ai été reconnaissant : ainsi se révélait du moins leur mauvaise conscience intellectuelle ! Mais se trouver au milieu de cette rerum concordia discors et de toute cette merveilleuse incertitude, de cette multiplicité de la vie, et ne point interroger, ne point trembler du désir et de la joie de l’interrogation, ne pas même haïr l’interrogateur, peut-être même s’en amuser jusqu’à l’épuisement — c’est cela que je trouve méprisable, et c’est ce sentiment de mépris que je commence par chercher chez chacun : — et une folie quelconque finit toujours par me convaincre que chaque homme possède ce sentiment en tant qu’homme. C’est là de l’injustice à ma façon.
3
Noble et vulgaire
Aux natures vulgaires tous les sentiments nobles et généreux paraissent impropres et, pour cela, le plus souvent invraisemblables : ils clignent de l’œil quand ils en entendent parler, et semblent vouloir dire : « il doit y avoir là un bon petit avantage, on ne peut pas regarder à travers tous les murs » : — ils se montrent envieux à l’égard de l’homme noble, comme s’il cherchait son avantage par des chemins détournés. S’ils sont convaincus avec trop de précision de l’absence d’intentions égoïstes et de gains personnels, l’homme noble devient pour eux une espèce de fou : ils le méprisent dans sa joie et se rient de ses yeux brillants. « Comment peut-on se réjouir du préjudice qui vous est causé, comment peut-on accepter un désavantage, avec les yeux ouverts ! L’affection noble doit se compliquer d’une maladie de la raison. » — Ainsi pensent-ils, et ils jettent un regard de mépris, le même qu’ils ont en voyant le plaisir que l’aliéné prend à son idée fixe. La nature vulgaire se distingue par le fait qu’elle garde sans cesse son avantage en vue et que cette préoccupation du but et de l’avantage est elle-même plus forte que l’instinct et le plus violent qu’elle a en elle : ne pas se laisser entraîner par son instinct à des actes qui ne répondent pas à un but — c’est là leur sagesse et le sentiment de leur dignité. Comparée à la nature vulgaire, la nature supérieure est la plus déraisonnable — car l’homme noble, généreux, celui qui se sacrifie, succombe en effet à ses instincts, et, dans ses meilleurs moments, sa raison fait une pause. Un animal qui protège ses petits au danger de sa vie, ou qui, lorsqu’il est en chaleur, suit la femelle jusqu’à la mort, ne songe pas au danger de la mort ; sa raison, elle aussi, fait une pause, puisque le plaisir que lui procure sa couvée ou sa femelle et la crainte d’en être privé le domine entièrement, il devient plus bête qu’il ne l’est généralement, tout comme l’homme noble et généreux. Celui-ci éprouve quelques sensations de plaisir ou de déplaisir avec tant d’intensité que l’intellect devra se taire ou se mettre au service de ces sensations : alors son cœur lui monte au cerveau et l’on parlera dorénavant de « passion ». (Çà et là on rencontre aussi l’opposé de ce phénomène, et, en quelque sorte, le « renversement de la passion », par exemple chez Fontenelle, à qui quelqu’un mit un jour la main sur le cœur, en disant : « Ce que vous avez là, mon cher, est aussi du cerveau. ») C’est la déraison, ou la fausse raison de la passion que le vulgaire méprise chez l’homme noble, surtout lorsque cette passion se concentre sur des objets dont la valeur lui paraît être tout à fait fantasque et arbitraire. Il s’irrite contre celui qui succombe à la passion du ventre, mais il comprend pourtant l’attrait qui exerce cette tyrannie ; il ne s’explique pas, par contre, comment on peut, par exemple, pour l’amour d’une passion de la connaissance, mettre en jeu sa santé et son honneur. Le goût des natures supérieures se fixe sur les exceptions, sur les choses qui généralement laissent froid et ne semblent pas avoir de saveur ; la nature supérieure a une façon d’apprécier qui lui est particulière. Avec cela, dans son idiosyncrasie du goût, elle s’imagine généralement ne pas avoir de façon d’apprécier à elle particulière, elle fixe au contraire ses valeurs et ses non-valeurs particulières comme des valeurs et des non-valeurs universelles, et tombe ainsi dans l’incompréhensible et l’irréalisable. Il est très rare qu’une nature supérieure conserve assez de raison pour comprendre et pour traiter les hommes ordinaires en tant qu’hommes ordinaires : généralement elle a foi en sa passion, comme si chez tous elle était la passion restée cachée, et justement dans cette idée elle est pleine d’ardeur et d’éloquence. Lorsque de tels hommes d’exception ne se considèrent pas eux-mêmes comme des exceptions, comment donc seraient-ils jamais capables de comprendre les natures vulgaires et d’évaluer la règle d’une façon équitable ! — Et ainsi ils parlent, eux aussi, de la folie, de l’impropriété et de l’esprit fantasque de l’humanité, pleins d’étonnement sur la frénésie du monde qui ne veut pas reconnaître ce qui serait pour lui « la seule chose nécessaire ». — C’est là l’éternelle injustice des hommes nobles.
4
Ce qui conserve l’espèce
Les esprits les plus forts et les plus méchants ont jusqu’à présent fait faire les plus grands progrès à l’humanité : ils allumèrent toujours à nouveau les passions qui s’endormaient — toute société organisée endort les passions, — ils éveillèrent toujours à nouveau le sens de la comparaison, de la contradiction, le plaisir de ce qui est neuf, osé, non éprouvé, ils forcèrent l’homme à opposer des opinions aux opinions, un type idéal à un type idéal. Par les armes, par le renversement des bornes frontières, par la violation de la piété, le plus souvent : mais aussi par de nouvelles religions et de nouvelles morales ! La même « méchanceté » est dans l’âme de tous les maîtres et de tous les prédicateurs de ce qui est neuf, — cette méchanceté qui jette le discrédit sur un conquérant, même lorsqu’elle s’exprime d’une façon plus subtile, et ne met pas de suite les muscles en mouvement, ce qui d’ailleurs fait diminuer le discrédit ! Ce qui est neuf, cependant, est de toute façon le mal, étant ce qui conquiert et veut renverser les vieilles bornes et les piétés anciennes ; et ce n’est que ce qui est ancien qui puisse être le bien ! Les hommes de bien de toutes les époques ont été ceux qui ont approfondi les vieilles idées pour leur faire porter des fruits, les cultivateurs de l’esprit. Mais toute terre finit par être épuisée et il faut que toujours revienne le soc de la charrue du mal. Il y a maintenant une doctrine de la morale, foncièrement erronée, doctrine surtout très fêtée en Angleterre : d’après elle les jugements « bien » et « mal » sont l’accumulation des expériences sur ce qui est « opportun » et « inopportun » ; d’après elle ce qui est appelé bien conserve l’espèce, ce qui est appelé mal est nuisible à l’espèce. Mais en réalité les mauvais instincts sont opportuns, conservateurs de l’espèce et indispensables au même titre que les bons : — si ce n’est que leur fonction est différente.
5
Devoirs absolus
Tous les hommes qui sentent qu’il leur faut les paroles et les intonations les plus violentes, les attitudes et les gestes les plus éloquents, pour pouvoir