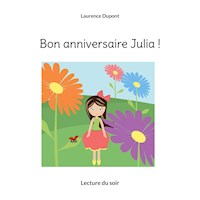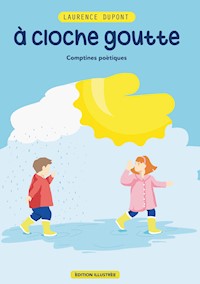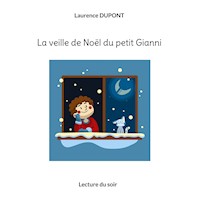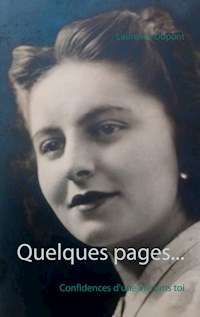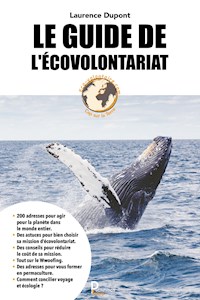
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Französisch
Comment concilier voyage et écologie ?
Ce guide de l’écovolontariat est le premier et le plus ancien dans le genre. Il s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent s’engager pour la protection de la planète tout en voyageant. Vous trouverez des missions écologiques en France et à l’étranger, d’une durée d’un jour à plusieurs mois. Protection d’espèces en danger, refuges pour animaux sauvages, reforestation, travail à la ferme, initiation à la permaculture, WWoofing, ramassage de déchets…
Ce guide a pour vocation de vous donner les clefs d’un voyage réussi, si vous souhaitez donner du sens à votre périple. Découvrez tous les conseils sur la façon dont il faut choisir votre mission, poser les bonnes questions afin d’éviter les arnaques !
Découvrez dans ce guide des adresses, des astuces, des consignes concernant l'écovolontariat, la permaculture, et tout sur le Wwoofing !
EXTRAIT
Désireux d’être utile, de s’engager pour l’environnement, de nombreux voyageurs choisissent désormais un tourisme alternatif, en France comme à l’étranger. Face à cet engouement, les organismes proposant des missions dans le voyage dit «utile» se multiplient et un nouveau jargon est né : tourisme solidaire, participatif, écotourisme… Il est parfois dur de s’y retrouver ! Avant d’aller plus loin, commençons par la sémantique. L’écovolontariat, répond au désir de voyager autrement hors des sentiers battus.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Laurence Dupont : Je suis une globetrotteuse et écolo convaincue. Ce guide est le fruit d'une aventure que j'ai vécue en 2006, intitulée le tour du monde de l'écovolontariat, lors de laquelle je me suis engagée au sein d'associations de protection de la planète. Depuis ce périple, je travaille à rassembler minutieusement le maximum d'informations sur les associations/structures auprès desquelles vous pouvez vous engager. J'ai également participé à l'élaboration de la charte de l'écovolontariat et tissé de nombreux liens avec les associations qui proposent des missions écologiques. Blogueuse référente dans le domaine, je poursuis l'aventure grâce à une communauté de plusieurs milliers d'internautes et aux lecteurs du Guide de l'écovolontariat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Publishroom Factory
www.publishroom.com
Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite et constitue une contrefaçon, aux termes des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Laurence Dupont
Le guide de l’écovolontariat
200 adresses pour agir pour la planète dans le monde entier.
Des astuces pour bien choisir sa mission d’écovolontariat.
Des conseils pour réduire le coût de sa mission.
Tout sur le Wwoofing.
Des adresses pour vous former en permaculture.
Comment concilier voyage et écologie ?
« L’écovolontariat est une action solidaire et participative qui consiste à aider, durant son temps libre, un projet lié à la préservation et à la valorisation de la diversité animale, végétale, environnementale, et culturelle. L’écovolontaire est un citoyen engagé et bénévole. » La charte de l’écovolontariat
Face au réchauffement climatique, à la sixième extinction, aux ravages liés au tourisme de masse, l’écovolontariat apporte une réponse à toute personne qui cherche à voyager différemment, à s’engager pour la protection de la planète.
Ce guide est le fruit d’un périple autour du tour du monde qui a définitivement changé mon regard sur le vivant. Il est le résultat d’un engagement de plus de dix ans dans l’écovolontariat et d’un long travail de collecte d’adresses. Il vous donne les clefs pour trouver la mission écologique qui vous convient !
Laurence Dupont
1. L’écovolontariat, c’est quoi ?
Désireux d’être utile, de s’engager pour l’environnement, de nombreux voyageurs choisissent désormais un tourisme alternatif, en France comme à l’étranger. Face à cet engouement, les organismes proposant des missions dans le voyage dit «utile» se multiplient et un nouveau jargon est né : tourisme solidaire, participatif, écotourisme… Il est parfois dur de s’y retrouver ! Avant d’aller plus loin, commençons par la sémantique. L’écovolontariat, répond au désir de voyager autrement hors des sentiers battus. Il est cependant à différencier :
L’écovolontariat est à différencier
▶de l’écotourisme
L’écotourisme promeut la découverte et la protection du patrimoine environnemental et culturel. Lorsque vous choisissez un séjour d’écotourisme, une large partie du séjour est consacrée à l’observation de la flore et de la faune, mais vous ne travaillez pas. L’écotourisme est un concept apparu dans les années quatre-vingt, lorsque certains voyagistes ont pris conscience de l’impact du tourisme sur l’environnement des pays d’accueil. Une des premières définitions a été donnée en 1987 par le Mexicain Hector Ceballos- Lascurain, directeur de la commission écotourisme de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature). Trois ans plus tard, en 1990, la Société internationale d’écotourisme (The inter- national ecotourism society, TIES) était créée. Cette ONG, dont l’objectif consiste à promouvoir et à encadrer l’écotourisme dans le monde, a sa déclinaison française, depuis 2005, avec l’Association française d’écotourisme. Elle précise que ce type de tourisme « favorise la protection des zones naturelles et veille au bien-être des populations locales en procurant des avantages économiques aux communautés d’accueil, aux organismes et aux administrations qui veillent à la préservation des zones naturelles ». Il existe quelques labels spécifiques à l’écotourisme comme « La Clé Verte », « Les gîtes Panda », « Station Verte » ;
▶du tourisme équitable et solidaire
En 2004, un comité de pilotage constitué de membres de l’Union nationale des associations de tourisme et de plein air (Unat) et d’associations de tourisme solidaire a défini le tourisme solidaire comme une activité qui met au centre du voyage l’homme et la rencontre. Les populations locales dans les différentes phases du projet touristique sont très impliquées et la répartition des ressources générées par cette activité est répartie le plus équitablement possible ;
▶du tourisme responsable
Le tourisme responsable ainsi que le tourisme durable englobent les principes du développement durable, à savoir le respect de l’environnement et des populations, appliqués au tourisme. Il s’agit d’un tourisme alternatif qui nécessite une réflexion personnelle. Il existe une certification pour un tourisme responsable basé sur un référentiel créé par l’association ATT (Association des tour-opérateurs thématiques). L’ATT regroupe les opérateurs du tourisme qui souhaitent œuvrer dans le sens d’un tourisme plus responsable et partageant des valeurs communes dans l’exercice de leurs pratiques professionnelles basées sur le respect, la solidarité et la qualité.
▶du volontourisme
Le volontourisme est aujourd’hui devenu un gros mot ! Contraction entre tourisme et volontariat, le volontourisme, qui ne répond à aucune charte, est un mot aujourd’hui employé pour dénoncer les dérives d’une forme de tourisme humanitaire, qui, soit dit en passant, est un non-sens. En effet, à plusieurs reprises, dans la presse, des reportages sont sortis sur les dérives de certains organismes qui proposaient aux vacanciers de partir en mission humanitaire dans des orphelinats au Cambodge. Des orphelinats qui étaient remplis de faux orphelins pour des raisons pécuniaires. Soyons clairs, l’écovolontariait n’est pas de l’humanitaire ! L’humanitaire est un domaine professionnel qui n’a rien à voir avec la détente et le voyage ! L’existence de ce guide vous servira à ne pas tomber dans le piège du volontourisme.
Le point sur le volontariat
Dans ce guide, je cite des organismes qui proposent des missions de volontariat comme le Service civique et le Service civique européen. Il ne s’agit pas d’écovolontariat, mais de volontariat officiellement défini et régi par un contrat. Cela peu intéresser les jeunes notamment qui souhaitent s’engager dans le long terme. Dans ce cas, vous êtes indemnisé.
▶Le service civique
Le service civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général, ouvert à tou.te. s les jeunes Français. es et étranger. e. s de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme. Seule compte la motivation. La durée de ce volontariat varie entre 6 et 12 mois, à raison de 35 h par semaine. En vous engageant dans un service civique, vous contribuez au développement local et à la promotion du volontariat.
Le/la volontaire reçoit une indemnité mensuelle à hauteur de 573 euros net par mois. Soit 467,34 € directement versés par l’État, quelle que soit la durée hebdomadaire de la mission et 106,31 € de prestation en nature ou en espèces (correspondant à la prise en charge des frais d’alimentation, d’hébergement ou de transports). Chaque volontaire participe à une formation civique et citoyenne et à la formation aux premiers secours PSC1.
▶Le service civique européen
Le Corps Européen de Solidarité - CES (connu auparavant comme Service Volontaire Européen) est une initiative de l’Union européenne qui vise à donner aux jeunes la possibilité de se porter volontaires en France ou à l’étranger pour une durée allant de 2 semaines à 12 mois. À ce titre, il permet aux volontaires d’être indemnisé. e. s durant leur période d’engagement. C’est aussi pourquoi, pour être éligible, la/le volontaire doit correspondre à certains critères.
Conditions :
Avoir entre 18 et 30 ans. Être légalement résident. e dans un des pays participant au programme.
Aucune formation, expérience, diplôme ou connaissance linguistique ne sont requis.
Le CES permet aux personnes ayant entre 18 et 30 ans, de se mettre au service d’un projet d’intérêt général (environnement, rénovation, animation, culturel, social, art), de vivre une expérience formatrice, d’apprendre une autre langue, de développer leur citoyenneté active, en faisant preuve de solidarité, dans un contexte interculturel.
Le/la volontaire bénéficie d’une prise en charge totale sur place (hébergement, restauration, transport, couverture maladie et responsabilité civile) et d’une indemnité selon les pays. Il/elle peut être amené. e à contribuer au financement de ses frais de voyage.
L’écovolontariat, un néologisme qui vient d’outre-manche
Vous l’avez compris, l’écovolontariat n’est ni de l’écotourisme ni du tourisme solidaire et encore moins du volontourisme ! L’écovolontaire s’engage dans un projet de protection de la biodiversité et agit aux côtés de professionnels.
L’écovolontariat est très empreint de la tradition anglo-saxonne. Les premiers séjours de volontariat international à vocation environnementale apparaissent aux États-Unis et en Angleterre. Très vite, les Anglo-Saxons n’hésitent pas à s’engager pendant leurs vacances afin de travailler pour la préservation de la biodiversité. Ils en retirent une expérience humaine enrichissante et professionnelle. Aucune compétence particulière n’est requise pour partir en mission : les jeunes Anglais et Américains y voient donc une opportunité professionnelle qu’ils pourront mettre en valeur dans leur future vie active.
En France, les missions de bénévolat à l’étranger sont longtemps restées du domaine de l’humanitaire au sein duquel le volontaire est un professionnel. Le système anglo-saxon, qui consiste à s’engager en travaillant tout en participant financièrement, a eu du mal à faire son chemin dans les mentalités françaises. Mais aujourd’hui l’écovolontariat se développe largement dans l’hexagone.
Une des premières associations françaises à avoir développé l’écovolontariat est A pas de Loup, connue aujourd’hui sous le nom Volontaire pour la nature.
Voici quelle est sa définition de l’écovolontariat. « L’écovolontariat désigne toute action bénévole de terrain (dans la nature) dans un but de préservation de l’environnement de protection ou de valorisation des espèces et des habitats naturels ». L’écovolontaire accomplit un acte citoyen utile au fonctionnement de nombreux programmes de conservation de la biodiversité.
L’association « Volontaire pour la Nature » a longtemps différencié plusieurs catégories répondant à différentes actions :
– Le chantier nature, pour une mission précise et ponctuelle ;
– La mission, qui se déroule dans la durée et vient en assistance à un programme de conservation existant. Les volontaires complètent les équipes de personnels permanents dans leur travail quotidien et partent aux dates où ils le désirent, selon les possibilités de la structure d’accueil ;
– Les sciences participatives où les participants sont autonomes et rejoignent un réseau d’observateurs d’un phénomène ou d’une espèce ;
– Les ambassadeurs de la nature où les volontaires sont formés puis agissent en autonomie pour transmettre un message de protection de la nature ou d’écogestes.
– L’écovolontariat de l’urgence qui fait appel à des volontaires expérimentés ou bien formés, qui interviennent en urgence sur des missions bien spécifiques.
À la suite d’une longue réflexion menée entre « Volontaire pour la Nature » et la Fondation Nicolas Hulot, qui a créé la plateforme « J’agis pour la nature », un nouveau terme est apparu : le « bénévolat nature ». Pour les responsables de « J’agis pour la nature », l’écovolontariat est aujourd’hui un terme récupéré par des prestataires de voyages touristiques. « Pour nous, le bénévole n’a à payer que pour son logement et sa nourriture. Et encore, les frais qu’il engage ne doivent pas être importants. Le bénévole ne doit pas participer au financement du programme de recherche et encore moins au fonctionnement de l’association. Nous préférons donc utiliser le terme « bénévolat nature ». Parmi les structures et associations françaises proposant des missions, nous retrouvons ces deux conceptions de l’écovolontariat : l’une que l’on qualifiera de « à la française », où on retrouvera des missions de bénévolat en France et/ou de longues missions à l’étranger avec une faible participation financière, et l’autre, à l’anglosaxone, qui propose de nombreuses missions à l’étranger où l’écovolontaire apporte, en plus de sa bonne volonté ; une participation financière. Une participation financière qui est considérée comme un don à la biodiversité qui est, dans certains cas, encouragé par l’État français par l’intermédiaire de déduction fiscale.
Après plusieurs années de tâtonnement, et de pratiques différentes au sein des différentes associations et structures, un collectif s’est réuni pour créer la charte de l’écovolontariat. Je vous conseille de lire attentivement cette charte, car elle vous donne les bases pour choisir les bonnes missions.
La charte de l’écovolontariat
Entre octobre 2013 et décembre 2014, un collectif coordonné par Cybelle Planète, dont eco-volontaire.com/Cap sur la Terre fait partie, a mené un débat démocratique afin de proposer une définition du terme ECOVOLONTARIAT, et de proposer une CHARTE ÉTHIQUE.
395 personnes ont participé à l’élaboration de cette charte : écovolontaires, structures d’écovolontariat, professionnels du tourisme, citoyens engagés…
Le débat a pris en compte l’avis de tous, sans restriction, et les résultats sont le reflet de la pensée collective.
Définition de l’écovolontariat
« L’écovolontariat est une action solidaire et participative qui consiste à aider, durant son temps libre, un projet lié à la préservation et à la valorisation de la diversité animale, végétale, environnementale, et culturelle. L’écovolontaire est un citoyen engagé et bénévole et ne peut, à ce titre, recevoir de contrepartie financière pour son action. » Cette définition est le fruit d’un débat d’une année, avec 395 personnes, toutes concernées par cette activité : écovolontaires, structures d’écovolontariat, professionnels du tourisme, citoyens engagés, voyageurs, étudiants, représentants d’associations. L’écovolontariat s’insère dans une démarche éthique forte, à laquelle les participants s’entendent adhérer totalement. Cette charte a pour but de proposer les principales clés de réflexions qui devront être menées en amont de la mise en place d’une mission d’écovolontariat, et respectées par les organismes signataires.
Engagement numéro1: Transparence sur l’utilisation de la contribution financière des écovolontaires
Dans le cas où les écovolontaires contribuent financièrement à leur mission, l’organisateur s’engage à afficher une totale transparence sur l’utilisation de l’argent versé. Cela implique le détail du pourcentage du montant revenant au projet d’accueil, à l’organisateur, et le cas échéant à un intermédiaire, et le pourcentage du montant dédié à l’hébergement et à la nourriture des écovolontaires
Engagement numéro 2 : Communication objective sur les missions d’écovolontariat
L’organisateur s’engage à donner une information honnête, explicite et objective sur la ou les missions qu’il propose. Cette information doit prendre en compte et détailler :
> Le programme de recherche ou de conservation, notamment les objectifs, la méthodologie, et si possible les résultats et publications.
> L’implication des écovolontaires dans le projet et leur encadrement,
> Les retombées sociales, économiques et écologiques, notamment :
– L’implication des populations locales et l’impact sur la collectivité,
– L’impact de la mission sur l’économie locale,
– L’impact écologique de la mission.
Engagement numéro 3 : Préparation des écovolontaires à la mission
L’organisateur s’engage à mettre en place une préparation préalable au départ des écovolontaires, afin :
> d’optimiser leur immersion culturelle,
> de clarifier le sens de leur implication au sein du projet d’accueil,
> d’informer les écovolontaires sur leurs conditions de participation (hébergement, confort, organisation du voyage).
Cette préparation peut prendre la forme d’une documentation, d’une rencontre, ou tout autre support adapté.
Engagement numéro 4 : Limitation de l’impact environnemental des missions
L’organisateur s’engage à estimer et à limiter, autant que possible, l’impact environnemental de la mission qu’il propose, et à donner accès à cette information aux écovolontaires.
L’organisateur s’engage également à mettre en place des actions visant à diminuer ces impacts, par exemple :
> recommandations aux écovolontaires sur les éco-gestes à mettre en place,> recommandations sur les programmes de compensation des émissions de CO2,> adaptation de la durée minimale de la mission en fonction de son éloignement (équilibre entre les bénéfices territoriaux dus à la mission et l’impact écologique dû au déplacement).
Engagement numéro 5 : Recueil des retours d’expérience des écovolontaires
L’organisateur s’engage à recueillir les expériences des écovolontaires (exemple : témoignages, compte-rendu) et à les publier. De plus, dans la mesure du possible, l’organisateur s’engage à mettre en relation les anciens et les futurs écovolontaires.
Engagement numéro 6 : Évaluation régulière des projets
L’organisateur s’engage à effectuer une évaluation régulière des projets qu’il propose aux écovolontaires basée sur :
> la cohérence du projet initial et avec son contenu actuel,
> la prise en compte des témoignages des écovolontaires sur le projet,
> les résultats éventuels,
> les projets en développement.
Engagement numéro 7 : Valorisation de la participation des écovolontaires
L’organisateur s’engage à publier, sur une base régulière, des comptes-rendus sur les actions et les résultats du projet et sur les réalisations auxquelles les écovolontaires ont participé lors de leur mission.
Engagement numéro 8 : Prise en compte du bien-être animal et de l’utilisation des espèces.
L’organisateur s’engage à refuser toute activité annexe portant sur l’utilisation d’animaux sauvages à des fins récréatives (exemple : nage avec les dauphins, cirques, dressages, nourrissages à des fins touristiques…).
Dans le cas de refuges animaliers, l’organisateur s’engage à ne proposer que des projets dont la priorité est de réintroduire les animaux dans leur milieu naturel et qui ne gardent ces animaux en refuge que lorsque leur réintroduction s’avère impossible.
La charte des écovolontaires
En 2018, quelques années après la mise en place de la charte de l’écovolontariat, un nouveau collectif s’est réuni, pour, cette fois-ci, élaborer une charte des écovolontaires. Suivant le même principe de la charte de l’écovolontariat, elle a été élaborée selon les principes de la consultation citoyenne. Écovolontaire/Cap sur la Terre était présent lors d’une des dernières étapes, au salon du tourisme solidaire qui s’est déroulé à Grenoble les 1 et 2 décembre 2018.
Engagement 1 : CHOISIR EN TOUTE CONSCIENCE
Hormis les critères de choix personnels, l’écovolontaire s’engage à s’informer sur les différentes pratiques de l’écovolontariat et à choisir une mission d’écovolontariat en accord avec la charte éthique de l’écovolontariat.
Engagement 2 : S’ENGAGER PLEINEMENT
Avant de s’inscrire à une mission, l’écovolontaire s’engage à s’informer sur les conditions d’accueil et de participation qu’il rencontrera au sein du projet.
L’écovolontaire s’engage également à évaluer de manière réaliste et transparente si ses capacités physiques et mentales répondent aux exigences requises par le projet.
Engagement 3 : PRÉPARER SA MISSION POUR ÊTRE PLUS EFFICACE SUR PLACE
Avant son départ pour une mission d’écovolontariat, le participant s’engage à s’informer sur le projet, les conditions géographiques et climatiques, ainsi que sur le contexte culturel, économique, et social dans lequel s’inscrit sa mission ; le participant s’engage également à participer à une formation de préparation si cette dernière est proposée par la structure d’écovolontariat.
Engagement 4 : PARTICIPER DANS LE RESPECT
L’écovolontaire est conscient d’être un invité au sein du projet et à se comporter avec toute la sensibilité voulue à l’égard de son hôte, dans le respect des instructions relatives à la sécurité, des animaux et de l’environnement, et aux règles de vie collectives.
L’écovolontaire saura renoncer, le temps de sa mission, à son confort et à ses habitudes, et à s’adapter aux conditions d’accueil et à son nouvel environnement en respectant les coutumes et les règles socioculturelles locales.
Engagement 5 : PARTAGER ET TOLÉRER
L’écovolontaire s’engage à vivre et à partager son expérience avec les autres participants et/ou membres du projet. Il est un acteur au sein du projet et partage avec lui son expérience et ses propositions.
Engagement 6 : RESTER FLEXIBLE DURANT SA MISSION
L’écovolontaire ne s’engage pas pour une activité déterminée, mais pour un projet auquel il souhaite apporter son aide. Bien que l’implication sur place de l’écovolontaire soit décrite avant son arrivée, l’écovolontaire s’engage à s’adapter et à accepter les aléas dus au travail sur le terrain et aux besoins du projet.
Engagement 7 : LIMITER SON IMPACT ENVIRONNEMENTAL
L’écovolontaire s’engage à limiter l’impact environnemental dû directement ou indirectement à sa participation, et dans la mesure de ses possibilités, en :
Adaptant la durée de sa participation en fonction de son éloignement et du mode de transport choisi (équilibre entre les bénéfices territoriaux liés à la mission et l’impact écologique du déplacement, compensation CO2).
Privilégiant les modes de transport les plus écologiques.
Utilisant personnellement des produits écologiques : savon, lessive, crème solaire, matériel électrique à énergie solaire…
Adoptant des éco-gestes sur place : eau douce, gestion des déchets, consommation énergétique…
Engagement 8 : NE PAS ATTENDRE DE RÉSULTAT SPÉCIFIQUE ET/OU IMMÉDIAT
L’écovolontaire a conscience de contribuer, à son échelle, à une action globale et sur le long terme. Comme le maillon d’une chaîne, il poursuit le travail des écovolontaires précédent et prépare celui des prochains arrivants. Ainsi, à la manière du Colibri, l’écovolontaire a conscience de faire sa part et, même si son action n’a pas de résultats directs visibles, de contribuer à une action de fond.
Engagement 9 : DONNER EN TOUTE CONSCIENCE
La participation de l’écovolontaire est entièrement bénévole, et il ne peut en attendre de contrepartie hormis la satisfaction d’avoir contribué à l’avancée du projet auquel il s’est engagé.
En plus de son aide sur le terrain, l’écovolontaire peut également contribuer à la réussite et la pérennisation du projet par une contribution financière.
2. L’écovolontariat, c’est fait pour moi ?
L’esprit de l’écovolontaire
L’écovolontaire est avant tout une personne curieuse, ouverte sur les autres, qui recherche un mode de voyage alternatif.
S’il existe autant de personnalités que d’écovolontaires, leur point de rencontre reste la protection de la nature, l’ouverture sur le monde et un goût prononcé pour l’aventure.
Jusqu’à 77 ans…
Il n’y a pas d’âge pour être écovolontaire ! Dans les différentes missions, vous rencontrerez des personnes de tous les âges, venues pour des raisons souvent très différentes. Bien sûr, de nombreux étudiants en biologie mettent à profit leurs vacances pour avoir une première expérience de terrain. Si la plupart des écovolontaires ont entre 20 ans et 30 ans, vous rencontrez de plus en plus des retraités, des familles, ainsi que des mineurs, si la structure les accepte.
Quelle condition physique ?
Nul besoin d’être un sportif ou un athlète. Toutefois, il est recommandé d’être en bonne condition physique. Selon les missions choisies, il peut vous être demandé d’effectuer des patrouilles la nuit ou des repérages sur le terrain qui demandent de longues heures de marche. Pensez également au climat, qui peut être dur à supporter dans les régions tropicales chaudes et humides.
L’anglais, langue exigée, ou presque…
Excepté pour les missions effectuées en France, la langue de Shakespeare est indispensable. Même en pays hispanophone, la langue utilisée pour la communication est souvent l’anglais, car les équipes sont internationales. Il faut être capable de communiquer un minimum de façon à pouvoir comprendre les tâches que l’on vous demande d’effectuer et à pouvoir bien s’intégrer au groupe d’écovolontaires. Un niveau un peu plus élevé sera demandé si vous devez vous improviser guide dans un centre qui accueille des touristes. En règle générale, la maîtrise de plusieurs langues est très appréciée.
Pas de compétences professionnelles particulières
Dans la majorité des cas, aucune compétence professionnelle spécifique ne sera exigée de vous. Les missions d’écovolontariat donnent l’occasion de découvrir un univers différent du vôtre. Bien sûr, vos capacités d’adaptation seront parfois mises à l’épreuve, car vous devrez effectuer un travail nouveau et acquérir, parfois très rapidement, un savoir, sur une espèce endémique par exemple.
Une vie spartiate
Les écovolontaires logent sur place, dans une ferme ou au premier étage du centre d’accueil. Si les conditions sont correctes, ne vous attendez pas toutefois à un grand confort ! Vous aurez, la plupart du temps, à partager votre chambre, meublée de lits superposés. Les bâtiments sont souvent en bois et très spartiates.
Les avantages de l’écovolontariat
L’écovolontariat est une excellente façon de découvrir un pays de l’intérieur, en intégrant une équipe qui mène une action de préservation de l’environnement. Selon le projet que vous choisissez, vous découvrez des espèces animales et des écosystèmes très particuliers. Certains étudiants pourront, si la structure le permet, transformer leur séjour en stage professionnel. Partir en mission donne également l’occasion de travailler au sein d’une équipe internationale et de vivre une expérience interculturelle très enrichissante sur le plan personnel.Vous en apprendrez beaucoup sur les problématiques environnementales notamment avec la population locale pour qui la protection n’est pas une priorité en raison de la grande pauvreté dans laquelle elle vit.
Dans les missions, vous apprendrez également à mener un style de vie écolo respectueux de la nature.
L’écovolontariat c’est aussi du travail
Si l’écovolontariat permet la découverte d’un pays et d’une culture, il ne faut pas oublier que vous travaillez plusieurs heures par jour ! Vous devez vous lever le matin, respecter des horaires et des consignes ! Si vous souhaitez juste découvrir la biodiversité d’un pays, choisissez plutôt l’écotourisme. Les missions d’écovolontariat impliquent un engagement de la part de l’écovolontaire qui ne bénéficie pas de la même liberté qu’un voyageur au long cours.
Le travail de l’écovolontaire
Le nombre d’heures de travail quotidien varie entre six et neuf heures par jour et vous disposez d’un ou deux jours de repos par semaine. Les conditions sont différentes selon le pays et la mission choisie. Le type de tâche qui vous sera demandée dépend du projet mené par l’association. Si vous vous engagez auprès d’une structure qui œuvre en faveur de la protection d’une espèce en danger, vous mènerez des observations sur les animaux et dans le cas d’un refuge participerez au bien être de l’animal. S’il s’agit d’un projet plus lié à la gestion forestière, vous découvrirez l’art de manier pelles et cisailles.
Auprès des animaux
Protection des tortues, d’iguanes, de vautours, centres de faunes sauvages pour animaux blessés, une grande partie des missions d’écovolontariat concerne la sauvegarde d’espèces en danger. Si vous vous lancez dans l’aventure, vous serez amené à prendre soind’animaux, sauvages pour la plupart. L’écovolontaire peut être contact avec les animaux, notamment lorsqu’il doit les nourrir ou bien nettoyer leurs cages. Si vous participez à un programme de réintroduction d’espèce endémique, vous pouvez être amené à les transporter du centre d’élevage vers leur milieu naturel afin de les relâcher. Assister aux premiers pas d’un petit iguane dans la mangrove est un moment toujours émouvant et chargé de sens. Toutefois, dans les bons refuges d’animaux sauvages, les contacts homme/animal sont limités au maximum pour maximiser les chances d’un retour à la vie sauvage.
Lorsque vous manipulez les animaux, vous êtes toujours accompagné, soit d’un responsable animalier, soit d’un bénévole expérimenté qui vous apprend les bons gestes pour ne pas stresser l’animal. Vous pouvez aussi assister un responsable qui donne des soins plus cliniques à un animal. Au village des tortues de Gonfaron, par exemple, des tortues, dans la plupart des cas écrasées par une voiture, sont opérées sur place.
Si vous choisissez un centre qui accueille des animaux « à la retraite » jadis utilisés dans des zoos ou des cirques, comme il en existe aux États-Unis, le contact n’est également pas direct et une distance doit être respectée entre vous et la cage dans laquelle vit l’animal. Ce peut être un ours, un tigre ou un éléphant. Il y a toujours un pincement au cœur à voir des bêtes sauvages enfermées qui ne seront jamais relâchées dans leur écosystème naturel, pour la bonne et simple raison qu’elles n’ont jamais connu la vie en liberté.
La préparation de la nourriture
Dans un centre d’animaux sauvages, d’élevage ou de recherche sur une espèce particulière, la préparation de la nourriture pour les animaux occupe toujours une grande partie de la journée. Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer de prime abord, ce travail n’a rien d’ennuyeux et est d’une grande diversité !
Dans un centre destiné à sauvegarder une espèce en danger, la reproduction est organisée et l’objectif est de
créer, pour les petits qui viennent de naître, des conditions semblables à celles qu’ils rencontreront lorsqu’ils seront relâchés. Dans ce cas, les écovolontaires vont chercher en pleine nature ce que les animaux devront consommer pour survivre une fois en liberté. Ceci nécessite non seulement une très bonne connaissance de l’alimentation naturelle de l’espèce, mais également du terrain. À la station des iguanes au Honduras, les volontaires partent à la chasse aux crabes, doivent récolter des termites et des feuilles dans la mangrove.
Lorsque les animaux ne sont pas destinés à retourner dans leur milieu naturel, la préparation de la nourriture demande également beaucoup de temps. Les écovolontaires y travaillent en général le matin, à tour de rôle. Si vous n’appréciez pas de découper en petits morceaux des fruits et des légumes en tout genre, mieux vaut s’abstenir !
Sensibilisation auprès du public
L’éducation à l’environnement auprès du public est un travail qui vous sera régulièrement demandé.
Cette mission de sensibilisation est très enrichissante, car elle privilégie le relationnel et donne l’occasion de partager vos convictions.
Les visites guidées ont lieu si le centre comporte une partie destinée à l’accueil des touristes. La maîtrise de plusieurs langues sera particulièrement appréciée. Mais, n’ayez crainte, un niveau moyen est suffisant. De plus, cet exercice donne l’occasion de progresser !
Il arrive qu’un visiteur en sache plus que vous sur l’animal en question. Si le cas se présente, laissez-le partager son savoir !
La taille des groupes varie en fonction de la saison et de la popularité du lieu. Si vous choisissez une période scolaire, il n’est pas exclu de conduire une classe de trente élèves !
Observation des animaux sauvages en pleine nature
Les missions d’observation d’animaux sont généralement très prisées des écovolontaires. Toutefois, nous attirons votre attention sur ce point, car, bien souvent, la confusion entre écovolontariat et écotourisme se joue à ce niveau. En effet, certains organismes emploient le terme de mission d’écovolontariat alors qu’ils vendent un séjour d’écotourisme où le public observe la faune sauvage, mais n’apporte pas vraiment d’aide, si ce n’est financière, au bon fonctionnement du projet.
Dans une mission d’écovolontariat, l’écovolontaire mène un réel travail, souvent en autonomie avec d’autres bénévoles, pour l’observation des espèces.
En Grèce et au Costa Rica, par exemple, des associations mènent un suivi des tortues marines sur plusieurs sites de nidification.
Les volontaires comptent les traces de tortues, baguent et mesurent les femelles pendant la nuit.
Au Honduras, les volontaires traversent la mangrove afin d’effectuer un repérage des jeunes iguanes relâchés l’année précédente. Les données récoltées se doivent d’être précises, car, après ce premier travail, des chercheurs les exploitent. En Picardie, les bénévoles participent activement à l’observation des veaux marins sur le terrain. Ils effectuent d’importantes marches équipés d’une longue vue. En Méditerranée, des campagnes de comptage de cétacés sont organisées pendant lesquelles les écovolontaires recensent les spécimens avant d’entrer les différentes données sur informatique. En Afrique, des associations font appel à des écovolontaires pour assurer le suivi des populations de chimpanzés.
Construction
Un centre d’accueil pour animaux sauvages, comme un lieu de démonstration pour le public, demande un entretien régulier des différentes installations. Très souvent, les travaux sont lourds et demandent de la main-d’œuvre, notamment lorsqu’il s’agit de construire une cage ou une clôture.Ces tâches sont assez éreintantes et demandent une certaine condition physique, mais elles sont réalisées à plusieurs et rien ne vous empêche de dire stop si c’est vraiment trop dur et de proposer de vous consacrer à autre chose !
Les patrouilles
Dans de nombreux pays à la biodiversité très riche, le braconnage et les activités illégales de déforestation agissent sur l’environnement telle une gangrène. Certaines associations luttent contre ce fléau, parallèlement à la mise en place d’un programme de conservation, en organisant des patrouilles destinées à contrer le braconnage. Parfois, des écovolontaires sont associés au projet, qui peut s’apparenter à une démarche éducative. Les patrouilles se déroulent souvent la nuit dans des lieux sensibles et à des périodes stratégiques. Par exemple, pendant la nidification des tortues marines. Des patrouilles sont également organisées dans des parcs, la journée, afin de surveiller les différentes activités humaines.
Entretien de sites
Les missions d’écovolontariat ne sont pas toujours en lien avec une espèce animale particulière. Certains projets sont plus centrés sur la conservation d’un écosystème et les tâches qui vous seront confiées seront très différentes de celles qui nécessitent un contact avec les animaux. Ces missions restent très importantes, car la conservation d’un milieu naturel constitue la base de la survie d’une espèce. L’écovolontaire participe à des campagnes d’arrachage lorsqu’il s’agit de lutter contre des plantes exotiques et colonisatrices, près d’une rivière ou d’une mare. Son travail peut tout simplement consister en du débroussaillage de façon à conserver les ruines d’un site historique. En Australie, l’organisme Conservation Volunteers Australia gère les ruines de l’ancienne prison de Port Arthur. Plus proche de nous, en France, l’association les Blongios propose différents chantiers tels le creusement de mares, le recépage d’arbres, la fauche et le ramassage de foin ou encore la création de clairières.
La gestion des déchets
La gestion des déchets occupe une place primordiale dans la vie d’un écovolontaire. Déjà au sein même du centre où vit l’équipe, les déchets sont triés lorsque cela est possible. Un emplacement est réservé au compost et le maître mot est « économie » en matière de consommation d’eau et d’énergie. Quel que soit le cœur du projet de l’association avec laquelle vous vous êtes engagé, vous participerez très souvent à des journées de nettoyage. En Amérique centrale, les plages côté mer des Caraïbes ressemblent malheureusement à de vrais dépotoirs. De nombreuses ONG organisent des journées de nettoyage en faisant appel à toute la population. En France, de nombreuses associations organisent des journées de ramassage de déchets, sur les plages ou dans les stations de ski.
Journée Type d’un écovolontaire
Au village des tortues
– Lever : 8 heures
– 9 h 30 : préparation de la nourriture pour les tortues
– 10 h 30 : nourrissage des tortues. Ce travail s’effectue deux par deux à l’aide d’une charrette. Vous pénétrez dans chaque enclos et surveillez par la même occasion si tout va bien.
– 12 heures : déjeuner. Si le responsable du village est là, c’est lui qui concocte la nourriture pour tout le monde.
– 14 heures : reprise du travail avec une visite guidée
– 15 heures : petit coup de main à la boutique les journées de grosse affluence. Une personne à la caisse pour les entrées, une personne dans le magasin pour la vente des articles