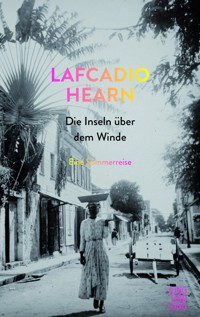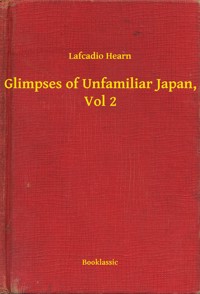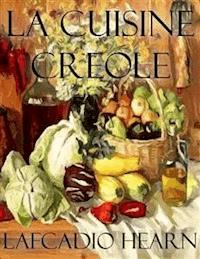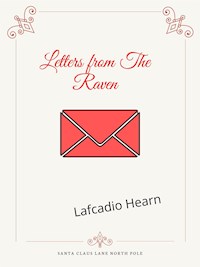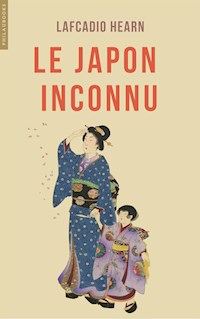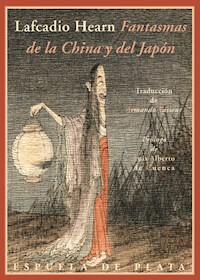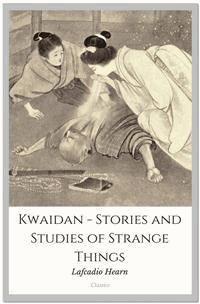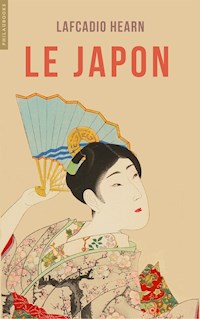
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Philaubooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Lafcadio Hearn a écrit Le Japon en 1903, et il en corrigea les épreuves l’année même de sa mort, qui survint à Tokyo, le 26 septembre 1904. II en avait composé les vingt principaux chapitres pour répondre à l’offre qui lui avait été faite d’une série de conférences à l’Université de Cornell, aux EtatsUnis.
Cette offre fut du reste retirée, à la suite de difficultés intérieures qui se produisirent dans cette université. Lafcadio Hearn a condensé, dans ces pages, toute l’expérience qu’il avait acquise en quatorze années d’une existence, pour ainsi dire, purement japonaise.
Il y a tenté, selon sa propre expression, une « Interprétation » de l’histoire de la civilisation, des moeurs et du caractère japonais. Il y a expliqué la formation de la société ancienne, la révolution moderne du Meiji, et il y met en lumière ce qu’il croit être l’esprit véritable de la nation.
Il y prévoit même, avec une étonnante perspicacité, un avenir qui s’est réalisé depuis, sous nos yeux. Le sujet, la méthode et les conclusions de cette pittoresque et pénétrante synthèse présentent de singulières analogies avec la Cité Antique de Fustel de Coulanges que, du reste, Lafcadio Hearn cite fréquemment. Ce livre pourrait s’intituler la Cité Extrême-Orientale, »
Marc Logé
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Le Japon
Lafcadio Hearn
Traduction parMarc Logé
Table des matières
1. Note du Traducteur
2. Difficultés
3. Charme et étrangeté
4. La religion primitive
5. La religion du foyer
6. La famille japonaise
7. Le culte de la communauté
8. Les progrès du Shintoisme
9. Adoration et purification
10. La Loi des morts
11. L'introduction du Bouddhisme
12. Le Bouddhisme Superieur
13. L'organisation sociale
14. L'usurpation militaire
15. La Religion de la loyauté
16. Le péril jésuite
17. Le régime féodal
18. La Renaissance Shinto
19. Survivances
20. La tyrannie officielle
21. L'éducation officielle
22. Le péril industriel
23. Considerations
24. Lettre de Herbert Spencer au Japon
À propos de l’auteur
1
Note du Traducteur
Lafcadio Hearn a écrit Le Japon en 1903, et il en corrigea les épreuves l’année même de sa mort, qui survint à Tokyo, le 26 septembre 1904. II en avait composé les vingt principaux chapitres pour répondre à l’offre qui lui avait été faite d’une série de conférences à l’Université de Cornell, aux EtatsUnis. Cette offre fut du reste retirée, à la suite de difficultés intérieures qui se produisirent dans cette université.
Lafcadio Hearn a condensé, dans ces pages, toute l’expérience qu’il avait acquise en quatorze années d’une existence, pour ainsi dire, purement japonaise. Il y a tenté, selon sa propre expression, une « Interprétation » de l’histoire de la civilisation, des mœurs et du caractère japonais. Il y a expliqué la formation de la société ancienne, la révolution moderne du Meiji, et il y met en lumière ce qu’il croit être l’esprit véritable de la nation. Il y prévoit même, avec une étonnante perspicacité, un avenir qui s’est réalisé depuis, sous nos yeux. Le sujet, la méthode et les conclusions de cette pittoresque et pénétrante synthèse présentent de singulières analogies avec la Cité Antique de Fustel de Coulanges que, du reste, Lafcadio Hearn cite fréquemment. Ce livre pourrait s’intituler la Cité Extrême-Orientale,
Marc Logé
2
Difficultés
On a publié sur le Japon un bon millier de volumes. Mais, à part quelques publications artistiques et quelques ouvrages d’un genre tout particulier, le nombre des ouvrages vraiment utiles ne dépasse guère une vingtaine. Cela tient à l’immense difficulté de distinguer et de comprendre ce qui se dissimule sous la façade de la vie japonaise. On ne parviendra pas, avant une cinquantaine d’années, à écrire le livre qui analysera à fond la vie japonaise et décrira exactement le Japon historique, sociologique, psychologique et moral. Le sujet est si vaste, si complexe, qu’une génération d’érudits ne l’épuisera pas ; et il est si difficile qu’il se trouvera toujours fort peu de savants pour y consacrer leur temps. Les Japonais eux-mêmes ne connaissent pour ainsi dire pas scientifiquement leur propre histoire, et on ne dispose pas encore des moyens d’établir les données de celle-ci, bien qu’on ait réuni d’innombrables documents. On manque absolument d’une bonne histoire, composée selon les méthodes modernes. Et ce n’est là qu’une des nombreuses lacunes qui découragent les chercheurs. Les éléments d’une étude sociale du Japon sont au moins aussi inaccessibles, pour le savant occidental. L’état primitif de la famille et du clan ; la formation des classes ; la distinction qui s’établit graduellement entre la loi politique et la loi religieuse ; la détermination des diverses puissances d’autorité et de leur action sur les mœurs ; l’influence des principes qui ont régularisé ou activé l’évolution de la société ; les changements de la morale et de l’esthétique ; tout cela, et bien autre chose encore, demeure toujours fort obscur.
Sur un certain point, au moins, mon étude contribuera à faire connaître le Japon en Occident. Et ce point n’est pas un des moins importants. Jusqu’ici ce. sont surtout les ennemis irréconciliables de la religion japonaise qui ont écrit sur cette religion. Les autres auteurs l’ont presque entièrement ignorée. Et cependant, on ne peut arriver à comprendre vraiment le Japon tant que l’on ne connaît pas sa religion, ou tant qu’on en donne une fausse interprétation. L’étude des mœurs et des institutions demande beaucoup plus qu’une notion imparfaite de la question religieuse. Et l’on n’arrive même pas à bien comprendre l’histoire industrielle d’un peuple, si l’on ignore les traditions religieuses et les coutumes qui réglèrent la vie industrielle pendant la première phase de son évolution.
Ou encore plaçons-nous au point de vue de l’art. Au Japon, l’art est si intimement associé à la religion que ce serait perdre son temps que d’essayer de le sentir ou de le comprendre sans connaître les croyances qu’il reflète. Et je ne parle pas seulement de la peinture et de la sculpture, mais de tous les ornements et des moindres figures : comme par exemple l’image qui égaye le cerf-volant d’un petit garçon ou la raquette d’une fillette, — le dessin figuré sur une cassette de laque, ou un vase d’émail, — les silhouettes qui animent la serviette d’un ouvrier, — la broderie qui enrichit la ceinture d’une princesse ; — le chien de papier ou le hochet de bois des tout petits, et aussi ces énormes Ni-0 qui gardent l’entrée des temples bouddhistes.
Et l’on n’appréciera jamais la littérature japonaise tant qu’on n’aura pas une étude écrite par un savant, qui non seulement comprendra les croyances japonaises, mais qui éprouvera pour elles au moins autant de sympathie que nos grands humanistes en ressentent pour la religion d’Euripide, de Pindare et de Théocrite. Comment pourrait-on juger les littératures française, anglaise, allemande et italienne, si l’on n’avait aucune idée des religions anciennes et modernes de l’Occident ? Et je ne pense pas spécialement à des auteurs exclusivement religieux, — à des poètes comme Dante et Milton. Mais je soutiens que même une pièce de Shakespeare serait incompréhensible pour quiconque ignorerait tout des croyances chrétiennes ou des croyances qui les ont précédées. On ne saurait posséder vraiment une langue européenne sans avoir quelque connaissance de la religion européenne.
La langue elle-même des illettrés est toute remplie d’allusions religieuses : les proverbes et les dictons des pauvres, les chansons des rues, l’argot des ateliers — contiennent tous d’innombrables expressions qui ne s’expliquent que par la foi du peuple. Et personne n’a éprouvé la vérité de cette observation mieux que moi, qui, pendant de longues années, ai essayé d’enseigner l’anglais au Japon, à des élèves dont la foi diffère absolument de la nôtre, et dont les idées morales son le résultat d’une organisation sociale totalement étrangère à la nôtre.
3
Charme et étrangeté
Les premières impressions du voyageur au Japon sont, pour la plupart, délicieuses. Et celui que le Japon laisserait sans émotion serait vraiment un homme d’un naturel aride ou grossier. Au contraire, cette émotion donne à qui la ressent la clef d’un difficile problème, elle lui ouvre le caractère d’une race et d’une civilisation.
Mes premières impressions du Japon, un Japon entrevu dans le soleil blanc d’une irréprochable journée de printemps ne devaient pas différer beaucoup de ce qu’éprouvent la moyenne des voyageurs. Je me rappelle surtout l’émerveillement et la joie du spectacle. Après quatorze années de séjour, ni l’émerveillement ni la joie ne se sont dissipés : ils se raniment encore bien souvent en moi, à l’appel de la moindre circonstance. Mais comment analyser ces sentiments, ou, plutôt, comment en deviner les raisons, car je ne puis pas encore prétendre que je façonnais vraiment le Japon.
Il y a longtemps, le meilleur et le plus cher de mes amis japonais me disait avant de mourir :
« Dans quatre ou cinq ans d’ici, quand vous serez convaincu que vous ne pouvez en rien comprendre les Japonais, c’est alors que vous commencerez à les comprendre un peu. »
Depuis j’ai vérifié cette amicale prophétie. Je me rends compte enfin que je ne comprends pas le moins du monde les Japonais. Je crois donc que je suis prêt à écrire cet essai.
Tout d’abord l’étrangeté apparente de toutes choses au Japon donne, au moins à certains esprits, une inquiétude surprenante, inexprimable. C’est, il me semble, le même sentiment du surnaturel qui nous gagne en présence de l’inconnu, de « l’absolument inconnu ». On se trouve soudain allant dans de bizarres petites rues. On circule parmi de bizarres petites personnes vêtues de robes et de sandales aux formes extraordinaires. Au premier instant on est tout à fait incapable de distinguer le sexe des passants. Les maisons sont construites et meublées de façon toute nouvelle pour vous. On est stupéfait de ne pouvoir même imaginer la nature et l’usage des innombrables objets exposés aux devantures : ce sont des aliments d’une origine inconnue, des emblèmes incompréhensibles d’une mystérieuse croyance, des masques et des jouets étranges rappelant sans doute les légendes des dieux et des dragons, des figurines grotesques des dieux eux-mêmes, dont le visage sourit énigmatique entre deux oreilles monstrueuses. Et partout sur les enseignes, sur les étoffes tendues sur le dos des passants, de merveilleux caractères chinois, des textes sorciers qui sont la note dominante irritante. Il est vrai qu’on remarquera aussi des poteaux télégraphiques, des machines à écrire, des ampoules électriques et des machines à coudre !...
Mais ces détails ne diminuent pas la vive impression d’étrangeté du premier contact, et cette impression ne s’affaiblit nullement au fur et à mesure que l’on connaît mieux ce monde fantastique. Vite on s’aperçoit que même les menus gestes des gens du peuple sont incompréhensibles pour nous. Ils travaillent, mais tout ce qu’ils font, ils le font au rebours de la méthode occidentale. Ils manient de façon imprévue des outils aux formes surprenantes. Le forgeron accroupi devant son enclume lève un marteau dont un forgeron européen ne saurait pas se servir. Le menuisier tire à lui, au lieu de les pousser, une scie curieuse et un rabot bizarre. En tout et toujours la gauche est le côté droit, et la droite est toujours le mauvais côté. Pour ouvrir ou pour fermer une serrure, il faut sûrement tourner la clef dans le sens inverse de celui auquel nous sommes habitués. M. Percival Lowell a dit ; très justement, que les « Japonais parlent à l’envers, lisent à l’envers et écrivent à l’envers ». L’habitude d’écrire à l’envers n’est pas sans raison. La calligraphie japonaise explique suffisamment pourquoi l’artiste pousse son pinceau ou son crayon au lieu de le tirer à lui. Mais pourquoi, au lieu de glisser le fil dans le trou de l’aiguille, une jeune japonaise pousse-t-elle le trou de l’aiguille sur le bout du fil ?... Tous ces procédés inconnus de nous, étrangers à nous, sont bien faits pour nous donner l’idée que les Japonais appartiennent à une autre humanité, et pour nous faire supposer qu’ils doivent nous ressembler, même au physique aussi peu que la population d’une autre planète. On ne relève pourtant pas entre eux et nous de différence anatomique. Leurs manières d’être, si absolument opposées aux nôtres, résultent non pas d’une évolution humaine entièrement indépendante de l’expérience aryenne, mais d’une évolution plus jeune que la nôtre.
Pourtant cette évolution n’est pas d’un ordre inférieur. Les résultats sans doute nous surprennent, mais ils nous enchantent aussi. La perfection délicate du travail, la vigueur légère et la grâce des objets, des ouvrages réalisés de façon exquise, pour ainsi dire sans instruments, des mécanismes conçus et construits par les moyens les plus simples qui soient, une asymétrie merveilleusement comprise et calculée pour l’effet, une harmonie et un goût parfaits se révélant dans les moindres choses, et surtout dans la juxtaposition des tons et des couleurs, — tout cela nous montre bien que notre Occident a beaucoup à apprendre de cette lointaine civilisation, et non seulement en fait d’art et de goût, mais aussi dans le domaine pratique et économique. Ce n’est point une fantaisie barbare qui s’exprime dans ces porcelaines prodigieuses, dans ces broderies merveilleuses, ni dans ces chefs d’œuvre de laque, d’ivoire et de bronze, qui transportent nos imaginations dans une région inconnue de la beauté.
Non, ce sont là les fruits d’une civilisation par ; venue, dans ses limites propres, à un tel raffinement que seul un artiste peut apprécier son exquise valeur, — d’une civilisation qu’on ne saurait qualifier d’imparfaite sans être logiquement forcé d’en dire autant de la civilisation hellénique.
Mais l’étrangeté psychologique du monde japonais est plus surprenante encore que son étrangeté apparente et matérielle. Et l’on apprécie vraiment l’étendue de cette originalité psychologique, lorsqu’on a constaté qu’un occidental cultivé ne parvient jamais, en somme, à posséder parfaitement la langue japonaise. En Orient et en Occident, les caractères essentiels de la nature humaine, ses bases sensibles se ressemblent beaucoup. Il n’y a qu’une divergence virtuelle entre l’esprit d’un enfant japonais et celui d’un enfant européen. Mais qu’ils grandissent l’un et l’autre, et la divergence s’accentuera très rapidement. Lorsqu’ils seront des hommes faits, ils seront si loin l’un de l’autre que cette distance est, pour ainsi dire, incommensurable. Les régions supérieures de la pensée japonaise n’ont rien de commun avec les mêmes régions de l’esprit occidental. Cette pensée s’exprime selon une logique, et cette émotion se manifeste selon un ordre sentimental qui nous étonnent et nous ahurissent. Les idées de ces hommes ne sont point nos idées, leurs sentiments ne sont point nos sentiments ; leur vie morale se déroule dans des domaines de la pensée et de l’émotion encore inexplorés de nous, ou que, peut-être, nous avons négligés depuis longtemps. Chacune des phrases courantes de la langue japonaise, traduite dans une langue occidentale, devient une sottise inimaginable, et la traduction littérale en japonais de la phrase anglaise la plus simple serait à peu près incompréhensible pour un Japonais ignorant de toute langue européenne.
Apprendre tous les mots du dictionnaire japonais n’aiderait nullement à comprendre les autres ni à s’en faire comprendre. Il faudrait, pour cela, avoir appris à penser en japonais, — c’est-à-dire, pour nous, à penser à l’envers, à penser sens dessus dessous à penser à l’aide de raisonnements totalement étrangers à la logique aryenne. La connaissance approfondie de plusieurs langues européennes vous aiderait aussi peu à apprendre le japonais qu’à deviner le langage des habitants de Mars. Pour arriver à parler japonais comme un Japonais, il faudrait renaître, et renouveler les principes mêmes de son esprit. Il est possible qu’une personne née au Japon de parents européens, et accoutumée dès l’enfance à l’usage du vocabulaire, en conserve pour plus tard une sorte de science intuitive, et parvienne ainsi à s’adapter à l’esprit des milieux japonais. Il existe un Anglais, nommé Black, né au Japon, versé à ce point dans la langue qu’il a réussi à se faire de jolis revenus comme conteur d’histoires professionnel — (hanashika). — Mais c’est là un cas exceptionnel.
Quant à la langue littéraire, elle exige un savoir beaucoup plus ardu que l’étude des milliers de caractères nécessaires aux mandarins chinois. On peut affirmer, à coup sûr, qu’un Européen n’arrivera jamais à déchiffrer à première vue un texte littéraire, — et le nombre des indigènes qui en sont capables est fort restreint. Quelques Européens, cependant, sont parvenus à lire le japonais assez bien pour que nous les admirions, mais ils n’ont pu s’instruire à ce point sans le secours de Japonais.
Comme l’étrangeté extérieure du Japon apparaît, à qui la pénètre, pleine de beauté, l’étrangeté intérieure semble avoir son charme, le charme d’une grande force morale qui règne jusque dans la vie familière du peuple. Et les dehors si attrayants de cette vie ne manifestent pas aux yeux de l’observateur passager l’originalité profonde qui résulte de l’influence de dizaines de siècles. Seul un esprit scientifique, tel que M. Percival Lowell, a pu formuler immédiatement le problème qui se cache sous cette apparence. L’étranger moins doué sent tout naturellement sa sympathie qui s’éveille. Il est étonné et ravi. Il s’explique par ce qu’il a connu de la vie la plus aimable, la plus heureuse de l’autre côté du monde, des mœurs qui le charment. Supposons qu’il ait la bonne fortune de pouvoir vivre pendant six mois ou un an dans quelque vieille ville de l’intérieur. Dès le début de son séjour il est frappé de la bonté et de la joie visibles r dans tout ce qui l’entoure. Dans les relations des habitants entre eux comme dans leurs relations avec lui-même, il observera une aménité constante, un tact, une bonne humeur qu’il n’aura rencontrés nulle part ailleurs, sinon dans la cordialité de quelques cercles restreints. Tout le monde se salue avec des regards heureux, et des mots aimables. Les visages sourient toujours. Les incidents les plus ordinaires de la vie quotidienne sont enveloppés d’un rayonnement de courtoisie à la fois si naïve et si parfaite que, loin de sembler apprise, elle paraît jaillir directement du cœur. Quelles que soient les circonstances, chacun conserve toujours une sorte de bonne humeur. Quelles que soient les catastrophes qui puissent advenir, orage, incendie, inondation, tremblement de terre, le rire des voix qui vous souhaitent la bienvenue, le gai sourire des yeux, le gracieux salut, l’empressement des questions bienveillantes, en toute chose le désir de plaire continuent d’enchanter l’existence. La religion ne projette point d’ombre sur cette clarté, les gens sourient en priant devant le Bouddha et les dieux, dans les cours des temples les enfants jouent, et dans les enceintes qui entourent les grands autels publics et qui sont plutôt destinés aux réjouissances qu’aux cérémonies pieuses, s’élèvent des estrades où l’on danse. La vie de famille aussi semble partout imprégnée de cette même douceur : point de disputes apparentes, ni de colère bruyante, ni de pleurs, ni de reproches. La cruauté, même envers les animaux, est inconnue. On voit les fermiers qui se rendent à la ville avancer patiemment aux côtés de leurs chevaux ou de leurs bœufs ; ils aident leurs muets compagnons à porter leurs fardeaux, et ils n’emploient ni fouet, ni aiguillons. Les charretiers et les kurumayas se détournent de leur chemin plutôt que de déranger ; un chien paresseux ou un poulet..
Et l’on peut vivre très longtemps au milieu de ces délicieuses apparences, sans que rien vienne jamais gâter le plaisir de vivre.
Bien entendu de telles mœurs disparaissent peu à peu, mais elles se rencontrent encore intactes dans les provinces lointaines. J’ai vécu ainsi dans : certaines régions où le moindre vol ne s’était pas produit depuis des centaines d’années, où les prisons récemment construites du Meiji demeuraient vides et inutiles, où les gens ne verrouillaient pas plus leurs portes la nuit que le jour. De tels traits sont familiers à tous les Japonais. Le visiteur de ces régions pourrait penser qu’on lui témoigne tant de bienveillance sur un ordre officiel. Mais comment expliquer la bonté que ces gens professent les uns pour les autres ? Vous n’apercevez ni dureté, ni grossièreté, ni malhonnêteté, ni violation des lois, et vous apprenez que ces mœurs durent depuis des siècles. Vous êtes tenté de vous croire mêlé à une humanité moralement supérieure. Vous attribuez cette urbanité douce, cette honnêteté impeccable, cette bienveillance ingénue dans la parole ..– et l’action à une parfaite bonté de cœur. Pourtant la simplicité qui vous enchante n’est point la simplicité de la barbarie.
Au Japon tout le monde sait écrire et parler parfaitement, tout le monde sait composer des poèmes, tout le monde sait se comporter avec politesse. Partout règnent la propreté et le bon goût, les intérieurs sont gais et soignés, et l’usage quotidien du bain chaud est général. Comment ne pas être charmé par une civilisation où toutes les relations semblent gouvernées par l’altruisme, toutes les actions inspirées par le devoir, et tous les objets modelés par l’Art ? Il est impossible de n’être pas ravi par de telles mœurs, et de ne pas s’indigner lorsqu’on les qualifie de « païennes ». Et selon le degré d’altruisme dont on est soi-même capable, ces bonnes gens réussiront, sans effort apparent, à vous rendre heureux. D’ailleurs le simple fait de vivre dans ce milieu procure un bonheur paisible ; on croit rêver un rêve où tout le monde nous ferait précisément l’accueil que nous préférons, où tout le monde nous dirait les choses qu’il nous est doux d’entendre, et nous rendrait les services qui nous sont agréables. Et ces gens se meuvent silencieusement, dans des lieux de parfait repos, tout baignés d’une lumière vaporeuse.
Oui, longtemps, ces êtres-fées vous donneront la douce joie du rêve.
Mais un jour ou l’autre, si vous demeurez parmi eux, votre plaisir vous paraîtra en effet ressembler ; de plus en plus au plaisir des rêves. Jamais vous n’oublierez ce rêve, jamais. Mais il se dissipera enfin comme ces vapeurs du printemps qui prêtent ; un charme surnaturel au paysage japonais, à l’aube des jours clairs. Vous avez goûté l’étrange bonheur de pénétrer dans le royaume des fées, dans un monde qui n’est pas, qui ne pourra jamais être le vôtre. Vous avez été transporté loin de votre temps, à travers l’immensité du passé, jusqu’à un âge aboli, aussi lointain que la gloire de l’Egypte ou de Ninive. Voilà le secret de la beauté et de l’étrangeté des choses japonaises, le secret du frisson qu’elles donnent, le secret du charme surhumain des hommes et des mœurs. Heureux mortels ! Le cours du Temps a reflué un moment pour vous vers la source. Mais souvenez-vous que tout ici n’est qu’enchantement, que vous avez été pris par le sortilège des morts, et qu’enfin les couleurs, les parfums et les sons s’évanouissent dans le vide et dans le silence.
Combien de nous ont fait souvent le rêve de vivre une saison dans le beau monde disparu de la culture grecque. Inspiré, à nos premières études, par le charme de l’Art et de la Pensée Grecque, ce désir nous vient avant même que nous soyons capables de nous représenter exactement la civilisation antique. Et s’il venait à se réaliser, sans doute nous apercevrions-nous qu’il nous est impossible de nous accommoder de cette civilisation. Et. cela non pas tant à cause des difficultés de s’adapter au milieu qu’à cause de la difficulté beaucoup plus grande d’accorder sa sensibilité à celle des hommes d’il y a trois mille ans. Malgré toutes les études grecques qui se sont multipliées depuis la Renaissance, il nous est encore impossible de comprendre nombre des aspects de la vie antique. Aucune âme moderne n’éprouve vraiment les sentiments et les émotions auxquels s’adressait la grande tragédie d’Œdipe. Pourtant nous connaissons la civilisation grecque beaucoup mieux que nos aïeux du dix-huitième siècle. La Révolution Française avait cru possible de rétablir en France les mœurs d’une république grecque, et d’élever les enfants suivant le système des Spartiates. Aujourd’hui, nous comprenons qu’un esprit formé par la civilisation moderne souffrirait du despotisme socialiste des cités antiques. Il ne nous serait pas plus possible de revivre la vie de la Grèce antique, fût-elle ressuscitée pour nous-mêmes, que de changer notre personnalité morale et sensible. Mais que ne donnerions-nous pas pour la joie de voir une telle résurrection, pour la joie d’assister à une fête de Corinthe, ou aux jeux Pan-Helléniques ?...Et, pourtant, ranimer un moment de la civilisation hellénique, se promener dans Crotone avec Pythagore, flâner dans les rues de la Syracuse de Théocrite, tout cela ne serait pas plus prodigieux que de se mêler à la vie japonaise. Et même, au point de vue historique, cela serait moins prodigieux. Le Japon nous offre, toujours vivantes, des mœurs plus anciennes, et d’une psychologie beaucoup plus lointaine de la nôtre, que les mœurs ou la psychologie d’une quelconque de ces périodes du miracle grec.
Et une civilisation plus primitive que la nôtre, et d’un aspect très différent, n’est pas nécessairement inférieure sous tous les rapports. La civilisation hellénique, même à son apogée, n’atteignit qu’à un stade élémentaire de notre évolution sociale. Pourtant les arts qu’elle encouragea nous donnent encore notre idéal de beauté suprême, et nos modèles inimitables. Ainsi cette civilisation infiniment plus archaïque du Vieux Japon atteignit une moyenne de culture esthétique et morale, digne en tout de notre admiration et de nos éloges. Seul, un esprit superficiel — très superficiel — qualifiera cette culture d’inférieure. Mais la civilisation japonaise est particulière à un degré qui n’a point d’équivalent en Occident. Elle se compose de nombreuses couches successives de culture étrangère superposée à la simple base indigène. L’ensemble est d’une complexité déconcertante. La majeure partie de cette culture est chinoise. Mais, ce qui est le plus surprenant, c’est que, malgré tout, le caractère original du peuple et de la société japonaise est encore reconnaissable.
Il ne faut pas chercher l’étrangeté ni le charme merveilleux du Japon dans ses emprunts innombrables. Il s’en est paré, comme la princesse des temps anciens révélait douze robes de cérémonie de couleurs et d’étoffes diverses, en les relevant plus ou moins, les unes au-dessus des autres, de façon à en montrer un peu toutes les nuances… au col, aux manches, et au bas de la jupe. Non ; ce qui est véritablement merveilleux au Japon, ce n’est point le vêtement, mais l’homme ou la femme qui le porte. Un costume a moins de prix parce qu’il est d’une belle coupe ou d’une belle couleur que parce qu’il réalise la conception de celui qui le créa, et qu’il représente le goût de celui qu’il vêt. Ainsi l’intérêt suprême de la vieille civilisation japonaise est dans ce qu’elle conserve et exprime du caractère de la race, de ce caractère que tous les changements du Meiji ne sont pas encore parvenus à changer. Mieux vaudrait dire, du reste, qu’elle suggère, plutôt qu’elle n’exprime, ce caractère de la race. Car il faut vraiment deviner celui-ci. Il nous serait sans doute plus aisé de le comprendre si nous possédions quelques documents sur ses origines ; mais ils nous manquent encore. Les ethnologues sont d’accord pour affirmer que la race japonaise s’est formée d’un mélange de peuples et que l’élément mongol y domine. Mais cet élément dominant est représenté par deux types très distincts : l’un est mince, presque féminin d’aspect ; l’autre est trapu et vigoureux. Dans certaines régions on retrouve des traces de sang chinois et coréen, — et il semble qu’il y ait eu aussi un fort-afflux de sang aïnou. On n’a pas pu déterminer s’il y avait aussi un élément malais ou polynésien. Pourtant on peut affirmer que la race japonaise, comme toutes les bonnes races, est très mélangée, et que les races diverses qui à l’origine se sont unies pour former ce peuple se sont confondues au point d’avoir produit, sous une longue discipline sociale, un type d’une assez grande uniformité. Mais bien que l’on reconnaisse immédiatement certains aspects de ce caractère, il présente encore pour nous bien des traits inexplicables.
Cependant il est très important de mieux connaître le caractère japonais. Le Japon est entré dans la concurrence mondiale, et la valeur d’un peuple dans cette lutte dépend autant de son caractère que de ses forces. Nous apprendrons à mieux comprendre le caractère japonais si nous arrivons à mieux déterminer dans quelles conditions il s’est formé, quels sont les grands faits généraux de l’expérience morale de la race. Et ces faits nous seront donnés ou suggérés par l’histoire des croyances nationales, et par l’histoire des institutions qui évolueront ou dériveront de la religion.
4
La religion primitive
La vraie religion du Japon, celle qui est encore professée, sous une forme ou sous une autre, par la nation tout entière, est le culte qui a été l’origine de toutes les religions et de toutes les sociétés civilisées : le culte des ancêtres. Au cours de milliers d’années, cette religion primitive a subi de nombreux changements, et a revêtu des aspects divers. Mais, dans tout le Japon, son caractère fondamental reste invariable. Outre les différentes formes du culte bouddhiste, il existe trois rites distincts, d’origine purement japonaise, et que modifia, par la suite, l’influence delà religion et du cérémonial chinois. Ces trois formes japonaises de l’adoration des ancêtres sont désignées par le mot Shinto, qui signifie : « le Chemin des Dieux. » Ce n’est pas là un terme fort ancien ; il fut créé pour éviter les confusions entre la religion indigène appelée le Chemin et la religion étrangère, le Bouddhisme, appelée Butsudo ou « Chemin de Bouddha ». Les trois formes de l’adoration shintoïste des ancêtres sont : la Religion Domestique, la Religion de la Communauté ou du dieu tutélaire, et la Religion Nationale. Autrement dit, l’adoration des ancêtres de la famille, l’adoration des ancêtres du clan, et l’adoration des ancêtres impériaux. Il y a bien d’autres formes de l’adoration shintoïste, mais nous ne nous en préoccuperons pas pour le moment.
De ces trois formes, la première, dans l’ordre de l’évolution, est le culte de la famille. Les deux autres en sont sorties ultérieurement. Pourtant, le culte de la famille n’est pas la religion domestique telle qu’elle existe de nos jours. La famille japonaise, aux temps primitifs, était bien autre chose qu’un ménage d’aujourd’hui ; elle en comprenait cent ou mille. Elle était semblable au γένος grec et à la gens romaine : c’était la famille patriarcale dans le sens le plus large. Il est probable que le Japon préhistorique ne connut pas l’adoration domestique de l’ancêtre. Les rites familiaux n’étaient alors accomplis qu’au lieu même de la sépulture. Mais le culte domestique n’est qu’un développement de ce rite familial primitif. Il faut donc se préoccuper de celui-ci avant d’entreprendre l’étude de l’évolution sociale du Japon.
L’histoire du culte des ancêtres se ressemble dans tous les pays. Celle du culte japonais vient confirmer de façon remarquable la théorie d’Herbert Spencer sur l’évolution religieuse. Afin de comprendre cette théorie, il faut remonter jusqu’à l’origine des croyances religieuses. Et le culte actuel des ancêtres au Japon n’est pas plus un culte « primitif » que ne l’était la religion domestique des Athéniens du temps de Périclès. Aucune des formes d’adoration qui existent encore n’est primitive. Quelle qu’elle soit, elle est sortie d’un autre culte de la famille irrégulier, et non-domestique, qui, à son tour, est sans doute sorti de rites funéraires encore plus anciens.
Ce que nous savons du culte des ancêtres dans les premières civilisations européennes ne remonte pas jusqu’à la forme primitive de ce culte. Pour les Grecs et les Romains, nos connaissances datent d’une époque où la religion domestique était depuis longtemps établie. Nous possédons des documents sur le caractère de cette religion. Mais nous ne pouvons établir la nature du culte primitif qui a dû la précéder qu’en étudiant l’histoire naturelle du culte des ancêtres chez un peuple non encore civilisé. Or, lorsque la race japonaise se fixa tout d’abord au Japon, elle n’y apporta pas une civilisation déjà bien définie. Et la religion domestique, telle qu’elle existe aujourd’hui, s’est sans doute établie seulement vers le VIIIe siècle, au moment où la tablette à esprit fut importée de Chine. Elle est donc une forme relativement moderne. Elle est au moins contemporaine de la véritable civilisation du pays. Et cependant elle contient des croyances et des idées qui sont incontestablement primitives. Et avant d’étudier cette religion elle-même il est indispensable d’examiner quelques-unes de ces croyances primitives.
Le plus ancien culte des ancêtres, « racine de toutes les religions », comme dit Herbert Spencer, coexista sans doute au Japon avec la première croyance aux esprits. Dès que les hommes conçurent l’idée d’un double, d’un autre soi-même vague et indistinct, ils songèrent aussi au culte propitiatoire des esprits. Pourtant, celte adoration des esprits dut précéder de longtemps le moment où les hommes formèrent pour la première fois des idées abstraites. Les adorateurs primitifs des ancêtres n’ont pas pu concevoir une déité suprême ; et tout ce que l’on sait des formes de leur adoration tend à démontrer qu’il n’y avait primitivement aucune différence entre leur conception des esprits et leur conception des dieux. Donc, il n’existait, pas alors de croyances définies à une vie future, et à des récompenses et des peines, — de croyance au ciel ou à l’enfer. L’idée même d’un mystérieux monde souterrain, ou Hadès, parut beaucoup plus tard. On imagina d’abord les morts demeurant dans leurs tombes, d’où ils sortaient de temps à autre pour rendre visite à leurs demeures terrestres, ou pour apparaître dans les rêves des vivants. Leur véritable demeure était la tombe, le tumulus. Ensuite se forma lentement l’idée d’un monde souterrain relié mystérieusement au sépulcre. Et enfin ce vague monde souterrain s’étendit et se partagea en régions de félicité ou de tourments spirituels. C’est un fait certain que la mythologie japonaise ne conçut jamais l’idée d’un Elysée ou d’un Tartare, ni la notion d’un ciel ou d’un enfer. Même de nos jours, la croyance shintoïste en est encore, en ce qui concerne le surnaturel, au point où était la pensée pré-homérique. De même chez les races indo-européennes, il n’y eut, au début, nulle différence entre les dieux et les esprits. Les dieux n’étaient pas même classés suivant leur importance. Ces distinctions ne s’établirent que peu à peu.
Les esprits des morts, dit Herbert Spencer, formaient dans la tribu primitive un groupe idéal dont les membres se distinguent peu les uns des autres. Mais ils se différencieront de plus en plus. Et, avec le progrès des sociétés, et la multiplication des traditions locales et générales, ces âmes humaines, jadis pareilles, prendront dans l’esprit populaire des caractères divers et une plus ou moins grande importance. Elles se sépareront alors au point qu’on pourra à peine retrouver en elles leur nature commune des premiers temps. »
Ainsi, dans l’Europe antique, comme dans l’Extrême-Orient, les plus grands dieux des nations naquirent de l’adoration des esprits. Mais, cette morale, fondée sur le culte des ancêtres qui donna leur organisation aux premières sociétés de l’Occident aussi bien que de l’Orient, date d’une époque antérieure à celle des dieux les plus puissants, époque à laquelle tous les morts étaient censés devenir dieux, sans distinction de rang.
Les premiers Japonais, pas plus que les primitifs adorateurs des ancêtres de la race aryenne, ne voyaient leurs morts montant vers une région d’outre-monde de lumière et de béatitude, ni descendant dans quelque royaume de continuel tourment. Leurs premières archives religieuses parlent d’un monde souterrain, où de mystérieux dieux tonnerres et des génies malfaisants vivaient dans la pourriture. Mais ce monde indéfini des morts communique avec le monde des vivants. L’esprit qui y demeurait, quoiqu’en quelque sorte attaché à son enveloppe pourrissante, pouvait encore recevoir, sur terre, les hommages des mortels. Avant l’introduction du bouddhisme, l’idée du ciel et de l’enfer n’existait pas. Les esprits des morts étaient constamment présents. Il fallait les apaiser et ils partageaient les plaisirs et les peines des vivants. Ils exigeaient de la lumière, des boissons et delà nourriture. En retour, ils répandaient des bienfaits. Leurs corps s’étaient dissous dans la terre, mais leur force spirituelle s’attardait sur la terre ; ils en faisaient vibrer la matière, ils se manifestaient dans le souffle du vent et dans les mouvements de l’eau. Grâce à la mort, ils avaient acquis une puissance mystérieuse. Ils étaient devenus des êtres supérieurs, des Kamis, des dieux.
Ils étaient devenus des dieux, mais au sens grec ou romain. Ni en Occident, ni en Orient, cette déification ne comportait de distinctions morales. « Tous les morts deviennent des dieux », écrivit le grand commentateur shintoïste Hirata. De même, dans la pensée des premiers Grecs et, plus lard, dans celle des Romains, tous les morts devenaient des dieux.
Fustel de Coulanges remarque dans la Cité Antique :
— « Cette sorte d’apothéose n’était pas le privilège des grands hommes. Il n’était pas nécessaire d’avoir été un homme vertueux : le méchant devenait un dieu tout comme l’homme de bien. Seulement il gardait dans cette seconde existence tous les mauvais penchants qu’il avait eus dans la première. »
Les choses se passaient de la même façon, selon la croyance shintoïste. L’homme bon devenait une divinité bienfaisante, l’homme méchant un mauvais génie. Mais ils étaient l’un et l’autre des Kamis.
Et Motowori a dit :
— « Puisqu’il y a des dieux malfaisants aussi bien que des dieux bienfaisants, il est nécessaire de les apaiser par des offrandes de mets délicats, ou en jouant de la harpe ou de la flûte, en chantant ou en dansant, et en faisant tout ce qui peut contribuer à les mettre de bonne humeur. »
Les Latins appelaient les esprits malfaisants des morts Larves, et les esprits bienfaisants, ou du moins inoffensifs, Lares, Mânes ou Génies, suivant Apulée. Mais c’étaient tous des dieux, dii mânes. Et Cicéron recommanda à ses lecteurs de rendre à tous les dii mânes l’hommage qui leur était dû. Il disait :
— « Ce sont des hommes qui ont quitté cette vie. Considérez-les comme des esprits divins. »
Dans la croyance shintoïste, comme dans la croyance grecque, mourir c’était acquérir un pouvoir surhumain, et la possibilité de prodiguer des bienfaits ou d’infliger des malheurs, grâce à des moyens surnaturels. Hier encore tel homme n’était qu’un simple travailleur sans importance. Il meurt, et tout aussitôt il devient une puissance divine, et ses enfants lui adressent des prières pour la prospérité de leurs entreprises. C’est ainsi que les personnages de la tragédie grecque, comme Alceste, sont soudain transformés, par la mort, en divinités, et qu’on s’adresse à eux dans le langage de l’adoration et de la prière. Pourtant le bonheur de chaque mort dépend du dévouement de ses parents. Tout esprit doit avoir une tombe convenable et recevoir des offrandes. Tant qu’il est honorablement abrité et nourri de façon satisfaisante, l’esprit est content, et il pourvoira à la durée du bonheur de ceux qui l’apaisent ainsi. Mais, lui refuse-t-on une demeure sépulcrale et les rites funéraires, les offrandes de mets et de boissons, l’esprit souffrira de faim et de soif. Sa colère le rendra malveillant, et il travaillera au malheur de ceux qui l’ont négligé.
Telles étaient les idées des anciens Grecs sur les morts : c’étaient aussi celles des anciens Japonais.
La religion des fantômes fut, jadis, la religion de nos propres ancêtres, qu’ils appartinssent à l’Europe septentrionale ou méridionale. Les pratiques qui en dérivèrent, telles que la coutume de décorer les tombes de fleurs, persistent encore de' nos jours, même dans les sociétés les plus civilisées. Pourtant nos façons de penser ont beaucoup changé sous les influences diverses de la civilisation f moderne. Il nous est difficile d’imaginer comment | on n’a jamais pu penser que le bonheur des morts dépendait d’une nourriture matérielle. Pourtant il est fort probable que la vraie croyance des anciennes sociétés européennes ressemblait, par bien des côtés, à la croyance qui subsiste dans le Japon moderne. Les morts sont censés n’absorber que | l’essence invisible des mets qu’on leur présente. Au début du culte des ancêtres, les offrandes d’aliments étaient importantes. Elles le furent moins ; lorsque se fut affirmée la croyance que les esprits n’exigeaient que peu de nourriture, même vaporeuse. Mais si petites que fussent les offrandes, il était indispensable qu’elles fussent faites régulièrement : le bien-être des morts dépendait de ces repas illusoires, et le bonheur des vivants dépendait du bien-être des morts. Les uns ne pouvaient se passer de l’aide des autres, et réciproquement. Le monde visible et le monde invisible étaient unis pour toujours par d’innombrables liens. Et on ne pouvait pas briser un seul chaînon ; de ces liens sans qu’il en résultât les conséquences les plus funestes.
L’histoire de tous les sacrifices religieux remonte à cette ancienne coutume des offrandes présentées aux esprits. Et la race indo-aryenne tout entière n’eut pas, à un certain moment, d’autre religion que celle des esprits. En somme, toute société humaine, à un moment donné de son histoire, a passé par la phase de l’adoration des ancêtres. Mais c’est vers l’Extrême-Orient qu’il nous faut diriger nos regards aujourd’hui, pour trouver ce culte coexistant avec une civilisation raffinée. Or, le culte japonais des ancêtres, tout en représentant les croyances d’un peuple non aryen et tout en offrant dans l’histoire de son développement plusieurs particularités intéressantes, contient encore beaucoup des idées qui caractérisent le culte des ancêtres en général.
Et il y survit surtout trois croyances qui sont au fond des religions des ancêtres, sous tous les climats et dans tous les pays :
1. Les morts demeurent dans ce monde ; ils hantent leurs tombes, et aussi leurs maisons de jadis, et ils partagent d’une façon invisible la vie de leurs descendants.
2. Tous les morts deviennent des dieux, c’est-à-dire qu’ils acquièrent un pouvoir surhumain. Mais ils gardent les traits caractéristiques qui les ont distingués pendant leur vie.
3. Le Bonheur des morts dépend des soins respectueux que leur donnent les vivants, Et le bonheur des vivants dépend de l’accomplissement des pieux devoirs qu’ils rendent aux morts.
À ces premières croyances, il faut ajouter les suivantes, qui furent sans doute des développements tardifs, mais qui durent pourtant exercer, à une certaine époque, une influence considérable.
4. Tous les événements, tous les phénomènes bons ou mauvais sont les œuvres des morts : – les moissons, les saisons, les inondations, les ouragans, les raz de marées des secousses sismiques, etc.
5. Toutes les actions humaines, bonnes où mauvaises, sont contrôlées par les morts.
Les trois premières croyances survivent depuis, j l’aube de la civilisation, — depuis l’époque où les morts étaient les dieux uniques, sans distinction | de puissances. Mais les deux dernières croyances semblent plutôt appartenir à la période où une ; véritable mythologie, un gigantesque polythéisme, sortit de la primitive adoration des fantômes. — Il n’y a rien de simple dans ces croyances qui sont effrayantes et colossales. Et, avant que le Bouddhisme ne vînt les dissiper, elles ont dû peser sur l’esprit d’un peuple vivant dans un pays de cataclysmes, comme un lourd cauchemar. Pourtant les croyances les plus anciennes sont, dans une forme atténuée, la base du culte, actuel. Bien que, depuis deux mille ans, l’adoration japonaise des ancêtres ait subi de nombreuses modifications, celles-ci n’ont pas transformé son caractère essentiel par rapport à la morale. Toute la trame de la société repose sur cette adoration comme sur une base morale. L’histoire du Japon est, en réalité, l’histoire de sa religion. En voici une preuve bien significative : l’ancien mot japonais de gouvernement, matsuri-goto, signifie littéralement affaires d’adoration. Nous verrons plus loin que, dans la société japonaise, non seulement le gouvernement, mais presque tout, dérive directement ou indirectement du culte des ancêtres. Dans toutes les affaires ce sont toujours les morts qui, plutôt que les vivants, ont été les chefs de la nation, et les sculpteurs de sa destinée.
5
La religion du foyer
Au cours de l’évolution sociale et religieuse, le culte des ancêtres a passé par trois phases distinctes. L’histoire de la société japonaise fournit des exemples de chacune de ces phases. La première est celle qui précéda l’organisation même de la société. Il n’existait pas encore de chef national ; la grande famille patriarcale, avec ses anciens et ses chefs guerriers pour seigneurs, formait la première branche de cette société. Alors on adorait seulement les esprits des ancêtres de la famille. Chaque famille cherchait simplement à apaiser ses morts.
Plus tard, les familles patriarcales se groupèrent en tribus. La coutume voulut alors que la tribu entière sacrifiât aux mânes du chef de clan. Et ce culte, en s’ajoutant au culte de la famille, marqua la deuxième forme de l’adoration des ancêtres.
Enfin, lorsque toutes les tribus et tous les clans se rallièrent autour d’un chef suprême, l’usage s’établit d’apaiser ainsi les esprits des chefs nationaux. C’est cette troisième forme du culte qui devint la religion obligatoire du pays. Elle ne remplaça aucun des deux cultes précédents. Ils existèrent tous les trois ensembles.
Il est difficile de retracer l’évolution, au Japon, de ces trois phases du culte des ancêtres. Pourtant on peut supposer, d’après certains documents, comment les formes permanentes de ce culte sortirent des rites funéraires primitifs. Ceux-ci étaient très différents des rites funéraires de l’Europe ancienne, et l’on y retrouve la trace d’une vie sociale tout à fait rudimentaire. Ainsi, la vieille coutume, en Grèce et en Italie, était d’enterrer les morts dans la propriété même de la famille ; c’est de cette pratique que datent les lois grecques et romaines sur la propriété. Parfois les morts étaient enterrés tout près de la maison. L’auteur de la Cité Antique cite, parmi d’autres textes anciens se rapportant à ce sujet, une intéressante invocation tirée de la tragédie à Hélène, d’Euripide : « Salut, tombeau de mes pères ! Je t’ai enterré, Protée, à la place où les hommes sortent, afin de pouvoir te saluer souvent. Et chaque fois que j’entre ou que je sors, moi, ton fils Théoclymène, je t’invoque, ô mon père. »
Or, dans le Japon ancien, les hommes fuyaient le voisinage de la mort. Il n’est guère probable qu’ils aient jamais considéré comme propice d’enterrer les morts tout près de la demeure des vivants de la famille. Certaines autorités japonaises assurent même qu’à des époques très reculées les morts ne recevaient aucune sépulture. Les corps étaient transportés dans des espaces déserts, et abandonnés aux bêtes de proie.
Cependant il existe des documents d’une valeur indiscutable sur les premiers rites funéraires, tels S qu’ils furent célébrés au moment où l’on commença à enterrer les morts. Et c’étaient des rites étranges et effrayants. On pense que, primitivement, la demeure familiale était abandonnée pour toujours aux morts. Il est vrai que la maison japonaise était alors une hutte de bois. En tous cas, le corps était déposé pendant la période de deuil, soit dans la maison où le décès avait eu lieu, et que la famille désertait, soit dans un abri voisin construit spécialement pour cela. Et toute cette période durant, les offrandes de mets et de boissons étaient disposées près du corps, tandis qu’en dehors de la maison s’accomplissaient les cérémonies. Les parents venaient réciter des poèmes, shinobigoto, à la louange du mort. Ils exécutaient des danses. Ils jouaient de la flûte et du tambour. Et, toute la nuit, devant la maison, un feu brûlait.
Lorsque ces rites étaient accomplis, les huit ou quinze jours de deuil écoulés, le corps était mis terre. Alors la maison abandonnée devenait probablement un temple ancestral, ou « maison des fantômes ; prototype du mya ou temple shintoïste.
En tous cas, à cette époque très lointaine, l’usage était certainement, dès qu’une mort survenait, d’ériger un moya, ou maison de deuil, pour y célébrer certains rites avant l’enterrement, Cet enterrement était du reste très simple. On n’érigeait pas encore de tombeaux, on ne dressait même pas de pierres tumulaires. Mais on recouvrait la sépulture d’un petit tertre dont les dimensions variaient en proportion du rang que le mort avait occupé.
Cette habitude d’abandonner la maison après une mort semblerait confirmer la prétendue origine nomade du peuple japonais. Elle ne se justifie pas dans les mœurs des premiers Grecs et des premiers Romains. Les rites funéraires de ceux-ci supposent au contraire l’existence de petites propriétés, occupées de façon permanente. Cependant l’usage japonais a dû comporter, même à l’époque la plus reculée, quelques exceptions imposées par la nécessité. Et c’est ce qui explique que, de nos jours, dans plusieurs régions du Japon, et plus particulièrement dans les régions éloignées des temples, les fermiers ensevelissent leurs morts dans leurs propres terres.
Après les funérailles, et à des intervalles réguliers, des cérémonies avaient lieu devant les tombes. Des mets et des boissons étaient offerts aux esprits.
Même lorsque la Chine eut importé la « tablette à esprit », et que le véritable culte domestique se fut établi, on ne cessa pas de faire des offrandes au lieu de sépulture. Cet usage persiste jusqu’à nos jours dans les rites bouddhistes comme dans les rites shintoïstes. Et au printemps de chaque année, un messager impérial dépose devant la tombe de l’Empereur Jimmu les offrandes d’oiseaux, de poissons et d’algues marines, de riz et de vin-de-riz, toutes semblables à celles qui furent présentées, il y a vingt-cinq siècles, à l’Esprit du Fondateur de l’Empire.
Cependant, avant la période où s’exerça l’influence chinoise, il semble bien que la famille n’ait adoré ses morts que devant la maison mortuaire, ou devant la tombe. Les esprits étaient supposés vivre dans leurs tombes, avec pourtant un accès ouvert à quelque monde mystérieux et souterrain. On ne croyait pas qu’ils avaient d’autres besoins que de boire et de manger. Aussi, plaçait-on dans les tombes des objets divers : un sabre, s’il s’agissait d’un homme ; un miroir, s’il s’agissait d’une femme. On choisissait les objets auxquels, durant sa vie, chacun avait attaché le plus de prix : bibelots en métaux précieux, pierres polies, gemmes...
À cette phase de l’adoration des ancêtres, tandis que les mânes sont censés réclamer les mêmes soins que durant la vie, on n’est pas surpris qu’il soit question de sacrifices humains, aussi bien que de sacrifices d’animaux. Ils étaient même fréquents aux obsèques des grands personnages. Et suivant certaines croyances dont on a perdu toute trace, ces sacrifices auraient même présenté un caractère beaucoup plus cruel que les hécatombes pré-homériques. Les victimes humaines étaient enterrées jusqu’au cou en un cercle, autour de la tombe, et livrées ainsi aux becs des oiseaux de proie, et aux. dents des fauves. Cette forme d’immolation s’appelait « hogaki », ou « haie humaine », ce qui donne à penser que chacun de ces sacrifices comportait un très grand nombre de victimes.
L’Empereur Suinin abolit, il y a près de dix-neuf cents ans, cette coutume, dès lors considérée, selon le Nihonghi, fort ancienne. L’Empereur Suinin avait été touché par les plaintes des victimes enterrées autour du tertre funéraire de son frère Yamato-Kiko-no-Mikoto. Et il dit : — « Il est bien douloureux d’obliger ceux qu’on a aimés dans cette vie à vous suivre dans la mort. Il s’agit, il est vrai, d’une coutume très ancienne. Mais pourquoi continuer à la suivre puisqu’elle est mauvaise ? Je veux qu’à partir d’aujourd’hui on prenne avis de l’interdire. »
Alors un courtisan, Nomi-no-Sùkumé, qui est maintenant adoré comme patron des lutteurs, suggéra l’idée de substituer des images en terre aux victimes vivantes. Son conseil fut suivi, et la « haie vivante » fut abolie. Toutefois, pendant plusieurs siècles encore, des hommes continuèrent à suivre leurs morts volontairement, ou par contrainte, puisque, en l’an 646 de notre ère, l’Empereur Kotoku publiait l’édit suivant :
« À la mort d’un homme, il y a eu des exemples de gens qui se sacrifièrent en s’étranglant, qui en immolèrent d’autres de la même manière, ou qui exigèrent le sacrifice du cheval de la personne décédée. Certains, même, ont manifesté leur douleur en enterrant des valeurs en l’honneur du mort,, en se coupant les cheveux, en se tailladant les cuisses, et en prononçant dans cet état un éloge des morts. Mais dorénavant on devra cesser absolument d’observer ces anciennes coutumes. » (Le Nihonghi.)
Les premiers rites funéraires, les sacrifices, l’abandon de la maison mortuaire, tout cela confirme bien que l’adoration des ancêtres exista d’abord sous une forme absolument primitive. Cela résulte aussi de l’horreur de la mort, professée par la religion shintoïste, qui y voyait une cause de souillure. De nos jours encore, les shintoïstes considèrent comme une souillure religieuse de prendre part à un enterrement, à moins qu’il ne soit réglé selon les rites de leur religion. L’antique légende de Iyenagi, descendant dans le monde souterrain à la recherche de sa femme perdue, prouve combien étaient terribles les croyances de jadis sur les pouvoirs fantômes qui présidaient à la corruption. Mais entre l’horreur de la mort en tant que corruption, et l’apothéose de l’esprit, il n’existe pas de contradiction. Au contraire, il faut voir dans cette apothéose elle-même une sorte de culte propitiatoire. Le Chemin des Dieux, le shintoïsme primitif, était une religion de crainte perpétuelle. Ce n’était pas seulement les demeures ordinaires que ses fidèles abandonnaient après une mort. Pendant de longs siècles, les empereurs eux-mêmes avaient l’habitude de changer de capitale après le décès de leur prédécesseur.
Pourtant, peu à peu, un culte plus élevé sortit des anciens rites funéraires. La moya, ou maison de deuil, fut remplacée par le temple shintoïste qui, aujourd’hui encore, affecte la forme d’une hutte japonaise primitive. Puis, sous l’influence chinoise, le culte ancestral s’établit au foyer même. Et plus tard le Bouddhisme conserva cette religion domestique. Celle-ci devint, graduellement, une religion de tendresse aussi bien que de devoir. Elle transforma et adoucit les pensées des hommes sur la mort. Dès le huitième siècle, l’adoration des ancêtres a évolué dans les trois formes principales sous lesquelles elle persiste encore. Et, à partir de ce moment, le culte de la famille se fixe, prend son caractère définitif, et, par bien des côtés, elle ressemble à la religion domestique des anciennes civilisations européennes.
Le culte domestique est actuellement la religion générale du Japon. Un autel lui est consacré dans la maison. Si la famille ne professe que la croyance shintoïste, cet autel ou mitamaya1, « auguste demeure de l’esprit », modèle minuscule d’un temple shintoïste, est placé sur une planche, au mur d’une chambre intérieure. On appelle cette planche le Mitama-San-ho-tana, ou « Planche des esprits augustes ». Dans la châsse, on place des tablettes de bois blanc où sont inscrits les noms des morts de la famille. Ces tablettes sont appelées matashiro, ce qui veut dire « substitut de l’esprit ». Elles sont aussi désignées par un autre mot, sans doute plus ancien, et qui signifie « bâtonnets à esprits ».
Si la famille adore ses esprits suivant le rite bouddhiste, la tablette mortuaire est déposée dans la butsudan, ou châsse, qui occupe en général la planche supérieure de l’alcôve d’une des chambres intérieures. Les tablettes mortuaires bouddhistes, sauf quelques rares exceptions, sont appelées ichai, ce qui veut dire communication de l’âme. Elles sont laquées et dorées ; leur socle représente en général une feuille de lotus en bois sculpté. On n’inscrit pas le véritable nom du mort sur le ichai, mais seulement son nom religieux et posthume.
Il est curieux de noter que, dans chacun de ces cultes, la tablette mortuaire représente une pierre tombale en réduction. En effet, les pierres tombales toutes simples des cimetières shintoïstes ont la forme des bâtons de fantômes, ou « bâtonnets à esprits » en bois, tandis que les monuments des vieux champs de repos bouddhistes ressemblent, en tous points, aux ichai dont la forme varie suivant l’âge et le sexe de la personne décédée.
La châsse de famille ne contient guère plus de cinq ou six tablettes mortuaires. Seuls les aïeux, les parents et les morts récents sont représentés ainsi. Les noms des ancêtres très éloignés sont inscrits sur les rouleaux conservés dans la butsudan ou dans le mitamaya.
Quel que soit le rite familial, on récite chaque jour des prières devant les tablettes des ancêtres, et on leur fait des offrandes. La nature des offrandes et le caractère de la prière dépendent [...]