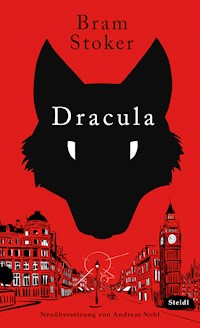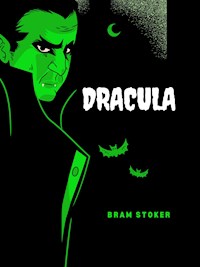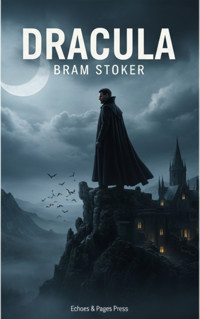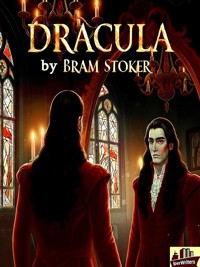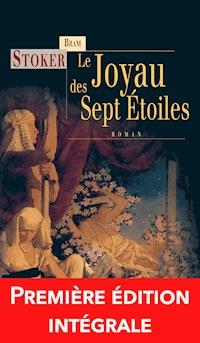
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Terre de Brume
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Pour la première fois, le texte original de ce roman fantastique de Stoker est publié dans son intégralité !
Assailli dans une pièce entièrement close par quelque chose ou quelqu’un, un éminent égyptologue est plongé dans un étrange état cataleptique. Puis, peu après, au même endroit, certains objets précieux disparaissent pendant que d’autres reviennent dans de troublantes et inexplicables conditions. Et, tandis que le mystère grandit, d’autres malédictions resurgissent, dont une sous la forme d’une main momifiée. Une main pourvue de sept doigts. Une main où scintillent d’extraordinaires joyaux, semblables à des étoiles…
Le Joyau des Sept Étoiles (1903) est présenté ici pour la première fois dans sa version intégrale. En effet, la seule traduction disponible en langue française était amputée d’environ un tiers du texte original, supprimant ainsi l’efficacité des descriptions que Stoker s’était appliqué à donner de cette descente dans les abîmes de l’effroi. Une deuxième fin est également proposée pour la première fois au lecteur français.
Il ne s’agit pas ici de vampirisme, mais l’horreur atteint, dans ce superbe roman, des sommets — ou plutôt des gouffres — d’angoisse inattendus.
EXTRAIT
Tout cela paraissait si réel que j’avais peine à imaginer que cela se soit produit antérieurement et cependant, chaque épisode survenait, non pas comme une étape nouvelle dans l’enchaînement logique des faits, mais comme une chose à laquelle on s’attend. C’est de cette façon que la mémoire joue ses tours pour le bien ou pour le mal, pour le plaisir ou pour la douleur, pour le bonheur ou pour le malheur. C’est ainsi que la vie est un mélange de douceur et d’amertume et que ce qui a été devient éternel.
De nouveau, le léger esquif, cessant de fendre les eaux tranquilles comme lorsque les avirons brillaient et ruisselaient d’eau, quitta le violent soleil de juillet pour glisser dans l’ombre fraîche des grandes branches de saules qui retombaient — j’étais debout dans le bateau qui oscillait, elle était assise immobile et, de ses doigts agiles, elle écartait les branches égarées, se protégeait des libertés que prenaient les rameaux sur notre passage. De nouveau, l’eau paraissait être d’un brun doré sous le dôme de verdure translucide, et la rive était recouverte d’une herbe couleur d’émeraude. De nouveau, nous étions là dans l’ombre fraîche, avec les mille bruits de la nature se produisant à l’intérieur et à l’extérieur de notre retraite, se fondant dans ce murmure somnolent qui fait oublier les ennuis bouleversants et les joies non moins bouleversantes du monde immense. De nouveau, dans cette solitude bénie, la jeune fille oubliant les conventions de son éducation première rigoriste, me parla avec naturel et sur un ton rêveur de la solitude qui assombrissait sa nouvelle existence. Elle me fit ressentir, avec une grande tristesse, comment dans cette vaste maison chaque personne se trouvait isolée du fait de la magnificence de son père et de la sienne, car, en ces lieux, disait-elle, la confiance n’avait pas d’autel, la sympathie pas de sanctuaire. Le visage de son père paraissait aussi lointain que semblait à présent lointaine la vie du vieux pays.
A PROPOS DE L’AUTEUR
Après une jeunesse précaire et difficile, Bram Stoker se lança dans le journalisme ses études terminées. C’est en 1871 que lui vint l’idée de ce qui allait devenir un des plus célèbres romans de littérature fantastique,
Dracula (1897). Mais la carrière littéraire de Bram Stoker ne s’arrêta pas là, et il rédigea de nombreuses autres œuvres, malheureusement occultées par le succès de
Dracula, parmi lesquelles
Le Joyau des Sept Étoiles, disponible pour la première fois en version intégrale dans la collection Terres Fantastiques, et
Le Repaire du Ver blanc. Bram Stoker mourut à Londres.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 553
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les éditeurs tiennent à remercier
Elisabeth Willenz, David Glover, Richard D. Nolane
AVERTISSEMENT
Bram Stoker fut longtemps l’homme d’un seul livre, Dracula, adapté en France en 1920. Il aura fallu attendre 1969 pour que Le Joyau des sept étoiles (paru rappelons-le en 1903) soit traduit (ou adapté…) dans une édition à tirage limité, et 1976, pour qu’une autre version (mais abrégée d’environ un tiers), chez un éditeur de grande diffusion, soit proposée au lecteur français. À vrai dire, les éditeurs anglais eux-mêmes, du vivant de Stoker, ou après sa mort, n’ont pas hésité à abréger ses romans fantastiques. Et ce sont ces éditions fautives qui ont servi aux éditeurs français lorsqu’ils ont traduit Le Joyau des Sept Étoiles, Le Repaire du ver blanc et, plus récemment, La Dame au linceul. L’œuvre romanesque fantastique de Bram Stoker est donc à redécouvrir en grande partie, même si aucun de ses romans n’atteint la puissance de son chef-d’œuvre, Dracula.
Cette nouvelle édition du Joyau des Sept Étoiles en rétablit le texte complet et propose une seconde fin, plus optimiste que la fin originale, qui a été longtemps la seule diffusée par les éditions abrégées.
XAVIER LEGRAND-FERRONNIÈRE
PRÉFACE
« Il serait impossible de dire que penser exactement du Joyau des Sept Étoiles de M. Bram Stoker », confessait un critique américain en 1904, avant d’ajouter immédiatement que « c’est un de ces livres qui mettent le jugement au défi en raison même de l’intérêt qu’ils suscitent1 ». Bien que favorablement reçu par les critiques — le Times Literary Supplement l’avait qualifié « d’histoire réellement palpitante » — le « Mystère égyptien » de Stoker créa un sentiment de gêne qui se révéla difficile à exorciser2. À tel point que, lorsqu’il décida de rééditer Le Joyau des Sept Étoiles près de dix ans plus tard, l’éditeur insista pour qu’il ait, cette fois, un dénouement heureux. Aujourd’hui encore, il reste comme une sorte d’énigme, comme un roman qui résiste aux interprétations et qui demeure l’œuvre « la plus difficile à étiqueter » de Stoker3.
Au fil des ans, Le Joyau des Sept Étoiles fut un des rares livres de Stoker, parmi ses dix-sept publiés, à être réimprimés régulièrement, mais toujours dans sa version expurgée. Resté longtemps dans l’ombre de l’impérissable fascination exercée par Dracula, il n’a pourtant jamais été totalement éclipsé par ce rival bien plus célèbre et, tout comme Dracula, il a connu au cinéma une seconde vie plutôt corsée, grâce aux films Blood from the Mummy’s Tomb (1971) et The Awakening (La Malédiction de la Vallée des Rois, 1980). En fait, Le Joyau des Sept Étoiles appartient à une longue tradition de fantastique populaire égyptien, remontant au moins à la première apparition de « la forme momifiée emmaillotée de bandelettes » d’Aysha dans le roman She de H. Rider Haggard (1887), et dont La Momie d’Anne Rice (1989) ou le film Stargate de Roland Emmerich (1994) figurent parmi les représentants les plus récents. Stoker vit même le succès de son magnum opus dépassé par celui d’un roman gothico-orientaliste lorsque Le Scarabée de Richard Marsh commença à supplanter rapidement Dracula en librairie vers la fin de l’année 1897. Peut-être n’est-ce donc pas un hasard si l’éditeur Heinemann mit lui aussi un scarabée, l’insecte sacré égyptien, sur la couverture du Joyau des Sept Étoiles quand il le publia en 1903.
L’Égypte occupait une place particulière dans l’imaginaire européen au XIXe siècle, agissant comme une sorte d’écran sur lequel pouvaient être projetés espoirs et angoisses impériaux. Aux yeux de nombreux Européens, l’Égypte ancienne représentait une civilisation en ruine dont les restes éparpillés pouvaient être rassemblés, classés et restaurés dans leur gloire d’antan sous la protection de l’Occident, loin de la dégénérescence supposée de ses habitants modernes. Considérée sous l’angle le plus rassurant, comme dans la philosophie de l’Histoire de Hegel, l’Égypte antique était simplement une halte sur le chemin de la montée de la raison, un site culturel où « nous rencontrons cette contradiction de principes que l’Ouest a pour mission de résoudre4 ». Mais c’était aussi un empire dont les réussites passées étaient souvent difficiles à déchiffrer, dont les avancées semblaient aller dans des directions troublantes ou déroutantes, vers un enseignement kabbalistique et une magie occulte plutôt que vers un savoir scientifique. Si des pays comme l’Angleterre et la France étaient vraiment les successeurs historiques de l’Égypte dans le monde, alors il n’y avait pas guère de réconfort à puiser dans les signes du déclin de celle-ci. Et les visiteurs de l’Égypte s’y voyaient quelquefois rappeler leur pays d’origine de manière bien peu agréable : lorsque Sir William Wilde, père d’Oscar Wilde et archéologue amateur, observa en 1838 un marché d’esclaves à Alexandrie, il n’y vit qu’une « place sale et affreuse, dont la misère n’était pas très éloignée de celle d’un parc à bestiaux irlandais5 ».
Ce fut Sir William Wilde qui, le premier, sensibilisa Stoker sur le potentiel imaginaire de l’égyptologie victorienne. Hôte régulier de la maison des Wilde à la fin des années 1860 et au début des années 1870, Stoker avait dû entendre de la bouche même de Sir William les relations plutôt dramatiques de ses expéditions archéologiques. On trouve dans Le Joyau des Sept Étoiles des récits de voyages qui font écho aux incidents racontés par Sir William dans ses écrits sur l’Égypte, quand il se vantait par exemple d’avoir dormi une nuit dans la chambre extérieure d’une tombe. En même temps, le roman déploie avec ostentation les fruits des infatigables recherches en bibliothèque de Stoker sur la culture de l’Égypte ancienne, et utilise les découvertes scientifiques d’égyptologues fort respectés comme Sir Flinders Petrie et Sir Ernest Wallis Budge (les deux sont nommément cités dans Le Joyau des Sept Étoiles) comme point de départ d’une histoire spéculative très différente de celle envisagée par le rationalisme philosophique de Hegel. Le résultat se lit comme un guide couvrant plus d’un siècle d’égyptomanie britannique : les momies y sont déballées en toute cérémonie sous les regards avides des spectateurs curieux, les bibelots et les ornements y sont amoureusement décrits et catalogués, et les étranges mythes et légendes d’une civilisation préchrétienne extraordinaire et provocante y deviennent l’objet d’un exposé érudit. Mais plus on en apprend, moins on y comprend quelque chose.
La publicité pour le livre insistait sur son étrange sens du mystère mais promettait aussi qu’il allait modifier la perception de ses lecteurs. Le Joyau des Sept Étoiles a beau se dérouler principalement dans le Londres edwardien, « le lecteur y est emporté très loin du présent prosaïque, vers le passé ensorcelant de l’Égypte antique »… Sous la plume de Stoker, affirmait-on, « les arts mystiques et les superstitions » de l’Égypte semblent devenir « du domaine du possible et ce, de manière séduisante6 ». Il n’est donc pas surprenant que l’un des plus fervents admirateurs du livre ait été l’écrivain et occultiste écossais J. W. Brodie-Innes, lequel écrivit sur-le-champ à Stoker pour lui dire que c’était là « un grand livre » qui jetait « une nouvelle lumière sur des problèmes que certains d’entre nous avaient explorés à tâtons dans l’obscurité depuis bien assez longtemps comme cela7 ». Et il envisageait ardemment de discuter des idées de Stoker à l’occasion de leur prochaine rencontre. Ce n’était pas là un mince compliment car, même s’il était un proche de l’Évêque d’Édimbourg et une figure familière du beau monde de la ville, Brodie-Innes était — tout comme William Peck, l’astronome municipal d’Édimbourg et le directeur de l’observatoire de celle-ci — l’un des membres les plus influents de ce centre de pratiques occultes qu’était le Temple d’Amon-Ra de l’Ordre hermétique de l’Aube Dorée, connu dans le monde entier sous le nom abrégé de Golden Dawn (« Aube Dorée »).
Il a souvent été dit que Stoker appartenait lui-même à cette société mystique et secrète ou qu’il en était tout au moins un de ses compagnons de route. Pourtant, et même si bon nombre de ses amis et connaissances ont eu des liens avec la Golden Dawn — le plus éminent d’entre eux étant le poète W. B. Yeats — il n’existe aucune preuve formelle que Stoker ait été un initié de l’Ordre8. À bien des égards, Stoker était un protestant anglo-irlandais nettement plus conventionnel que ne le fut jamais Yeats, un écrivain dont la voix narratrice résonne parfois des graves intonations protestantes que l’on trouve d’habitude chez des moralistes victoriens tels que Samuel Smiles. Pourtant, à l’image de son ami Sir Arthur Conan Doyle, Stoker était de toute évidence passionné par les univers symbiotiques de la recherche psychique et du spiritisme. Il correspondait avec Sir Oliver Lodge, un temps président de la Society for Psychical Research, lorsque celui-ci affirma avoir découvert une preuve scientifique à l’appui de la croyance en l’immortalité, et sa bibliothèque contenait des textes ésotériques tels que Le Livre des Morts égyptien. Ces centres d’intérêt se retrouvent avec force dans les romans gothiques de Stoker. Les notes de travail de Dracula évoquent un personnage nommé Alfred Singleton, décrit comme « un agent de recherches psychiques », et qui par la suite semble avoir été incorporé à celui du professeur Van Helsing, le savant mâtiné de mage du livre, un homme possédant toutes les qualifications requises pour devenir un membre de la Society for Psychical Research9. Dans The Lady of the Shroud, un roman qui se présente au départ comme une suite à Dracula, le héros est une sorte d’aventurier de la recherche psychique nommé Rupert Sent Leger, parcourant le monde afin d’enquêter sur d’étranges pratiques indigènes pour le compte du Journal of Occultism. Intimidé ni par les « animaux sauvages » ni par les « hommes sauvages », Sent Leger « s’était attaqué à la magie africaine et au mysticisme indien » avec un tel succès que « depuis longtemps la Psychical Research Society […] le considérait comme son agent ou sa source de découvertes le plus fiable10 »…
Dans une veine similaire, Le Joyau des Sept Étoiles explore ce qu’une autre autorité scientifique mentionnée dans le roman, le physicien et spiritualiste Sir William Crookes, avait appelé « le sombre royaume séparant le connu de l’inconnu » avec ses « tentations particulières » et ses promesses « de réalités ultimes, subtiles, immenses, merveilleuses11 ». Comme dans Dracula, les mots d’ouverture sont prononcés par un jeune avocat, sauf qu’ici, le livre est en totalité consacré à son histoire, à l’exception de deux longues digressions au cours desquelles d’autres personnages racontent la leur. On peut voir en Malcolm Ross une version plus naïve, mais tout aussi romantique, de Jonathan Harker, et la fin du roman le trouve angoissé et brisé comme l’était celui-ci suite à son emprisonnement dans le château de Dracula. Au début, Le Joyau des Sept Étoiles se lit pourtant comme un mystère en chambre close susceptible d’être résolu de manière rationnelle. Aux petites heures du matin, le bruit de quelqu’un qui frappe et sonne à la porte tire Malcolm Ross d’un rêve tournant autour d’une jeune femme rencontrée récemment, nommée Margaret Trelawny. À sa porte, il découvre le groom portant un message de la jeune femme lui demandant de se rendre de toute urgence à sa maison de famille à Notting Hill où l’on vient d’attenter à la vie de son père. Margaret a découvert Abel Trelawny dans sa chambre, qui fait office de bureau, gisant inconscient devant le coffre-fort après avoir été, de toute évidence, tiré ensanglanté hors de son lit. Le coffre fermé suggère que les agresseurs de son père ont été surpris avant d’avoir pu terminer leur travail. Pourtant, « il n’existe pas la moindre trace de leur fuite. Aucun indice, rien n’a été dérangé; il n’y a ni porte ni fenêtre ouverte, ni aucun bruit (p. 94) ».
Mais cette suite d’événements déconcertants, avec son absence d’indices intelligibles, fait aussi partie d’un mystère médical. Les médecins de Trelawny sont tout aussi perplexes que les enquêteurs de la police, lorsqu’il devient clair que l’état comateux de leur patient n’est dû ni à un coup sur la tête, ni à la perte de sang provoquée par la profonde blessure qu’il porte au poignet, et rien n’indique qu’il a pu être drogué ou hypnotisé. Ainsi que le fait remarquer l’un des médecins, l’inconscience de Trelawny « ne ressemble à aucun des nombreux cas de sommeil hypnotique que j’ai pu observer à l’hôpital Charcot de Paris (p. 51) ». La seule piste en faveur d’une résolution de l’énigme ou d’un diagnostic semble plutôt être à rechercher dans la vocation de Trelawny pour l’archéologie, ce qui suggérerait donc l’existence d’un étrange lien entre son coma énigmatique et les objets égyptiens qu’il a passé toute sa vie à collectionner. En effet, Trelawny apparaît comme bien autre chose qu’un simple thésauriseur et amateur d’antiquités égyptiennes : à la manière de Faust, il s’est lancé dans une dangereuse traque, celle des pouvoirs magiques contrôlant la vie et la mort, s’efforçant de retrouver les anciens arts mystiques de l’Égypte en faisant revenir à la vie une des adeptes de cet antique savoir, la reine Tera, une « femme [qui] excellait dans toutes les sciences de son époque (p. 195) ». Une fois réveillé, tout aussi mystérieusement qu’il avait perdu conscience, Trelawny reprend sa quête obsessionnelle, faisant de Malcolm Ross et de Margaret ses assistants. Et le point culminant du Joyau des Sept Étoiles ne sera rien moins qu’une résurrection minutieusement ritualisée et baptisée « La Grande Expérience » (p. 211).
Voici donc un roman baignant littéralement dans l’égyptomanie mais, en dépit de la riche culture ainsi déployée, l’Égypte y est traitée comme s’il émanait d’elle un esprit sinistre, s’emparant inexorablement des existences de tous ceux qui entrent en contact avec lui. (Dans la publicité pour la cassette vidéo de The Awakening, avec Charlon Heston et Stephanie Zimbalist, le film est présenté comme étant « dominé par une autre grande vedette dramatique : l’Égypte elle-même, l’Égypte éternelle… ») La plus grande partie de l’histoire reste confinée entre les murs de la demeure londonienne de Trelawny, là où « tant d’anciennes reliques » sont exposées « qu’on se retrouvait sans le vouloir transporté vers d’étranges contrées et d’étranges époques » et Margaret en arrive à avoir du mal à savoir si elle vit « dans une maison privée ou au British Museum (p. 55) ». Quand Malcolm découvre la maison dans la lumière grise de l’aube, il est tout de suite impressionné par sa taille, mais une fois à l’intérieur, le lecteur sent monter une sensation grandissante de claustrophobie alors que l’histoire commence à se refermer sur elle-même, devenant curieusement involutée et produisant « un mystère qui ne cesse de se dérouler pour mieux se refermer à nouveau sur lui-même12 ». Faisant au mieux tout juste office de foyer familial, la demeure de Trelawny fonctionne avant tout comme un mausolée ou une nécropole où des vigiles de minuit et d’inexplicables allées et venues sont presque des événements courants. Même Sir James Frere, le spécialiste médical sceptique, au « visage aussi grave et impénétrable que celui du sphinx », établit vite un rapport entre la catalepsie de Trelawny et sa collection de momies et d’ornements avant de prescrire sommairement de se débarrasser de tout cet « assemblage d’horreurs » (p. 80).
Dans les faits, la maison est transformée en un champ de force magique, en un lieu choisi pour le défi métaphysique opposant les pouvoirs de « l’ancien monde et [ceux] du nouveau (p. 230) »… En effet, la mise en scène finale de la résurrection de la reine Tera rappelle par bien des détails une grande séance de spiritisme au cours de laquelle les participants-enquêteurs doivent garder leurs yeux « fixés sur l’aspect scientifique des choses et attendre les développements à venir du côté psychique (p. 209) ». En même temps, la mystérieuse fusion entre les espaces domestique et sacré dans Le Joyau des Sept Étoiles a d’évidentes résonances kabbalistiques, évoquant à la fois le penchant de la Golden Dawn pour les mystérieuses religions égyptiennes et les cérémonies hiératiques qu’elle organisait derrière des portes closes à Marylebone ou à Camden Town… Cependant ces fils divergents ne sont jamais vraiment rattachés en fin de compte les uns aux autres et le roman reste suspendu de manière irritante entre les croyances et les pratiques d’un mysticisme de secte et celles du rationalisme scientifique, incapable de décider si tout se résoudra au moment ultime dans l’harmonie ou dans l’opposition entre ces deux points de vue. En dépit de l’enthousiasme de Brodie-Innes, Le Joyau des Sept Étoiles est loin de constituer une adhésion sans réserve à l’occultisme, qu’il aborde avec un mélange de crainte et de désespoir. Encadrée par les conventions littéraires du gothique edwardien, la narration de Malcolm Ross se développe sur un ton exploratoire, sa seule certitude étant celle de ses doutes et de ses peurs intimes. La question de savoir si les brèches épistémologiques qui criblent le roman peuvent être en partie comblées par des rêves d’une nouvelle cosmologie reste ouverte.
« Dans l’occultisme », écrit le critique marxiste de la culture Theodor Adorno, « l’esprit gémit sous son propre enchantement comme quelqu’un qui fait un cauchemar, et dont les tourments grandissent avec la sensation qu’il est en train de rêver sans pouvoir pour autant se réveiller13. » La condition de Malcolm Ross retourne même cette sinistre formulation comme un gant car les choses qu’il voit ont tout de « l’horreur d’un rêve à l’intérieur d’un autre », ceci combiné avec la conscience que ces perceptions font partie d’une façon ou d’une autre de sa réalité éveillée (p. 60). La maison et le rêve deviennent interchangeables, créant un monde intérieur scellé dans lequel l’ingérence de l’extérieur est reléguée au statut de simple bruit lointain, « le crissement occasionnel de roues, le cri d’un fêtard, l’écho éloigné des sifflets et le grondement des trains (p. 59) ». Ce retrait dans un sombre espace intérieur fait appel à un vocabulaire psychologique constamment changeant, de telle façon que le roman apparaît comme une succession d’états mentaux troublés et paniqués, passant de la vision et de la rêverie à la transe hypnotique et à l’accès cataleptique, pour finalement s’effondrer en une « indicible horreur (p. 273) ». Le déploiement de la notion « d’inconscience » est particulièrement révélateur, se référant, suivant le cas, au sommeil, aux gestes ou à la parole, et s’étendant sur toute la gamme des acceptions courante et spécialisée du terme, souvent incompatibles entre elles. La psychologie pratique de Malcolm Ross (reposant sur la pseudo-science du XIXe siècle appelée « physiognomonie ») lui permet soi-disant de juger « la personnalité des témoins […] par leurs gestes inconscients et leur comportement (p. 49) »; lors de ses moments les plus introspectifs, Malcolm Ross décrit son propre esprit comme une structure complexe de pensées et de voix se faisant concurrence entre elles, sans qu’aucune soit totalement formulée, avec la sensation permanente que « quelque autre pensée, plus sombre et plus profonde », se tient embusquée « derrière » ces propos à moitié entendus, une pensée « dont la voix n’a pas encore résonné (p. 85) ».
Comme c’était à prévoir, Stoker ne relie pas entre elles ces remarques éparses pour en tirer un exposé cohérent de la personnalité humaine. Au lieu de cela il surimpose une théorie de la psyché relevant de l’occulte égyptien — même si des préoccupations bien occidentales ne sont jamais loin. « Dans les anciennes croyances », nous dit-on, « l’être humain était divisé en plusieurs parties ». Citant le distingué égyptologue E. A. Wallis Budge, Abel Trelawny dessine une représentation à plusieurs faces du moi reposant sur une « division des fonctions, spirituelles et somatiques, éthérées et corporelles, idéales et réelles », permettant à « l’individu doué » de se déplacer librement au travers du temps, de l’espace et des corps (p. 202)… La plus puissante de ces forces est le « Ka » d’une personne, son « Double », le « principe actif » de la vie humaine, dont l’indépendance par rapport au corps physique crée les conditions préalables essentielles pour la résurrection de la reine Tera (p. 248).
Ainsi que Trelawny l’explique avec soin à sa fille, le « Ka » est « un fait admis par le mysticisme moderne » qui « a pris naissance dans l’Égypte antique (p. 202) ». L’accent mis sur le mot « moderne » est crucial, car les arcanes des époques passées sont ici légitimés par un recours aux formes de savoir contemporaines assez large pour inclure à la fois Sir Ernest Wallis Budge et l’Ordre Hermétique de l’Aube Dorée. L’idée de l’existence de personnalités multiples gagnait du terrain depuis les années 1870 et même un neurologue comme Charcot discutait de la dissociation du moi. Pour ceux qui s’intéressaient à des phénomènes comme la télépathie, les rêves prophétiques ou la métempsycose, comme par exemple les membres de la Society for Psychical Research, la notion de ce que Frederic W. H. Myers appelait « personnalité multiplex » était extraordinairement attirante. Dans les Proceedings de la Société, Myers arguait que le « caractère multiplex et variable de ce que nous connaissons comme la Personnalité de l’homme » ne devait pas être simplement considéré comme « pathologique », puisqu’on pourrait tirer avantage à « le définir et travailler sur lui en le considérant comme une modifiabilité encore non reconnue. » Ses phrases de conclusion proposaient une vue phylogénétique du moi qui plaide avec force pour la survivance de la personnalité au travers de dizaines de siècles décrite dans le roman de Stoker. Myers émettait l’hypothèse que « la toile des habitudes et des désirs, des appétits et des peurs » qui constituent nos sentiments les plus intimes pourrait éventuellement n’être rien d’autre que « le manteau que nos rudes ancêtres avaient eux-mêmes tissé pour se protéger de la tempête cosmique ». Si ce manteau pouvait « glisser de nos épaules au soleil, alors quelque chose de plus ancien et de plus radieux » pourrait être entrevu à nouveau, ne serait-ce que l’espace d’un instant14.
Selon les enseignements occultes, cette mutabilité ou multiplicité de la personnalité peut être contrôlée ou maîtrisée grâce à un exercice rigoureux de la volonté… Pareillement, Trelawny fait remarquer au cours de son exposé détaillé des croyances de l’Égypte ancienne que « toutes les possibilités et les capacités de transferts corporels », inhérentes au moi divisé sont « toujours dirigées par une volonté ou par une intelligence qui ne peuvent être enchaînées (p. 203) ». La magie égyptienne était seulement l’un des composants du renouveau de l’occulte à la fin de l’ère victorienne, mais conjuguée avec des idées et des pratiques tirées du rosicrucianisme et du bouddhisme, elle fut systématisée en un programme discipliné de rituels et d’initiations qui la vidèrent de la plus grande partie de son fatalisme originel. En démontrant la force que possédait le pouvoir de la volonté, la nécromancie égyptienne pouvait apparaître comme un frein bienvenu à l’inflation des explications psychologiques du comportement humain. Face aux travaux de David Ferrier sur la localisation des fonctions du cerveau ou les mesures des impulsions électriques du cœur de Sir John Burdon-Sanderson (des hommes dont les découvertes figurent dans les pages de Dracula), la volonté semblait être le dernier bastion de l’autonomie personnelle, et même de l’individualisme libéral — le point au-delà duquel aucune science matérialiste ne pouvait s’aventurer sans dommage. Pour une occultiste telle que Madame Blavatsky, la science moderne était de « la pensée ancienne déformée et rien de plus15 ». Guère étonnant alors, que là où la science semblait tendre vers « les aspects invisibles, « spirituels », de la nature et de l’expérience », comme dans certains des nouveaux développements de la physique et de la chimie, elle attirait rapidement une audience variée et enthousiaste16.
En négociant avec précaution sur ce terrain spéculatif, Le Joyau des Sept Étoiles paraît offrir quelque chose à tout le monde. Des illuminés comme Madame Blavatsky ou Aleister Crowley n’hésitaient jamais à s’approprier des textes populaires à leurs propres fins, quitte à les lire de travers si nécessaire — ce que firent Madame Blavatsky avec She de H. Rider Haggard et Crowley avec L’Étrange Cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Pour des occultistes tels que Brodie-Innes, Le Joyau des Sept Étoiles pouvait se lire comme une saga sur le pouvoir immuable des pratiques ésotériques et magiques, alors que pour celui qui s’intéressait à la spiritualité et au spiritisme, mais avec un esprit plus scientifique, Stoker semblait jeter un pont entre le savoir du passé et les données expérimentales du présent. Il est certain que le roman devient de plus en plus solennel au fur et à mesure qu’approche son dénouement. À un moment donné, Trelawny avance que l’humanité se trouve peut-être sur le point d’entrer dans une nouvelle ère, ayant atteint « ce stade de progrès intellectuel où la mécanique destinée aux découvertes est en train d’être inventée », pour nous permettre enfin de saisir la véritable « essence des choses (p. 215) ». Non seulement, l’astrologie allait être « acceptée sur une base scientifique (p. 214) », mais Trelawny s’attend à ce que les travaux sur les rayons de Röntgen et les propriétés du radium, les travaux des « Curie et Laborde, de Sir William Crookes et Becquerel » convergent avec « l’enquête égyptienne » pour faire surgir une nouvelle compréhension des « secrets de la lumière (p. 216) ». Cependant, en dépit de ces passages inspirés, le roman reste profondément désuni, incapable de soutenir la vision progressiste brillamment évoquée par Trelawny. Le final du Joyau des Sept Étoiles fait penser à « l’armaggedon magique » imaginé par Yeats dans les années 189017. Mais pourquoi cela ?
La source de la difficulté, et c’est souvent le cas dans les écrits de Stoker, se situe dans l’insistante question de la féminité : que veut une femme ? (Ou, plutôt, qu’est-ce que Stoker redoute qu’elle puisse vouloir ?) Dès le début, le désir de Malcolm Ross pour Margaret Trelawny, le point à partir duquel la question est posée, est présenté comme hanté par des sentiments de futilité et de crainte. Margaret apparaît d’abord comme « la jeune fille » dans un rêve, protégée « des ennuis bouleversants et les joies non moins bouleversantes du monde immense (p. 27) » (c’est moi qui souligne), mais ce rêve est immédiatement mis en pièces par le retour du monde extérieur sous la forme d’un appel à l’aide de la vraie Margaret. Malcolm dépeint ce réveil comme une sorte de signe de la Chute, car il le relie à l’impossibilité qu’il puisse exister « un repos complet », nous rappelant que « même dans l’Éden, le serpent relève sa tête parmi les rameaux chargés de fruits de l’Arbre de la Connaissance (p. 28) ».
De manière symptomatique, la présence bien vivante de Margaret louvoie entre le vulnérable et l’inquiétant. Dans l’une des premières descriptions, Malcolm s’émerveille de « la mystérieuse profondeur » de ses yeux qui sont « d’un noir velouté », mais ajoute que leur charme rappelle celui d’un « miroir noir tel que ceux utilisés par le Dr Dee au cours de ses rites sorciers (p. 49) ». Au cours du roman cette antinomie se durcit en « une étrange double existence », tandis que le moi précédent de Margaret commence à se retrouver voilé par une distance et une réserve soudaines, et lors de ces « évasions vers sa nouvelle personnalité (p. 238) », elle commence à faire preuve de l’inquiétante capacité à pouvoir prédire l’avenir « comme si elle avait eu une certaine conviction ou une connaissance des intentions du corps astral de la reine (p. 237) ». Bien que « toute la glorieuse beauté (p. 265) » du corps nu de la reine soit au-delà de toute représentation, littérairement et moralement parlant, les quelques aperçus qui nous en sont offerts montrent clairement que Margaret est bien son double et que, avant la résurrection de la souveraine, Margaret n’est pas « le moins du monde un individu, mais simplement un aspect de la reine Tera elle-même (p. 235) ». À la fin du roman, les yeux de Margaret étincellent « comme des soleils noirs (p. 270) ». Dans le texte original de 1903, elle est sacrifiée pour que puisse revivre la reine.
Alors que la personne de la reine Tera se dessine lentement, révélant graduellement ses contours et son histoire, ses apparitions sont accompagnées d’une spirale de violence qui s’intensifie régulièrement. Après les attaques contre Abel Trelawny chez lui, les flash-back se déroulant là où repose Tera dans sa tombe égyptienne, apportent des avertissements brutaux et explicites sur les dangers qu’il y a à fouiller la « fosse de la momie (p. 139) ». Avant même que le corps momifié de Tera ait été retiré de la « caverne des morts », l’explorateur hollandais du XVIIe siècle qui l’avait découverte éprouve « une paralysie momentanée » à l’instant où il fixe le fabuleux joyau rouge sang du titre du roman, serré dans la main merveilleusement conservée de la reine « surgissant des toiles d’embaumement ». Elle lui rappelle « la tête légendaire de la Méduse Gorgone, qui avait une chevelure de serpents dont la seule vue transformait en pierre ceux qui la regardaient (p. XX, 141) ».
Trelawny reste inflexible sur un point : le but de sa « Grande Expérience » est de redécouvrir des sciences perdues depuis longtemps. Mais lorsque Malcolm Ross affirme que le « grand enjeu » de l’entreprise de l’égyptologue est « la résurrection de la femme, et la vie de la femme (p. 241) », il met le doigt sur une vérité importante. Car dans la magie égyptienne, le savoir est non seulement une forme de pouvoir, mais il est aussi personnifié par une forme d’expertise singulièrement individuelle. Dans ses combats contre « l’ambition des prêtres », la reine Tera « avait surpassé ses professeurs » et « avait, par d’étranges moyens, arraché à la Nature ses secrets (p. 156) »… Cependant, la consolidation de ses pouvoirs avait eu pour effet de remettre sa féminité en question. Il est très instructif de constater que dans l’esprit de Tera, pour représenter le triomphe de la féminité dans un monde d’hommes, sa domination doit être conçue comme un jeu à somme nulle, émasculant ses adversaires : « tout en étant une reine », elle avait « réclamé tous les privilèges de la royauté et de la masculinité (p. 156) ».
Ce qui rend si remarquable le pouvoir de la reine Tera aux yeux de Trelawny, c’est le statut inférieur et les limites imposées aux femmes dans la société de l’Égypte antique. Lorsque Margaret s’élève contre l’idée que le corps de la reine ait pu être dévêtu par un groupe d’hommes, il insiste sur le fait que les embaumeurs originels ne pouvaient être que des hommes car il n’y avait ni « les droits de la femme ni les femmes médecins dans l’Égypte antique, ma chérie ! (p. 260) » Cette référence appuyée rappelle la propre ambivalence de Stoker, susceptible de se muer quelquefois en hostilité déclarée, face aux exigences des femmes pour une émancipation sociale et politique dans une période d’agitation féministe grandissante. Dans son dernier roman, Le Repaire du ver blanc (1911), par exemple, il identifie la monstrueuse Lady Arabella March avec « l’absence de principe d’une suffragette ». Cependant, la remarque de Trelawny glisse sur le fait que l’égyptologie du XIXe siècle était loin d’être isolée des débats sociaux de l’époque. La force des traditions matrilinéaires dans la civilisation égyptienne offrait un contraste provoquant avec l’Angleterre contemporaine, et entre les mains d’Amelia Edwards, fondatrice de l’Egypt Exploration Fund et l’une des vulgarisatrices les plus populaires de l’égyptologie, de nouvelles découvertes pouvaient devenir autant d’avantages dans la polémique. Dans son exposé sur « La position sociale et politique de la femme dans l’Égypte antique » (vers 1890), Edwards utilise le règne de la reine Hatshepsout comme un cas d’étude sur la manière par laquelle une femme pouvait exercer le pouvoir et démontrer sa supériorité sur un homme. En soulignant le statut généralement élevé des femmes égyptiennes, Edwards dessine un portrait de la reine Hatshepsout qui supporte la comparaison avec celui de la reine Tera par Stoker. Les deux femmes sont décrites quelquefois habillées en homme, toutes deux sont des chefs et des conquérants à qui l’on attribue des pouvoirs divins, et elles sont présentées comme des savants (selon Edwards, Hatshepsout aurait été la première à concevoir l’idée du canal de Suez — « la grande femme-Pharaon » n’est rien moins que « l’ancêtre scientifique de M. de Lesseps18 »). Et dans les deux cas, Stoker et Edwards distinguent leurs reines en soulignant que leur apparence est plus européenne qu’orientale — « c’était comme une statue sculptée dans l’ivoire par la main d’un Praxitèle (p. 265) ».
Mais les ressemblances s’arrêtent là. Dans le roman de Stoker, l’enchantement du héros face à la vision d’une « femme merveilleusement énergique (p. 110) » se mêle avec une menace de mort et de destruction. Ainsi, juste avant que Trelawny et ceux qui l’accompagnent ne jettent un coup d’œil honteux au corps « complètement nu » de la reine Tera — à l’exception de son visage recouvert (p. 264) — Malcolm Ross se sent soudainement emporté par le sentiment que « tout le côté matériel et sordide de la mort (nous) apparaissait comme affreusement réel (p. 262) ». Dans son alternance entre sa vénération pour Margaret et sa terreur de la reine Tera, la narration de Ross tente désespérément, suivant les mots de Freud, d’isoler les « effets horrifiants » de la féminité, associés à la « vue des organes génitaux », de « ceux qui procurent du plaisir » — tout comme les hommes dans le roman en viennent à être divisés entre les survivants et les morts19. Une suite de substitutions s’enchaîne au cours de l’histoire, passant du joyau rouge sang à la main tranchée et sanglante de la momie, au corps blanc de la reine et à la silhouette de Margaret, se tenant « toute droite (p. 110) » de manière frappante. Chaque substitution nous rapproche un peu plus de la mort. Le voile d’embaumement de la reine Tera se révèle être sa robe de mariée, mais il n’y a pas vraiment de distinction entre les deux.
En 1912, l’année de la mort de Stoker, parut une version révisée et abrégée du Joyau des Sept Étoiles qui se concluait par le mariage de Margaret avec Malcolm. Les critiques sont en désaccord sur la question de savoir si cette nouvelle fin était ou non de Stoker. Dans les derniers mois de sa vie, celui-ci était extrêmement malade et il n’existe aucune preuve directe permettant d’affirmer qu’il a procédé lui-même à ces changements. Et l’on sait que plusieurs de ses livres ont été retouchés et en partie réécrits à l’occasion de leur réédition, peu de temps après sa mort. En revanche, la quantité de texte nouveau est peu importante et l’on a pu établir avec certitude que Stoker était prêt à couper ou à modifier drastiquement ses œuvres si cela pouvait assurer leur publication — on sait par exemple que suite au refus d’un éditeur, il changea radicalement la fin de son roman historique Miss Betty (1898) pour l’achever sur une touche plus optimiste. Mais dans le cas du Joyau des Sept Étoiles, la majeure partie de la fin de 1912 se trouve déjà implicitement dans la conclusion originale de 1903, en tant que simple inversion de celle-ci, si bien que la question de savoir si Stoker l’a écrite ou non est finalement sans objet. Au lieu de subsumer Margaret sous le flot d’énergie destructive de Tera, l’édition de 1912 fait s’absorber Tera dans la spiritualité supérieure de Margaret. Donc Margaret devient la reine de Malcolm et le roman retourne au monde des rêves où il avait débuté. Chacune de ces représentations de la femme passe dans l’autre et il n’existe ici aucun conflit réel, car ainsi que l’a observé Jacqueline Rose dans un autre contexte (mais pas totalement dépourvu de rapport avec celui-ci), « l’idéalisation et l’agression sont les deux faces opposées et complètement solidaires de la même pièce de monnaie20 ».
Parmi le texte coupé dans la version de 1912 figure le chapitre le plus excessivement conjectural du roman original, intitulé « Pouvoirs anciens et nouveaux »… Ici les espoirs optimistes de progrès scientifique de Trelawny se retrouvent dos à dos avec les ruminations manichéennes découragées de Malcolm Ross. Là où Trelawny considère son travail expérimental comme une réconciliation de l’enseignement biblique avec le savoir scientifique dans le but de créer un maître discours englobant tout, Malcolm se demande s’il y a
« la place dans l’Univers pour des Dieux qui s’opposent, ou, si c’était le cas, les plus forts permettraient-ils des manifestations de puissance de la part de la Force adverse qui tendraient vers l’affaiblissement de ses propres enseignements et desseins (p. 214) ».
Les théories « scientifiques ou pseudo-scientifiques » de Trelawny détournent un instant l’esprit de Malcolm des « rêveries sur les mystères de l’occulte (p. 218) », mais, une fois encore, ces conjectures échevelées ne sont que les extrêmes diamétralement opposés d’un seul continuum imaginatif, dans la mesure où les idées de Trelawny sont inspirées elles aussi par les mêmes mystères occultes.
Parvenus à ce point, nous avons fait un long voyage depuis « le pays des faits (p. 62) » où le sec intellect d’homme de loi incarné par Malcolm se sent plus à son aise. Si les noms des grands savants comme Sir William Crookes sont invoqués avec excitation, c’est davantage pour permettre des envols de l’imagination que pour ramener le lecteur sur la terre ferme de la certitude scientifique. Et l’atmosphère de séance de spiritisme entourant la « Grande Expérience » de Trelawny rappelle la popularité du spiritisme comme terrain de médiation à la fin du XIXe siècle entre la religion et la science, ou tout au moins les branches les plus éthériques de la physique moderne. Comme « le simple et solide cosmos des rationalistes victoriens » se dématérialisait dans le monde moins substantiel du radium et des rayons X, les savants edwardiens pouvaient être comparés aux « noceurs dans Le Masque de la Mort Rouge […] qui poursuivent l’intrus fantôme d’une pièce à l’autre pour finalement le coincer et lui arracher son masque » et ne rien trouver du tout derrière celui-ci21. En fin de compte, Le Joyau des Sept Étoiles apporte peut-être le contrechamp manquant de cette image désolée : la vue d’une femme morte cachant son visage de ses mains, « le regard vitreux de ses yeux entre ses doigts […] plus terrible qu’un regard à découvert (p. 274) ».
DAVID GLOVER
1. « An Egyptian Mystery », The New York Times Saturday Review of Books, 5 mars 1904, p. 157.
2. « New Books and Reprints », The Times Literary Supplement, 6 novembre 1903, p. 323.
3. Carol A. Senf, introduction à The Critical Response to Bram Stoker, Wesport, Ct., 1993, p. 18.
4. G. W. F. Hegel, Leçons sur la Philosophie de l’Histoire, 1837.
5. W. R. W. Wilde, Narrative of a Voyage, Dublin, 1840, p. 47.
6. « Harpers Book News », The New York Times Saturday Review of Books, 5 mars 1904, p. 155.
7. Lettre de J. W. Brodie-Innes à Stoker du 29 novembre 1903, Collection Brotherton, université de Leeds.
8. Ellic Howe, The Magicians of the Golden Dawn : a Documentary History of a Magical Order 1887-1923, Londres, 1972, p. 285.
9. Voir Christopher Frayling, Vampyres : Lord Byron to Count Dracula, Londres, 1991, p. 308.
10. Bram Stoker, The Lady of the Shroud, 1909, p. 53. Ce roman a été — très — adapté en français : La Dame au Linceul, Arles : Actes Sud, « Babel ; 181 ; Les Fantastiques », 1996. (N.d.l’É.)
11. William Crookes, « Radiant Matter », British Association for the Advancement of Science Reports, 1879, p. 167.
12. « Harpers Book News », The New York Times Saturday Review of Books, 19 mars 1904, p. 189.
13. Theodor Adorno, Minima Moralia : Réflexions sur la vie mutilée, Payot, 1980.
14. Frederic W. H. Myers, « Multiplex Personality », Proceedings of the Society for Psychical Research 4, 1886, p. 496 et 514.
15. Madame Blavatsky, citée dans Richard Ellman, Yeats : the Man and the Masks, Oxford, 1979, p. 56.
16. Brian Wynne, « Physics and Psychics : Science, Symbolic Action, and Social Control in Late Victorian England » in Barry Barnes et Steven Shapin (eds.), Natural Order : Historical Studies of Scientific Culture, Beverly Hills, Ca., 1979, p. 176.
17. Lettre non datée à Florence Farr, in Clifford Bax (ed.), Florence Farr, Bernard Shaw, W. B. Yeats : Letters, New York, 1942, p. 51. De toute évidence, Yeats croyait qu’une telle catastrophe allait préfigurer une renaissance spirituelle, mais ce n’est pas vraiment là la substance du roman de Stoker.
18. Cette phrase est tirée de Amelia B. Edwards, Pharaohs, Fellahs and Explorers, New York, 1891, p. 281 où l’auteur atténue considérablement sa thèse féministe. Pour une excellente relation de l’exposé — inédit en volume — d’A. B. Edwards, voir Billie Melman, Women’s Orients : English Women and the Middle-East 1718-1918, Ann Arbor, Mich., 1992, p. 264-69.
19. Sigmund Freud, « Medusa’s Head » (1922) in James Strachey (ed.), The Standard Edition of the Complete Psychological Works 18, Londres, 1955, p. 273-274.
20. Jacqueline Rose, The Haunting of Sylvia Plath, Londres, 1991, p. 151.
21. Esmé Wingfield-Stratford, The Victorian Aftermath 1901-1914, Londres, 1933, p. 130-131.
BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
BIBLIOGRAPHIE
Dalby, Richard,Bram Stoker : A Bibliography of First Editions, Londres, 1983.
BIOGRAPHIES, SOUVENIRS
Belford, Barbara,Bram Stoker : His Life and Times, New York, 1996.
Farson, Daniel,The Man Who Wrote Dracula : a Biography of Bram Stoker, Londres, 1975.
Ludlam, Harry,A Biography of Dracula : the Life Story of Bram Stoker, Londres, 1962. Réédité sous le titre de A Biography of Bram Stoker : Creator of Dracula, Londres, 1977.
Pozzuoli, Alain,Bram Stoker, prince des Ténèbres, Paris, 1989.
Shepard, Leslie,Bram Stoker : Irish Theatre Manager and Author, Dublin, 1994.
Stoker, Bram,Personal Reminiscences of Henry Irving, 2 vol., Londres, 1906, édition révisée, 1907.
ÉTUDES CRITIQUES
Carter, Margaret L. (ed.), Dracula : the Vampire and the Critics, Ann Arbor, Michigan, 1988.
Gelder, Ken,Reading the Vampires, Londres, 1994.
Glover, David,Vampires, Mummies and Liberals : Bram Stoker and the Politics of Popular Fiction, Durham, NC, 1996.
Halberstam, Judith, « Technologies of Monstrosity : Bram Stoker’s Dracula », in Victorian Studies 36, printemps 1993, p. 333-52.
Hughes, William,Beyond Dracula : Bram Stoker’s Fiction and its Cultural Context, Basingstoke, 2000.
Hughes, William & Andrew Smith (eds.), Bram Stoker : History, Psychoanalysis and the Gothic, Basingstoke, 1998.
Rickels, Lawrence A., « Mummy’s Curse », in The American Journal of Semiotics 9, 1992, p. 47-58.
Roth, Phyllis A.,Bram Stoker, Boston, 1982.
Schaffer, Talia, « A Wild Desire Tooks Me : the Homoerotic History of Dracula », in ELH 61, été 1994, p. 381-425.
Senf, Carol A. (ed.), The Critical Response to Bram Stoker, Westport, Ct., 1993.
ÉTUDES GÉNÉRALES
Barreca, Regina (ed.), Sex and Death in Victorian Literature, Londres, 1996.
Chrisman, Laura, « The imperial unconscious ? Representations of imperial discourse », Critical Quarterly, 32, automne 1990, p. 38-58.
Daly, Nicholas, « That Obscure Object of Desire : Victorian Commodity Culture and Fictions of the Mummy », Novel, 28, automne 1994, p. 24-51.
Lant, Antonia, « The Curse of the Pharaoh, or How Cinema Contracted Egyptomania », October, 59, hiver 1992, p. 87-112.
Lowe, Lisa,Critical Terrains : French and British Orientalism, Ithaca, NY, 1991.
Owen, Alex,The Darkened Room : Women, Power and Spiritualism in Late Victorian England, Londres, 1989.
Reed, John R.,Victorian Will, Athens, Oh., 1989.
Showalter, Elaine,Sexual Anarchy : Gender and Culture at the Fin de Siècle, New York, 1990.
Valente, Joseph,Dracula’s Crypt : Bram Stoker, Irishness, and the Question of Blood, Urbana & Chicago, 2002.
Note de l’éditeur
Cette préface a été publiée pour la première fois en Angleterre en tête de la réédition de l’édition intégrale du Joyau des Sept Étoiles, parue dans la collection « Oxford Popular Fiction » (Londres, New York : Oxford University Press, 1996). Nous remercions son auteur, David Glover, de nous avoir autorisés à la reproduire, et d’avoir actualisé les différentes rubriques bibliographiques.
Pour Eleanor et Constance Hoyt1
1. Deux jeunes Américaines que Bram Stoker avait rencontrées un peu avant d’avoir terminé Le Joyau des Sept Étoiles. Elinor (et non Eleanor) Hoyt deviendra par la suite une romancière connue sous le nom d’Elinor Wylie (1885-1928). (N.d.T.)
CHAPITRE PREMIER
UN APPEL DANS LA NUIT
Tout cela paraissait si réel que j’avais peine à imaginer que cela se soit produit antérieurement et cependant, chaque épisode survenait, non pas comme une étape nouvelle dans l’enchaînement logique des faits, mais comme une chose à laquelle on s’attend. C’est de cette façon que la mémoire joue ses tours pour le bien ou pour le mal, pour le plaisir ou pour la douleur, pour le bonheur ou pour le malheur. C’est ainsi que la vie est un mélange de douceur et d’amertume et que ce qui a été devient éternel.
De nouveau, le léger esquif, cessant de fendre les eaux tranquilles comme lorsque les avirons brillaient et ruisselaient d’eau, quitta le violent soleil de juillet pour glisser dans l’ombre fraîche des grandes branches de saules qui retombaient — j’étais debout dans le bateau qui oscillait, elle était assise immobile et, de ses doigts agiles, elle écartait les branches égarées, se protégeait des libertés que prenaient les rameaux sur notre passage. De nouveau, l’eau paraissait être d’un brun doré sous le dôme de verdure translucide, et la rive était recouverte d’une herbe couleur d’émeraude. De nouveau, nous étions là dans l’ombre fraîche, avec les mille bruits de la nature se produisant à l’intérieur et à l’extérieur de notre retraite, se fondant dans ce murmure somnolent qui fait oublier les ennuis bouleversants et les joies non moins bouleversantes du monde immense. De nouveau, dans cette solitude bénie, la jeune fille oubliant les conventions de son éducation première rigoriste, me parla avec naturel et sur un ton rêveur de la solitude qui assombrissait sa nouvelle existence. Elle me fit ressentir, avec une grande tristesse, comment dans cette vaste maison chaque personne se trouvait isolée du fait de la magnificence de son père et de la sienne, car, en ces lieux, disait-elle, la confiance n’avait pas d’autel, la sympathie pas de sanctuaire. Le visage de son père paraissait aussi lointain que semblait à présent lointaine la vie du vieux pays. Une fois de plus, la sagesse d’homme et l’expérience recueillie par moi au long des années étaient mises aux pieds de la jeune fille. Apparemment d’elles-mêmes, car moi, en tant qu’individu je n’avais pas voix au chapitre, je devais simplement obéir à des ordres impératifs. Et, une fois de plus, les secondes recommencèrent à s’enfuir en se multipliant indéfiniment. Car c’est dans les arcanes des rêves que les existences se fondent et se renouvellent, changent tout en restant semblables à elles-mêmes, comme l’âme d’un musicien dans une fugue. Et ainsi les souvenirs s’évanouissent, sans cesse, dans le sommeil.
Il semble qu’il ne puisse jamais exister de repos parfait. Même dans l’Éden, le serpent relève sa tête parmi les rameaux chargés de fruits de l’Arbre de la Connaissance. Le silence de la nuit sans rêves est brisé par le rugissement de l’avalanche, le bruissement de soudaines pluies torrentielles, le résonnement de la cloche d’une locomotive soulignant sa course à travers une ville américaine endormie, le bruit sec de roues à aube au loin sur la mer… Quoi que ce soit, cela brise le charme de mon Éden. Le dôme de verdure au-dessus de nous, piqueté de points de lumière ressemblant à des diamants, semble frémir sous l’effet des battements sans fin des roues à aube, et la cloche fiévreuse paraît ne plus vouloir cesser de sonner…
Immédiatement les portes du sommeil s’ouvrirent toutes grandes, et tandis que je m’éveillais, mes oreilles saisirent la cause de ces bruits qui m’avaient dérangé. La vie à l’état de veille est assez prosaïque — il y avait quelqu’un qui frappait et qui sonnait à une porte d’entrée.
Je m’étais tout à fait habitué aux bruits passagers dans mon étude de Jermyn Street ; d’habitude, je ne me préoccupais aucunement, que je dorme ou pas, des activités de mes voisins, aussi peu discrètes fussent-elles. Mais ce bruit-là était trop continu, trop insistant, trop impératif pour rester ignoré. Il y avait une intelligence en activité derrière ce bruit sans fin, et une tension ou un besoin derrière cette intelligence. Je n’avais rien non plus d’un égoïste, et à la pensée que quelqu’un puisse avoir besoin d’aide, je sautai sans plus réfléchir hors de mon lit. Je jetai instinctivement un regard à ma montre. Il était juste trois heures du matin et il y avait un mince liséré gris autour du store vert qui plongeait ma chambre dans l’ombre. Il était évident que ces coups frappés et cette sonnerie se situaient à la porte de notre maison, et il était également sûr qu’il n’y avait personne d’éveillé pour répondre à cet appel. J’enfilai ma robe de chambre et mes pantoufles et descendis jusqu’à la porte d’entrée. Quand je l’ouvris, je trouvai là un groom pimpant qui d’une main pressait avec impassibilité le bouton de la sonnette tandis que de l’autre il faisait fonctionner sans relâche le marteau de la porte. Dès qu’il me vit, le bruit cessa ; il porta instinctivement une main au bord de son chapeau, et de l’autre, sortit une lettre de sa poche. Un élégant brougham stationnait devant ma porte, les chevaux paraissaient essoufflés, comme s’ils étaient venus très vite. Un policeman, dont la lanterne de nuit, accrochée à son ceinturon, était encore allumée, avait été attiré par le bruit et restait dans les environs.
– Je vous demande pardon, monsieur, je suis désolé de vous déranger, mais j’ai reçu des ordres formels. Je ne devais pas perdre un instant, il fallait que je frappe et que je sonne jusqu’à ce qu’on vienne. Puis-je vous demander, monsieur, si Mr Malcolm Ross demeure ici ?
– Je suis Mr Malcolm Ross.
– Alors, cette lettre est pour vous, monsieur, et cette voiture est aussi pour vous !
Je pris, avec une vive curiosité, la lettre qu’il me tendait. En temps qu’avocat, j’avais déjà connu bien sûr des expériences plutôt bizarres, y compris des requêtes imprévues durant mes heures de travail, mais jamais rien de ce genre. Je rentrai dans le vestibule, en tirant la porte, mais en la laissant entrebâillée. Puis, je donnai de la lumière électrique. La lettre était d’une écriture inconnue, mais féminine. Elle commençait en ces termes, sans préambule du genre « cher monsieur » :
Vous m’avez dit que vous me viendriez volontiers en aide en cas de besoin, et je suis persuadée que vous étiez sincère. L’occasion se présente plus tôt que je ne m’y attendais. Je suis plongée dans d’affreux ennuis, je ne sais de quel côté me tourner, à qui m’adresser. On a, je le crains, essayé de tuer mon père ; cependant, Dieu merci, il est toujours vivant. Mais il est complètement inconscient. On a fait venir des médecins et la police, mais il n’y a personne en qui je puisse avoir confiance. Venez immédiatement, si cela vous est possible, et pardonnez-moi si vous le pouvez.Je suppose que je me rendrai compte plus tard de ce que j’ai fait en vous demandant pareil service, mais pour l’instant, je ne peux penser à rien. Venez ! Venez tout de suite !
Margaret Trelawny
À mesure que je lisais cette lettre, le chagrin et l’exultation étaient entrés en conflit dans mon esprit. Mais ma pensée dominante était celle-ci : elle était dans les ennuis et elle m’avait appelé — moi ! Ce n’était donc pas sans raison que j’avais rêvé d’elle. J’appelai le groom :
– Attendez-moi. Je suis à vous dans un instant. Puis je me précipitai dans l’escalier.
Il me fallut à peine quelques minutes pour faire ma toilette et m’habiller, et bientôt, nous allions par les rues aussi vite que les chevaux pouvaient nous emmener. C’était un matin de marché, et quand nous sortîmes sur Piccadilly, il y avait un flot ininterrompu de charrettes venant de l’ouest, mais sur le reste du parcours la route était libre, et nous allâmes promptement. J’avais dit au groom de venir avec moi à l’intérieur du coupé pour qu’il puisse, pendant le parcours, me mettre au courant de ce qui s’était passé. Il était assis assez gauchement, son chapeau sur les genoux, et il me raconta.
– Miss Trelawny a envoyé un domestique pour nous dire de sortir immédiatement une voiture. Quand nous avons été prêts, elle est venue elle-même, elle m’a donné la lettre et elle a dit à Morgan — le cocher — d’aller aussi vite que possible. Elle a dit, monsieur, que je ne devais pas perdre une seconde, et qu’il me fallait frapper sans interruption jusqu’à ce qu’on vienne.
– Oui, je sais, je sais… vous me l’avez déjà dit ! Ce que je voudrais savoir, c’est la raison pour laquelle elle me fait demander. Qu’est-il arrivé dans la maison ?
– Je ne sais pas très bien moi-même, monsieur, sauf que notre maître a été trouvé sans connaissance dans sa chambre, avec ses draps couverts de sang. Jusqu’ici on n’a pas encore pu le réveiller. C’est Miss Trelawny qui l’a trouvé.
– Comment se fait-il qu’elle l’ait découvert à une pareille heure ? C’était au milieu de la nuit, je suppose ?
– Je ne sais pas, monsieur. Je n’ai absolument pas entendu parler des détails.
Comme il ne pouvait m’en apprendre plus, je fis arrêter la voiture un instant pour le laisser sortir et monter sur le siège du cocher, puis je profitai d’être seul pour tourner et retourner cette histoire dans mon esprit. Il y avait bien des choses que j’aurais pu demander au domestique et l’espace un bref instant, après son départ, je m’en voulus de ne pas avoir profité de l’occasion. Mais à y repenser, je fus heureux de n’avoir pas cédé à cette tentation. Je compris qu’il serait bien plus délicat de ma part d’apprendre ce que je désirais connaître de l’entourage de Miss Trelawny de sa bouche même plutôt que de celle de ses domestiques.
Nous roulions rapidement sur Knightsbridge ; le bruit discret que faisait ce véhicule bien entretenu troublait à peine la quiétude de l’air matinal. Nous remontâmes Kensington Palace Road et nous nous arrêtâmes bientôt devant une grande maison située entre le côté gauche, plus près, d’après ce que je pus en juger, de l’extrémité de l’avenue correspondant à Notting Hill que de celle qui correspond à Kensington. C’était une maison vraiment belle, non seulement par ses dimensions, mais encore par son architecture. Elle paraissait très vaste, même à la lumière grisâtre du petit matin, qui a tendance à diminuer la taille des choses.
Miss Trelawny m’accueillit dans le hall. Elle n’était pas le moins du monde timide. Elle paraissait tout diriger autour d’elle avec une sorte d’autorité due à sa grande naissance, d’autant plus remarquable qu’elle était très énervée et pâle comme la neige. Dans le grand vestibule se trouvaient plusieurs domestiques, les hommes groupés près de la porte, les femmes se rassemblant dans les coins éloignés et les embrasures des portes. Un officier de police était en train de parler à Miss Trelawny ; deux hommes en uniforme et un autre en civil se tenaient près de lui. Quand elle me prit la main dans un mouvement plein de spontanéité, ses yeux eurent un regard exprimant le soulagement et elle poussa un léger soupir tout aussi tranquille. Elle m’accueillit par une phrase simple :
– Je savais que vous viendriez !
Le serrement d’une main peut signifier beaucoup, même s’il n’a pas l’intention d’avoir un sens particulier. La main de Miss Trelawny se perdit dans la mienne. Ce n’était pas en raison de sa petite taille — elle était jolie et souple, avec de longs doigts délicats : une main rare et belle — non, c’était une forme d’abandon inconscient. Et même si sur l’instant, je ne me préoccupai guère de l’origine du frisson qui me traversa alors, cela me revint plus tard.
Elle se retourna pour dire au policier :
– Vous connaissez Mr Malcolm Ross ?
– Je connais Mr Malcolm Ross, répondit l’officier de police en saluant. Il se rappellera peut-être que j’ai eu l’honneur de travailler avec lui dans l’affaire de Brixton Coining.
Je ne l’avais pas reconnu tout d’abord, car toute mon attention était accaparée par Miss Trelawny.
– Bien sûr, commissaire Dolan, je me rappelle très bien ! dis-je.
Et nous nous serrâmes la main. Impossible de ne pas voir combien Miss Trelawny semblait soulagée que nous nous connussions. Il y avait dans son comportement un vague malaise qui retint mon attention. Je sentis instinctivement que ce serait moins embarrassant pour elle de me parler en tête à tête. Si bien que je dis au commissaire :
– Il sera peut-être préférable que Miss Trelawny me voie seul pendant quelques minutes. Vous avez, naturellement, déjà entendu tout ce qu’elle sait, et je comprendrai mieux la situation si je puis poser quelques questions. Je reverrai ensuite toute la situation avec vous, si vous le permettez.
– Je serai heureux de vous apporter tout le concours dont je serai capable, monsieur, répondit-il avec chaleur.
Je suivis Miss Trelawny, entrai dans une pièce coquettement meublée qui donnait sur le vestibule et avait vue sur le jardin situé derrière la maison. Quand nous fûmes entrés et quand j’eus refermé la porte, elle dit :
– Je vous remercierai plus tard de la bonté que vous m’avez témoignée en venant m’assister dans mes ennuis, mais dès à présent, vous pourrez mieux me venir en aide quand vous connaîtrez les faits.
– Allez-y, lui dis-je. Dites-moi tout ce que vous savez et ne me faites grâce d’aucun détail, si insignifiant qu’il puisse vous paraître en ce moment.
Elle continua immédiatement :
– J’ai été réveillée par un bruit ; je ne savais pas ce que c’était. Je savais seulement que je l’entendais dans mon sommeil, car immédiatement après je me trouvai réveillée, le cœur battant la chamade, et je tendais anxieusement l’oreille à un bruit qui venait de la chambre de mon père. Ma chambre est contiguë de la sienne et je peux souvent l’entendre bouger avant de m’endormir. Il travaille tard, quelquefois même extrêmement tard, si bien que lorsque je m’éveille de bonne heure, comme cela m’arrive de temps en temps, ou bien dans la grisaille de l’aube, je l’entends encore bouger. J’ai essayé une fois de lui faire des remontrances pour rester éveillé si tard, car cela ne peut pas être bon pour lui, mais je n’ai jamais renouvelé cette tentative. Vous savez à quel point il peut être froid et dur — du moins vous vous rappelez peut-être ce que je vous en ai dit, et quand il reste calme dans ces moments-là, il peut être terrifiant. Quand il est en colère, je le supporte beaucoup mieux, mais quand il parle avec lenteur et sang-froid, quand les coins de sa bouche se soulèvent pour laisser apparaître des dents pointues, il me semble que… eh bien ! je ne sais pas, moi ! La nuit dernière, je me suis levée sans bruit et je me suis approchée de la porte, car j’avais réellement peur de le déranger. Je n’entendais rien bouger, aucun cri, mais seulement le bruit que ferait quelque chose qu’on traîne et une respiration lente et difficile. Oh ! c’était terrible d’attendre là dans l’obscurité et le silence, en craignant… en craignant je ne savais quoi !
« J’ai fini par prendre mon courage à deux mains1




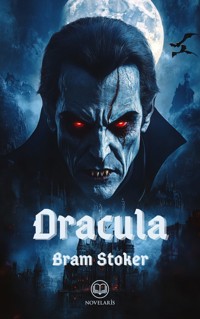

![DRACULA by Bram Stoker [2025 Kindle Edition] - The #1 Classic Vampire Horror Novel that Inspired Nosferatu | FREE with Kindle Unlimited - Bram Stoker - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/1519075e598819811bf5aaf3b61c7775/w200_u90.jpg)