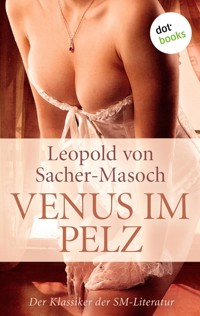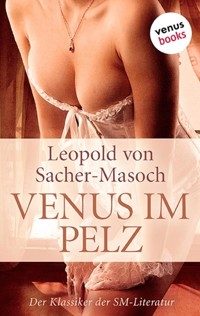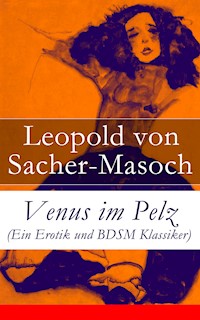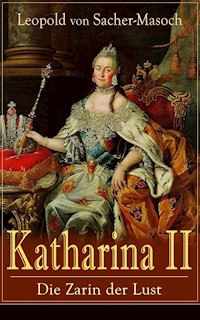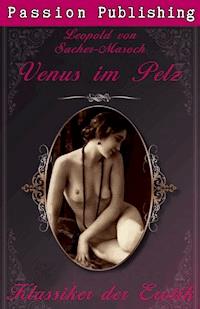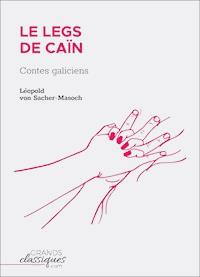
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GrandsClassiques.com
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Aventures amoureuses dans lesquelles se mêlent sensualité et puissance.
POUR UN PUBLIC AVERTI. Ayant vécu en Galicie, Léopold von Sacher-Masoch possède une bonne connaissance des coutumes de cette région d'Europe Centrale, nées du mélange des peuples polonais, petits-russiens, allemands et juifs, en lutte continuelle pour des questions de classe et de nationalité. L'auteur nous livre cinq histoires d'amour tourmentées et malheureuses, construites autour des événements ayant ébranlé la région, tels la peste de 1830 ou la Révolution polonaise de 1846.
Une série de récits romanesques ancrés dans le XIXe siècle, par l'initiateur de la littérature classique masochiste.
EXTRAIT DE
FRINKO BALABAN
Celui qui, porté par un frêle esquif, glisse sur la mer calme et sereine, laissant l’élément liquide jouer avec lui, pendant que les contours diffus des côtes s’évanouissent peu à peu dans un voile de brume et que son regard rêveur sonde l’océan aérien au-dessus de lui, celui-là me comprendra peut-être quand je parle de la plaine galicienne, de cet océan de neige à travers lequel vous emporte en hiver le traîneau fugitif. Comme l’onde, la plaine attire l’âme et la pénètre d’une mélancolique langueur. Pourtant l’allure du traîneau est vive et leste comme le vol de l’aigle, tandis que la barque roule dans l’eau comme le canard qui s’enlève pesamment. La couleur aussi de la plaine sans bornes est plus sombre, et son langage plus morne, plus menaçant ; c’est la nature implacable qui s’y montre sans voiles, et la mort y semble plus près de vous, elle vous effleure du bout de son aile, on entend frémir dans l’air ses mille voix.
La clarté transparente d’une après-midi d’hiver m’avait séduit ; ma résolution était prise d’en profiter.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Léopold von Sacher-Masoch (1836-1895) est un écrivain et historien né en Autriche et aux origines cosmopolites. Son œuvre est principalement constituée de contes nationaux et de romans historiques regroupés en cycles. Il s'y trouve généralement une héroïne dominatrice ou sadique, et le sens narratif vient des légendes et histoires du folklore slave, ayant bercé d'enfance de l'auteur. Le terme « masochisme » est forgé à partir du patronyme de Sacher-Masoch par le psychiatre Krafft-Ebing dans
Psychopathia Sexualis (publié en 1886), et est considéré par celui-ci comme une pathologie. Pour Gilles Deleuze, qui a analysé et popularisé l'auteur, son œuvre est pornologique, car projetant la pornographie dans le champ philosophique.
À PROPOS DE LA COLLECTION
Retrouvez les plus grands noms de la littérature érotique dans notre collection
Grands classiques érotiques.
Autrefois poussés à la clandestinité et relégués dans « l'Enfer des bibliothèques », les auteurs de ces œuvres incontournables du genre sont aujourd'hui reconnus mondialement.
Du Marquis de Sade à Alphonse Momas et ses multiples pseudonymes, en passant par le lyrique Alfred de Musset ou la féministe Renée Dunan, les
Grands classiques érotiques proposent un catalogue complet et varié qui contentera tant les novices que les connaisseurs.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L’Errant
Nos fusils sur l’épaule, nous marchions avec précaution, le vieux garde et moi, dans la forêt vierge qui étale ses masses noires et compactes au pied des Karpathes. Les ombres du soir assombrissaient encore cet océan sans rivages de pins drus et serrés ; aucun bruit ne troublait le silence, aucune voix d’être vivant, aucun frémissement dans les arbres, pas d’autre lumière que de temps en temps un lambeau de la résille d’or mat que le soleil couchant jetait encore sur la mousse et les herbes. Parfois le ciel d’un bleu pâle, sans nuages, apparaissait entre les cimes immobiles des vieux pins. Un lourd parfum de pourriture végétale était suspendu dans les branches entrelacées. Sous nos pas, rien ne craquait, on enfonçait comme dans un tapis. De fois à autre on rencontrait un de ces blocs erratiques, frustes et moussus, qui sont semés sur les pentes des Karpathes, dans les forêts et jusque dans la plaine couverte de moissons dorées, témoins silencieux d’une époque oubliée où les flots d’une mer battaient les flancs déchiquetés de nos montagnes. Ce fut comme un écho lointain de ces jours monotones de la création, quand soudain il se leva un vent très fort qui vint en mugissant rouler ses vagues invisibles entre les lourdes cimes, faisant frissonner les aiguilles des pins et ployer les hautes herbes qui s’inclinaient sur son passage.
Le vieux garde s’arrêta, ramena ses cheveux blancs que la bise avait ébouriffés, et se mit à sourire. Au-dessus de nous, dans l’éther bleu, se montrait un aigle. Le garde s’abrita les yeux d’une main et regarda l’oiseau en fronçant ses épais sourcils, puis d’une voix dolente :
— Voulez-vous tirer ? dit-il.
— À cette distance ? Merci !
— La tempête le rabat vers nous, murmura le vieux forestier, qui restait immobile.
Il ne se trompait pas, le point noir ailé grossissait de seconde en seconde, déjà je voyais briller le plumage. Nous gagnâmes une clairière entourée de pins sombres, parmi lesquels se détachaient comme des squelettes quelques rares bouleaux blancs.
L’aigle tournoyait sur nos têtes.
— Eh bien ! monsieur, c’est le moment de tirer.
— À toi, mon brave.
Le garde ferma les yeux, clignota un moment, souleva son vieux fusil rouillé et l’arma.
— Faut-il décidément ?
— Sans doute, moi je serais sûr de le manquer.
— À la grâce de Dieu !
Il épaula d’un air délibéré, un éclair jaillit, la forêt répercuta sourdement la détonation. L’aigle battit des ailes, un instant il parut encore soulevé par l’air, puis il tomba lourdement comme une pierre. Nous courûmes vers l’endroit où il s’était abattu.
« Caïn ! Caïn ! » cria une voix qui sortait du fourré, voix d’airain, terrible comme celle du Seigneur s’adressant dans le paradis aux premiers hommes ou plus tard au maudit qui a frappé son frère.
Les branches s’écartèrent. Devant nous se tenait une apparition fantastique, surhumaine.
Un vieillard de taille gigantesque était debout dans le maquis ; autour de sa tête nue flottaient de longs cheveux blancs, une barbe blanche descendait sur sa poitrine, et sous ses épais sourcils de grands yeux sombres s’attachaient sur nous comme ceux d’un juge, d’un vengeur. Son vêtement de bure était tout déchiré et rapiécé, et il portait une gourde en bandoulière ; appuyé sur son bâton, il hochait tristement la tête. Enfin il sortit, ramassa l’aigle mort, dont le sang ruissela sur ses doigts, et le contempla en silence.
Le garde se signa.
« C’est un errant ! murmura-t-il d’un ton d’effroi, un saint homme. »
Sans ajouter un mot il mit la bretelle de son fusil sur l’épaule et disparut entre les arbres séculaires.
Malgré moi, mon pied prit racine et mes yeux se fixèrent sur le sinistre vieillard. J’avais entendu parler plus d’une fois de cette secte étrange, à laquelle notre peuple a voué une vénération si profonde. Je pouvais maintenant satisfaire ma curiosité.
— Te voilà bien avancé, Caïn ! dit l’errant au bout de quelques minutes en se tournant vers moi. Ta soif de meurtre est-elle assouvie par le sang de ton frère ?
— Mais l’aigle n’est-il pas un forban ? répliquai-je. Ne fait-on pas bien de le détruire ?
— Hélas ! oui, c’est un meurtrier, dit en soupirant le vieillard ; il verse le sang comme tous ceux qui vivent. Mais sommes-nous obligés d’en faire autant ? Je ne le fais pas, moi ; mais toi… oui, oui, toi aussi, tu es de la race de Caïn, tu portes le signe…
J’étais mal à l’aise.
— Et toi, lui dis-je enfin, qui es-tu donc ?
— Je suis un errant.
— Qu’est-ce, un errant ?
— Un homme qui fuit la vie…
Il déposa le cadavre de l’oiseau sur le sol et me regarda ; ses yeux avaient maintenant une expression de douceur infinie.
— Repens-toi, reprit-il d’une voix pénétrante, répudie le legs de Caïn ; cherche la vérité, apprends à renoncer, à mépriser la vie, à aimer la mort.
— Où est la vérité ? Peux-tu m’en montrer le chemin ?
— Je ne suis pas un saint, répondit-il ; je ne suis point en possession de la vérité. Mais je te dirai ce que je sais.
Il fit quelques pas vers un tronc d’arbre pourri qui était couché dans la clairière et s’y assit ; je m’installai en face de lui sur un bloc de pierre, les mains sur les genoux, prêt à l’écouter. La tête appuyée sur ses deux mains, il regarda quelque temps devant lui comme pour se recueillir.
« Moi aussi, commença-t-il enfin, je suis un fils de Caïn, petit-fils de ceux qui ont mangé de l’arbre de la vie. Pour l’expier, je suis condamné à errer, à errer jusqu’au jour où je serai libéré de la vie… Moi aussi, j’ai vécu, j’ai follement joui de l’existence. J’ai possédé tout ce que peut embrasser le désir insatiable de l’homme, et j’en ai reconnu le néant. J’ai aimé et j’ai été bafoué, foulé aux pieds quand je me livrais tout entier, adoré quand je me jouais du bonheur des autres, adoré comme un Dieu ! J’ai vu cette âme que je croyais sœur de la mienne et ce corps que mon amour tenait pour sacré, je les ai vus vendus comme une vile marchandise. J’ai trouvé ma femme, la mère de mes enfants, dans les bras d’un étranger… J’ai été l’esclave de la femme et j’ai été son maître, et j’ai été comme le roi Salomon, qui aimait le nombre… C’est dans l’abondance que j’avais grandi, sans me douter de la misère humaine ; en une nuit s’écroula l’édifice de notre fortune, et lorsqu’il fallut enterrer mon père, il n’y avait pas de quoi payer le cercueil. Pendant des années, j’ai lutté, j’ai connu le chagrin et les noirs soucis, la faim et les nuits sans sommeil, l’angoisse mortelle, la maladie. J’ai disputé à mes frères les biens terrestres, opposant la ruse à la ruse, la violence à la violence, j’ai tué et j’ai été moi-même à deux pas de la mort, tout cela pour l’amour de cet or infernal… Et j’ai aimé l’état dont j’étais citoyen et le peuple dont je parle la langue, j’ai eu des dignités et des titres, j’ai prêté serment sous le drapeau et je suis parti pour la guerre plein de colère et d’ardeur, j’ai haï, j’ai assassiné ceux qui parlaient une autre langue, et je n’ai recueilli que honte et mépris…
« Comme les enfants de Caïn, je n’ai point ménagé la sueur de mes frères, ni hésité à payer de leur sang mes plaisirs. Puis à mon tour j’ai porté le joug et me suis courbé sous le fouet, j’ai peiné pour les autres, travaillé sans repos et sans trêve pour grossir mon gain. Heureux ou misérable, riche ou pauvre, je ne redoutais qu’une chose : la mort. J’ai tremblé à l’idée de quitter cette existence, j’ai maudit le jour où je suis né en songeant à la fin qui nous attend. Que de tourments, tant que j’espérais encore !… Mais la science m’est venue. J’ai vu la guerre des vivants, j’ai vu l’existence sous son vrai jour… »
Il hocha la tête, et s’absorba dans ses réflexions.
— Et quelle est la science que tu possèdes ? demandai-je après une pause.
— Le premier point, c’est que vous autres, pauvres fous, vous vous imaginez que Dieu a fait le monde aussi parfait que possible et qu’il a institué un ordre moral. Fatale erreur ! Le monde est défectueux, l’existence est une épreuve, un triste pèlerinage, et tout ce qui vit, vit de meurtre et de vol !
— Ainsi, selon vous, l’homme n’est qu’une bête féroce ?
— Sans doute ; la plus intelligente, la plus sanguinaire, la plus cruelle des bêtes féroces. Quelle autre est si ingénieuse à opprimer ses semblables ? Partout je ne vois que lutte et rivalité, que meurtre, pillage, fourberie, servitude… Toute peine, tout effort n’a d’autre mobile que l’existence : vivre à tout prix et transmettre sa misérable vie à d’autres créatures !
— La seconde vérité, continua gravement le vieillard, c’est que la jouissance n’a rien de réel ; qu’est-ce donc, sinon la fin d’un besoin qui nous dévore ? Et pourtant chacun court après ce vain mirage, et il ne peut en définitive qu’assurer sa vie. Mais crois-moi, ce n’est pas la privation qui fait notre misère, c’est cette attente éternelle d’un bonheur qui ne vient pas, qui ne peut jamais venir. Et qu’est-ce que ce bonheur qui, toujours à portée de la main et toujours insaisissable, fuit devant nous depuis le berceau jusqu’à la tombe ? Peux-tu me le dire ?
Je secouai la tête sans répondre.
« Qu’est-ce donc que le bonheur ? continua le vieillard. Je l’ai cherché partout où s’agite le souffle de la vie. Le bonheur, n’est-ce pas la paix, qu’en vain nous poursuivons ici-bas ? N’est-ce pas la mort ? la mort qui nous inspire tant d’effroi ? Le bonheur ! qui ne l’a cherché tout d’abord dans l’amour, et qui n’a fini par sourire tristement au souvenir de ses joies imaginaires ! Quelle humiliation de se dire que la nature n’allume en nous ce feu dévorant que pour nous faire servir à l’accomplissement de ses obscurs desseins ! Elle se soucie bien de nous ! À la femme, elle a départi tant de charmes, afin qu’elle puisse nous réduire sous son joug et nous dire : Travaille pour moi et pour mes enfants !… L’amour, c’est la guerre des sexes. Rivaux implacables, l’homme et la femme oublient leur hostilité native dans un court moment de vertige et d’illusion pour se séparer de nouveau plus ardents que jamais au combat. Pauvres fous qui croyez sceller un pacte éternel entre ces deux ennemis, comme si vous pouviez changer les lois de la nature et dire à la plante : Fleuris, mais ne te fane pas, et garde-toi de fructifier !… »
Il se prit à sourire, mais sans amertume ni malice ; dans ses yeux brillait la clarté tranquille d’une lumière supérieure.
« Et j’ai éprouvé de même la malédiction qui s’attache à la propriété… Née de la violence et de la ruse, elle provoque les représailles et engendre la discorde et les forfaits sans fin. L’infernale convoitise pousse les enfants de Caïn à s’emparer de tout ce qui est à leur portée ; et, comme si ce n’était pas assez qu’un seul accapare ce qui suffirait à des milliers de ses semblables, il voudrait s’y établir, lui et toute sa couvée, pour toute éternité. Et ils luttent, l’un pour prendre, l’autre pour garder ce qu’il a pris… Il étendit les bras comme pour repousser une vision terrible. Mais l’homme isolé ne peut soutenir le combat contre le nombre ; alors ils forment des ligues qui s’appellent communes, peuples, états. Et les lois viennent sanctionner toute usurpation. Et notre sueur, notre sang, sont monnayés pour payer les caprices de quelques-uns qui aiment le faste, les femmes et le cliquetis des armes ! La justice est faussée, et ceux qui élèvent la voix au nom du peuple, on les corrompt ou on les supprime, et ceux qui le servent le volent. Puis le volé s’insurge, et c’est encore la bestialité qui triomphe sur des ruines tachées de sang !…
« Les peuples sont des hommes en grand, ni moins rapaces, ni moins sanguinaires. Il est vrai que la nature nous a donné la destruction pour moyen d’existence, que le fort a partout sur le faible droit de vie et de mort. Tous les crimes que la loi punit dans la vie privée, les peuples les commettent sans scrupule les uns sur les autres. On se vole, on se pille, se trahit, s’extermine en grand, sous couleur de patriotisme et de raison d’état !… »
Le vieillard se tut pendant quelque temps.
— Le grand mystère de la vie, dit-il enfin d’un ton solennel, veux-tu le connaître ?
— Parle.
— Le mystère de la vie, c’est que chacun veut vivre par la rapine et le meurtre, et qu’il devrait vivre par sa peine. Le travail seul peut nous affranchir de la misère originelle. Tant que chacun cherche à vivre aux dépens du prochain, la paix sera impossible. Le travail est le tribut que tu dois payer à la vie : travaille, si tu veux vivre et jouir. Et c’est dans l’effort qu’est notre part de bonheur. Celui qui se réjouit de ne rien faire est la dupe de son égoïsme ; l’ennui incurable, le dégoût profond de la vie et la peur de mourir s’attachent à ses pas.
« La Mort ! spectre terrible qui se dresse sur le seuil de l’existence, la Mort, accompagnée de ses sombres acolytes, la Peur et le Doute. Pas un ne veut se souvenir, songer au temps infini où il n’existait pas encore. Pourquoi donc craindre ce que nous avons été déjà et pendant si longtemps ? Partout la mort nous entoure, nous guette ; c’est pitié de voir chacun la fuir et implorer une heure de sursis ! Si peu comprennent que c’est elle qui nous apporte la liberté et la paix !
« Mieux vaudrait, il est vrai, ne pas naître, ou bien, une fois né, rêver jusqu’à la fin ce rêve décevant, sans être ébloui par ses fallacieuses et splendides visions, puis replonger ensuite pour jamais dans le giron de la nature !…
Le vieillard couvrit de ses mains sèches et brunes son visage sillonné de rides profondes, et parut s’oublier lui-même dans une vague rêverie.
— Tu viens de me dire, repris-je, ce que la vie t’a enseigné. Ne veux-tu me dire maintenant la conclusion ?
— J’ai entrevu la vérité, s’écria l’errant, j’ai compris que le vrai bonheur est dans la science, et qu’il vaut encore mieux renoncer à tout que lutter pour jouir. Et j’ai dit : je ne veux plus verser le sang de mes frères ni les voler ; j’ai quitté ma maison et ma femme pour courir les chemins. Satan est le maître du monde ; c’est donc un péché d’appartenir à l’Église ou à l’État, et le mariage aussi est un péché capital… Six choses constituent le legs de Caïn : l’amour, la propriété, l’état, la guerre, le travail, la mort, — le legs de Caïn le Maudit, qui fut condamné à être errant et fugitif sur la terre. Le juste ne réclame rien de ce legs, il n’a point de patrie ni d’abri, il fuit le monde et les hommes, il doit errer, errer, errer… Et quand la mort vient le trouver, il faut qu’il l’attende avec sérénité, sous le ciel, dans les champs ou dans la forêt, car l’errant doit mourir comme il a vécu, en état de fuite… Ce soir, j’ai cru sentir les approches de la mort, mais elle a passé à côté de moi, et je vais me remettre en route et suivre ses traces.
Il se leva, prit son bâton.
« Fuir la vie est le premier point, dit-il, et une expression de charité céleste illumina ses traits, souhaiter la mort et la chercher est le second. »
Il me quitta et disparut bientôt dans le taillis.
Je restai seul, pensif ; la nuit se fit autour de moi. Le tronc pourri commençait à émettre une lueur phosphorescente, dans laquelle devenait visible un monde de plantes parasites et d’insectes laborieux. Je songeai. Les images du jour défilèrent devant moi comme ces bulles qui naissent et disparaissent à la surface d’un cours d’eau, je les contemplais sans terreur et sans joie. Je voyais le mécanisme de la création, je voyais la vie et la mort associées et se transformant l’une dans l’autre, et la mort moins terrible que la vie. Et plus je m’abîme en moi-même, et plus tout ce qui m’entoure devient vivant et me parle et arrive à moi :
« Tu veux fuir, pauvre fou, tu ne le peux pas, tu es comme nous. Tes artères battent à l’unisson des artères de la nature. Tu dois naître, grandir, disparaître comme nous, enfant du soleil, ne t’en défends pas, il ne sert de rien… »
Un bruissement solennel courut dans les feuilles, sur ma tête les lampadaires éternels brûlaient dans leur calme sublime. Et je crus voir devant moi la déesse sombre et taciturne, qui sans cesse enfante et engloutit ; et elle me parla en ces termes :
« Tu veux te poser en face de moi comme un être à part, pauvre présomptueux ! Tu es la ride à la surface de l’eau qui un moment brille sous les rayons de la lune pour s’évanouir ensuite dans le courant. Apprends à être modeste et patient et à t’humilier. Si ton jour te semble plus long que celui de l’éphémère, pour moi, qui n’ai ni commencement ni fin, ce n’en est pas moins qu’un instant… Fils de Caïn, tu dois vivre, tu dois tuer ; comprends enfin que tu es mon esclave et que ta résistance est vaine. Et bannis cette crainte puérile de la mort. Je suis éternelle et invariable, comme toi tu es mortel et changeant. Je suis la vie, et tes tourments ni ton existence ne m’importent… Toi comme eux tous, vous sortez de moi, et tôt ou tard à moi vous retournez. Vois comme à l’automne les êtres se changent en chrysalide, ou cherchent à protéger leurs œufs, puis meurent tranquilles, en attendant le printemps. Toi-même ne meurs-tu pas chaque soir pour renaître le lendemain ? et tu as peur du dernier sommeil !
« Je vois avec indifférence la chute des feuilles, les guerres, les fléaux qui emportent mes enfants, car je suis vivante dans la mort et immortelle dans la destruction. Comprends-moi et tu cesseras de me craindre et de m’accuser ; tu te sauveras de la vie pour retourner dans mon giron, après une courte angoisse. »
Ainsi me parla la grande voix. Puis le silence se fit de nouveau. La nature rentra dans sa morne indifférence et me laissa à mes pensées.
Une terreur vague m’envahit ; j’aurais voulu fuir, je me levai pour sortir de la forêt. Bientôt je fus dans la plaine qui s’étendait paisible sous un ciel clair rempli d’étoiles. Au loin, je voyais déjà mon village et les fenêtres éclairées de ma maison. Un calme profond se fit en moi, et un désir ardent de science et de vérité s’alluma dans mon âme. Et comme j’enfilai le sentier bien connu à travers les champs et les près, j’aperçus tout à coup une étoile qui brillait au ciel, et il me sembla qu’elle me précédait, comme l’étoile des rois mages qui cherchaient la lumière du monde.
Dom Juan de Kolomea
Chapitre 1
Nous étions sortis de Kolomea en voiture pour nous rendre à la campagne. C’était un vendredi soir. « Vendredi, bon commencement », dit le proverbe polonais ; mon cocher allemand, un colon du village de Mariahilf, prétendait au contraire que le vendredi était un jour de malheur, Notre-Seigneur étant mort ce jour-là sur la croix. C’est mon Allemand qui eut raison cette fois ; à une heure de Kolomea, nous tombâmes sur un piquet de garde rurale.
« Halte-là ! votre passeport ! »
Nous arrêtâmes ; mais le passeport ! Mes papiers, à moi, étaient en règle ; personne ne s’était inquiété de mon Souabe. Il était là sur son siège comme si les passeports eussent été encore à inventer, faisait claquer son fouet, remettait de l’amadou dans sa pipe. Évidemment ce pouvait être un conspirateur. Sa face insolemment béate semblait provoquer les paysans russes. De passeport, il n’en avait point ; ils haussèrent les épaules.
— Un conspirateur ! fit l’un d’eux.
— Voyons, mes amis ! regardez-le donc. Peine perdue !
— C’est un conspirateur.
Mon Souabe remue sur sa planche d’un air embarrassé ; il écorche le russe, rien n’y fait. La garde rurale connaît ses devoirs. Qui oserait lui offrir un billet de banque ? Pas moi. On nous empoigne et l’on nous conduit à l’auberge la plus proche à quelque cent pas de là.
De loin, on eût dit des éclairs qui passaient devant la maison : c’était la faux redressée en baïonnette d’une sentinelle. Juste au-dessus de la cheminée se montrait la lune, qui regardait le paysan et sa faux ; elle regardait par la petite fenêtre de l’auberge et y jetait ses lumières comme de la menue monnaie, et emplissait d’argent les flaques devant la porte, pour faire enrager l’avare juif, je veux dire l’aubergiste, qui nous reçut debout sur le seuil, et qui manifesta sa joie par une sorte de lamentation monotone. Il dandinait son corps à la façon des canards ; s’approchant de moi, il me fit d’un baiser une tache sur la manche droite, puis sur la gauche également, et se mit à gourmander les paysans d’avoir arrêté un monsieur tel que moi, un monsieur qui bien sûr était noir et jaune dans l’âme, il l’aurait juré sur la Thora… et il vociférait et se démenait comme s’il eût été personnellement victime d’un attentat inouï.
Je laissai mon Souabe avec les chevaux, gardé à vue par les paysans, et j’allai m’étendre dans la salle commune sur la banquette qui courait autour de l’immense poêle. Je m’ennuyai bientôt. L’ami Mochkou était fort occupé à verser à ses hôtes de l’eau-de-vie et des nouvelles ; deux ou trois fois seulement il s’abattit près de moi en sautant par-dessus le large buffet comme une puce, et s’y colla, et s’efforça d’entamer une conversation politique et littéraire. Ce n’était pas une ressource.
Je me mis à examiner la pièce où je me trouvais. Le ton dominant était le vert-de-gris. Une lampe à pétrole, alimentée avec parcimonie, répandait sur tous les objets une lumière verdâtre ; des moisissures vertes tapissaient les murs, le vaste poêle carré semblait verni au vert-de-gris, des touffes de mousse poussaient entre les pavés du parquet – une lie verte dans les verres à brandevin, du verdet authentique sur les petites mesures en cuivre, où les paysans buvaient à même devant le buffet sur lequel ils jetaient leur monnaie de billon. Une végétation glauque avait envahi le fromage que Mochkou m’apporta ; sa femme était assise derrière le poêle, en robe de chambre jaune à ramages vert pré, occupée à bercer son enfant vert pâle. Du vert-de-gris sur la peau chagrine du juif, autour de ses petits yeux inquiets, de ses narines mobiles, dans les coins aigres de sa bouche, qui ricanait ! Il y a de ces visages qui verdissent avec le temps comme le vieux cuivre.
Le buffet me séparait des consommateurs, qui étaient groupés autour d’une table longue et étroite, pour la plupart des paysans des environs ; ils conversaient à voix basse en rapprochant leurs têtes velues, tristes, sournoises. L’un me parut être le diak (le « chantre d’église »). Il tenait le haut bout, maniait une large tabatière, où il puisait seul pour ne point déroger, et faisait aux paysans la lecture d’un vieux journal russe à moitié pourri, aux reflets verts ; tout cela sans bruit, gravement, dignement. Au-dehors, la garde chantait un refrain mélancolique dont les sons semblaient venir de très loin : ils planaient autour de l’auberge comme des esprits qui n’osaient pénétrer au milieu de ces vivants qui chuchotaient. Par les fentes et les ouvertures, la mélancolie s’insinuait sous toutes ses formes, moisissures, clair de lune, chanson ; mon ennui aussi devenait de la mélancolie, de cette mélancolie qui caractérise notre race, et qui est de la résignation, du fatalisme. Mon ennui était aussi inévitable que le sommeil ou la mort. Le chantre était arrivé aux morts de la semaine et aux cours de la bourse, quand tout à coup on entendit au-dehors le claquement d’un fouet, un piétinement de chevaux et des voix confuses. Puis un silence ; ensuite une voix étrangère qui vint se mêler à celle des paysans. C’était une voix d’homme, une voix qui riait, qui était comme remplie d’une musique gaie, franche, superbe, et qui ne craignait point ceux à qui elle s’adressait ; elle s’approchait de plus en plus, enfin un homme franchit le seuil.
Je me redressai, mais je ne vis que sa haute taille, car il entrait à reculons en parlementant toujours avec les paysans sur un ton de plaisanterie.
« Ah ! çà, mes amis, faites-moi donc la grâce de me reconnaître ! Est-ce que j’ai l’air d’un émissaire, moi ? Est-ce que le comité national se promène sur la route impériale à quatre chevaux, sans passeport ? Est-ce qu’il flâne la pipe à la bouche, comme moi ? Frères, faites-moi la grâce d’être raisonnables ! »
On vit paraître dans la porte plusieurs têtes de paysans et autant de mains qui frottaient des mentons, ce qui voulait dire : voilà une grâce, frère, que nous ne te ferons point.
— Ainsi vous ne voulez pas vous raviser… à aucun prix ?
— Impossible.
— Mais suis-je donc un Polonais ? Voulez-vous que mes père et mère se retournent dans leur tombe au cimetière russe de Tserneliça ? Est-ce que mes aïeux n’ont pas combattu les Polonais sous le Cosaque Bogdan Khmielniçki ? Ne sont-ils pas allés avec lui les assiéger dans Zbaraz, où ils étaient campés, couchés, assis ou debout, à leur choix ? Voyons, faites-moi la grâce, laissez-moi partir…
— Impossible !
— Même si mon bisaïeul a fait le siège de Lemberg sous l’hetman Dorozenko ? Je vous assure qu’alors les têtes de gentilshommes polonais n’étaient pas plus chères que les poires ; mais, bonne santé, et que ça finisse !
— Impossible !
— C’est impossible pour de bon ? Sérieusement ?
— Sérieusement.
— Tant pis. Bonne santé tout de même !
L’étranger se résigna sans plainte. Il entra, inclina légèrement la tête en réponse aux salamalecs du juif, et s’assit devant le buffet en me tournant le dos. La juive fit un mouvement, le regarda, déposa sur le poêle son enfant, qui dormait, et s’approcha du buffet. Elle avait dû être belle jadis, quand Mochkou l’épousa ; maintenant ses traits avaient quelque chose de singulièrement âpre. La douleur, la honte, les coups de pied et de fouet ont longtemps travaillé cette race jusqu’à donner à tous ces visages cette expression à la fois ardente et fanée, triste et railleuse, humble et haineuse. Elle courbait le dos, ses mains fines et transparentes jouaient avec un des gobelets, ses yeux s’arrêtèrent sur le nouveau venu. De ces grands yeux noirs et humides s’échappait une âme de feu, comme un vampire qui sort d’une tombe ; ses regards s’attachaient au beau visage de l’étranger.
Il était vraiment beau. Il se pencha vers elle par-dessus la table, y jeta quelques pièces d’argent, et demanda une bouteille de vin.
— Vas-y, dit le juif à sa femme.
Elle se courba davantage, s’en alla les yeux fermés comme une somnambule. Mochkou, s’adressant à moi, me dit à voix basse :
« C’est un homme dangereux, un homme bien dangereux ! »
Et il hocha sa petite tête prudente, au front couvert de petites boucles noires.
II avait éveillé l’attention de l’étranger, qui se retourna subitement, m’aperçut, se leva, tira son bonnet de peau de mouton, et s’excusa très poliment. Je lui rendis son salut. La bienveillance russe a si bien imprégné le langage et les mœurs qu’il est presque impossible à l’effort individuel d’aller au-delà de la tendresse insinuante des phrases consacrées. Néanmoins nous nous saluâmes avec plus de politesse encore que ne le veut l’usage. Quand nous eûmes fini de nous proclamer réciproquement nos très humbles valets et de « tomber aux pieds » l’un de l’autre, l’homme dangereux s’assit en face de moi et me demanda la permission, « par miséricorde », de bourrer sa pipe turque. Déjà les paysans fumaient, le diak fumait, le poêle lui-même s’était mis de la partie ; pouvais-je le priver de sa pipe ?
— Ces paysans ! fit-il gaiement ; dites-moi vous-même, à cent pas me feriez-vous cette chose de me prendre pour un Polonais ?
— Non, certainement.
— Eh bien ! vous voyez, frère, s’écria-t-il plein de reconnaissance ; mais faites donc entendre raison à ceux-là !
Il tira de son gousset une pierre, y déposa un fragment d’amadou, et se mit à battre le briquet avec son couteau de poche.
— Cependant le juif vous appelle un homme dangereux.
— Ah ! oui…
Il regarda la table en souriant dans sa barbe.
« L’ami Mochkou veut dire : pour les femmes. Avez-vous remarqué comme il a renvoyé la sienne ? Ça prend feu si facilement… »
L’amadou aussi prenait feu ; il le mit dans la pipe, et bientôt nous enveloppa de nuages bleuâtres. Il avait modestement baissé les yeux et souriait toujours. Je pus l’examiner à loisir. C’était évidemment un propriétaire, car il était fort bien mis ; sa blague à tabac était richement brodée ; il avait des façons de gentilhomme. Il devait être des environs ou du moins du cercle de Kolomea, car le juif le connaissait ; il était russe, il venait de le dire, pas assez bavard d’ailleurs pour un Polonais. C’était un homme qui pouvait plaire aux femmes. Rien de cette pesante vigueur, de cette lourdeur brutale qui chez d’autres peuples passe pour de la virilité : il avait une beauté noble, svelte, gracieuse ; mais une énergie élastique, une ténacité à toute épreuve, se révélaient dans chacun de ses mouvements. Des cheveux bruns et lisses, une barbe pleine, coupée assez court et légèrement frisée, ombrageaient un visage régulier, bronzé par le hâle. Il n’était plus tout à fait jeune, mais il avait des yeux bleus pleins de gaieté, des yeux d’enfant. Une bonté, une bienveillance inaltérable était répandue sur ses traits basanés, et se devinait dans les lignes nombreuses que la vie avait burinées sur ce mâle visage.
Il se leva et arpenta plusieurs fois la salle d’auberge. Le pantalon bouffant emprisonné dans ses bottes molles en cuir jaune, les reins ceints d’une écharpe aux couleurs vives sous un ample habit ouvert par-devant, la tête coiffée d’un bonnet de fourrure, il avait l’air d’un de ces vieux boyards aussi sages que braves qui siégeaient en conseil avec les princes Vladimir et Jaroslav ou faisaient la guerre avec Igor et Roman. Certes, il pouvait être dangereux aux femmes, je n’avais pas de peine à l’en croire ; à le voir se promener ainsi de long en large, le sourire aux lèvres, j’éprouvais moi-même du plaisir.
La juive revint avec la bouteille demandée, la déposa sur la table, et retourna s’asseoir derrière le poêle, les yeux obstinément fixés sur lui. Mon boyard s’approcha, regarda la bouteille ; il paraissait préoccupé.
— Un verre de tokai, dit-il en riant, c’est encore ce qu’il y a de mieux pour remplacer le sang chaud d’une femme.
Il passa la main sur son cœur d’un geste comme s’il voulait comprimer une palpitation.
« Vous aviez peut-être ?… »
Je m’arrêtai, craignant d’être indiscret.
« Un rendez-vous ? Précisément. »
Il cligna les yeux, tira d’épaisses bouffées de sa pipe, hocha la tête.
— Et quel rendez-vous ! comprenez-moi bien. Je puis dire que je suis heureux auprès des femmes, extraordinairement heureux. Si on me lâchait dans le ciel parmi les saintes, le ciel serait bientôt… que Dieu me pardonne le péché ! Faites-moi la grâce de me croire !
— Je vous crois volontiers.
— Eh bien ! voyez. Nous avons un proverbe : « ce que tu ne dis pas à ton meilleur ami ni à ta femme, tu le diras à un étranger sur la grande route ». Débouche la bouteille,Mochkou, donne-nous deux verres, et vous, par miséricorde, buvez avec moi et laissez-moi vous raconter mes aventures, des aventures rares, précieuses comme les autographes de Goliath le Philistin — je ne dis pas rares comme les deniers de Judas Iscariote, j’en ai tant vu dans les églises de Russie et de Galicie que je commence à croire qu’il n’a pas déjà fait une si mauvaise affaire… Mais où est donc Mochkou ?
Le cabaretier arriva en sautillant, rua deux ou trois fois du pied gauche, prit un tire-bouchon dans sa poche, fit tomber la cire, souffla dessus, puis serra la bouteille entre ses genoux maigres, et la déboucha lentement avec des grimaces horribles. Ensuite il souffla une dernière fois dans la bouteille par acquit de conscience, et versa le tokai doré dans les deux verres les plus propres qui soient tolérés dans Israël. L’étranger éleva le sien :
« À votre santé ! »
Il était sincère, car il vida son verre d’un seul trait. Ce n’était point un buveur, il n’avait pas goûté et claqué de la langue avant de boire.
Le juif le regardait et lui dit timidement :
« C’est bien de l’honneur pour nous que monsieur le bienfaiteur nous rende visite, et quelle santé magnifique ! Toujours sur la brèche ! »
Pour souligner cette remarque, Mochkou prit un air de lion, écartant ses bras grêles et piétinant en cadence.
— Et comment se portent madame la bienfaitrice et les chers enfants ?
— Bien, toujours bien.
Mon boyard se versa un second verre et le vida, mais en tenant les yeux baissés, comme honteux ; le juif était déjà loin lorsqu’il me jeta un regard embarrassé, et je vis qu’il était tout rouge. Il garda le silence pendant quelque temps, fumant devant lui, me versant à boire ; enfin il reprit à voix basse :
— Je dois vous paraître bien ridicule. Vous vous dites : « Le vieux nigaud a sa femme et ses enfants à la maison, et voilà-t-il pas qu’il veut m’entretenir de ses exploits amoureux ? » Je vous en supplie, ne dites rien, je le sais de reste ; mais d’abord, voyez-vous, il y a du plaisir à causer avec un étranger, et puis, pardonnez-moi, c’est singulier, on se rencontre et l’on ne doit jamais peut-être se revoir, et pourtant on se soucie de l’opinion que l’autre pourrait emporter de vous… moi du moins. Il est vrai – je ne veux pas me peindre en beau – que je ne suis point insensible à la gloriole ; je crois que je serais désolé qu’on ignorât mes bonnes fortunes. Cependant ce soir j’ai été ridicule.
Je voulus l’interrompre.
« Laissez, poursuivit-il, c’est inutile ; je sais ce que je dis, car vous ne connaissez pas mon histoire ; tout le monde ici la connaît, mais vous l’ignorez. On devient vaniteux, ridiculement vaniteux, lorsqu’on plaît aux femmes : on voudrait se faire admirer, on jette sa monnaie aux mendiants sur la route et ses confidences aux étrangers dans les cabarets. Maintenant il vaut mieux que je vous raconte le tout ; ayez la grâce de m’écouter. Vous avez quelque chose qui m’inspire confiance. »
Je le remerciai.
— Eh bien !… D’ailleurs que faire ici ? Ils n’ont pas seulement un jeu de cartes. J’ai peut-être tort… Ah ! bah !Mochkou, encore une bouteille de tokai !… À présent écoutez.
Il appuya sa tête sur ses deux mains et se prit à rêver. Le silence régnait dans la salle ; au-dehors résonnait le chant lugubre de la garde rurale, tantôt venant de loin comme une lamentation funèbre, tantôt tout près de nous et tout bas, comme si l’âme de cet étranger se fût exhalée en vibrations douloureusement joyeuses.
— Vous êtes donc marié ? lui demandai-je enfin.
— Oui.
— Et heureux ?
Il se mit à rire. Son rire était franc comme celui d’un enfant ; je ne sais pourquoi j’eus le frisson.
— Heureux ! dit-il. Que voulez-vous que je vous réponde ? Faites-moi la grâce de réfléchir sur ce mot, le bonheur.Êtes-vous agronome ?
— Non.
— Cependant vous devez connaître un peu l’économie rurale ? Eh bien ! le bonheur, voyez-vous, ce n’est pas comme un village ou une propriété qui serait à vous, c’est comme une ferme – comprenez-moi bien, je vous prie – , comme une ferme. Ceux qui veulent s’y établir pour l’éternité, observer les rotations et fumer les champs, et ménager la futaie, et planter des pépinières ou construire des routes.
Il se prit la tête des deux mains.
« Bon Dieu ! ils font comme s’ils peinaient pour leurs enfants. Tâchez d’y faire votre beurre, et plutôt aujourd’hui que demain : épuisez le sol, dévastez la forêt, sacrifiez les prairies, laissez pousser l’herbe dans les chemins et sur les granges, et quand tout se trouve usé et que l’étable menace ruine, c’est bien, et le grenier aussi, c’est mieux ! voire la maison, c’est parfait ! Cela s’appelle jouir de la vie… Voilà le bonheur. Amusons-nous ! »
La seconde bouteille fut débouchée ; il s’empressa de remplir nos verres.
« Qu’est-ce que le bonheur ? s’écria-t-il encore ; c’est un souffle, voyez, regardez, où est-il maintenant ? »
Il montra du doigt la légère vapeur qui, échappée de ses lèvres, allait en se dissolvant.
« C’est ce chant que vous entendez, qui nage dans l’air et s’envole et va se perdre dans la nuit pour toujours… »
Nous nous tûmes tous les deux pendant quelques minutes. Enfin il reprit :
« Pardonnez-moi, pouvez-vous me dire pourquoi tous les mariages sont malheureux, ou du moins la plupart ?… Ai-je tort ? Non… Eh bien ! c’est un fait. Moi, je dis qu’il faut porter ce qui est fatal, ce qui est dans la nature, comme l’hiver ou la nuit, ou la mort ; mais y a-t-il une nécessité qui veut que les mariages soient généralement malheureux ? Est-ce que c’est une loi de la nature ? »
Mon homme mettait dans ses questions toute l’ardeur du savant qui cherche la solution d’un problème ; il me regardait avec une curiosité enfantine.
« Qu’est-ce donc qui empêche les mariages d’être heureux ? continua-t-il. Frère, le savez-vous ? »
Je répondis une banalité ; il m’interrompit, s’excusa et reprit son discours.
« Pardonnez-moi, ce sont de ces choses qu’on lit dans les livres allemands ; c’est très bon de lire, mais on prend l’habitude des phrases toutes faites. Moi aussi je pourrais dire : « Ma femme n’a pas répondu à mes aspirations », ou bien : « Que c’est triste de ne pas se voir compris ! Je ne suis pas un homme comme les autres ; je ne trouve pas de femme capable de me comprendre, et je cherche toujours » Tout cela, voyez-vous, ce sont des façons de parler, des mensonges ! »
Il remplit de nouveau son verre ; ses yeux brillaient, sa langue était déliée, les paroles lui venaient avec abondance.
« Eh bien ! monsieur, qu’est-ce qui ruine le mariage ? dit-il en posant ses deux mains sur mes épaules comme s’il voulait me serrer sur son cœur. Monsieur, ce sont les enfants. »
Je fus surpris.
« Mais, cher ami, répondis-je, voyez ce juif et sa femme ; sont-ils assez misérables ? Et croyez-vous qu’ils ne tireraient pas chacun de son côté, comme les bêtes, s’il n’y avait les enfants ? »
Il hocha la tête, et leva les deux mains étendues comme pour me bénir.
« C’est comme je vous le dis, frère, c’est ainsi ; ce n’est que cela. Écoutez mon histoire. »
Chapitre 2
— Tel que vous me voyez, j’ai été un grand innocent, comment dirai-je ? un vrai nigaud. J’avais peur des femmes. À cheval, j’étais un homme. Ou bien je prenais mon fusil et battais la campagne, toujours par monts et par vaux ; quand je rencontrais l’ours, je le laissais approcher et je lui disais : « Hop, frère », il se dressait, je sentais son haleine, et je lui logeais une balle dans la tache blanche au milieu de la poitrine ; mais quand je voyais une femme, je l’évitais : m’adressait-elle la parole, je rougissais, je balbutiais… un vrai nigaud, monsieur. Je croyais toujours qu’une femme avait les cheveux plus longs que nous et les vêtements plus longs aussi, voilà tout. Vous savez comme on est chez nous ; même les domestiques ne vous parlent point de ces choses, et l’on grandit, on a presque de la barbe au menton, et l’on ne sait pas pourquoi le cœur vous bat quand on se trouve en face d’une femme. Un vrai nigaud, vous dis-je ! Et puis, quand je sus, je me figurai que j’avais découvert l’Amérique. Tout à coup je devins amoureux, je ne sais comment… Mais je vous ennuie ?
— Au contraire ! je vous en prie…
— Bien. Je devins amoureux. Mon pauvre père s’était mis en tête de nous faire danser, ma sœur et moi. On fit venir un petit Français avec son violon, puis arrivèrent les propriétaires des environs avec leurs fils et leurs filles. C’était une société très gaie et sans gêne ; tout le monde se connaissait, on riait, moi seul je tremblais. Mon petit Français ne fait ni une ni deux, il aligne les couples, m’attrape par la manche et happe aussi une demoiselle de notre voisin, une enfant ; elle trébuchait encore dans sa robe longue, et elle avait des tresses blondes qui descendaient jusqu’en bas. Nous voilà dans les rangs ; elle tenait ma main, car moi j’étais mort. Nous dansâmes ainsi. Je ne la regardais pas ; nos mains brûlaient l’une dans l’autre. À la fin, j’entends le signal, chacun se pose en face de sa danseuse, joint les talons, laisse tomber la tête sur la poitrine comme si on vous l’eût coupée, arrondit le bras, saisit le bout de ses doigts et lui baise la main. Tout mon sang afflua au cerveau. Elle me fit sa révérence, et, quand je relevai la tête, elle était très rouge, et elle avait des yeux ! Ah ! ces yeux !
Il ferma les siens, et se pencha en arrière.
— Bravo, messieurs !
« C’était fini. Je ne dansai plus avec elle depuis lors.