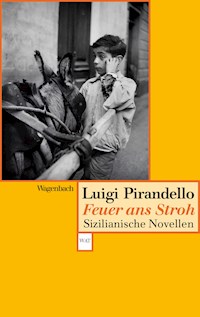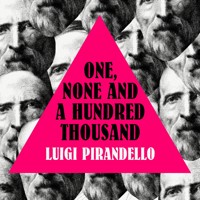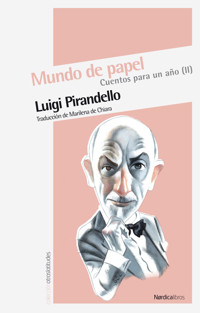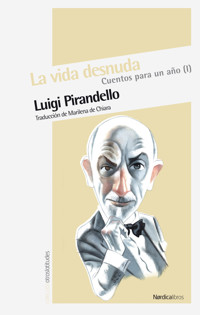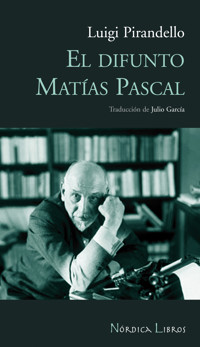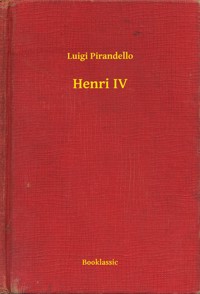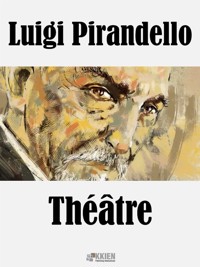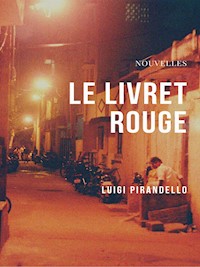
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Pirandello nous propose avec ce recueil cinq nouvelles empreintes de réalisme et d'émotion. - Dans le village de Nisia, en Sicile, chaque femme peut, si son bébé meurt, recueillir un nouveau né à l'hospice. Elle reçoit alors un livret rouge, lequel vaut 6 francs par mois... - Tommaso, surpris avec sa maîtresse par le mari trompé, tue ce dernier et tente de mettre fin à ses jours. Grièvement blessé, son médecin parvient à le sauver. Mais pourquoi? - Assis dans son lit, l'honorable Constanzo Ramberti s'observe en train de mourir. Homme politique important, il pense à ses obsèques. La réalité correspondra t'elle à ce qu'il a imaginé? - Tullio, homme solitaire, vit dans l'obscurité. Tout à coup, la lumière se fait... - Les professeurs Sabato et Lamella s'alcoolisent et parlent philosophie...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 114
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le Livret rouge
Le Livret rougePIRANDELLO-LE LIVRET ROUGELE DEVOIR DU MÉDECINL’ILLUSTRE DISPARULA LUMIÈRE D’EN FACEDESSUS ET DESSOUSPage de copyrightLe Livret rouge
Luigi Pirandello
PIRANDELLO
Conteur, romancier, dramaturge, Luigi Pirandello se définit lui-même un humoriste. Cette étiquette lui convient, mais à condition de ne pas confondre, comme on a coutume de le faire trop souvent en France, humoriste et auteur gai ou auteur comique. L’humour de Pirandello se rapproche beaucoup plus de celui d’un Swift ou d’un Dickens que de celui d’un Tristan Bernard ou d’un Mark Twain. S’il éveille parfois le sourire, plus souvent, il tend à émouvoir, et même jusqu’aux larmes.
C’est à la vérité un humour qui ne ressemble à aucun autre que l’on trouve chez Pirandello, un humour fait d’ironie et de clairvoyance impitoyables, qui, non seulement excelle à discerner l’endroit et l’envers de tous les sentiments humains, la part de drôlerie contenue dans un drame, la part de tragique contenue dans une farce, mais encore et surtout qui s’applique à mettre en lumière l’incessante comédie que chaque homme ou chaque femme se joue à lui-même de sa naissance à sa mort.
Pirandello, sicilien comme Giovanni Verga – il est né à Agrigente en 1867 – montre le même dédain de la rhétorique, de l’emphase, du verbalisme que l’auteur de Cavalleria Rusticana, la même lucidité dans l’analyse, la même sécheresse qui parfois s’enflamme et brûle d’une fièvre contenue. Il est, après Verga, un échantillon de ce Midi italien qui échappe à la volubilité et au lyrisme de l’Orient et tend à une netteté de contour qui rappelle la Grèce.
Chez Pirandello, cette netteté est moins apparente dans la forme même que dans le fond. Son humorisme procède d’une volonté de réalisme total. Il a défini lui-même son humour : « L’humorisme est un phénomène de dédoublement dans l’acte de la conception ; il est comme un Hermès Bifrons dont un visage rit des pleurs de l’autre visage ». Et ailleurs : « L’artiste ordinaire ne fait attention qu’au corps, l’humoriste au corps et à l’ombre ; et parfois, plus à l’ombre qu’au corps ; il note toutes les plaisanteries de cette ombre, comment tantôt elle s’allonge et tantôt se raccourcit, comme pour faire des grimaces au corps qui, pendant ce temps, n’en tient pas compte et n’y prend pas garde ».
Ce qui donne toute son originalité à Pirandello, c’est que son humorisme n’est pas une simple théorie d’art, un procédé nouveau ou renouvelé d’observer et de peindre les hommes, mais qu’il dérive d’une conception fondamentale de la vie et de la personnalité humaines.
La « dissociation des sentiments », qui est à la base de l’art de Pirandello, n’est pas artificielle, ce n’est pas un pur jeu de dilettante, elle correspond à une réalité profonde, irrémédiable, qui ne peut qu’entraîner tout homme qui réfléchit au scepticisme et au pessimisme absolus. Nous ne sommes pas maîtres de nos pensées, de nos sentiments, de nos volontés, nous ne sommes pas maîtres de notre personnalité. Nous sommes soumis aux lois de l’univers, à toutes sortes d’influences physiques, ataviques, etc., et surtout – c’est là le domaine favori de Pirandello – nous n’avons aucune existence personnelle, nous n’existons qu’en fonction des autres, nous jouons le personnage que notre entourage, notre métier, la société nous imposent et nous arrivons à ne plus savoir ce que nous sommes, si notre véritable personnalité est celle dont nous rêvons, celle que nous vivons ou celle que nous simulons devant les autres. Bien plus, nous ne connaissons de nous-mêmes que l’idée que nous en prenons. Parti de la « dissociation des sentiments »Pirandello s’est très vite consacré exclusivement à l’étude de la « dissociation de la personnalité ». Tous ses contes, tous ses romans, tous ses drames, ont pour sujet des « dissociations de personnalité », simples au début, mais qui sont devenues de plus en plus complexes, surtout depuis que Pirandello a abordé le théâtre. Le roman qui a établi la renommée de Pirandello en Italie, en 1904, Feu Mathias Pascal, est au point de départ de cette étude. Mathias Pascal est un pauvre homme qui fuit, loin d’une épouse et d’une belle-mère acariâtres, vers l’Amérique. Il s’arrête en route à Monte-Carlo, risque ses derniers sous à la roulette. Il y rencontre la fortune. Mais on a retrouvé le lendemain de son départ, dans la petite rivière qui traverse son village, un noyé qu’on a pris pour lui et enterré sous son nom. Mathias décide alors de vivre en marge de l’état-civil, libéré de tous les préjugés et de tous les liens sociaux. Et c’est ici que commence le véritable roman : dépouillé de sa personnalité sociale, il n’est plus rien, ni personne. Il est volé, mais comment porter plainte quand on n’a plus d’état-civil ? Il rencontre une femme qu’il aime et dont il est aimé, mais comment l’épouser ? Il se décide après maintes péripéties à rentrer dans son village et à se faire réintégrer dans sa « personnalité »première.
Un des derniers drames de Pirandello met en scène une femme qui a abandonné, autrefois, son mari et sa petite fille et qui, quinze ans après, est retrouvée et recueillie par son mari qui lui pardonne et lui rend sa place au foyer. Mais, comme il a toujours fait croire à sa fille que sa mère était morte et l’a élevée dans le culte de cette mère disparue, un subterfuge est nécessaire : il feint de se remarier. La haine de la fille pour sa mère, qu’elle croit sa marâtre, crée un drame extrêmement émouvant.
Ces trop longues explications n’étaient peut-être pas inutiles pour donner aux nouvelles qui suivent leur véritable physionomie. Leur forme les apparente à l’art d’un Maupassant, mais leur contenu est profondément différent.
Le Livret rouge dissocie une « personnalité » de mère : une femme qui, par amour maternel, tue un enfant. Le devoir du médecin, montre les interprétations multiples et contradictoires données d’un même fait par chacun des acteurs et des spectateurs du drame. Dessus et dessous formule une interprétation générale de la vie, dérivant de l’interprétation d’une destinée particulière. L’Illustre Disparu montre la différence entre l’idée qu’un homme se fait d’une chose et la réalisation de cette chose.
On aurait tort pourtant de voir dans Pirandello un idéologue, un philosophe : c’est avant tout un créateur. La variété de ses sujets, de ses héros – on le verra en lisant les pages qui suivent – est extraordinaire. Personne n’a peint avec plus de force et de vérité les Italiens d’aujourd’hui, et en particulier la bourgeoisie, ce mélange unique d’ardeur, de finesse, de crédulité, de passion, de positivisme, de poésie et de pharisaïsme, qui fait de l’Italien moyen un être complexe et presque indéchiffrable. On aimera aussi la sympathie émue dont Pirandello sait envelopper ses tristes héros.
Benjamin CRÉMIEUX
-LE LIVRET ROUGE
Nisias. – Un gros village qui bourdonne sur une plage étroite au bord de la mer de Sicile.
Naître dans de mauvaises conditions, n’est pas une prérogative exclusive des hommes. Les villages non plus, ne naissent pas comme ils veulent, ni où ils veulent, mais là où quelque nécessité naturelle engendre de la vie. Alors si un trop grand nombre d’hommes, attirés par cette nécessité, accourent en ce lieu, s’ils s’y reproduisent en trop grand nombre, si, enfin, la place y est trop mesurée, il s’ensuit que le village en question ne saurait avoir une croissance normale.
Nisias, pour grandir, a dû se hisser, maison par maison, le long des mornes pentes escarpées du plateau voisin, qui, un peu au delà du bourg surplombe, menaçant, la mer. Nisias aurait pu s’étendre à son aise sur ce plateau vaste et bien aéré, mais aurait dû pour cela s’éloigner de sa plage. Et un beau jour, peut-être, un beau jour, aurait-on vu quelque maison, plantée de force là-haut, redescendre sur la plage, coiffée de ses tuiles et bien serrée dans le châle de son crépi. C’est que, sur la plage, la vie bouillonne.
Sur le plateau, les gens de Nisias ont placé leur cimetière. Les morts ont de quoi respirer.
– Nous respirerons là-haut, disent les gens de Nisias.
Ils parient de la sorte parce qu’en bas, sur la plage, on ne respire point au milieu du trafic bruyant et poussiéreux du soufre, du charbon, du bois, des céréales, des salaisons, non, on ne respire pas. Ceux qui veulent respirer doivent aller là-haut ; ils y vont quand ils sont morts, et s’imaginent qu’une fois morts, ils respireront.
C’est une consolation.
* *
*
Il faut être indulgent pour les habitants de Nisias, car il n’est guère facile de se montrer honnête quand on se trouve dans une aussi mauvaise situation.
Dans ces pauvres maisons pressées les unes contre les autres, véritables tanières, plutôt que logis humains, fermente une horrible puanteur lourde, humide, âcre, qui corrompt petit à petit la plus solide vertu. Pour aider à cette corruption de la vertu, entendez pour augmenter la puanteur, il y a les gorets et les poules ; il y a de plus, assez souvent, un petit âne qui piétine dans sa litière. La fumée ne sait par où sortir et stagne dans ces bouges, noircissant plafonds et murailles. Et du haut des mauvais chromos encrassés de suie, les saints protecteurs qu’on a pendus aux murs, font des grimaces de dégoût.
Les hommes se rendent moins bien compte de cet état de chose, embrigadés et abrutis tout le jour comme ils le sont sur les quais ou sur les navires ; les femmes, elles, en sont pénétrées ; elles en deviennent comme enragées, et on dirait que le meilleur moyen qu’elles aient trouvé de passer leur rage, soit de faire des enfants.
C’est effrayant ! L’une en a douze, une autre quatorze, une autre seize… Il est vrai d’ailleurs, qu’elles ne parviennent pas à en élever plus de trois ou quatre. Mais ceux qui meurent au maillot, aident à grandir et à s’établir les trois ou quatre survivants, faut-il dire plus heureux ou plus malheureux que les autres ? Chaque femme, en effet, aussitôt après la mort d’un bébé, court à l’hospice des enfants assistés, et prend un nourrisson, qu’escorte un livret rouge, lequel vaut six francs par mois, durant pas mal d’années.
À Nisias, tous les marchands de toile et en général tous les marchands d’étoffes sont des Maltais. Même s’ils sont nés en Sicile, ce sont des Maltais. : « Aller chez le Maltais », signifie à Nisias, aller se pourvoir de toile. Et les Maltais armés de leur demi-mètre font à Nisias des affaires d’or : ils accaparent ces fameux livrets rouges ; ils donnent en échange d’un livret deux cents lires de marchandises : un trousseau de mariée. Les filles à Nisias se marient toutes ainsi, grâce aux livrets rouges des enfants assistés, qu’en retour leurs mères devraient allaiter.
Il fait beau voir, à la fin de chaque mois, la procession des Maltais ventrus et taciturnes, en pantoufles brodées et casquette de soie noire, un large mouchoir rouge d’une main et de l’autre leur tabatière de corne ou d’argent, se présenter à la Mairie de Nisias, chacun avec sept ou dix ou quinze de ces livrets rouges. Ils s’asseyent en file sur le banc du long corridor poussiéreux où s’ouvre le guichet des paiements, et chacun attend son tour, en somnolant pacifiquement, en se bourrant le nez de tabac, en chassant les mouches, tout doux, tout doux. Le paiement des mois de nourrice aux Maltais est désormais traditionnel à Nisias.
– Marenga (Rose), crie l’employé.
– Présente, répond le Maltais.
* *
*
Marenga Rose de Nicolao est célèbre à la Mairie de Nisias. Voilà plus de vingt ans qu’elle alimente l’usure des Maltais d’une série ininterrompue de livrets rouges.
Combien a-t-elle perdu d’enfants au maillot ? Elle-même n’en sait plus le compte. Elle en a élevé quatre, quatre filles. Trois sont déjà mariées. Et maintenant, elle a fiancé sa quatrième.
Mais on ne sait plus, véritablement, en la regardant, s’il s’agit d’une femme ou d’un tas de chiffons ; si bien que les Maltais auxquels elle s’était adressée pour ses trois aînées, se sont refusés à lui faire crédit pour la dernière.
– Gnora Rosilla, vous n’y arriverez pas.
– Moi ! je n’y arriverai pas, moi ?
Elle s’est sentie offensée dans sa dignité de bête de race si longtemps bonne laitière, et, comme on ne discute pas avec les Maltais taciturnes, elle a hurlé férocement devant leurs boutiques.
Puisqu’à l’hospice on lui a confié un enfant trouvé, cela ne veut-il pas dire qu’on l’a reconnue capable de l’allaiter ?
Mais à cet argument, les Maltais, dans l’ombre, derrière le comptoir de leur boutique, ont souri dans leur barbe en hochant la tête. On peut supposer qu’ils n’avaient pas grande confiance dans le médecin et dans l’adjoint au maire chargés de veiller sur le sort des enfants-assistés. Mais non. Les Maltais savent qu’aux yeux du médecin et de l’adjoint, la tâche d’une mère qui a une fille à établir et ne peut y parvenir que grâce à un livret rouge, est autrement lourde et mérite beaucoup plus d’égards que celle d’élever un enfant trouvé : celui-là, s’il meurt, qui en aura du chagrin ? et qui s’en plaindra, s’il souffre ?
Une fille est une fille, un nourrisson de l’hospice, un nourrisson de l’hospice. Et, d’ailleurs, si la fille ne se marie pas, il est à craindre qu’elle ne contribue à son tour à augmenter le nombre des enfants assistés dont la Commune devra se charger par la suite.
Mais si la mort d’un enfant assisté est une bonne fortune pour la Commune, c’est de toutes façons pour le Maltais une mauvaise affaire, même quand il réussit à récupérer la marchandise livrée à crédit, Aussi n’est-il point rare de voir à certaines heures de la journée, sous couleur de faire un petit tour de promenade, les Maltais se livrer à des rondes d’inspection dans les ruelles sales toutes grouillantes d’enfants nus, terreux, brûlés par le soleil, de gorets crayeux et de poules, tandis que d’un seuil à l’autre bavardent et plus souvent se querellent toutes ces mères à livrets rouges.
Les nourrissons sont exactement de la part des Maltais l’objet des mêmes soins que les gorets de la part des femmes. Certains Maltais, au comble de la consternation, sont allés jusqu’à faire donner le sein par leur propre femme, une demi-heure chaque jour, à des nourrissons trop amaigris.
Passons. Rose Marenga a trouvé finalement un Maltais de seconde catégorie, un petit Maltais débutant qui a promis de lui avancer en plusieurs fois, non pas comme à l’ordinaire, deux cents francs de marchandises, mais cent-quarante seulement. Le fiancé et ses parents s’en sont contentés, et l’on a décidé les épousailles.
Et maintenant un nourrisson affamé, dans une sorte de sac tendu sur des cerceaux d’osier, accroché par deux ficelles, dans un coin de la bauge, hurle du matin au soir, tandis que la fille de Rose Marenga, Tuzza, la fiancée, « fait à l’amour », avec son épouseur, rit, coud son trousseau, et de temps en temps tire la ficelle pendue à ce berceau primitif qu’elle balance :