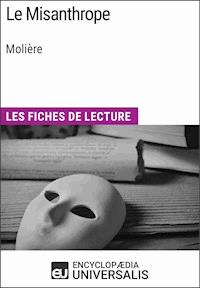
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Französisch
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalis
Dès Boileau et la fin du XVIIe et surtout durant le XVIIIe siècle, on n’a cessé de célébrer
Le Misanthrope de Molière (1622-1673) : une pièce aussi harmonieuse, aussi rigoureuse, en un mot une comédie aussi sérieuse a enfin réussi à légitimer le comique en le rendant moral.
Une fiche de lecture spécialement conçue pour le numérique, pour tout savoir sur Le Misanthrope de Molière
Chaque fiche de lecture présente une œuvre clé de la littérature ou de la pensée. Cette présentation est couplée avec un article de synthèse sur l’auteur de l’œuvre.
A propos de l’Encyclopaedia Universalis :
Reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité incomparable de ses publications, Encyclopaedia Universalis met la connaissance à la portée de tous. Écrite par plus de 7 400 auteurs spécialistes et riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins…), l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable collection de référence disponible en français. Elle aborde tous les domaines du savoir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 52
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782852296275
© Encyclopædia Universalis France, 2019. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Nito/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Encyclopædia Universalis.
Ce volume présente des notices sur des œuvres clés de la littérature ou de la pensée autour d’un thème, ici Le Misanthrope, Molière (Les Fiches de lecture d'Universalis).
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
LE MISANTHROPE, Molière (Fiche de lecture)
Dès Boileau et la fin du XVIIe et surtout durant le XVIIIe siècle, on n’a cessé de célébrer Le Misanthrope de Molière (1622-1673) : une pièce aussi harmonieuse, aussi rigoureuse, en un mot une comédie aussi sérieuse a enfin réussi à légitimer le comique en le rendant moral. De plus, s’il prend bien appui sur des personnages topiques, en particulier à travers l’opposition de la prude et de la coquette, Molière ne renonce pas ici à l’ambiguïté quand il peint les personnages de Philinte et d’Alceste. Enfin, par un approfondissement des types moraux abordés, l’auteur du Misanthrope parvient à créer un effet de sympathie inédit de la part des spectateurs à l’égard de ses personnages.
• L’« humeur noire » d’Alceste
Le 4 juin 1666, au théâtre du Palais-Royal, en pleine affaire Tartuffe, Molière interprète le rôle d’Alceste. « Atrabilaire amoureux » (ce devait être le sous-titre de la comédie avant que Molière n’y renonce lors de la publication), celui-ci déclame ses chagrins, et fait preuve d’une singulière bizarrerie. Il surprend tout son monde en affirmant qu’il ne veut rien tant qu’être seul sur scène, ou partir (« Moi, je veux me fâcher, et ne veux point entendre »). Et l’on verra, à la fin de l’acte V, qu’Alceste sait tirer les conclusions de sa déclaration première puisqu’il quittera lui-même la scène pour se réfugier dans un « désert » solitaire, absolu et non-théâtral (« Trahi de toutes parts, accablé d’injustices,/ Je vais sortir d’un gouffre où triomphent les vices ;/ Et chercher sur la terre un endroit écarté,/ Où d’être homme d’honneur on ait la liberté »).
La deuxième bizarrerie consiste en son amour paradoxal : Alceste, qui veut qu’on soit vrai et sincère, aime précisément celle qui correspond le moins à ses goûts – puisque Célimène est l’emblème de la coquette –, et n’aime pas celle qu’il devrait aduler : la prude Arsinoé. Pis, il aime Célimène pour ses péchés, tout en voulant ne pas l’aimer, et préférerait, comme le dit la chanson (acte I, scène 2), abandonner Paris plutôt que sa maîtresse. On verra ainsi que, ne pouvant réformer sa maîtresse et échouant à la conserver – elle refuse de le suivre –, il quittera Paris et sa maîtresse.
Troisième bizarrerie : paradoxal et violent, ce personnage qui entre sur le plateau pour faire le vide – il ne veut que parler à Célimène, et n’y parviendra qu’à la fin de la pièce – n’est pas un « rebelle » : il est vêtu en jeune courtisan, en honnête homme de salon, mais apparaît pourvu d’une aptitude extraordinaire à résister au monde auquel il appartient, comme s’il cherchait une vérité là où elle ne peut être.
Enfin, devant Philinte, son ami raisonneur partisan de l’attitude moyenne (« Le monde par vos soins ne se changera pas »), Alceste ne veut rien entendre. Il s’enferme dans son amour impossible, comme dans son refus radical d’être là où il est. En cela il plaît et fait rire, parce que cette somme de paradoxes sonne comme autant de ridicules que le public du Palais-Royal, rompu à l’hypocrisie mondaine, est à même de saisir.
• Scènes de conversation : le jeu des ridicules et l’impossible vérité
À ceci près que l’hypocrisie, symptôme des mœurs du siècle, déjà largement traitée par Molière – et avec quels risques, dans Tartuffe (alors interdit) et Dom Juan (disparu de l’affiche et non publié), les deux pièces précédentes –, est, en soi, bien condamnable et que l’idéal de pureté et de vérité soutenu par Alceste est, en soi, parfaitement recevable, comme le soulignera Rousseau dans sa Lettre à d’Alembert, en reprochant à l’auteur de tourner en dérision son personnage. Ainsi, peu à peu, tout se brouille : Alceste n’a-t-il pas raison de rejeter le monde, d’affronter le péché pour convertir la pécheresse, même en vain ; n’est-il pas fondé à dire ce que la raison et la morale indiquent, et à avouer ce que son cœur lui dicte ? Et le prudent Philinte, en jouant ponctuellement le sage, est-il dans le vrai lorsqu’il promeut une morale qui fait la part belle à une légère hypocrisie afin de préserver la paix des salons et des ménages ?
Restent les hommes de qualité, les gens de lettres et de cour, qui viennent converser avec Célimène, et chercher à s’emparer de la riche et belle veuve pour réaliser un intéressant mariage. Face au misanthrope pris de colère parce que légitimement jaloux, les Oronte, les Acaste et les Clitandre, à tous égards, composent. Tout cela permet des numéros de virtuosité où la conversation, art majeur du temps, est doublement représentée : on en rit parce qu’elle est souvent ridicule, on l’apprécie parce qu’elle divertit. Et parce qu’elle est ostensiblement théâtralisée, on la voit à distance, avec tous ses rites, son utilité sociale et ses dangers moraux. Car si Molière semble condamner les mœurs, il prend soin de montrer des personnages qui ne sont pas totalement ridicules : Oronte lui-même, dans la scène du sonnet (I, 2), suscite le rire dans le rapport qu’il entretient avec Alceste – lui aussi ridicule et raisonnable en l’espèce –, et parce qu’il joue à être un grand écrivain, mais n’est pas pour autant l’auteur d’un poème plus contestable que tous les sonnets du temps. Mieux encore, il a le courage et l’honnêteté – ou le ridicule, selon le point de vue qu’on adopte – de défendre une esthétique en laquelle il croit, quitte à faire un procès pour se faire reconnaître.





























