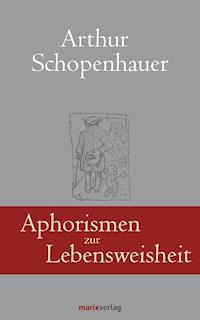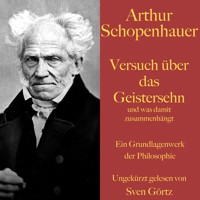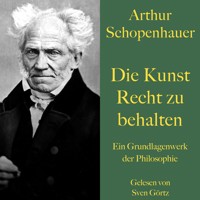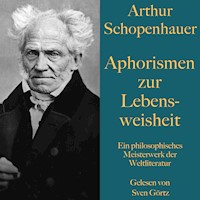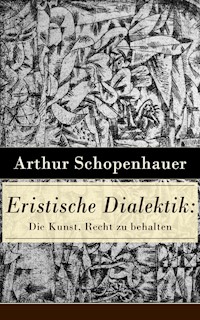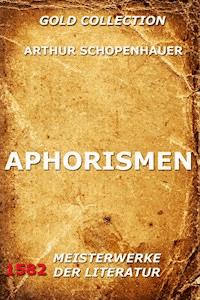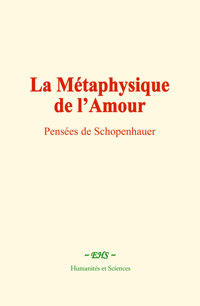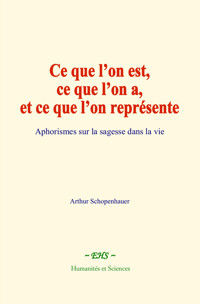0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Philaubooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
- Texte révisé suivi de repères chronologiques.
Extrait.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Le Monde comme volonté et comme représentation
Tome I
Arthur Schopenhauer
Traduction par Auguste Burdeau
Copyright © 2020 Philaubooks, pour ce livre numérique, à l’exclusion du contenu appartenant au domaine public ou placé sous licence libre.
ISBN : 979-10-372-0162-1
Réalisé avec Vellum
Table des matières
Préface de la première édition
Préface de la deuxième édition
Préface de la troisième édition
Préface de la quatrième édition
Livre I
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
Chapitre 14
Chapitre 15
Chapitre 16
Livre II
Chapitre 17
Chapitre 18
Chapitre 19
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 22
Chapitre 23
Chapitre 24
Chapitre 25
Chapitre 26
Chapitre 27
Chapitre 28
Chapitre 29
Livre III
Chapitre 30
Chapitre 31
Chapitre 32
Chapitre 33
Chapitre 34
Chapitre 35
Chapitre 36
Chapitre 37
Chapitre 38
Chapitre 39
Chapitre 40
Chapitre 41
Chapitre 42
Chapitre 43
Chapitre 44
Chapitre 45
Chapitre 46
Chapitre 47
Chapitre 48
Chapitre 49
Chapitre 50
Chapitre 51
Chapitre 52
Livre IV
Chapitre 53
Chapitre 54
Chapitre 55
Chapitre 56
Chapitre 57
Chapitre 58
Chapitre 59
Chapitre 60
Chapitre 61
Chapitre 62
Chapitre 63
Chapitre 64
Chapitre 65
Chapitre 66
Chapitre 67
Chapitre 68
Chapitre 69
Chapitre 70
Chapitre 71
Repères chronologiques
Préface de la première édition
Si l’on veut lire ce livre de la manière qui en rend l’intelligence aussi aisée que possible, on devra suivre les indications ci-après.
Ce qui est proposé ici au lecteur, c’est une pensée unique. Néanmoins, quels qu’aient été mes efforts, il m’était impossible de la lui rendre accessible par un chemin plus court que ce gros ouvrage. — Cette pensée est, selon moi, celle que depuis si longtemps on recherche, et dont la recherche s’appelle la philosophie, celle que l’on considère, parmi ceux qui savent l’histoire, comme aussi introuvable que la pierre philosophale, comme si Pline n’avait pas dit fort sagement : « Combien il est de choses qu’on juge impossibles, jusqu’au jour où elles se trouvent faites. » (Hist. nat., VII, 1.)
Cette pensée, que j’ai à communiquer ici, apparaît successivement, selon le point de vue d’où on la considère, comme étant ce qu’on nomme la métaphysique, ce qu’on nomme l’éthique, et ce qu’on nomme l’esthétique ; et en vérité, il faut qu’elle soit bien tout cela à la fois, si elle est ce que j’ai déjà affirmé qu’elle était.
Quand il s’agit d’un système de pensées, il doit nécessairement se présenter dans un ordre architectonique : en d’autres termes, chaque partie du système en doit supporter une autre, sans que la réciproque soit vraie ; la pierre de base supporte tout le reste, sans que le reste la supporte, et le sommet est supporté par le reste, sans supporter rien à son tour. Au contraire, lorsqu’il s’agit d’une pensée une, si ample qu’elle soit, elle doit s’offrir avec la plus parfaite unité. Sans doute, pour la commodité de l’exposition, elle souffre d’être divisée en parties ; mais l’ordre de ces parties est un ordre organique, si bien que chaque partie y contribue au maintien du tout, et est maintenue à son tour par le tout ; aucune n’est ni la première, ni la dernière ; la pensée dans son ensemble doit de sa clarté à chaque partie, et il n’est si petite partie qui puisse être entendue à fond, si l’ensemble n’a été auparavant compris. — Or il faut bien qu’un livre ait un commencement et une fin, et il différera toujours en cela d’un organisme ; mais, d’autre part, le contenu devra ressembler à un système organique : d’où il suit qu’ici il y a contradiction entre la forme et la matière.
Cela étant, il n’y a évidemment qu’un conseil à donner à qui voudra pénétrer dans la pensée ici proposée : c’est de lire le livre deux fois, la première avec beaucoup de patience, une patience qu’on trouvera si l’on veut bien croire bonnement que le commencement suppose la fin, à peu près comme la fin suppose le commencement, et même que chaque partie suppose chacune des suivantes, à peu près comme celles-ci la supposent à leur tour. Je dis « à peu près », car cela n’est pas exact en toute rigueur, et l’on n’a de bonne foi rien négligé de ce qui pouvait faire comprendre d’emblée des choses qui ne seront entièrement expliquées que par la suite, ni rien en général de ce qui pouvait contribuer à rendre l’idée plus saisissable et plus claire. On aurait même pu atteindre jusqu’à un certain point ce résultat, s’il n’arrivait pas tout naturellement que le lecteur, au lieu de s’attacher exclusivement au passage qu’il a sous les yeux, s’en va songeant aux conséquences possibles ; ce qui fait qu’aux contradictions réelles et nombreuses qui déjà existent entre la pensée de l’auteur, d’une part, et les opinions du temps et sans doute aussi du lecteur, d’autre part, il peut s’en venir ajouter d’autres, supposées et imaginaires, en assez grand nombre pour donner l’air d’un conflit violent d’idées à ce qui en réalité est un malentendu simple : mais on est d’autant moins disposé à y voir un malentendu, que l’auteur est parvenu à force de soins à rendre son exposé clair et ses expressions limpides au point de ne laisser aucun doute sur le sens du passage qu’on a immédiatement sous les yeux, et dont cependant il n’a pu exprimer à la fois tous les rapports avec le reste de sa pensée. C’est pourquoi, comme je l’ai déjà dit, la première lecture exige de la patience, une patience appuyée sur cette idée, qu’à la seconde fois bien des choses, et toutes peut-être, apparaîtront sous un jour absolument nouveau. En outre, en s’efforçant consciencieusement d’arriver à se faire comprendre pleinement et même facilement, l’auteur pourra se trouver amené parfois à se répéter : on devra l’excuser sur la difficulté du sujet. La structure de l’ensemble qu’il présente, et qui ne s’offre pas sous l’aspect d’une chaîne d’idées, mais d’un tout organique, l’oblige d’ailleurs à toucher deux fois certains points de sa matière. Il faut accuser aussi cette structure spéciale, et l’étroite dépendance des parties entre elles, si je n’ai pu recourir à l’usage, précieux d’ordinaire, d’une division en chapitres et paragraphes, et si je me suis réduit à un partage en quatre portions essentielles, qui sont comme quatre points de vue différents. En parcourant ces quatre parties, ce à quoi il faut bien avoir garde, c’est à ne pas perdre de vue, au milieu des détails successivement traités, la pensée capitale d’où ils dépendent, ni la marche générale de l’exposition. — Telle est ma première et indispensable recommandation au lecteur malveillant (je dis malveillant, parce qu’étant philosophe il a affaire en moi à un autre philosophe). Le conseil qui suit n’est pas moins nécessaire.
En effet, il faut, en second lieu, lire, avant le livre lui-même, une introduction qui, à vrai dire, n’est pas jointe au présent ouvrage, ayant été publiée il y a cinq ans sous ce titre : De la quadruple racine du principe de la raison suffisante ; essai de philosophie1. Faute de connaître cette introduction et de s’être ainsi préparé, on ne saurait arriver à pénétrer vraiment le sens du livre actuel ; ce qu’elle contient est supposé par cet ouvrage-ci, comme si elle en faisait partie. J’ajoute que si elle n’avait point paru il y a plusieurs années, elle ne pourrait toutefois pas être placée comme une introduction proprement dite en tête de cet ouvrage : elle devrait être incorporée au livre premier : celui-ci comporte en effet certaines lacunes, il y manque ce qui est exprimé dans l’essai ci-dessus indiqué ; de là des imperfections auxquelles on ne peut remédier qu’en se référant à la Quadruple racine. Mais je répugnais à l’idée de me recopier, ou de me torturer à chercher d’autres mots pour redire ce que j’ai déjà dit, et c’est pourquoi j’ai préféré l’autre parti : ce n’est pas cependant qu’il ne m’eût été possible de fournir, du contenu de l’essai précité, un exposé meilleur, ne fût-ce que par cette raison que je l’eusse débarrassé de certains concepts que m’imposait alors un respect excessif envers la doctrine de Kant, tels que les catégories, le sens intime et la sensibilité extérieure, etc. Toutefois, il faut le dire, si ces concepts subsistaient là, c’est uniquement parce que je ne les avais pas encore examinés assez à fond ; si bien qu’ils constituaient seulement un accessoire, sans lien avec mon objet essentiel, et qu’il est par suite facile au lecteur de faire lui-même les corrections nécessaires dans les quelques passages de l’essai auxquelles je pense ici. — Cette réserve faite, il faut avant tout avoir compris, avec l’aide de cet écrit, ce que c’est que le principe de raison suffisante, ce qu’il signifie, à quoi il s’étend et à quoi il ne s’applique pas, et enfin qu’il ne préexiste pas avant toutes choses, en telle manière que le monde entier existerait seulement en conséquence de ce principe et en conformité avec lui, comme son corollaire, mais au contraire qu’il est simplement la forme sous laquelle l’objet, de quelque nature qu’il soit, est connu, du sujet, qui lui impose ses conditions en vertu de cela seul qu’il est un individu connaissant : il faut, dis-je, avoir compris ces choses, pour pouvoir entrer dans la méthode de philosopher qui se trouve essayée ici pour la première fois.
C’est encore par cette même répugnance soit à me répéter mot pour mot, soit à redire la même chose avec des expressions moins bonnes, les meilleures que j’aie pu trouver ayant été épuisées déjà, que j’ai laissé subsister dans le présent ouvrage une autre lacune encore : en effet, j’ai mis de côté ce que j’avais exposé dans le premier chapitre de mon essai Sur la vision et sur les couleurs et qui aurait été ici fort bien à sa place, sans un seul changement. Il est nécessaire aussi, en effet, de connaître au préalable ce petit écrit.
Enfin j’ai une troisième demande à exprimer au lecteur, mais elle va de soi : je demande en effet qu’il connaisse un fait, le plus considérable qui se soit produit depuis vingt siècles en philosophie, et pourtant bien voisin de nous je veux parler des ouvrages principaux de Kant. L’effet qu’ils produisent sur un esprit qui s’en pénètre véritablement ne peut mieux se comparer, je l’ai déjà dit ailleurs, qu’à l’opération de la cataracte. Et pour continuer la comparaison, je dirai que tout mon but ici est de prouver que j’offre aux personnes délivrées de la cataracte par cette opération, des lunettes comme on en fait pour des gens dans leur cas, et qui ne sauraient être utilisées, évidemment, avant l’opération même. — Toutefois, si je prends pour point de départ ce que ce grand esprit a établi, il n’en est pas moins vrai qu’une étude attentive de ses écrits m’a amené à y découvrir des erreurs considérables, que je devais isoler, accuser, pour en purifier sa doctrine, et, ne gardant de celle-ci que le meilleur, en mettre les parties excellentes en lumière, et les utiliser. Comme, d’autre part, je ne pouvais interrompre et embrouiller mon exposition en y mêlant une discussion continue de Kant, j’ai consacré à cette discussion un Appendice spécial. Et si, comme je l’ai dit déjà, mon ouvrage veut des lecteurs familiers avec la philosophie de Kant, il veut aussi qu’ils connaissent l’Appendice dont je parle : aussi, à ce point de vue, le plus sage serait de commencer par lire l’Appendice, d’autant qu’il a par son contenu des liens étroits avec ce qui fait l’objet de mon livre premier. Seulement, on ne pouvait non plus éviter, vu la nature du sujet, que l’Appendice ne se référât çà et là à l’ouvrage lui-même : d’où il faut conclure tout simplement que, comme partie capitale de l’œuvre, il demande à être lu à deux reprises.
Ainsi donc la philosophie de Kant est la seule avec laquelle il soit strictement nécessaire d’être familier pour entendre ce que j’ai à exposer. — Si cependant le lecteur se trouvait en outre avoir fréquenté l’école du divin Platon il serait d’autant mieux en état de recevoir mes idées et de s’en laisser pénétrer. — Maintenant supposez qu’il ait reçu le bienfait de la connaissance des Védas, de ce livre dont l’accès nous a été révélé par les Oupanischads, — et c’est là à mes yeux le plus réel avantage que ce siècle encore jeune ait sur le précédent, car selon moi l’influence de la littérature sanscrite sur notre temps ne sera pas moins profonde que ne le fut au XVe siècle la renaissance des lettres grecques, — supposez un tel lecteur, qui ait reçu les leçons de la primitive sagesse hindoue, et qui se les soit assimilées, alors il sera au plus haut point préparé à entendre ce que j’ai à lui enseigner. Ma doctrine ne lui semblera point, comme à d’autres, une étrangère, encore moins une ennemie ; car je pourrais, s’il n’y avait à cela bien de l’orgueil, dire que, parmi les affirmations isolées que nous présentent les Oupanischads, il n’en est pas une qui ne résulte, comme une conséquence aisée à tirer, de la pensée que je vais exposer, bien que celle-ci en revanche ne se trouve pas encore dans les Oupanischads.
Mais je vois d’ici le lecteur bouillir d’impatience, et, laissant enfin échapper un reproche trop longtemps contenu, se demander de quel front je viens offrir au public un ouvrage en y mettant des conditions et en formulant des exigences dont les deux premières sont excessives et indiscrètes, et cela dans un temps si riche en penseurs, qu’il ne se passe pas d’année où en Allemagne seulement les presses ne fournissent au public au moins trois mille ouvrages pleins d’idées, originaux, indispensables, sans parler d’écrits périodiques innombrables et de feuilles quotidiennes à l’infini ? Dans un temps où l’on est à mille lieues d’une disette de philosophes et neufs et profonds ; où la seule Allemagne peut en montrer plus de tout vivants que n’en pourraient présenter plusieurs des siècles passés en se réunissant ? Comment, va dire le lecteur fâché, comment venir à bout de tout ce monde, si, pour lire un seul livre, il faut tant de cérémonies ?
Je n’ai rien à répliquer, absolument rien, à tous ces reproches ; j’espère toutefois avoir mérité la reconnaissance des lecteurs qui me les feront, en les avertissant à temps de ne pas perdre une seule heure à lire un livre dont on ne saurait tirer aucun fruit si l’on ne se soumet pas aux conditions que j’ai dites ; ils le laisseront donc de côté, et avec d’autant plus de raison, qu’il y a gros à parier qu’il ne leur conviendrait pas : il est bien plutôt fait pour un groupe de pauci homines, et il devra attendre, tranquillement et modestement, de rencontrer les quelques personnes qui, par une tournure d’esprit à vrai dire singulière, seront en mesure d’en tirer parti. Car, sans parler des difficultés à vaincre et de l’effort à faire, que mon livre impose au lecteur, quel est, en ce temps-ci, où nos savants sont arrivés à cette magistrale situation d’esprit, de confondre en semble le paradoxe et l’erreur, quel est l’homme cultivé qui tolérerait d’entrer en relations avec une pensée avec laquelle il se trouverait en désaccord sur tous les points à peu près où il a son siège fait et où il croit posséder la vérité ? Et en outre, quelle ne serait pas la désillusion de ceux qui, ayant pris l’ouvrage sur son titre, n’y trouveraient rien de ce qu’ils s’attendaient à y trouver, par cette seule raison qu’ils ont appris l’art de spéculer chez un grand philosophe2, auteur de livres attendrissants, mais qui a une seule petite faiblesse : c’est de prendre toutes les idées qu’il a apprises et reçues dans son esprit avant l’âge de quinze ans, comme autant de pensées fondamentales et innées de l’esprit humain. En vérité, la déception ici encore serait trop forte. Aussi mon avis aux lecteurs en question est bien formel : qu’ils mettent mon livre de côté.
Mais je sens qu’ils ne me tiendront pas quitte à si bon compte. Voilà un lecteur qui est arrivé à la fin d’une préface, pour y trouver le conseil ci-dessus : il n’en a pas moins dépensé son bel argent blanc ; comment pourra-t-il rentrer dans ses frais ? — Je n’ai plus qu’un moyen de m’en tirer : je lui rappellerai qu’il y a bien des moyens d’utiliser un livre en dehors de celui qui consiste à le lire. Celui-ci pourra, à l’instar de beaucoup d’autres, servir à remplir un vide dans sa bibliothèque : proprement relié, il y fera bonne figure. Ou bien, s’il a quelque amie éclairée, il pourra le déposer sur sa table à ouvrage ou sur sa table à thé. Ou bien enfin, — ce qui vaudrait mieux que tout et ce que je lui recommande tout particulièrement, — il pourra en faire un compte-rendu critique.
Ceci soit dit pour plaisanter : mais, dans cette existence dont on ne sait si l’on doit rire ou pleurer, il faut bien faire à la plaisanterie sa part ; il n’est pas un journal assez grave pour s’y refuser. Maintenant, pour revenir au sérieux, je présente ce livre au public avec la ferme conviction que tôt ou tard il rencontrera ceux pour qui seuls il est fait ; au surplus, je me repose tranquillement sur cette pensée, qu’il aura lui aussi la destinée réservée à toute vérité, à quelque ordre de savoir qu’elle se rapporte, et fût-ce au plus important : pour elle un triomphe d’un instant sépare seul le long espace de temps où elle fut taxée de paradoxe, de celui où elle sera rabaissée au rang des banalités. Quant à l’inventeur, le plus souvent il ne voit de ces trois époques que la première ; mais qu’importe ? si l’existence humaine est courte, la vérité a les bras longs et la vie dure : disons donc la vérité.
Écrit à Dresde, août 1818.
1Cet ouvrage a été traduit en français par M. Cantacuzène. Un vol. in-8, Germer Baillière (1882).
2Jacobi.
Préface de la deuxième édition
Ce n’est pas à mes contemporains, ce n’est pas à mes compatriotes, c’est à l’humanité que j’offre mon œuvre cette fois achevée, dans l’espérance qu’elle en pourra tirer quelque fruit : si tard que ce soit, il ne m’importe, car tel est le lot ordinaire de toute œuvre bonne en quelque genre que ce soit, d’avoir beaucoup à attendre pour être reconnue telle. Oui, c’est pour l’humanité, non pour la génération qui passe, tout occupée de son rêve d’un instant, que ma tête a, presque contre le gré de ma volonté, consacré toute une longue vie d’un travail ininterrompu à ce livre. Il est vrai que le public, tout ce temps durant, n’y a pas pris intérêt ; mais je ne vais pas là-dessus prendre le change : je n’ai cessé de voir d’autre part le faux, le mauvais, et à la fin l’absurdité et le non-sens1, entourés de l’admiration et du respect universel ; j’ai de la sorte appris ceci : qu’il faut bien que les esprits capables de reconnaître ce qui est solide et juste soient tout à fait rares, rares au point qu’on peut passer douze années à en chercher autour de soi sans en trouver ; sans quoi il ne se pourrait pas que les esprits capables de produire les œuvres justes et solides fussent eux-mêmes assez rares, pour que leurs œuvres fissent exception et saillie au milieu du cours banal des choses terrestres, et pour qu’enfin ils pussent compter sur la postérité, perspective qui leur est indispensable pour refaire et revivifier leurs forces. — Celui qui prend à cœur, qui prend en main une œuvre sans utilité matérielle, doit d’abord n’attendre aucun intérêt de la part de ses contemporains. Ce à quoi il peut s’attendre, par exemple, c’est à voir une apparence vaine de la réalité qu’il cherche se présenter, se faire accepter, avoir son jour de succès : ce qui d’ailleurs est dans l’ordre. Car la réalité en elle-même ne doit être cherchée que pour elle-même : sans quoi on ne la trouvera pas, car toute préoccupation nuit à la pénétration. Aussi, et l’histoire de la littérature en fait foi, il n’est nulle œuvre de valeur qui, pour arriver à sa pleine valeur, n’ait réclamé beaucoup de temps, cela surtout quand elle était du genre instructif et non du genre divertissant ; et pendant ce temps, le faux brillait d’un grand éclat. Il y aurait bien un moyen : ce serait d’unir la réalité avec l’apparence de la réalité ; mais cela est difficile et parfois impossible.
C’est la malédiction de ce monde de la nécessité et du besoin, que tout doit servir des besoins, faire la corvée pour eux : aussi, par sa nature même, il ne permet pas qu’un effort noble et élevé, quel qu’il soit, ainsi l’effort de l’esprit vers la lumière et la vérité, se déploie sans obstacle, ou puisse seulement s’exercer pour lui-même. Non pas : dès que pareille chose s’est manifestée, dès que l’idée en a été introduite par un exemple, aussitôt les intérêts matériels, les desseins personnels, s’ingénient à s’en servir soit comme d’un instrument, soit comme d’un masque. Il était donc naturel, dès que Kant eut rénové aux yeux de tous la philosophie, qu’elle devînt un instrument pour de certains intérêts : intérêts d’État en haut, intérêts individuels en bas ; — pour préciser, ce n’est pas elle qui a subi ce sort ; c’est celle que j’appelle son double. Tout cela ne peut nous étonner : les hommes ne sont, pour une majorité énorme, incroyable, capables par nature même que de buts matériels : ils n’en peuvent concevoir d’autres. Par conséquent, l’effort dont nous parlons, vers la vérité seule, est trop haut, trop exceptionnel, pour qu’on puisse s’attendre à voir la totalité des hommes, ou un grand nombre, ou seulement même quelques-uns, y prendre intérêt. Si, malgré cela, on voit parfois, comme il arrive aujourd’hui en Allemagne, un grand déploiement d’activité dépensée à étudier, à écrire, à discourir des choses de la philosophie, on peut de confiance affirmer que le véritable primum mobile, le ressort caché de tout ce mouvement, si l’on veut bien mettre de côté les grands airs et les déclarations pompeuses, c’est quelque but tout réel et nullement idéal, un intérêt individuel, un intérêt de corporation, d’Église, d’État, mais bref un intérêt matériel ; que, par suite, ce qui met en train toutes les plumes de nos prétendus savants universels, ce sont des raisons de parti, des visées, et non des vues ; et qu’enfin, dans toute cette troupe en émoi, la dernière chose dont on se préoccupe, c’est la vérité. Celle-ci ne rencontre point de partisans, et, dans l’ardeur de cette mêlée philosophique, elle peut suivre paisiblement son chemin, aussi inaperçue qu’elle l’eût été dans la froide nuit du siècle le plus ténébreux emprisonné dans les dogmes d’Église les plus étroits, dans ces âges où elle n’était transmise qu’à un petit nombre d’initiés, comme une doctrine occulte, qu’on n’osait bien souvent confier qu’au parchemin. Aucun temps, j’ose le dire, n’est moins favorable à la philosophie que celui où elle est indignement exploitée ou comme moyen de gouvernement, ou comme simple gagne-pain. Imagine-t-on que dans une telle poussée et une semblable cohue, la vérité, dont nul n’a souci, va surgir par-dessus le marché ? Mais la vérité n’est pas une fille qui saute au cou de qui ne la désire pas ; c’est plutôt une fière beauté, à qui l’on peut tout sacrifier, sans être assuré pour cela de la moindre faveur.
Tandis que les gouvernements font de la philosophie un instrument de politique, les professeurs de philosophie voient dans leur enseignement un métier comme un autre, qui nourrit son homme ; ils se poussent donc vers les chaires, protestant de leurs bonnes intentions, c’est-à-dire de leur dévouement aux projets des hommes d’État. Et ils tiennent leurs engagements : ce n’est ni la vérité, ni l’évidence, ni Platon, ni Aristote, mais uniquement la politique à laquelle ils sont inféodés qui devient leur étoile, leur critérium décisif, pour juger du vrai, du bon, du remarquable ou du contraire. Tout ce qui ne répond pas au programme accepté, fût-ce l’œuvre la plus considérable et la plus merveilleuse en telle matière, est condamné, ou, s’il y a péril à le faire, étouffé dans un silence universel. Voyez leur levée de boucliers contre le panthéisme : qui donc serait assez simple pour l’attribuer à une conviction personnelle ? Mais aussi, comment la philosophie, devenue un gagne-pain, ne dégénérerait-elle pas en sophistique ? C’est en vertu de cette nécessité, et parce que la maxime : « Je chante celui dont je mange le pain », est éternellement vraie, que les anciens voyaient dans le trafic de la sagesse la marque distinctive du sophiste. Ajoutez à cela qu’en ce bas monde il est ordinaire de rencontrer presque partout la médiocrité : elle seule peut raisonnablement s’acheter à prix d’argent ; il faut donc, ici comme ailleurs, savoir s’en contenter. Aussi voyons nous dans toutes les universités allemandes cette aimable médiocrité travailler, par des procédés à elle, à créer la philosophie qui n’existe pas encore, et cela sur un type et un plan prescrits d’avance, — spectacle dont il y aurait quelque cruauté à se moquer.
Tandis que la philosophie, depuis longtemps déjà, était ainsi asservie à des intérêts généraux ou personnels, j’ai, pour mon compte, suivi paisiblement le cours de mes méditations ; il est vrai de dire que j’y étais comme contraint et entraîné par une sorte d’instinct irrésistible. Mais cet instinct était fortifié d’une conviction réfléchie : j’estimais que la vérité qu’un homme a découverte, ou la lumière qu’il a projetée sur quelque point obscur, peut un jour frapper un autre être pensant, l’émouvoir, le réjouir et le consoler ; c’est à lui qu’on parle, comme nous ont parlé d’autres esprits semblables à nous et qui nous ont consolés nous-mêmes dans ce désert de la vie. En attendant, on poursuit sa tâche et pour elle et pour soi. Mais, privilège singulier et remarquable des conceptions philosophiques ! celles-là seules qu’on a élaborées et approfondies pour son propre compte peuvent ensuite profiter aux autres, et jamais celles qui de prime abord leur sont destinées. Les premières sont aisément reconnaissables à la parfaite sincérité dont elles sont empreintes : rarement est-on disposé à se duper soi-même, et à se servir, comme on dit, des noix vides. — Par suite, aucune trace de sophisme, aucun verbiage dans les écrits : toute phrase confiée au papier paie aussitôt de sa peine celui qui la lit. De là cet éclatant caractère de loyauté et de franchise dont mes œuvres sont comme marquées au front : par ce premier trait elles contrastent déjà vivement avec celles des trois grands sophistes de la période post-kantienne.
Mon point de vue est uniquement celui de la réflexion, consultation de la raison toujours fidèlement communiquée, jamais je ne recours à l’inspiration, qu’on décore du titre d’intuition intellectuelle ou de connaissance absolue, mais dont le véritable nom serait jactance vide et charlatanisme. Animé de cet esprit, et témoin en même temps de la faveur universelle que rencontraient la fausse et la mauvaise philosophie, des honneurs accordés à cette jactance 2 et à ce charlatanisme3, j’ai depuis longtemps renoncé aux suffrages de mes contemporains. Comment une génération qui a pendant vingt ans proclamé un Hegel, ce Caliban intellectuel, le plus grand des philosophes, qui a fait retentir de ses louanges l’Europe entière, comment, dis-je, cette génération pourrait-elle rendre jaloux de ses applaudissements le spectateur d’une pareille comédie ? Elle n’a plus de couronnes de gloire à décerner ; sa faveur est prostituée, son mépris sans effet. Le sérieux de mes paroles a pour garant ma conduite : si je m’étais le moins du monde soucié de l’approbation de mes contemporains, j’aurais supprimé vingt passages de mes écrits qui heurtent de front toutes les idées reçues, et même ont parfois quelque chose de blessant. Mais je regarderais comme un crime d’en sacrifier une syllabe, pour me concilier la faveur du public. Jamais je n’ai eu qu’un guide, la vérité : en m’attachant à la suivre, je ne pouvais compter sur une autre estime que la mienne propre ; aussi détournais-je les yeux de la décadence intellectuelle du siècle et de la corruption presque universelle de notre littérature, où l’art d’adapter aux petites pensées les grands mots a été conduit au plus haut point. Si, malgré tout, je ne puis me flatter d’avoir échappé aux imperfections et aux défaillances qui me sont naturelles, tout au moins ne les aurai-je pas aggravées par d’indignes compromis.
Pour ce qui regarde cette seconde édition, je me félicite de n’avoir, après vingt-cinq années écoulées, rien à y retrancher : mes convictions essentielles ont donc, pour moi du moins, subi l’épreuve du temps. — Les changements introduits dans le premier volume4, qui à lui seul reproduit tout le contenu de la première édition, ces changements, dis-je, ne portent jamais sur le fond, mais uniquement sur des détails accessoires ; ils consistent presque toujours en quelques brèves explications ajoutées çà et là au texte. — Seule la critique de la philosophie kantienne a été considérablement remaniée et éclaircie par de nouveaux développements ; ces additions n’auraient pu trouver place dans un supplément isolé, analogue à ceux que j’ai réunis dans le second volume, et qui forment un appendice à chacun des livres du premier, où j’expose ma doctrine personnelle. Si j’ai adopté pour ceux-ci un tel système de corrections et de développements, c’est que, durant les vingt-cinq années qui en ont suivi la première rédaction, ma méthode et ma manière d’exposer se sont tellement modifiées, qu’il m’eût été à peu près impossible de fondre en un tout unique les matières du premier et du second volume : une telle synthèse eût été aussi préjudiciable à l’un qu’à l’autre. Je donne donc séparément les deux œuvres, et souvent je n’ai rien changé à la première exposition, là où je parlerais aujourd’hui d’autre sorte ; c’est que je n’ai pas voulu gâter par la critique méticuleuse de la vieillesse l’œuvre de mes jeunes années. — Les corrections nécessaires à ce point de vue s’offriront d’elles-mêmes à l’esprit du lecteur avec le secours du second volume. Ils se complètent l’un l’autre, dans la plus entière acception du mot et offrent, au point de vue de la pensée, la même relation que les deux âges qu’ils représentent.
Ainsi, non seulement chacun des deux volumes renferme ce qu’on ne trouve pas dans l’autre, mais encore les mérites de l’un sont précisément ceux qui chez l’autre font défaut. Si donc la première partie de mon œuvre est supérieure à la seconde par les qualités qui sont le propre de l’ardeur juvénile et de la vigueur native de la pensée, en revanche la seconde l’emporte sur elle par la maturité et la lente élaboration des idées, le fruit d’une longue expérience et d’un effort persévérant. À l’âge où j’avais la force de concevoir tout d’une pièce l’idée fondamentale de mon système, puis de la poursuivre dans ses quatre ramifications pour revenir ensuite à leur tronc commun, enfin de la développer avec clarté dans son ensemble, alors j’étais incapable de parfaire toutes les parties de mon œuvre avec cette exactitude, cette pénétration et cette ampleur, que peut seule donner une méditation prolongée ; condition nécessaire pour éprouver une doctrine, pour l’éclairer de faits nombreux et de documents variés, pour en mettre en lumière tous les aspects, en faire ressortir dans un puissant contraste les perspectives diverses, enfin pour en distinguer avec netteté les éléments et les disposer dans le meilleur ordre possible. Je reconnais qu’il eût sans doute été plus agréable pour le lecteur d’avoir entre les mains un ouvrage venu d’un seul jet que deux moitiés de livre, dont on ne peut se servir qu’en les rapprochant l’une de l’autre ; mais je le prie de considérer qu’il m’eût fallu pour cela produire, à un moment donné de mon existence, ce qui ne pouvait l’être qu’à deux moments différents, autrement dit, réunir au même âge les dons que la nature a départis à deux périodes distinctes de la vie humaine. Je ne saurais mieux comparer cette nécessité de publier mon œuvre en deux parties complémentaires l’une de l’autre qu’au procédé employé pour rendre achromatique l’objectif d’une lunette, que l’on ne peut construire d’une seule pièce : on l’a obtenu par la combinaison d’une lentille concave de flint avec une lentille convexe de crown, et les propriétés réunies des deux lentilles ont amené le résultat désiré. — Au reste, l’ennui qu’éprouvera le lecteur d’avoir en main deux volumes à la fois sera peut-être compensé par la variété et le délassement que procure d’ordinaire un même sujet, conçu dans la même tête et développé par le même esprit, mais à des âges fort différents. Il y a intérêt cependant, pour celui qui n’est pas encore familiarisé avec ma philosophie, de commencer par lire le premier volume en entier, sans s’inquiéter des Suppléments, et de n’y recourir qu’après une seconde lecture ; autrement il embrasserait difficilement le système dans son ensemble, tel qu’il n’apparaît que dans le premier volume ; le second, au contraire, ne présente que les points essentiels de la doctrine confirmés par plus de détails et de plus amples développements.
Au cas où l’on ne serait pas disposé à relire le premier volume, on ferait bien néanmoins de ne prendre connaissance du second qu’après avoir achevé le premier et de le lire à part dans l’ordre de succession des chapitres. Ceux-ci, il est vrai, ne se relient pas toujours très étroitement entre eux, mais il sera facile de suppléer à cet enchaînement par les souvenirs du premier volume, si une fois on s’en est bien pénétré ; d’ailleurs, on trouvera partout des renvois aux passages correspondants de ce premier volume, et à cet effet j’ai substitué dans la seconde édition des paragraphes numérotés aux simples traits qui marquaient les divisions dans la première.
Déjà dans la préface de la première édition, j’ai déclaré que ma philosophie procède de celle de Kant, et suppose par suite une connaissance approfondie de cette dernière ; je tiens à le répéter ici. Car la doctrine de Kant bien comprise amène dans tout esprit un changement d’idées si radical, qu’on y peut voir une véritable rénovation intellectuelle ; elle seule, en effet, a la puissance de nous délivrer entièrement de ce réalisme instinctif, qui semble résulter de la destination primitive de l’intelligence : c’est une entreprise à laquelle ni Berkeley ni Malebranche ne sauraient suffire, enfermés qu’ils sont l’un et l’autre dans les généralités : Kant, au contraire, descend dans les derniers détails, et cela avec une méthode qui ne comporte pas plus d’imitation qu’elle n’a eu de modèle ; sa vertu sur l’esprit est singulière et pour ainsi dire instantanée ; elle arrive à le désabuser absolument de ses illusions et à lui faire voir toutes choses sous un jour entièrement nouveau. Et c’est ainsi qu’il se trouve tout préparé aux solutions plus positives encore que j’apporte. D’autre part, celui qui ne s’est pas assimilé la doctrine de Kant, quelle que puisse être d’ailleurs sa pratique de la philosophie, est encore dans une sorte d’innocence primitive : il n’est pas sorti de ce réalisme naïf et enfantin que nous apportons tous en naissant ; il peut être propre à tout, hormis à philosopher. Il est au premier ce que le jeune homme mineur est au majeur. Si cette vérité a aujourd’hui un air de paradoxe, on en jugeait autrement dans les trente premières années qui ont suivi l’apparition de la Critique de la raison pure : c’est que, depuis cette époque, a grandi une génération qui, à vrai dire, ne connaît pas Kant. Pour le comprendre, il ne suffit pas, en effet, d’une lecture rapide et superficielle ou d’une exposition de seconde main. Ce fait, d’autre part, est le résultat de la mauvaise direction imprimée aux intelligences, à qui l’on a fait perdre leur temps sur les conceptions d’esprits médiocres et par suite incompétents, ou, qui pis est, de sophistes hâbleurs, indignement vantés. De là cette inexprimable confusion dans les principes premiers de la science, pour tout dire, cette épaisse grossièreté de pensée mal déguisée sous la prétention et la préciosité de la forme, et qui caractérise les œuvres philosophiques d’une génération élevée à pareille école. Or, c’est une déplorable illusion de croire qu’une doctrine comme celle de Kant puisse être étudiée ailleurs que dans les textes originaux. Je dois même dénoncer au public les analyses qui en ont été données, et surtout les plus récentes ; il y a quelques années à peine, j’ai découvert dans les écrits de certains hégéliens des expositions de la philosophie kantienne qui touchent au fantastique. Mais aussi, comment des esprits faussés et détraqués dès la première jeunesse par les extravagances de l’hégélianisme seraient-ils encore en état de suivre les profondes spéculations d’un Kant ? Ils sont de longue main habitués à prendre pour une pensée philosophique le plus vide des bavardages, à traiter de finesse une sophistique misérable, et de dialectique un art puéril de déraisonner ; à force d’accepter les combinaisons les plus insensées de termes contradictoires, où l’esprit se torture et s’épuise inutilement à découvrir un sens intelligible, ils en sont arrivés à se fêler le cerveau. Ce n’est pas d’une critique de la raison, d’une philosophie qu’ils auraient besoin, mais bien d’une medicina mentis, et d’abord, en guise de purgatif, d’un petit cours de sens-communologie5 ; après quoi on verrait s’il y a lieu de leur parler philosophie. C’est donc en vain que la doctrine de Kant serait cherchée ailleurs que dans ses propres ouvrages, toujours féconds en enseignements, même quand ils contiennent des fautes ou des erreurs. C’est surtout de son originalité qu’on doit dire, ce qui s’applique d’ailleurs à tout vrai philosophe, qu’il ne peut être connu que par ses propres écrits, et jamais par ceux des autres. Car les pensées des intelligences d’élite ne se prêtent pas au filtrage à travers un esprit ordinaire. Conçues sous ces fronts larges, élevés et proéminents, au-dessous desquels brille une prunelle de flamme, elles perdent toute vigueur et toute vie, ne sont plus elles-mêmes, transportées entre les étroites parois de ces crânes bas, déprimés et épais, dont les regards errants semblent toujours épier quelque intérêt personnel. On ne saurait mieux comparer ces sortes de cerveaux qu’aux miroirs à surface inégale, où les objets apparaissent tout contournés et déprimés, et présentent, au lieu d’une figure aux belles proportions, une image grimaçante. Les conceptions philosophiques ne peuvent être communiquées que par les génies mêmes qui les ont créées ; et si l’on se sent attiré vers la philosophie, c’est dans l’intime sanctuaire de leurs œuvres qu’il faut aller consulter les maîtres immortels. Les chapitres essentiels des livres d’un véritable penseur jettent cent fois plus de jour sur ses doctrines que les languissantes et confuses analyses, produits d’intelligences médiocres et presque toujours entêtées du système à la mode ou d’opinions à elles. Ce qu’il y a de vraiment étonnant, c’est l’avidité et la préférence marquée du public pour ces productions de seconde main. On dirait qu’il existe une affinité élective qui attire l’un vers l’autre les êtres vulgaires ; il semble que la parole d’un grand homme leur soit plus agréable, lorsqu’elle passe par la bouche d’un de leurs pareils. Peut-être aussi pourrait-on voir là une explication du principe de l’enseignement mutuel, en vertu duquel les leçons dont les enfants profitent le mieux sont celles qu’ils reçoivent de leurs camarades.
Un dernier mot aux professeurs de philosophie. J’ai toujours admiré la pénétration, la sûreté et la délicatesse de tact qui leur ont fait envisager dès son apparition ma philosophie comme une chose absolument étrangère à leur manière de voir, et même comme une invention dangereuse, ou, pour employer une expression triviale, comme un article qu’ils ne tiennent pas dans leur boutique ; j’ai aussi beaucoup admiré la remarquable sagacité politique avec laquelle ils ont du premier coup trouvé la seule tactique praticable à mon endroit, l’ensemble parfait avec lequel ils l’ont adoptée, la fidèle persévérance qu’ils ont mise à la suivre. Ce procédé, qui se recommande d’ailleurs par sa simplicité, consiste, suivant le mot heureux de Gœthe, à affecter d’ignorer ce qu’on veut faire ignorer (im Ignoriren und dadurch sekretiren), à supprimer purement et simplement tout ce qui a quelque mérite et quelque importance. Le succès de cette tactique du silence est encore favorisé par les cris de corybantes dont les membres de la ligue philosophique saluent à tour de rôle les nouveau-nés de leur intelligence. Cela force le public à regarder de leur côté, et à remarquer de quel air d’importance ils se congratulent mutuellement. Comment méconnaître l’opportunité d’une telle conduite ? Qui donc peut trouver à redire à la maxime : Primum vivere, deinde philosophari ? Ces messieurs veulent vivre avant tout, et vivre de la philosophie, ils n’ont qu’elle pour nourrir femme et enfants, et ils courent les risques de l’aventure, malgré l’avertissement que leur donne Pétrarque : « Povera e nuda vai filosofia. » Or, ma doctrine n’est guère propre à servir de gagne-pain ; elle manque des éléments les plus essentiels à toute philosophie d’école bien rétribuée ; elle n’a pas de théologie spéculative, ce qui doit former (quoi qu’en dise cet importun de Kant dans sa Critique de la raison) le thème principal de tout enseignement philosophique ; ce qui, il est vrai, oblige aussi à parler sans cesse de choses tout à fait inconnaissables. Bien plus, je ne prends même point parti sur cette fiction si utile et aujourd’hui indispensable, qui est la découverte propre des professeurs de philosophie, je veux dire l’existence d’une raison possédant l’intuition immédiate et la connaissance absolue : il suffit pourtant d’en bien faire entrer tout d’abord l’idée dans l’esprit du lecteur pour pouvoir ensuite se lancer avec la plus grande aisance, à quatre chevaux de front, comme on dit, sur ce terrain que Kant a entièrement et définitivement interdit à l’intelligence humaine, sur ce domaine situé au-delà de toute expérience possible, où se trouvent, dès l’entrée, révélés naturellement et disposés dans le meilleur ordre, les dogmes essentiels du christianisme moderne, mêlé de judaïsme et d’optimisme. Qu’y a-t-il, je vous prie, de commun entre ma philosophie, dépourvue de ces données fondamentales, qui ne connaît aucun égard, qui ne fait pas vivre, qui se perd dans la spéculation, n’ayant pour étoile que la vérité toute nue, sans rémunération, sans amitiés, le plus souvent en butte à la persécution, et poursuivant néanmoins sa marche, sans regarder à droite ou à gauche, qu’y a-t-il de commun, je le répète, entre elle et cette bonne alma mater, cette philosophie universitaire d’excellent rapport, qui, chargée de cent intérêts et de mille ménagements divers, s’avance avec circonspection et en louvoyant, sans jamais perdre de vue la crainte du Seigneur, les volontés du ministère, les dogmes de la religion d’État, les exigences de l’éditeur, la faveur des étudiants, la bonne amitié des collègues, la marche de la politique quotidienne, l’opinion du jour et mille autres inspirations du même genre ? En quoi ma recherche calme et sévère du vrai ressemble-t-elle aux discussions dont retentissent les chaires et les bancs des écoles, et dont le secret mobile est toujours quelque ambition personnelle ? Ce sont là, j’ose le dire, deux formes radicalement distinctes de la philosophie. Aussi ne trouve-t-on chez moi aucune espèce d’accommodement, aucune camaraderie : ce qui n’arrange personne, sauf peut-être celui qui cherche uniquement la vérité. Mais ce n’est pas l’affaire des sectes philosophiques actuelles, toujours à la poursuite de quelque but utilitaire ; je n’ai à leur offrir, moi, que des vues désintéressées, qui ne peuvent en aucune façon cadrer avec leurs desseins personnels, ayant été formées en l’absence de tout dessein préconçu. Pour que ma doctrine devînt une philosophie d’école, il faudrait la venue de temps nouveaux. Il ferait beau voir aujourd’hui qu’une philosophie comme la mienne, qui ne rapporte rien, eût une place au soleil et fût un objet d’attention générale. C’est ce qu’il fallait prévenir à tout prix, et, pour cela, tous devaient marcher contre elle comme un seul homme. Mais contester et contredire des idées n’est pas toujours chose aisée, et le procédé est d’autant plus scabreux qu’il a l’inconvénient d’attirer l’attention du public sur la chose en litige : qui sait si la lecture de mes écrits ne l’eût pas dégoûté des élucubrations des professeurs de philosophie ? Car, lorsqu’une fois on a tâté des œuvres sérieuses, rarement continue-t-on à se plaire à la farce, surtout celle du genre ennuyeux. La conspiration du silence universel à laquelle on s’est arrêté était donc le seul système de défense possible ; je conseille fort de s’y tenir et de le faire durer aussi longtemps qu’il se pourra, c’est-à-dire tant que cette ignorance affectée ne sera pas soupçonnée d’être une ignorance réelle ; il sera toujours temps alors de changer de front. En attendant, il demeure loisible à chacun de dérober çà et là quelque petite plume pour s’en parer au besoin, l’exubérance de la pensée n’étant pas le mal dont nos gens ont à souffrir. La méthode du silence et de l’ignorance systématiques peut réussir assez longtemps encore, et durer au moins tout le temps qui me reste à vivre. Si, par hasard, quelque voix indiscrète a déjà protesté, elle s’est bientôt perdue dans le tapage de l’éloquence professorale, très habile à leurrer, avec des airs de gravité, le bon public, et à détourner ailleurs son attention. Je conseillerais pourtant le maintien sévère de l’union dans la défense et une active surveillance à l’égard des jeunes gens, qui sont parfois terriblement indiscrets. Je n’oserais d’ailleurs garantir l’éternel succès d’une tactique si admirable, et je ne puis répondre du dénouement final. Car c’est chose souvent bien étrange que le gouvernement de cet excellent public, si facile à mener en général. Sans doute, les Gorgias et les Hippias, maîtres de l’opinion, ont pu à peu près dans tous les temps faire triompher l’absurde, et les voix isolées sont d’ordinaire couvertes par le chœur des dupeurs et des dupés ; et pourtant, l’œuvre de bonne foi conserve toujours je ne sais quelle action extraordinaire, calme, lente et profonde ; aussi, arrive-t-elle bientôt, par une sorte de miracle, à dominer ce grand tumulte : comme on voit un ballon se dégager peu à peu des épaisses vapeurs du sol pour planer dans les pures régions, d’où aucune force humaine ne saurait le faire redescendre.
Francfort-sur-le-Mein, février 1844.
1La Philosophie de Hegel.
2Fichte et Schelling. (Note de Schopenhauer.)
3Hegel. (Note de Schopenhauer.)
4L’ouvrage comporte en allemand deux volumes ; la traduction en comprend trois ; le premier volume dont parle ici Schopenhauer embrasse donc jusqu’au milieu du second volume de la traduction.
5En français dans le texte.
Préface de la troisième édition
Le vrai et le bien feraient plus aisément leur chemin dans le monde, si ceux qui en sont incapables ne s’entendaient pour leur barrer la route. Combien d’œuvres utiles ont été déjà ou retardées ou ajournées, quand elles n’ont pas été entièrement étouffées par cet obstacle ! Cette cause a eu pour effet, en ce qui me concerne, de ne me permettre de publier qu’à l’âge de soixante-douze ans la troisième édition du présent ouvrage, dont la première remonte à ma trentième année. Je me console de ce malheur en répétant le mot de Pétrarque : « Si quid tota die currens, pervernit ad vesperam, satis est. » (De vera sapientia, p. 140.)
Et moi aussi me voilà enfin arrivé au but, et j’ai la satisfaction de voir qu’au moment où finit ma carrière, mon action commence ; j’ai aussi l’espoir que, selon une loi bien vieille, cette action sera d’autant plus durable qu’elle a été plus tardive.
Le lecteur pourra constater que rien de ce que renfermait la seconde édition n’a été supprimé dans celle-ci : elle a été, au contraire, assez considérablement augmentée, puisque, imprimée dans le même caractère, elle contient 136 pages de plus que la seconde.
Sept ans après l’apparition de cette dernière, j’ai publié deux volumes intitulés : Parerga et Paralipomena. Tous les morceaux réunis sous le second mot de ce titre ne comprennent que des additions à l’exposé systématique de ma philosophie ; ils auraient donc trouvé leur place naturelle dans les deux présents volumes ; mais force m’a été de les imprimer alors n’importe où, incertain que j’étais de vivre assez pour voir cette troisième édition. Ils se trouvent dans le deuxième volume des Parerga. On les reconnaîtra aisément aux titres mêmes des chapitres.
Francfort-sur-le-Main, septembre 1859.
Préface de la quatrième édition
Schopenhauer a fait pour son livre du Monde comme volonté et comme représentation comme pour ses autres ouvrages ; il nous a laissé de la troisième édition un exemplaire, dont les pages, séparées par des feuilles, contiennent les additions et corrections à apporter à l’édition suivante. Toutefois ces annotations sont ici en moins grand nombre que celles qu’il a faites à ses autres écrits : la raison, sans doute, en est dans la circonstance que, la troisième édition du Monde comme volonté et comme représentation renferme 136 pages de plus que la seconde, la quatrième, que nous donnons ici avec le même caractère d’impression, a seulement quelques pages de plus que la troisième.
J’ai inséré les additions destinées par Schopenhauer à la présente édition tantôt aux endroits indiqués par lui-même, tantôt au bas du texte primitif.
Ces changements se bornent d’ailleurs à quelques retouches de style, à la restitution de quelques citations inexactes et à la correction des fautes d’impression laissées dans la troisième édition.
La quatrième édition que nous publions de l’œuvre principale de Schopenhauer offre donc, en général, assez peu de différences avec la troisième.
Berlin, mai 1873.
Julius FRAUENSTAEDT.
Livre I
Le Monde comme représentation, premier point de vue.
La représentation soumise au principe de raison suffisante : l’objet de l’expérience et de la science.
Sors de ton enfance, ami, réveille-toi.
(J.-J.Rousseau)
Chapitre 1
Le monde est ma représentation. — Cette proposition est une vérité pour tout être vivant et pensant, bien que, chez l’homme seul, elle arrive à se transformer en connaissance abstraite et réfléchie. Dès qu’il est capable de l’amener à cet état, on peut dire que l’esprit philosophique est né en lui. Il possède alors l’entière certitude de ne connaître ni un soleil ni une terre, mais seulement un œil qui voit ce soleil, une main qui touche cette terre ; il sait, en un mot, que le monde dont il est entouré n’existe que comme représentation, dans son rapport avec un être percevant, qui est l’homme lui-même. S’il est une vérité qu’on puisse affirmer a priori, c’est bien celle-là ; car elle exprime le mode de toute expérience possible et imaginable, concept de beaucoup plus général que ceux même de temps, d’espace et de causalité qui l’impliquent. Chacun de ces concepts, en effet, dans lesquels nous avons reconnu des formes diverses du principe de raison, n’est applicable qu’à un ordre déterminé de représentations ; la distinction du sujet et de l’objet, au contraire, est le mode commun à toutes, le seul sous lequel on puisse concevoir une représentation quelconque, abstraite ou intuitive, rationnelle ou empirique. Aucune vérité n’est donc plus certaine, plus absolue, plus évidente que celle-ci : tout ce qui existe existe pour la pensée, c’est-à-dire, l’univers entier n’est objet qu’à l’égard d’un sujet, perception que par rapport à un esprit percevant, en un mot, il est pure représentation.
Cette loi s’applique naturellement à tout le présent, à tout le passé et à tout l’avenir, à ce qui est loin comme à ce qui est près de nous ; car elle est vraie du temps et de l’espace eux-mêmes, grâce auxquels les représentations particulières se distinguent les unes des autres. Tout ce que le monde renferme ou peut renfermer est dans cette dépendance nécessaire vis-à-vis du sujet et n’existe que pour le sujet. Le monde est donc représentation.
Cette vérité est d’ailleurs loin d’être neuve. Elle fait déjà le fond des considérations sceptiques d’où procède la philosophie de Descartes. Mais ce fut Berkeley qui le premier la formula d’une manière catégorique ; par là il a rendu à la philosophie un immortel service, encore que le reste de ses doctrines ne mérite guère de vivre. Le grand tort de Kant, comme je l’expose dans l’Appendice qui lui est consacré, a été de méconnaître ce principe fondamental.
En revanche, cette importante vérité a été de bonne heure admise par les sages de l’Inde, puisqu’elle apparaît comme la base même de la philosophie védanta, attribuée à Vyâsa. Nous avons sur ce point le témoignage de W. Jones, dans sa dernière dissertation ayant pour objet la philosophie asiatique : « Le dogme essentiel de l’école védanta consistait, non à nier l’existence de la matière, c’est-à-dire de la solidité, de l’impénétrabilité, de l’étendue (négation qui, en effet, serait absurde), mais seulement à réformer sur ce point l’opinion vulgaire, et à soutenir que cette matière n’a pas une réalité indépendante de la perception de l’esprit, existence et perceptibilité étant deux termes équivalents 1. »
Cette simple indication montre suffisamment dans le védantisme le réalisme empirique associé à l’idéalisme transcendantal. C’est à cet unique point de vue et comme pure représentation que le monde sera étudié dans ce premier livre. Une telle conception, absolument vraie d’ailleurs en elle-même, est cependant exclusive et résulte d’une abstraction volontairement opérée par l’esprit ; la meilleure preuve en est dans la répugnance naturelle des hommes à admettre que le monde ne soit qu’une simple représentation, idée néanmoins incontestable. Mais cette vue, qui ne porte que sur une face des choses, sera complétée dans le livre suivant par une autre vérité, moins évidente, il faut l’avouer, que la première ; la seconde demande, en effet, pour être comprise, une recherche plus approfondie, un plus grand effort d’abstraction, enfin une dissociation des éléments hétérogènes accompagnée d’une synthèse des principes semblables. Cette austère vérité, bien propre à faire réfléchir l’homme, sinon à le faire trembler, voici comment il peut et doit l’énoncer à côté de l’autre : « Le monde est ma volonté. »
En attendant, il nous faut, dans ce premier livre, envisager le monde sous un seul de ses aspects, celui qui sert de point de départ à notre théorie, c’est-à-dire la propriété qu’il possède d’être pensé. Nous devons, dès lors, considérer tous les objets présents, y compris notre propre corps (ceci sera développé plus loin), comme autant de représentations et ne jamais les appeler d’un autre nom. La seule chose dont il soit fait abstraction ici (chacun, j’espère, s’en pourra convaincre par la suite), c’est uniquement la volonté, qui constitue l’autre côté du monde : à un premier point de vue, en effet, ce monde n’existe absolument que comme représentation ; à un autre point de vue, il n’existe que comme volonté. Une réalité qui ne peut se ramener ni au premier ni au second de ces éléments, qui serait un objet en soi (et c’est malheureusement la déplorable transformation qu’a subie, entre les mains même de Kant, sa chose en soi), cette prétendue réalité, dis-je, est une pure chimère, un feu follet propre seulement à égarer la philosophie qui lui fait accueil.
1« The fundamental tenet of the Vedanta school consisted not in denying the existence of matter, that is of solidity, impenetrability, and extended figure (to deny which would be lunacy), but in correcting the popular opinion of it, and in contending that it has no essence independent of mental perception ; that existence and perceptibility are convertible terms. » (Asiatic researches, vol. IV, p. 164.)
Chapitre 2
Ce qui connaît tout le reste, sans être soi-même connu, c’est le sujet. Le sujet est, par suite, le substratum du monde, la condition invariable, toujours sous-entendue de tout phénomène, de tout objet ; car tout ce qui existe, existe seulement pour le sujet. Ce sujet, chacun le trouve en soi, en tant du moins qu’il connaît, non en tant qu’il est objet de connaissance. Notre propre corps lui-même est déjà un objet, et, par suite, mérite le nom de représentation. Il n’est, en effet, qu’un objet parmi d’autres objets, soumis aux mêmes lois que ceux-ci ; c’est seulement un objet immédiat 1. Comme tout objet d’intuition, il est soumis aux conditions formelles de la pensée, le temps et l’espace, d’où naît la pluralité.
Mais le sujet lui-même, le principe qui connaît sans être connu, ne tombe pas sous ces conditions ; car il est toujours supposé implicitement par elles. On ne peut lui appliquer ni la pluralité, ni la catégorie opposée, l’unité. Nous ne connaissons donc jamais le sujet ; c’est lui qui connaît, partout où il y a connaissance.
Le monde, considéré comme représentation, seul point de vue qui nous occupe ici, comprend deux moitiés essentielles, nécessaires et inséparables. La première est l’objet qui a pour forme l’espace, le temps, et par suite la pluralité ; la seconde est le sujet qui échappe à la double loi du temps et de l’espace, étant toujours tout entier et indivisible dans chaque être percevant. Il s’ensuit qu’un seul sujet, plus l’objet, suffirait à constituer le monde considéré comme représentation, aussi complètement que les millions de sujets qui existent ; mais que cet unique sujet percevant disparaisse, et, du même coup, le monde conçu comme représentation disparaît aussi. Ces deux moitiés sont donc inséparables, même dans la pensée ; chacune d’elles n’est réelle et intelligible que par l’autre et pour l’autre ; elles existent et cessent d’exister ensemble. Elles se limitent réciproquement : où commence l’objet, le sujet finit. Cette mutuelle limitation apparaît dans le fait que les formes générales essentielles à tout objet : temps, espace et causalité, peuvent se tirer et se déduire entièrement du sujet lui-même, abstraction faite de l’objet : ce qu’on peut traduire dans la langue de Kant, en disant qu’elles se trouvent a priori dans notre conscience. De tous les services rendus par Kant à la philosophie, le plus grand est peut-être dans cette découverte. À cette vue, j’ajoute, pour ma part, que le principe de raison est l’expression générale de toutes ces conditions formelles de l’objet, connues a priori ; que toute connaissance purement a priori se ramène au contenu de ce principe, avec tout ce qu’il implique ; en un mot, qu’en lui est concentrée toute la certitude de notre science a priori. J’ai expliqué en détail, dans ma Dissertation sur le principe de raison, comment il est la condition de tout objet possible ; ce qui signifie qu’un objet quelconque est lié nécessairement à d’autres, étant déterminé par eux et les déterminant à son tour. Cette loi est si vraie que toute la réalité des objets en tant qu’objets ou simples représentations consiste uniquement dans ce rapport de détermination nécessaire et réciproque : cette réalité est donc purement relative. Nous aurons bientôt l’occasion de développer cette idée. J’ai montré, de plus, que cette relation nécessaire, exprimée d’une manière générale par le principe de raison, revêt des formes diverses, selon la différence des classes où viennent se ranger les objets au point de vue de leur possibilité, nouvelle preuve de la répartition exacte de ces classes. Je suppose toujours implicitement, dans le présent ouvrage, que tout ce que j’ai écrit dans cette dissertation est connu et présent à l’esprit du lecteur. Si je n’avais pas exposé ailleurs ces idées, elles auraient ici leur place naturelle.
1La quadruple racine du principe de raison