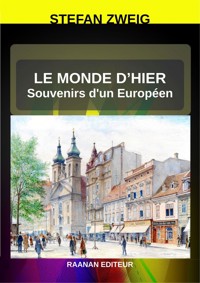
1,50 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Le Monde d'hier. Souvenirs d'un Européen est une autobiographie de l'écrivain autrichien Stefan Zweig parue en 1943. L'ouvrage commence par la description de Vienne à la fin du XIXe siècle et celle du milieu familial qui a vu naître Stefan Zweig et se poursuit jusqu'à la déclaration de la Seconde Guerre mondiale, en septembre 1939. |Source Wikipédia| Résumé bref Le Monde d'hier décrit avec nostalgie la Vienne et l'Europe d'avant 1914 : une Europe insouciante, traditionnelle, conventionnelle, artistique, à l'apogée de sa richesse et de sa puissance dont Zweig est un témoin privilégié, fréquentant Freud, Verhaeren, Rilke ou Valéry. Le livre décrit une époque de stabilité et de liberté d'esprit, qui va voir cet « âge d'or de sécurité » s'effondrer avec les deux guerres mondiales et la disparition des monarchies européennes. En bref, la mort d'une civilisation qui avait pourtant une si grande confiance en l'avenir.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Table of Contents
PRÉFACE
LE MONDE DE LA SÉCURITÉ
L’ÉCOLE AU SIÈCLE PASSÉ
EROS MATUTINUS
UNIVERSITAS VITÆ
PARIS, LA VILLE DE L’ÉTERNELLE JEUNESSE
DÉTOURS SUR LE CHEMIN QUI ME RAMÈNE À MOI
PAR DELÀ LES FRONTIÈRES DE L’EUROPE
LES RAYONS ET LES OMBRES SUR L’EUROPE
LES PREMIERS JOURS DE LA GUERRE DE 1914
LA LUTTE POUR LA FRATERNITÉ SPIRITUELLE
AU CŒUR DE L’EUROPE
RETOUR EN AUTRICHE
DE NOUVEAU PAR LE MONDE
COUCHER DE SOLEIL
INCIPIT HITLER
L’AGONIE DE LA PAIX
Notes
STEFAN ZWEIG
LE MONDE D’HIER
Paris 1943
Traducteur Jean-Paul Zimmermann
Raanan Éditeur
Livre 1206 | édition 1
raananediteur.com
Faisons face au temps
comme il nous cherche.
SHAKESPEARE : Cymbeline.
PRÉFACE
Je n’ai jamais attaché à ma personne assez d’importance pour être tenté de raconter aux autres l’histoire de ma vie. Il a fallu qu’il se passât beaucoup de choses, une somme d’événements, de catastrophes et d’épreuves telles que rarement génération d’homme en aura vécu de pareilles, pour me donner le courage de commencer un livre qui eût pour personnage principal ou, plus exactement, pour centre mon propre moi. Rien n’est plus éloigné de mon dessein que de me mettre ainsi en évidence, sinon en qualité de commentateur du film qui se déroule ; le temps produit les images, je me borne à un mot d’explication, et ce n’est pas tant mon destin que je raconte que celui de toute une génération, notre génération singulière et chargée de destinée comme peu d’autres l’ont été au cours de l’histoire. Chacun de nous, même le plus infime et le plus humble de tous, a été bouleversé dans son être intime par les soubresauts volcaniques qui ont presque sans relâche agité notre terre européenne ; et moi, confondu dans la multitude, je ne me reconnais que ce seul privilège : en ma qualité d’Autrichien, de Juif, d’écrivain, d’humaniste et de pacifiste, je me suis toujours trouvé présent là où ces secousses sismiques se produisaient avec le plus de violence. Par trois fois elles ont bouleversé mon foyer et mon existence, m’ont, avec leur dramatique véhémence, détaché de tout mon passé et précipité dans le vide, dans ce pays qui m’était déjà bien connu où le désarroi fait s’écrier : « Je ne sais où aller. » Mais je ne m’en plains pas : le sans-patrie en un certain sens se trouve libéré, et celui qui n’a plus d’attache n’a plus à avoir égard à rien. J’espère ainsi remplir une des conditions essentielles à toute peinture loyale de notre époque : la sincérité et l’impartialité.
Car si jamais quelqu’un se trouva retranché de toutes racines, et même de la terre qui a nourri ces racines, véritablement ce fut moi. Je suis né en 1881 dans un grand et puissant empire, celui des Habsbourg ; mais qu’on ne le cherche pas sur la carte ; il en a été effacé sans laisser de traces. J’ai été élevé à Vienne, la métropole deux fois millénaire, souveraine de plusieurs nations, et il m’a fallu la quitter comme un criminel avant qu’elle fût humiliée jusqu’à n’être plus qu’une ville de province allemande. Mon œuvre littéraire, dans sa langue originale, a été réduite en cendres et dans le pays même où mes livres s’étaient fait des amis de millions de lecteurs. C’est ainsi que je n’ai plus de lien nulle part, étranger partout, hôte tout au plus là où le sort m’est le moins hostile ; même la vraie patrie que mon cœur a élue, l’Europe, est perdue pour moi depuis que pour la seconde fois, prise de la fièvre du suicide, elle se déchire dans une guerre fratricide. Contre ma volonté j’ai été le témoin de la plus effroyable défaite de la raison et du plus sauvage triomphe de la brutalité qu’atteste la chronique des temps ; jamais, – je ne le note point avec orgueil, mais avec un sentiment de honte, – une génération n’est tombée comme la nôtre d’une telle puissance intellectuelle dans une telle décadence morale. Durant ce peu d’années au cours desquelles ma barbe, ayant commencé de pousser, s’est mise à grisonner, durant ce dernier demi-siècle, il s’est produit plus de transformations radicales qu’en d’autres temps au cours de dix âges d’hommes, et chacun de nous le sent : il s’est produit presque trop de choses ! Mon aujourd’hui est si différent de chacun de mes hier, avec mon ascension et mes chutes, qu’il me semble parfois avoir vécu non pas une existence, mais plusieurs existences toutes diverses. Car il m’arrive souvent que, disant, sans y prendre garde : « Ma vie », je me demande involontairement : « Laquelle de mes vies ? » Celle d’avant la guerre mondiale, celle d’avant la première ou d’avant la seconde, ou encore ma vie de maintenant ? Puis je me surprends à dire : « Ma maison », et je ne puis décider sur-le-champ de laquelle de mes anciennes demeures j’entendais parler, de celle de Bath ou de Salzbourg, ou de ma maison paternelle à Vienne ; ou encore si je dis « chez nous », il me souvient avec effroi que depuis longtemps je ne suis pas plus intégré aux gens de ma patrie qu’aux Anglais ou aux Américains, que je ne suis plus relié organiquement à ceux de là-bas, et qu’ici je ne saurais jamais trouver mon rang et ma place assurés ; le monde au milieu duquel j’ai grandi, et celui d’aujourd’hui, et ceux qui s’insèrent entre ces deux extrêmes, se séparent de plus en plus dans mon sentiment en autant de mondes totalement distincts ; chaque fois qu’au cours d’une conversation je rapporte à de jeunes amis des épisodes de l’époque qui a précédé la première guerre, je m’aperçois à leurs questions étonnées combien de choses sont devenues pour eux de l’histoire, combien ils se représentent mal ce qui est encore pour moi la plus évidente des réalités. Et un secret instinct en moi leur donne raison : entre notre aujourd’hui, notre hier et notre avant-hier, tous les ponts ont été rompus. Je ne puis faire que je ne m’étonne de l’abondance, de la variété que nous avons condensées dans le peu d’espace d’une seule existence, à la vérité fort précaire et dangereuse, simplement quand je la compare avec le genre de vie de nos devanciers. Mon père, mon grand-père, qu’ont-ils vu ? Toute leur vie se passait dans l’uniformité. Une vie unique du commencement à la fin, sans élévations, sans chutes, sans ébranlements et sans périls, une vie avec de légères tensions, des passages insensibles ; d’un même rythme paisible et nonchalant, le flot du temps les portait du berceau à la tombe. Ils demeuraient dans le même pays, dans la même ville et presque toujours dans la même maison ; ce qui se passait au dehors, dans le vaste monde, n’était événement que dans le journal et ne venait pas frapper à la porte de leur chambre. Une guerre éclatait bien quelque part, mais ce n’était toujours qu’une petite guerre rapportée aux proportions de celles d’aujourd’hui, et elle se déroulait loin des frontières, on n’entendait pas le bruit des canons, et au bout de six mois elle était éteinte, oubliée, elle n’était plus qu’une page d’histoire desséchée, et l’ancienne vie reprenait, toujours la même. Quant à nous, tout ce que nous avons vécu est passé sans retour, rien n’a subsisté de ce qui avait précédé, rien n’est revenu ; il nous a été réservé d’être engagés de tout notre être dans un torrent d’événements, que l’histoire d’ordinaire distribue avec parcimonie entre certains pays, entre certains siècles isolés. Au pis aller une génération avait traversé une révolution, la seconde une émeute, la troisième une guerre, la quatrième une famine, la cinquième une banqueroute, – et bien des peuples, bien des générations bénies n’ont rien connu de tout cela. Quant à nous, qui sommes aujourd’hui dans la soixantaine et aurions droit encore à quelques années de vie, que n’avons-nous pas vu et souffert et vécu ? Nous avons labouré d’un bout à l’autre le champ de toutes les catastrophes imaginables et nous n’avons pas tourné la dernière page. Et moi tout seul, j’ai été le témoin des deux plus grandes guerres qui ont désolé l’humanité et je les ai vécues sur deux fronts différents, la première sur le front allemand, la seconde sur le front opposé. J’ai connu dans l’avant-guerre la forme et le degré les plus élevés de la liberté individuelle et, depuis, l’état de la pire dégradation qu’on eût vue depuis des siècles, j’ai été célébré et mis hors la loi, j’ai été libre et asservi, riche et pauvre. Tous les chevaux livides de l’Apocalypse se sont rués à travers mon existence, la révolution et la famine, l’avilissement de la monnaie et la terreur, les épidémies et l’émigration ; j’ai vu croître sous nos yeux, et se répandre parmi les masses, les grandes idéologies, le fascisme en Italie, le national-socialisme en Allemagne, le bolchévisme en Russie et avant tout, cette pestilence des pestilences, le nationalisme, qui a empoisonné la fleur de notre culture européenne. Il m’a fallu être le témoin impuissant et sans défense de cet inimaginable retour de l’humanité à un état de barbarie qu’on croyait depuis longtemps oublié, avec ses dogmes et son programme anti-humains consciemment élaborés. Il nous était réservé de revoir après des siècles des guerres sans déclaration de guerre, des camps de concentration, des supplices, des spoliations massives et des bombardements de villes sans défense, tous actes de bestialité que les cinquante dernières générations n’ont pas connues et que les futures, espérons-le, ne souffriront plus. Et, paradoxalement, dans le temps que notre monde reculait moralement d’un siècle, j’ai vu cette même humanité s’élever par l’intelligence et la technique à des prodiges, inouïs, dépassant d’un coup d’aile tout ce qu’avaient produit des millions d’années : la conquête de l’éther par l’avion, la transmission instantanée de la parole terrestre sur toute la surface de notre globe et par là même tout notre espace vaincu, la division de l’atome, les plus insidieuses maladies victorieusement combattues, la réalisation presque journalière de ce qui hier encore semblait impossible. Jamais jusqu’à notre époque l’humanité dans son ensemble ne s’est révélée plus diabolique et n’a accompli tant de miracles qui l’égalent à la divinité.
Il me paraît être de mon devoir de rendre témoignage de cette vie ardente, dramatique, fertile en surprises, qui aura été la nôtre, car, je le répète, chacun a été témoin de ces formidables transformations, chacun a été forcé d’être témoin. Pour notre génération il n’y a point d’évasion, point de retraite hors du réel présent ; grâce à notre nouvelle organisation du synchronisme universel, nous sommes constamment engagés dans notre époque. Quand des bombes réduisaient en miettes les maisons de Shanghai, nous l’apprenions en Europe, dans nos chambres, avant que les blessés eussent été retirés des décombres. Ce qui se passait à des milliers de milles au delà des mers fonçait sur nous en images animées. Il n’y avait point de protection, point de sûreté contre la nécessité d’être constamment informé de tout, de participer à tout. Point de pays où l’on pût se réfugier, point de solitude et de silence que l’on pût acheter ; partout, toujours, la main du destin nous saisissait et nous ramenait dans son insatiable jeu.
Constamment il fallait se soumettre aux exigences de l’État, se livrer en proie à la plus stupide politique, s’adapter aux changements les plus fantastiques, toujours on était enchaîné à la communauté, quelque acharnement qu’on mît à se détendre ; on était entraîné irrésistiblement. Quiconque a passé, ou, pour mieux dire, a été chassé et traqué à travers cette époque, – nous avons eu peu de répit, – a vécu plus d’histoire qu’aucun de ses ancêtres. Aujourd’hui nous nous retrouvons à un tournant, à une conclusion et à un début. Ce n’est pas sans dessein que j’arrête à une date précise cette vue perspective de ma vie passée. Car cette journée de septembre 1939 met un point final à l’époque qui a formé et instruit les sexagénaires, mes contemporains. Mais si, par notre témoignage, nous transmettons à la génération qui nous suit une seule parcelle de vérité sauvée de l’édifice qui s’écroule, nous n’aurons pas travaillé tout à fait en vain.
Je suis conscient des conditions défavorables mais très caractéristiques de notre époque, dans lesquelles j’entreprends de donner forme à mes souvenirs. Je les rédige en pleine guerre, je les rédige à l’étranger et sans la moindre pièce qui puisse secourir ma mémoire. Je n’ai à ma disposition dans ma chambre d’hôtel ni un exemplaire de mes livres, ni une note, ni une lettre d’amis. Nulle part je ne puis me procurer un renseignement, car dans le monde entier le service postal est coupé aux frontières ou entravé par la censure. Nous vivons aussi isolés les uns des autres qu’aux temps lointains où l’on n’avait inventé ni les bateaux à vapeur, ni les chemins de fer, ni l’avion, ni la poste. De tout mon passé je n’ai donc par devers moi que ce que je porte sous mon front. Tout le reste est en cet instant pour moi ou inaccessible ou perdu. Mais notre génération a appris à fond l’art excellent de ne point se consumer du regret de ce qui est perdu, et peut-être ce manque de documents et des détails tournera-t-il au profit de mon ouvrage. Car je considère que notre mémoire n’est pas la faculté de retenir par hasard tels éléments en laissant fuir par hasard tout le reste, je la tiens pour une puissance d’ordonner sa matière, en connaissance de cause, avec sagesse. Tout ce qu’on oublie de sa propre vie, un secret instinct l’avait depuis longtemps condamné à l’oubli. Seul ce qui se veut conserver pour nous-mêmes a quelque droit d’être conservé pour autrui. Parlez donc et choisissez pour moi, ô vous, mes souvenirs, et rendez au moins un reflet de ma vie, avant qu’elle sombre dans les ténèbres.
LE MONDE DE LA SÉCURITÉ
Élevés dans le calme et la retraite et le repos,
Nous sommes tout à coup jetés dans le monde ;
Battus de cent mille vagues,
Tout nous sollicite, bien des choses nous plaisent,
Bien d’autres nous affligent, et d’heure en heure,
Notre âme inquiète chancelle ;
Nous éprouvons des sensations et ce que nous avons senti,
Le tourbillon varié du monde le balaie loin de nous.
GOETHE.
Quand j’essaie de trouver pour l’époque qui a précédé la première guerre mondiale et dans laquelle j’ai été élevé, une formule qui la résume, je me flatte de l’avoir le plus heureusement rencontrée quand je dis : c’était l’âge d’or de la sécurité. Tout, dans notre monarchie autrichienne vieille de près d’un millénaire, semblait fondé sur la durée, et l’État lui-même paraissait le suprême garant de cette pérennité. Les droits qu’il accordait aux citoyens étaient scellés par actes du Parlement, cette représentation librement élue du peuple, et chacun de nos devoirs était exactement défini. Notre valeur monétaire, la couronne autrichienne, circulait en belles pièces d’or et nous assurait ainsi de son immutabilité. Chacun savait combien il possédait ou combien lui revenait, ce qui était permis ou défendu. Chaque chose avait sa norme, sa mesure et son poids déterminés. Qui possédait une fortune pouvait calculer exactement ce qu’elle lui rapportait en intérêts annuels, le fonctionnaire, l’officier trouvaient dans le calendrier l’année exacte de leur avancement, de leur retraite. Chaque famille avait son budget bien établi, elle savait ce qu’elle aurait à dépenser pour le vivre et le couvert, pour les voyages estivaux et les spectacles ; en outre, une petite somme était inévitablement réservée pour l’imprévu, pour les frais de maladie et les soins du médecin. Qui possédait une maison la considérait comme l’asile assuré de ses enfants et petits-enfants, le domaine et la maison de commerce se transmettaient de génération en génération ; alors que le nourrisson était encore au berceau, on déposait dans la tirelire ou à la caisse d’épargne une première obole en vue de son voyage à travers l’existence, une petite « réserve » pour l’avenir. Tout, dans ce vaste empire, demeurait inébranlablement à sa place, et à la plus élevée le vieil empereur ; et s’il venait à mourir, on savait (ou on croyait) qu’un autre lui succéderait et que rien ne changerait dans cet ordre sagement concerté. Personne ne croyait à la guerre, à des révolutions ou à des bouleversements. Toute transformation radicale, toute violence paraissait presque impossible dans cet âge de la raison.
Ce sentiment de la sécurité était le trésor commun de millions d’êtres, leur idéal de vie, le plus digne d’un effort pour le conserver. Sans cette sécurité la vie ne valait pas d’être vécue, et des milieux toujours plus étendus aspiraient à une part de ce bien précieux. Seuls les possédants jouirent d’abord de cet avantage, mais peu à peu les grandes masses y accédèrent ; le siècle de la sécurité devint l’âge d’or du régime des assurances. L’on assura sa maison contre le feu et les cambrioleurs, son champ contre la grêle et les orages, son corps contre les accidents et la maladie, l’on acheta des rentes viagères afin de pourvoir aux infirmités de l’âge, et l’on déposa dans le berceau des filles une police qui devait leur assurer une dot. Enfin les ouvriers eux-mêmes s’organisèrent et conquirent de haute lutte un salaire normalisé et des caisses de maladie ; les domestiques prirent sur leurs économies une assurance-vieillesse et payèrent en avances à une caisse mortuaire leur propre enterrement. Seuls ceux qui pouvaient envisager l’avenir sans appréhension jouissaient du présent avec une bonne conscience.
Dans cette confiance touchante où l’on était d’avoir des palissades sans les moindres brèches par où le mauvais sort eût pu faire irruption, malgré toute la solidité et la modestie des conceptions de vie qu’elle supposait, il y avait une grande et dangereuse présomption. Le dix-neuvième siècle, avec son idéalisme libéral, était sincèrement convaincu qu’il se trouvait sur la route droite qui mène infailliblement au « meilleur des mondes possibles ». On ne considérait qu’avec dédain les époques révolues, avec leurs guerres, leurs famines et leurs révoltes, on jugeait que l’humanité, faute d’être suffisamment éclairée, n’y avait pas atteint la majorité. Il s’en fallait de quelques décades à peine pour que tout mal et toute violence fussent définitivement vaincus, et cette foi en un « Progrès » fatal et continu avait dans ce temps-là toute la force d’une religion. Déjà l’on croyait en ce « Progrès » plus qu’en la Bible, et cet évangile semblait irréfutablement démontré par les merveilles sans cesse renouvelées de la science et de la technique. Et en effet, une générale ascension se faisait toujours plus visible à la fin de ce siècle de paix, toujours plus rapide, toujours plus diverse. Dans les rues, au lieu des pâles luminaires, brillaient des lampes électriques, les grands magasins portaient leur nouvelle splendeur tentatrice des artères principales jusque dans les faubourgs, déjà grâce au téléphone les hommes pouvaient converser à distance, déjà ils volaient avec une rapidité inespérée dans des voitures sans chevaux, déjà ils s’élançaient dans les airs et réalisaient le rêve d’Icare. Le confort pénétrait dans les maisons bourgeoises, on n’avait plus à rapporter l’eau de la fontaine ou du canal, à allumer péniblement le feu du fourneau, l’hygiène se répandait partout, la crasse disparaissait. Les hommes devenaient plus beaux, plus robustes, plus sains depuis que le sport trempait et durcissait leurs corps ; on rencontrait toujours plus rarement dans les rues des estropiés, des goitreux, des mutilés, et tous ces miracles étaient l’œuvre de la science, cet archange du progrès. Au point de vue social aussi l’humanité était en marche ; d’année en année on accordait à l’individu de nouveaux droits, la justice se faisait plus douce et plus humaine, et même le problème des problèmes, le paupérisme des grandes masses, ne semblait plus insoluble. Le droit de vote s’étendait à des classes de plus en plus étendues, qui acquéraient ainsi la possibilité de défendre leurs intérêts par des voies légales, des sociologues et des professeurs rivalisaient de zèle pour rendre plus saine et même plus heureuse la vie des prolétaires : – quoi d’étonnant que ce siècle s’admirât avec complaisance dans ses œuvres et ne considérât la fin d’une décade que comme le prélude à une décade meilleure ? On ne croyait pas plus à des retours de barbarie, tels que des guerres entre les peuples d’Europe, qu’on ne croyait aux spectres ou aux sorciers ; nos pères étaient tout imbus de la confiance qu’ils avaient dans le pouvoir et l’efficacité infaillibles de la tolérance et de l’esprit de conciliation. Ils pensaient sincèrement que les frontières et les divergences entre nations et confessions se fondraient peu à peu dans une humanité commune et qu’ainsi la paix et la sécurité, les plus précieux des biens, seraient impartis à tous les hommes.
Il nous convient à nous, les hommes d’aujourd’hui, qui depuis longtemps avons retranché de notre vocabulaire le mot « sécurité », de railler le délire optimiste de cette génération aveuglée par son idéalisme naïf et qui se persuadait que les progrès techniques de l’humanité devaient entraîner fatalement une aussi rapide ascension morale. Nous qui avons appris dans le siècle nouveau à ne nous étonner plus d’aucune explosion de la bestialité collective, nous qui attendons de chaque jour qui se lève des abominations pires que toutes celles qui ont précédé, nous sommes singulièrement plus sceptiques quant à la possibilité d’élever moralement les hommes. Nous avons dû donner raison à Freud, quand il ne voyait dans notre culture qu’un mince sédiment qui à chaque instant peut être crevé par les puissances destructrices du monde souterrain, nous avons dû nous habituer peu à peu à vivre sans terrain solide sous nos pieds, sans droit, sans liberté, sans sécurité. Depuis longtemps nous avons renoncé pour notre propre existence à la religion de nos pères, à leur foi en une élévation rapide et continue de l’humanité ; il nous semble assez niais, à nous qui avons été cruellement instruits, ce préjugé optimiste en regard de la catastrophe qui, d’un seul coup, nous a fait reculer et perdre le bénéfice de mille années d’efforts. Mais si leur opinion n’était que folie, c’est une merveilleuse et noble folie que servaient nos pères, plus humaine et féconde que les paroles d’aujourd’hui. Et, chose étrange, malgré toutes mes expériences et mes déceptions, quelque chose en moi ne peut s’en détacher tout à fait. Ce qu’un homme a, durant son enfance, incorporé à son sang de l’air du temps ne saurait plus être éliminé. Et malgré tout ce que chaque jour me crie aux oreilles, malgré tout ce que moi-même et mes innombrables compagnons d’infortune avons souffert d’humiliations et d’épreuves, il ne m’est pas possible de renier sans recours la foi de ma jeunesse et de désespérer d’un relèvement et d’une nouvelle renaissance. De l’abîme de terreur où nous marchons à tâtons comme des aveugles, l’âme bouleversée et le cœur brisé, je jette encore un regard vers ces anciennes constellations qui resplendissaient sur ma jeunesse et me console avec la confiance héréditaire que cette décadence ne paraîtra qu’une interruption momentanée dans le rythme éternel de l’irrésistible progrès.
Maintenant que la grande tempête l’a fracassé depuis longtemps, nous savons positivement que ce monde de la sécurité n’était qu’une construction de songe. Pourtant mes parents l’ont habitée comme une maison de pierre. Jamais un ouragan ou même un vent coulis un peu violent n’ont pénétré dans leur chaude et confortable existence ; assurément ils jouissaient d’une protection particulière contre les assauts du vent : ils étaient des gens aisés qui, peu à peu, s’élevèrent jusqu’à la richesse et même à la très grande richesse ; et la fortune, dans ces temps-là, vous calfeutrait sûrement fenêtres et parois. Leur genre de vie me paraît typique de cette « bonne bourgeoisie juive » qui a enrichi la culture viennoise de tant de valeurs essentielles (et qui, en récompense, a été complètement exterminée), et cela au point qu’en peignant leur existence paisible et silencieuse, il me semble faire en réalité un récit tout impersonnel : dix ou vingt mille familles ont vécu à Vienne comme mes parents dans ce siècle des valeurs assurées.
La famille de mon père était originaire de la Moravie. Dans les petites agglomérations campagnardes, les communautés juives vivaient là en meilleure harmonie avec les paysans et les petits bourgeois ; ainsi ils ne manifestaient aucunement ce sentiment d’oppression et, d’autre part, cette impatience d’arriver et cette souplesse des Juifs orientaux, des Galiciens. Rendus forts et vigoureux par la vie à la campagne, ils allaient leur chemin à travers les champs avec un calme assuré, tout comme les paysans de leur patrie. Émancipés de bonne heure de toute orthodoxie étroite, ils étaient des adhérents passionnés de la nouvelle religion du « Progrès » et fournissaient dans l’aire du libéralisme politique les députés au Parlement les plus considérés. Quand ils émigraient à Vienne, ils s’adaptaient avec une rapidité surprenante à la société la plus cultivée de la capitale, et leur élévation personnelle se rattachait intensément à tout l’élan ascensionnel de l’époque. Notre famille offrait un exemple typique de cette évolution. Mon aïeul paternel avait fait le commerce des produits manufacturés. Alors débuta en Autriche, dans la seconde moitié du siècle, la grande expansion industrielle. Les machines à tisser et à filer importées d’Angleterre provoquèrent par leur exploitation rationnelle un prodigieux abaissement des prix comparés à ceux des produits du tissage à la main, et ce furent justement les marchands juifs, avec leurs dons d’observation commerciale et leur vue d’ensemble sur la situation internationale, qui reconnurent les premiers en Autriche la nécessité et les avantages d’une transformation de la production industrielle. Ils fondèrent, le plus souvent avec des capitaux modestes, ces fabriques rapidement improvisées qui, d’abord, n’utilisèrent que la force motrice de l’eau et se développèrent peu à peu jusqu’à devenir cette puissante industrie textile de la Bohême qui domina toute l’Autriche et les Balkans. Aussi, tandis que mon grand-père, représentant d’une époque antérieure, ne servit que d’intermédiaire en faisant le trafic de produits terminés, mon père, déjà, s’avança résolument dans les temps nouveaux en fondant dans le nord de la Bohême, à l’âge de trente ans, une petite tisseranderie, qu’il agrandit au cours des années, lentement et prudemment, jusqu’à en faire une entreprise importante.
Cette prudence, en dépit des conjonctures favorables et tentantes, était tout à fait dans l’esprit du temps. Elle répondait de plus à la nature réservée et nullement avide de mon père. Il avait adopté le credo de son époque : Safety first ; il préférait de beaucoup être à la tête d’une entreprise « solide », – encore un terme favori de ce temps, – qu’il gérait avec ses propres capitaux, plutôt que de l’étendre démesurément à grand renfort de crédits en banque ou d’hypothèques. Son seul orgueil était de n’avoir jamais fait figurer son nom sur une reconnaissance de dette ou une lettre de change et d’avoir eu toujours un compte créditeur en banque, — naturellement la plus solide de toutes, la banque Rothschild. Il répugnait à tout profit qui comportât l’ombre d’un risque, et, durant toute sa vie, il ne prit jamais part à une entreprise qui ne fût pas la sienne. Si malgré tout, il finit par s’enrichir considérablement, il ne le devait nullement à des spéculations téméraires ou à des opérations à longue portée, mais au fait qu’il s’adaptait à la méthode générale de cette époque prudente, qui consistait à ne dépenser qu’une part modique des revenus et à augmenter ainsi d’année en année le capital d’un montant toujours plus important. Comme la plupart des hommes de sa génération, il aurait considéré comme un déplorable dissipateur celui qui aurait dévoré légèrement la moitié de ses bénéfices sans « penser à l’avenir », — encore une expression caractéristique de cet âge de la sécurité. Grâce à cette constante épargne des bénéfices, l’enrichissement progressif des possédants ne supposait en somme, de leur part, qu’une sorte d’opération passive à une époque de prospérité croissante, où l’État, d’autre part, ne songeait pas à soutirer en impôts plus d’un modeste pour cent même sur les revenus les plus considérables et où, d’ailleurs, les obligations de l’État et les valeurs industrielles rapportaient de gros intérêts. Et cette conduite ne laissait pas d’être d’un bon rendement ; l’économie n’était pas encore dépouillée, le commerçant solvable et réglé dans ses affaires n’était pas écorché comme aux temps de l’inflation, et c’étaient justement les plus patients, ceux qui ne spéculaient pas, qui récoltaient les plus beaux gains. Grâce à cette adaptation au système général de son temps, mon père pouvait passer à l’âge de cinquante ans pour un homme très riche, même sur le plan international. Mais notre train de maison ne suivait que d’une allure fort hésitante cette augmentation toujours plus rapide de notre fortune. On se pourvut de quelques commodités, on déménagea d’un petit appartement dans un plus grand, on retint au printemps pour les après-midi une voiture de louage, on voyagea en seconde classe avec wagon-lit, mais ce n’est que dans sa cinquantième année que mon père s’accorda pour la première fois le luxe d’aller passer avec ma mère un mois d’hiver à Nice. Dans l’ensemble notre principe demeura inchangé, selon lequel on jouit de sa richesse en la possédant et non pas en en faisant étalage. Même quand il fut devenu millionnaire, mon père n’a jamais fumé un havane ; comme l’empereur François-Joseph, il s’en tenait à ses Virginies démocratiques ; il resta fidèle à ses simples Trabucos de régie ; et s’il jouait aux cartes, c’était toujours avec des mises insignifiantes. Il persista inflexiblement dans sa retenue, dans son genre de vie confortable, certes, mais discret. Quoiqu’il fût infiniment plus représentatif et cultivé que la plupart de ses collègues, – il jouait excellemment du piano, écrivait avec élégance et clarté, parlait le français et l’anglais, – il se déroba obstinément aux distinctions et aux charges honorifiques et de sa vie ne sollicita ou n’accepta aucun titre, ni aucune dignité, bien qu’en sa qualité de gros industriel on lui en offrît bien souvent. De n’avoir jamais rien demandé, de ne s’être jamais engagé dans la voie des requêtes et des remerciements, il en concevait une secrète fierté, qui lui était plus chère que tous les signes extérieurs de la distinction.
Or, il se trouve dans la carrière de chacun de nous un moment où, dans le tableau de son existence, il se rencontre inévitablement avec son propre père. Cette inclination à une vie toute privée et anonyme commence à se développer en moi d’année en année et se fait toujours plus irrésistible, si contraire qu’elle paraisse être à ma profession même, qui exige en quelque sorte que je rende publics et mon nom et ma personne. Mais par un même sentiment de secrète fierté, j’ai toujours décliné toute distinction honorifique, je n’ai jamais accepté ni un ordre, ni un titre, ni la présidence d’aucune société, je n’ai jamais fait partie ni d’une académie, ni d’un comité, ni d’un jury ; ce m’est un supplice de m’asseoir à une table officielle, et la pensée d’avoir à présenter une requête, même en faveur d’un tiers, me dessèche la gorge avant le premier mot prononcé. Je sais combien de telles gênes sont inopportunes dans un monde où l’on ne peut demeurer libre que par l’astuce et la fuite, où, comme le disait sagement le père Goethe, « les ordres et les titres vous évitent les bourrades dans la cohue ». Mais c’est mon père en moi et son secret orgueil qui me font reculer et je ne saurais leur résister ; car c’est à lui que je dois ce que j’éprouve peut-être comme mon seul bien assuré, le sentiment de la liberté intérieure.
Ma mère, née Brettauer, était d’une origine différente, plus internationale. Elle avait vu le jour à Ancône, dans l’Italie méridionale, et l’italien était sa langue maternelle aussi bien que l’allemand ; chaque fois qu’elle parlait avec ma grand-mère ou avec sa sœur et ne voulait pas être entendue des domestiques, elle adoptait l’italien. Le risotto, les artichauts encore assez rares dans ce temps-là, comme aussi toutes les autres particularités de la cuisine méridionale, m’étaient familiers dès ma plus tendre enfance, et chaque fois que, depuis, je voyageai en Italie, je me sentis chez moi dès la première heure. Mais la famille de ma mère n’était nullement italienne, elle avait conscience d’être internationale : les Brettauer, qui possédaient à l’origine une maison de banque à Hohenems, une petite ville à la frontière suisse, avaient d’assez bonne heure essaimé par le monde, à l’imitation des grandes familles de banquiers juifs, mais naturellement sur un plan beaucoup plus réduit. Les uns se fixèrent à Saint-Gall, d’autres à Vienne et à Paris, mon grand-père en Italie, un de mes oncles à New-York, et ces contacts internationaux leur avaient conféré une politesse plus raffinée, des vues plus larges et aussi un certain orgueil familial. Il n’y avait plus de petits marchands dans cette maison, plus de courtiers, mais seulement des banquiers, des directeurs, des professeurs, des avocats et des médecins, chacun d’eux parlait plusieurs langues, et je me souviens avec quel naturel, chez ma tante de Paris, on passait à table de l’une à l’autre. C’était une famille où l’on était soigneux de tenir son rang, et quand une jeune parente pauvre était en âge de se marier, toute la famille se cotisait pour fournir une dot imposante, afin d’éviter une mésalliance. Mon père était respecté en sa qualité de gros industriel, cependant ma mère, encore que leur union fût des plus heureuses, n’aurait jamais souffert que les parents de son mari prétendissent au même rang que les siens. Cet orgueil d’être issus d’une « bonne » famille était chez tous les Brettauer un sentiment indéracinable, et quand, à l’époque de ma maturité, l’un d’entre eux me voulait témoigner une particulière bienveillance, il proférait d’un ton condescendant : « Après tout, tu es un vrai Brettauer », comme s’il constatait : « Après tout, tu t’es rangé du bon côté ».
Cette espèce d’aristocratie, que bien des familles juives s’octroyaient dans la conscience qu’elles avaient prise de leur toute-puissance, tantôt nous amusait, tantôt nous exaspérait, mon frère et moi, et cela dès notre enfance. Sans cesse on nous cornait aux oreilles que tels étaient des gens « distingués », que tels autres ne l’étaient pas ; au sujet de chacun de nos amis, on s’informait s’il était de « bonne famille », et l’on vérifiait, jusqu’à la plus lointaine génération, l’origine et de la parenté et de la fortune. Cette sempiternelle manie de classer les personnes, qui faisait le sujet principal de toutes les conversations en famille et en société, nous semblait alors des plus ridicules et bien digne des snobs, puisqu’en somme il ne s’agit, dans toutes les familles juives, que d’une différence de quelque cinquante ou cent ans, s’il faut déterminer l’époque où elles sont sorties du même ghetto commun. Je n’ai compris que beaucoup plus tard, que cette notion de la « bonne » famille, qui nous paraissait la farce et la parodie d’une pseudo-noblesse tout artificielle, exprime une des tendances les plus profondes et les plus mystérieuses du judaïsme. On admet généralement que le but propre et typique de la vie du Juif est de s’enrichir. Rien de plus faux. La richesse n’est pour lui qu’un degré intermédiaire, un moyen d’atteindre le but véritable et nullement une fin en soi. La propre volonté du Juif, son idéal immanent est de s’élever spirituellement, d’atteindre à un niveau culturel supérieur. Déjà dans le judaïsme orthodoxe de l’Orient, où les faiblesses, comme aussi les avantages de toute la race, sont marqués avec plus d’intensité, cette primauté de l’aspiration au spirituel sur le pur matériel trouve son illustration : le pieux, le savant versé dans la connaissance des écritures est mille fois plus estimé que le riche dans l’intérieur de la communauté ; même le plus favorisé des biens de ce monde donnera sa fille à un homme sage orné des dons de l’esprit, fût-il pauvre comme Job, plus volontiers qu’à un marchand. Cette prééminence du spirituel se rencontre invariablement chez les Juifs de toutes les conditions ; le plus misérable colporteur, qui se traîne avec sa charge par toutes les intempéries, s’efforcera, à l’aide des plus lourds sacrifices, de faire étudier au moins un de ses fils, et l’on considère comme un titre de gloire pour toute la famille de posséder dans son sein un membre qui se distingue manifestement par la force de la pensée, un professeur, un savant, un musicien, comme si lui seul, par sa réussite, les anoblissait tous. Je ne sais quoi dans le Juif cherche inconsciemment à échapper à ce qui adhère de moralement douteux, de répugnant, de mesquin, de purement matériel à tout commerce, à tout ce qui n’est que du monde des affaires, et à s’élever dans la sphère plus pure du spirituel, où l’argent ne compte plus, comme s’il voulait se racheter, – pour parler en style wagnérien, – lui et toute sa race, de la malédiction de l’argent. C’est pourquoi, dans le monde juif, l’aspiration à la richesse est épuisée après deux, tout au plus trois générations dans le sein d’une même famille ; et justement les plus puissantes dynasties trouvent les fils peu disposés à reprendre les banques, les fabriques, les affaires en pleine prospérité de leurs pères. Ce n’est pas un hasard qu’un Lord Rothschild soit ornithologiste, un Warburg historien de l’art, un Cassirer philosophe, un Sassoon poète ; ils ont tous obéi à la même tendance inconsciente à se libérer de ce qui a rétréci le judaïsme, la froide volonté de gagner de l’argent, et peut-être que par là s’exprime encore la secrète aspiration à échapper, par la fuite dans le spirituel, à ce qui est spécifiquement juif, pour se fondre dans la commune humanité. Une « bonne famille » implique donc davantage qu’un certain rang social auquel on prétend en s’affublant de cette expression ; elle signifie un judaïsme qui s’est affranchi ou commence de s’affranchir de tous les défauts, de toutes les étroitesses et petitesses que le ghetto lui a imposées, par son adaptation à une autre culture et, si possible, à une culture universelle. Que cette fuite dans le spirituel, en produisant un encombrement disproportionné des professions libérales, ait pu devenir aussi fatale au judaïsme que sa limitation aux choses matérielles, c’est là un de ces éternels paradoxes inhérents à la destinée d’Israël.
― ― ―
À peine trouverait-on une ville en Europe où l’aspiration à la culture se fît plus passionnée qu’à Vienne. Comme la monarchie autrichienne avait depuis des siècles abdiqué ses ambitions politiques et n’avait remporté aucun succès éclatant sur les champs de bataille, l’orgueil patriotique avait tourné en volonté impérieuse de conquérir la suprématie artistique. De l’empire des Habsbourg, qui avait dominé l’Europe, s’étaient détachées depuis longtemps plusieurs provinces aussi importantes que prospères, terres allemandes et italiennes, flamandes et wallonnes ; la capitale avait gardé intacte son ancienne splendeur, elle était l’asile de la cour, la conservatrice d’une tradition millénaire. Les Romains avaient posé les premières pierres de cette cité, ils avaient érigé un castrum, poste avancé destiné à protéger la civilisation latine contre les barbares, et, plus de mille ans après, l’assaut des Turcs contre l’occident s’était brisé sur ces murailles ; ici étaient venus les Nibelungen, d’ici avait resplendi sur le monde l’immortelle pléiade des musiciens : Gluck, Haydn et Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms et Johann Strauss, ici ont conflué tous les courants de la culture européenne ; à la cour, dans l’aristocratie, dans le peuple, les sangs allemand, slave, hongrois, espagnol, italien, français, flamand s’étaient mêlés, et ce fut le génie propre de cette ville de la musique que de fondre harmonieusement tous ces contrastes en quelque chose de nouveau et de particulier, l’esprit autrichien, l’esprit viennois. Accueillante et douée d’un sens spécial de la réceptivité, cette cité attira à elle les forces les plus disparates, elle les défendit, les assouplit, les adoucit ; la vie était plaisante dans cette atmosphère de conciliation spirituelle, et, à son insu, chaque bourgeois de cette ville était promu par son éducation à ce cosmopolitisme qui répudie tout nationalisme étroit, à la dignité, enfin, de citoyen du monde.
Cet art de l’assimilation, des passages insensibles et musicaux, se manifestait déjà dans la structure extérieure de la ville. S’étant agrandie lentement au cours de siècles et développée organiquement à partir de sa première enceinte centrale, elle était assez populeuse avec ses deux millions d’habitants pour offrir tout le luxe et toute la diversité d’une grande cité et cependant elle n’était pas si démesurée qu’elle fût séparée de la nature, comme Londres ou New-York. Les dernières maisons de la ville se miraient dans le cours majestueux du Danube, ou prenaient vue sur la grande plaine, ou se perdaient dans des jardins et des champs, ou s’étageaient sur les flancs de douces collines, les derniers contreforts boisés des Alpes ; on percevait à peine le passage de la nature à l’agglomération urbaine, l’une se fondait dans l’autre sans résistance et sans désaccord ; à l’intérieur, on sentait que la ville avait crû comme le tronc d’un arbre qui ajoute un anneau à un autre ; et au lieu des anciennes fortifications, le cœur précieux de la cité était enfermé dans le Ring, la rue aux pompeux édifices ; au centre, les vieux palais de la cour et de l’aristocratie racontaient toute une histoire conservée dans les pierres ; ici, chez les Lichnowsky, Beethoven avait joué du piano, là, Haydn avait été l’hôte des Esterhazy, plus loin, dans la vieille université, avait retenti pour la première fois la Création de Haydn, la Hofburg avait vu des générations d’empereurs, Schönbrunn avait abrité Napoléon, dans le dôme de Saint-Étienne les princes chrétiens alliés s’étaient agenouillés pour rendre grâce à Dieu de la délivrance de l’Europe attaquée par les Turcs, l’Université avait accueilli dans ses murs d’innombrables flambeaux de la science ; et parmi tous les monuments anciens se dressait fièrement, fastueusement, avec ses avenues resplendissantes et l’étincellement des magasins, la nouvelle architecture. Mais l’antique n’était pas plus en désaccord avec la moderne que la pierre taillée avec la vierge nature. Il était délicieux de vivre ici, dans cette ville hospitalière, qui accueillait tout ce qui venait de l’étranger et se donnait généreusement, il était plus naturel de jouir de la vie dans son air léger, ailé, comme à Paris, de sérénité. Vienne était, on le sait, une ville jouisseuse, mais quel est le sens de la culture, sinon d’extraire de la matière brute de l’existence, par les séductions flatteuses de l’art et de l’amour, ce qu’elle recèle de plus tendre et de plus subtil. Si l’on était fort gourmet dans cette ville, très attentif à goûter de bon vin, de bonne bière fraîche et mordante, des entremets et des tourtes plantureuses, on était délicat aussi dans les jouissances plus raffinées. Le talent de faire de la musique, de danser, de jouer du théâtre, de converser, de se comporter avec goût et de plaire en obligeant était cultivé ici comme un art particulier. Les affaires militaires, politiques ou commerciales ne tenaient pas une place prépondérante dans la vie des particuliers comme aussi de la société dans son ensemble ; le premier regard que le Viennois moyen jetait sur son journal du matin ne se portait pas sur les discussions du Parlement ou les événements mondiaux, mais sur le répertoire du théâtre, lequel prenait une importance dans la vie publique qu’on eût difficilement comprise dans d’autres villes. Car le théâtre impérial, le Burgtheater, était pour le Viennois, pour l’Autrichien, plus qu’une simple scène où les acteurs jouaient des rôles ; c’était le microcosme où se reflétait le macrocosme, le miroir varié, où la société se contemplait elle-même, le seul véritable Cortegiano, le bréviaire du bon goût. L’acteur du Hoftheater servait de modèle aux spectateurs : ils apprenaient de lui comment on s’habillait, comment on entrait dans une chambre, comment on conversait, de quels mots pouvait user un homme bien élevé, lesquels il avait à éviter ; la scène n’était pas un lieu de divertissement, mais un guide en paroles et en action des bonnes manières, de la prononciation correcte ; et un nimbe de respect auréolait tout ce qui avait quelque rapport, même lointain, avec le théâtre du château impérial. Le président du Conseil, le plus riche magnat pouvaient passer par les rues de Vienne sans que personne se retournât ; mais chaque vendeuse, chaque cocher de fiacre reconnaissait un acteur du Théâtre ou une chanteuse de l’Opéra ; quand nous autres garçons avions croisé l’un d’entre eux (chacun de nous collectionnait leurs photographies, leurs autographes), nous étions fiers de rapporter cet événement, et le culte presque idolâtre que nous rendions à ces personnages allait si loin qu’il s’étendait à tout leur entourage ; le coiffeur de Sonnenthal, le cocher de Joseph Kainz étaient des gens respectés que l’on enviait secrètement ; de jeunes élégants s’enorgueillissaient de se faire habiller par le même tailleur. Chaque jubilé, chaque enterrement d’un grand acteur était un fait d’importance qui reléguait dans l’ombre tous ceux de la politique. Être joué au Burgtheater était le rêve suprême de tout écrivain viennois, parce que cela vous conférait une espèce de noblesse viagère et comportait toute sorte de distinctions honorifiques, telles que des entrées gratuites la vie durant et des invitations à toutes les manifestations officielles ; on était devenu l’hôte d’une maison impériale, et je me souviens encore de la solennité qui accompagna ma propre admission. Le matin le directeur du Théâtre m’avait prié de passer à son bureau pour me communiquer, après les félicitations d’usage, que mon drame était accepté ; quand je rentrai chez moi le soir, j’y trouvai sa carte : il m’avait proprement rendu ma visite, à moi qui n’avais que vingt-six ans ; en qualité d’auteur de la scène impériale, j’avais, par ma seule admission, passé au rang de « gentleman », et un directeur de cette maison avait à me traiter en égal. Et ce qui se passait au Théâtre impérial touchait indirectement tout le monde, même ceux qui n’avaient aucun rapport immédiat avec l’événement. Je me souviens, par exemple, qu’au temps de ma prime jeunesse, notre cuisinière fit un jour irruption dans le salon, les yeux baignés de larmes : on venait de lui rapporter que Charlotte Wolter, la plus célèbre actrice du Burgtheater, était morte ; ce qu’il y avait de grotesque de ce deuil tumultueux, c’est que cette vieille cuisinière illettrée n’avait jamais mis les pieds dans ce théâtre aristocratique et n’avait jamais vu la Wolter sur la scène, ne l’avait jamais aperçue dans la rue ; mais une grande actrice nationale était tellement à Vienne la propriété collective de toute la cité que même celui qui n’y avait aucune part éprouvait sa mort comme une catastrophe. Chaque perte, le départ d’un chanteur ou d’un artiste célèbre, se transformait irrésistiblement en un deuil national. Quand le « vieux » Burgtheater, où avaient été jouées pour la première fois Les Noces de Figaro de Mozart, fut démoli, toute la société viennoise se rassembla une dernière fois dans la salle, affectant la contenance solennelle et affligée qu’on prend aux funérailles ; le rideau n’était pas plus tôt tombé que tout le monde se précipitait sur la scène pour emporter au moins comme une relique un éclat de ces tréteaux où s’étaient produits les artistes bien-aimés, et dans des douzaines de maisons bourgeoises on pouvait voir encore après des décennies de ces morceaux de bois sans apparence conservés dans de précieuses cassettes, comme dans les églises les morceaux de la Croix. Nous-mêmes n’eûmes pas une conduite beaucoup plus raisonnable quand la Salle dite de Bösendorf fut démolie. En elle-même, cette salle de concert réservée exclusivement à la musique de chambre était une construction sans apparence, sans caractère artistique ; cet ancien manège du prince Lichtenstein avait été boisé très simplement et adapté ainsi à son nouvel usage. Mais il avait la résonance d’un violon ancien, il était pour les amateurs de musique un lieu consacré, parce que Chopin et Brahms, Liszt et Rubinstein y avaient donné des concerts et que nombre des plus célèbres quatuors s’y étaient fait entendre pour la première fois ; et maintenant il lui fallait céder la place à des constructions nouvelles ; cela était inconvenable pour nous, qui y avions vécu des heures inoubliables. Quand expirèrent les dernières mesures de Beethoven, que le quatuor Rosé avait joué plus divinement que jamais, personne ne quitta sa place. Nous applaudissions à grand bruit, des femmes sanglotaient dans leur excitation, personne ne voulait admettre que ce fût un congé définitif. On éteignit dans la salle pour nous chasser. Pas un des quatre ou cinq cents fanatiques ne se leva. Nous demeurâmes une demi-heure, une heure, comme si, par notre présence, nous pouvions obtenir de force que ce lieu sacré fût sauvé. Et que de pétitions, de protestations, d’articles lancés, que de manifestations organisées par nous autres étudiants, pour que la maison mortuaire de Beethoven ne fût pas abattue ! Chacune de ces demeures historiques à Vienne était pour nous un peu d’âme qu’on nous arrachait du corps.
Ce fanatisme pour les beaux-arts et particulièrement pour l’art théâtral se rencontrait à Vienne dans toutes les classes de la population. En elle-même Vienne, par ses traditions plusieurs fois centenaires, était une cité très nettement stratifiée, mais en même temps (comme je l’ai écrit un jour) elle était admirablement orchestrée. Le pupitre était toujours occupé par la maison impériale. Le Château était au centre, non pas seulement au sens purement spatial, mais aussi au sens culturel, de la monarchie aux multiples nationalités. Autour de ce château, les palais de la haute aristocratie autrichienne, polonaise, tchèque, hongroise, formaient en quelque sorte la seconde enceinte. Venait ensuite la « bonne société » formée de la petite noblesse, des hauts fonctionnaires, des représentants de l’industrie et des « anciennes familles », enfin, au-dessous, la petite bourgeoisie et le prolétariat. Chacune de ces classes formait un petit monde séparé, chacune avait son arrondissement propre ; la haute noblesse vivait dans ses palais au cœur de la ville, la diplomatie dans le troisième arrondissement, l’industrie et le commerce dans le voisinage du Ring, la petite bourgeoisie dans les arrondissements du centre, du second au neuvième, le prolétariat dans les quartiers extérieurs. Mais tout le monde communiait au théâtre ou aux grandes festivités, comme, par exemple, à la fête des fleurs au Prater, où trois cent mille personnes acclamaient avec enthousiasme « les dix familles de la haute » dans leurs voitures magnifiquement décorées. À Vienne tout ce qui comportait couleurs ou musique tournait à la festivité, les processions religieuses comme la Fête-Dieu, les parades militaires, la « Musique du château impérial » ; même les enterrements se faisaient au milieu d’un grand concours du peuple enthousiaste, et c’était l’ambition de tout bon Viennois d’avoir de belles funérailles avec un cortège fastueux et une suite nombreuse ; un Viennois authentique faisait de sa mort même un spectacle attrayant pour ses concitoyens. Toute la ville s’accordait dans ce goût de ce qui est coloré, sonore, festival, dans le plaisir qu’elle prenait aux spectacles considérés comme un jeu et un miroir de la vie, que ce fût sur la scène ou en plein air.
Il était aisé de railler cette « théâtromanie » des Viennois, qui, véritablement, tournait parfois au grotesque, quand elle les portait à s’enquérir des circonstances les plus futiles de la vie de leurs favoris ; et l’on peut réellement attribuer pour une part à cette surestimation des choses qui procurent du plaisir notre indolence en politique, notre infériorité économique en face de notre voisin si résolu, l’Empire allemand. Mais cette attention trop grande accordée aux événements du monde des arts a fait mûrir chez nous quelque chose de particulier, tout d’abord une extraordinaire vénération pour toutes les productions artistiques, puis, grâce à un exercice séculaire, une connaissance délicate de ces choses, et enfin un niveau très élevé de toute notre culture. Toujours l’artiste se sent le plus à l’aise et aussi le plus excité à produire là où il est estimé et même surestimé, toujours l’art atteint à son apogée là où il est mêlé à la vie de tout un peuple. Et de même que Florence et Rome, à l’époque de la Renaissance, attiraient à elles les peintres et leur enseignaient la grandeur, parce que chacun d’entre eux sentait qu’il avait sans cesse à surpasser les autres et à se dépasser lui-même dans ce perpétuel concours où toute la bourgeoisie était juge, de même aussi les musiciens, les acteurs de Vienne connaissaient leur importance dans la ville. À l’Opéra de Vienne, au Burgtheater, on ne laissait échapper aucune imperfection ; chaque fausse note était aussitôt remarquée, chaque rentrée incorrecte, chaque coupure était censurée, et ce contrôle n’était pas seulement exercé aux premières par les critiques professionnels, mais soir après soir par l’oreille attentive, affinée par de perpétuelles comparaisons, du public tout entier. Tandis qu’en politique, dans l’administration, dans les mœurs, tout allait tant bien que mal et que l’on avait de l’indulgence pour toutes les veuleries et des égards pour tous les manquements, dans les choses de l’art il n’y avait pas de pardon ; c’est que l’honneur de la cité était en jeu. Chaque chanteur, chaque acteur, chaque musicien était toujours obligé de donner son maximum, sinon il était perdu. Il était délicieux d’être à Vienne le favori des foules, mais il était difficile de le demeurer ; un relâchement n’était jamais pardonné. Et de savoir qu’il était sans cesse surveillé avec une attention impitoyable, chaque artiste viennois était contraint de donner toute sa mesure, ce qui explique que le niveau général ait toujours été si élevé. Chacun d’entre nous a, des années de sa jeunesse, emporté pour la vie une règle sévère et inflexible pour juger des productions artistiques. Qui a connu à l’Opéra, sous la direction de Gustave Mahler, cette discipline de fer jusque dans les moindres détails, à l’orchestre philharmonique cet élan lié tout naturellement à l’exactitude la plus rigoureuse, celui-là est aujourd’hui bien rarement satisfait d’un spectacle ou d’une exécution musicale. Mais nous avons appris aussi à être sévères envers nous-mêmes et pour toutes nos productions artistiques ; un certain point de perfection était et demeurait pour nous exemplaire, tel qu’en peu de villes de monde il s’est imposé aussi exigeant aux artistes en formation. Mais ce sens du rythme et du mouvement justes, le simple peuple le partageait avec les raffinés ; le petit bourgeois qui goûtait le « nouveau » demandait à l’orchestre d’aussi bonne musique qu’il exigeait de bon vin du cabaretier ; au Prater, d’autre part, le peuple savait exactement laquelle des fanfares militaires avait le plus de mordant, si c’étaient les « Maîtres allemands » ou les Hongrois ; qui vivait à Vienne respirait avec l’air le sentiment du rythme. Et de même que le goût musical se traduisait chez nous autres écrivains par une prose particulièrement châtiée, le sens de la mesure se manifestait chez les autres par leur tenue en société et toute leur existence journalière. Un Viennois sans goûts artistiques et sans amour de la forme était inconcevable dans la bonne société ; mais dans les classes inférieures elles-mêmes les plus humbles puisaient un certain instinct de la beauté dans le caractère du paysage, dans la sérénité humanisée du milieu ; on n’était pas un vrai Viennois sans cet amour de la culture, sans ce don de jouir, en évaluant son plaisir, du plus sain des superflus que nous offre la vie.
Or, l’adaptation à ce milieu que constituent un peuple et son séjour n’est pas seulement pour les Juifs une mesure extérieure de protection, mais un besoin intime et profond. Leur aspiration à une patrie, à un repos, à une trêve, à une sécurité, à un lieu où ils ne soient pas étrangers les contraint de se rattacher avec passion à la culture du monde où ils vivent. Et jamais une telle symbiose ne se révéla plus heureuse et plus féconde qu’en Autriche, sinon dans l’Espagne du XVe siècle. Installés depuis plus de deux cents ans dans la ville impériale, les Juifs y rencontrèrent un peuple de mœurs faciles et d’humeur conciliante, et qui, sous son apparente légèreté, nourrissait le même instinct profond des valeurs esthétiques et spirituelles qui avaient pour eux-mêmes tant d’importance. Ils trouvèrent plus à Vienne : ils y eurent une tâche à remplir. Au cours du siècle passé, le culte des arts avait perdu en Autriche ses gardiens et ses protecteurs traditionnels, je veux dire la maison impériale et l’aristocratie. Tandis qu’au XVIIIe siècle, Marie-Thérèse confiait à Gluck le soin d’enseigner la musique à ses filles, que Joseph II discutait en connaisseur avec Mozart des opéras de ce grand maître, que Léopold III composait lui-même, les souverains qui leur succédèrent, François II et Ferdinand, ne s’intéressaient plus du tout aux beaux-arts, et notre empereur François-Joseph, qui, à quatre-vingts ans, n’avait pas lu un livre en dehors de son Précis d’art militaire et n’en avait pas tenu un entre ses mains, témoignait même à l’égard de la musique une antipathie déclarée. Et pareillement la haute noblesse avait abdiqué son mécénat ; on avait vu jadis les temps glorieux où les Esterhazy accueillaient chez eux Joseph Haydn, où les Lobkovitz, les Kinsky et les Waldstein se disputaient l’honneur de donner dans leurs palais la première exécution des œuvres de Beethoven, où une comtesse Thun se jetait à genoux devant le grand démon en le suppliant de ne pas retirer à l’Opéra son Fidélio. Déjà Wagner, Brahms et Johann Strauss ou Hugo Wolf ne trouvèrent plus auprès d’eux le moindre appui ; afin de maintenir les concerts philharmoniques à leur ancien niveau, de rendre l’existence possible aux peintres et aux sculpteurs, il fallait que la bourgeoisie sautât sur la brèche, et ce fut justement l’orgueil et l’ambition de la bourgeoisie juive, de paraître là au premier rang et de maintenir dans son ancien éclat la renommée de la culture viennoise. Ils avaient toujours aimé cette ville et s’y étaient acclimatés de toute leur âme, mais ce n’est que par leur amour de l’art viennois qu’ils jugèrent y avoir acquis droit de cité et se sentirent devenus vraiment Viennois. Par ailleurs ils ne jouaient dans la vie publique qu’un rôle assez effacé ; l’éclat de la maison impériale reléguait dans l’ombre les fortunes des particuliers, les plus hautes situations dans la conduite des affaires se transmettaient par hérédité, la diplomatie était réservée à l’aristocratie, l’armée et les fonctions les plus élevées aux anciennes familles, et les Juifs ne cherchèrent pas à se pousser dans ces cercles privilégiés. Pleins de tact, ils respectaient comme allant de soi ces prérogatives traditionnelles ; je me souviens, par exemple, que mon père évita toute sa vie de dîner chez Sacher, non pas par économie, car la différence entre les tarifs de cette maison et ceux des autres grands hôtels était minime, mais par le sentiment naturel des distances à observer ; il lui eût paru pénible ou inconvenant de s’asseoir à une table voisine de celles des princes Schwarzenberg ou Lobkovitz. Ce n’est que dans le culte des beaux-arts que tout le monde à Vienne se sentait les mêmes droits, parce que l’amour de l’art passait là pour un devoir de toute la communauté, et la bourgeoisie juive a pris une part considérable au développement de la culture viennoise en la favorisant par tous les moyens. Les Israélites constituaient le véritable public, ils remplissaient les théâtres, les salles de concert, ils achetaient les livres, les gravures, ils visitaient les expositions, ils étaient partout, avec leur intelligence plus souple et moins liée par une tradition, les promoteurs et les champions de toutes les nouveautés. Presque toutes les grandes collections d’œuvres d’art du XIXe siècle avaient été constituées par eux, presque toutes les tentatives artistiques n’avaient été rendues possibles que par eux ; sans l’intérêt stimulant que la bourgeoisie juive accordait à ces choses et qui contrastait avec l’indolence de la cour, de l’aristocratie et des millionnaires chrétiens, curieux uniquement de chevaux de course et de chasses, Vienne aurait retardé sur Berlin dans le domaine des beaux-arts, et cela dans la même mesure où l’Autriche demeurait politiquement inférieure à l’Allemagne. Quiconque voulait à Vienne faire passer une nouveauté, l’hôte étranger qui cherchait à obtenir audience auprès d’un public compréhensif, en était réduit à s’adresser à cette bourgeoisie juive ; quand on essaya, au temps de l’antisémitisme, de fonder un théâtre dit « national », il ne se trouva ni auteurs, ni acteurs, ni public pour le soutenir ; au bout de quelques mois ce « théâtre national » tomba lamentablement ; et cette tentative avortée illustra pour la première fois cette vérité, que les neuf dixièmes de ce que le monde célébrait comme étant la culture viennoise du XIXe siècle, avaient été favorisés, soutenus et parfois créés spontanément par la société juive de la cité.





























