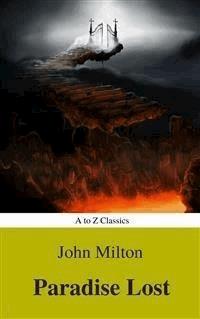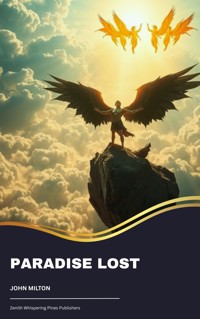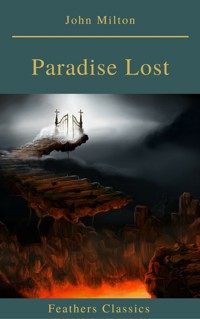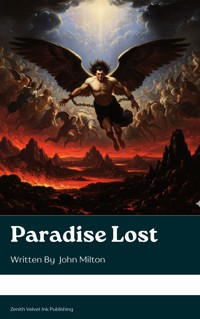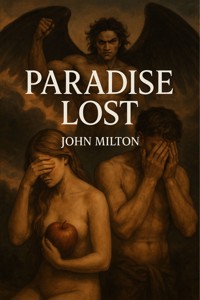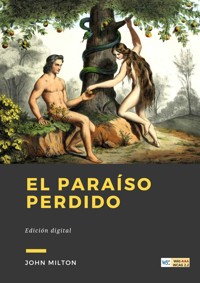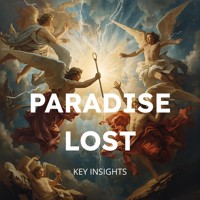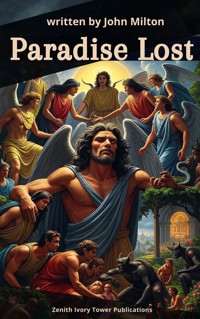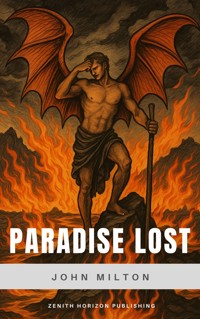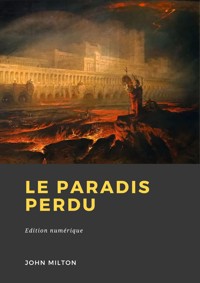
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Librofilio
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Plongez dans l'épopée poétique intemporelle de "Le Paradis perdu" de John Milton, un chef-d'œuvre de la littérature anglaise. Ce poème épique vous transporte au cœur d'une lutte cosmique entre le bien et le mal, explorant les thèmes de la chute de l'homme, de la rédemption et de la quête de sens. Suivez le destin de Satan, chassé du paradis et déterminé à corrompre l'humanité, ainsi que celui d'Adam et Ève, les premiers hommes confrontés à la tentation et à la perte de l'Éden. Milton déploie une plume puissante pour décrire les batailles célestes, les paysages enchanteurs et les personnages mythiques qui peuplent son récit. "Le Paradis perdu" est bien plus qu'un simple poème, c'est une exploration profonde de la condition humaine, de la liberté, de la responsabilité et de la grâce divine. Milton nous offre une réflexion philosophique sur le bien et le mal, la souffrance et l'espoir, dans un style d'écriture riche et évocateur. Ce classique de la littérature continue de fasciner les lecteurs par son ampleur et sa portée philosophique. "Le Paradis perdu" est une œuvre monumentale qui a influencé de nombreux écrivains et penseurs à travers les siècles.
Plongez dans cette épopée poétique grandiose et laissez-vous captiver par l'écriture majestueuse de John Milton. "Le Paradis perdu" est une lecture incontournable pour tous ceux qui cherchent une réflexion profonde sur la condition humaine et les questions existentielles.
À PROPOS DE L'AUTEUR
John Milton (1608-1674) était un poète anglais célèbre pour son poème épique "Paradise Lost" (1667), considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de la littérature anglaise. Milton était également un penseur politique et un défenseur de la liberté d'expression. Il a écrit de nombreux autres poèmes, dont "Paradise Regained" (1671) et "Samson Agonistes" (1671). Son écriture était caractérisée par son style épique, sa maîtrise de la langue anglaise et son exploration de thèmes religieux et philosophiques. Milton reste une figure influente de la littérature anglaise et son héritage perdure encore aujourd'hui.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 509
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le Paradis perdu
John Milton
– 1667 –Traduction : François-René de Chateaubriand, 1861
Je prie le lecteur de consulter l’Avertissement placé en tête de l’Essai sur la Littérature anglaise, et de revoir dans l’Essai même les chapitres relatifs à la vie et aux ouvrages de Milton.
Si je n’avais voulu donner qu’une traduction élégante du Paradis perdu, on m’accordera peut-être assez de connaissance de l’art pour qu’il ne m’eût pas été impossible d’atteindre la hauteur d’une traduction de cette nature ; mais c’est une traduction littérale dans toute la force du terme que j’ai entreprise, une traduction qu’un enfant et un poëte pourront suivre sur le texte, ligne à ligne, mot à mot, comme un dictionnaire ouvert sous leurs yeux. Ce qu’il m’a fallu de travail pour arriver à ce résultat, pour dérouler une longue phrase d’une manière lucide sans hacher le style, pour arrêter les périodes sur la même chute, la même mesure, la même harmonie ; ce qu’il m’a fallu de travail pour tout cela ne peut se dire. Qui m’obligeait à cette exactitude, dont il y aura si peu de juges et dont on me saura si peu de gré ? Cette conscience que je mets à tout, et qui me remplit de remords quand je n’ai pas fait ce que j’ai pu faire. J’ai refondu trois fois la traduction sur le manuscrit et le placard ; je l’ai remaniée quatre fois d’un bout à l’autre sur les épreuves ; tâche que je ne me serais jamais imposée si je l’eusse d’abord mieux comprise.
Au surplus, je suis loin de croire avoir évité tous les écueils de ce travail ; il est impossible qu’un ouvrage d’une telle étendue, d’une telle difficulté, ne renferme pas quelque contre-sens. Toutefois, il y a plusieurs manières d’entendre les mêmes passages ; les Anglais eux-mêmes ne sont pas toujours d’accord sur le texte, comme on peut le voir dans les glossateurs. Pour éviter de se jeter dans des controverses interminables, je prie le lecteur de ne pas confondre un faux sens avec un sens douteux ou susceptible d’interprétations diverses.
Je n’ai nullement la prétention d’avoir rendu intelligibles des descriptions empruntées de l’Apocalypse ou tirées des Prophètes, telles que ces mers de verre qui sont fondées en vue, ces roues qui tournent dans des roues, etc. Pour trouver un sens un peu clair à ces descriptions, il en aurait fallu retrancher la moitié : j’ai exprimé le tout par un rigoureux mot à mot, laissant le champ libre à l’interprétation des nouveaux Swedenborg qui entendront cela couramment.
Milton emprunte quelquefois l’ancien jargon italien : d’autour d’Ève sont lancés des dards de désir qui souhaite la présence d’Ève. Je ne sais pas si c’est le désir qui souhaite ; ce pourrait bien être le dard ; je n’ai donc pu exprimer que ce que je comprenais (si toutefois je comprenais), étant persuadé qu’on peut comprendre de pareilles choses de cent façons.
Si de longs passages présentent des difficultés, quelques traits rapides n’en offrent pas moins. Que signifie ce vers :
Your fear itself of death removes the fear.
« Votre crainte même de la mort écarte la crainte. »
Il y a des commentaires immenses là-dessus ; en voici un : « Le serpent dit : Dieu ne peut vous punir sans cesser d’être juste : s’il n’est plus juste il n’est plus Dieu ; ainsi vous ne devez point craindre sa menace ; autrement vous êtes en contradiction avec vous-même, puisque c’est précisément votre crainte qui détruit votre crainte. » Le commentateur ajoute, pour achever l’explication, « qu’il est bien fâché de ne pouvoir répandre un plus grand jour sur cet endroit. »
Dans l’invocation au commencement du VIIe livre, on lit :
I have presum’d(An earthly guest) and drawn empireal air,Thy temp’ring.
J’ai traduit comme mes devanciers : tempéré par toi. Richardson prétend que Milton fait ici allusion à ces voyageurs qui pour monter au haut du Ténériffe emportent des éponges mouillées, et se procurent de cette manière un air respirable ; voilà beaucoup d’autorités : cependant je crois que thy temp’ring veut dire simplement ta température. Thy est le pronom possessif, et non le pronom personnel thee. Temp’ring me semble un mot forgé par Milton, comme tant d’autres : la température de la muse, son air, son élément natal. Je suis persuadé que c’est là le sens simple et naturel de la phrase ; l’autre sens me paraît un sens subtil et détourné : toutefois, je n’ai pas osé le rejeter, parce qu’on a tort quand on a raison contre tout le monde.
Dans la description du cygne, le poète se sert d’une expression qui donne également ces deux sens : « Ses ailes lui servaient de manteau superbe, » ou bien : « Il formait sur l’eau une légère écume. » J’ai conservé le premier sens, adopté par la plupart des traducteurs, tout en regrettant l’autre.
Dans l’invocation du livre IX, la ponctuation qui m’a semblé la meilleure m’a fait adopter un sens nouveau : après ces mots : Heroic deemed, il y a un point et une virgule, de sorte que chief mastery me paraît devoir être pris, par exclamation, dans un sens ironique : en effet, la période qui suit est ironique. Le passage devient ainsi beaucoup plus clair que quand on unit chief mastery avec le membre de phrase qui le précède.
Vers la fin du dernier discours qu’Adam tient à Ève pour l’engager à ne pas aller seule au travail, il règne beaucoup d’obscurité ; mais je pense que cette obscurité est ici un grand art du poëte. Adam est troublé, un pressentiment l’avertit, il ne sait presque plus ce qu’il dit : il y a quelque chose qui fait frémir dans ces ténèbres étendues tout à coup sur les pensées du premier homme prêt à accorder la permission fatale qui doit le perdre lui et sa race.
J’avais songé à mettre à la fin de ma traduction un tableau des différents sens que l’on peut donner à tels ou tels vers du Paradis perdu, mais j’ai été arrêté par cette question que je n’ai cessé de me faire dans le cours de mon travail : Qu’importe tout cela aux lecteurs et aux auteurs d’aujourd’hui ? Qu’importe maintenant la conscience en toute chose ? Qui lira mes commentaires ? Qui s’en souciera ?
J’ai calqué le poëme de Milton à la vitre ; je n’ai pas craint de changer le régime des verbes lorsqu’en restant plus français j’aurais fait perdre à l’original quelque chose de sa précision, de son originalité ou de son énergie : cela se comprendra mieux par des exemples.
Le poète décrit le palais infernal ; il dit :
Many a rowOf starry lamps. . . . . .. . . . . . . . Yelded light
As from a sky.
J’ai traduit : « Plusieurs rangs de lampes étoilées… émanent la lumière comme un firmament. » Or je sais qu’émaner, en français, n’est pas un verbe actif : un firmament n’émane pas de la lumière, la lumière émane d’un firmament : mais traduisez ainsi, que devient l’image ? Du moins le lecteur pénètre ici dans le génie de la langue anglaise ; il apprend la différence qui existe entre les régimes des verbes dans cette langue et dans la nôtre.
Souvent, en relisant mes pages j’ai cru les trouver obscures ou traînantes, j’ai essayé de faire mieux : lorsque la période a été debout élégante ou claire, au lieu de Milton je n’ai rencontré que Bitaubé ; ma prose lucide n’était plus qu’une prose commune ou artificielle, telle qu’on en trouve dans tous les écrits communs du genre classique. Je suis revenu à ma première traduction. Quand l’obscurité a été invincible, je l’ai laissée ; à travers cette obscurité on sentira encore le dieu.
Dans le second livre du Paradis perdu, on lit ce passage :
No rest : through many a dark and dreary valeThey pass’d and many a region dolorous,O’er many a frozen, many a fiery Alp,Rocks, caves, lakes, fens, bogs, dens, and shades of death,A universe of death, which God by curseCreated evil, for evil only good,Where all life dies, death lives, and nature breeds,Perverse, all monstrous, all prodigious things,Abominable, inutterable, and worseThan fables yet have feign’d or fear conceiv’d,
Gorgons, and Hydras, and Chimaeras dire.
« Elles traversent maintes vallées sombres et désertes, maintes régions douloureuses, par-dessus maintes Alpes de glace et maintes Alpes de feu : rocs, grottes, lacs, mares, gouffres, antres et ombres de mort ; univers de mort, que Dieu dans sa malédiction créa mauvais, bon pour le mal seulement ; univers où toute vie meurt, où toute mort vit, où la nature perverse engendre toutes choses monstrueuses, toutes choses prodigieuses, abominables, inexprimables, et pires que ce que la fable inventa ou la frayeur conçut : gorgones et hydres et chimères effroyables. »
Ici le mot répété many est traduit par notre vieux mot maintes, qui donne à la fois la traduction littérale et presque la même consonance. Le fameux vers monosyllabique si admiré des Anglais :
Rocks, caves, lakes, fens, bogs, dens, and shades of death,
j’ai essayé de le rendre par les monosyllabes rocs, lacs, mares, gouffres, antres et ombres de mort, en retranchant les articles. Le passage rendu de cette manière produit des effets d’harmonie semblables ; mais, j’en conviens, c’est un peu aux dépens de la syntaxe. Voici le même passage, traduit dans toutes les règles de la grammaire par Dupré de Saint-Maur :
« En vain traversaient-elles des vallées sombres et hideuses, des régions de douleur, des montagnes de glace et de feu ; en vain franchissaient-elles des rochers, des fondrières, des lacs, des précipices et des marais empestés ; elles retrouvaient toujours d’épouvantables ténèbres, les ombres de la mort, que Dieu forma dans sa colère, au jour qu’il créa les maux inséparables du crime. Elles ne voyaient que des lieux où la vie expire, et où la mort seule est vivante : la nature perverse n’y produit rien que d’énorme et de monstrueux ; tout en est horrible, inexprimable, et pire encore que tout ce que les fables ont feint, ou que la crainte s’est jamais figuré de Gorgones, d’Hydres et de Chimères dévorantes. »
Je ne parle point de ce que le traducteur prête ici au texte ; c’est au lecteur à voir ce qu’il gagne ou perd par cette paraphrase ou par mon mot à mot. On peut consulter les autres traductions, examiner ce que mes prédécesseurs ont ajouté ou omis (car ils passent en général les endroits difficiles), peut-être en résultera-t-il cette conviction que la version littérale est ce qu’il y a de mieux pour faire connaître un auteur tel que Milton.
J’en suis tellement convaincu que dans l’Essai sur la Littérature anglaise, en citant quelques passages du Paradis perdu, je me suis légèrement éloigné du texte : eh bien ! qu’on lise les mêmes passages dans la traduction littérale du poëme, et l’on verra, ce me semble, qu’ils sont beaucoup mieux rendus, même pour l’harmonie.
Tout le monde, je le sais, a la prétention d’exactitude : je ressemble peut-être à ce bon abbé Leroy, curé de Saint-Herbland de Rouen et prédicateur du roi : lui aussi a traduit Milton, et en vers ! Il dit : « Pour ce qui est de notre traduction, son principal mérite, comme nous l’avons dit, c’est d’être fidèle. »
Or, voici comme il est fidèle, de son propre aveu. Dans les notes du VIIe chant, on lit : « J’ai substitué ceci à la fable de Bellérophon, m’étant proposé d’en purger cet ouvrage. (…) J’ai adapté, au reste, les plaintes de Milton de façon qu’elles puissent convenir encore plus à un homme de mérite. (…) Ici j’ai changé ou retranché un long récit de l’aventure d’Orphée, mis à mort par les Bacchantes sur le mont Rhodope. »
Changer ou retrancher l’admirable passage où Milton se compare à Orphée déchiré par ses ennemis !
« La Muse ne put défendre son fils ! »
Je ne crois pas néanmoins qu’il faille aller jusqu’à cette précision de Luneau de Boisjerman : « Ne pas avoir besoin de répétition, comme qui serait non de pouvoir d’un seul coup ». La traduction interlinéaire de Luneau est cependant utile ; mais il ne faut pas trop s’y fier ; car, par une inadvertance étrange, en suivant le mot à mot, elle fourmille de contre-sens ; souvent la glose au-dessous donne un sons opposé à la traduction interlinéaire.
Ce que je viens de dire sera mon excuse pour les chicanes de langue que l’on pourrait me faire. Je passe condamnation sur tout, pourvu qu’on m’accorde que le portrait, quelque mauvais qu’on le trouve, est ressemblant.
J’ai déjà signalé1 les difficultés grammaticales de la langue de Milton ; une des plus grandes vient de l’introduction de plusieurs nominatifs indirects dans une période régie par un principal nominatif, de sorte que tout à coup vous trouverez un he, un their qui vous étonnent, qui vous obligent à un effort de mémoire ou qui vous forcent à remonter la période pour retrouver la personne ou les personnes auxquelles ce he ou ce their appartiennent. Une autre espèce d’obscurité naît de la concision et de l’ellipse ; faut-il donc s’étonner de la variété et des contre-sens des traductions dans ces passages ? Ai-je rencontré plus juste ? Je le crois, mais je n’en suis pas sûr : il ne me paraît même pas clair que Milton ait toujours bien lui-même rendu sa pensée : ce haut génie s’est contenté quelquefois de l’à peu près, et il a dit à la foule : « Devine, si tu peux. »
Le nominatif absolu des Grecs, si fréquent dans le style antique de Milton, est très-inélégant dans notre langue. Thou Looking on pour thee Looking on. Je l’ai cependant employé sans égard à son étrangeté, aussi frappante en anglais qu’en français.
Les ablatifs absolus du latin dont Le Paradis perdu abonde, sont un peu plus usités dans notre langue ; mais en les conservant j’ai parfois été obligé d’y joindre un des temps du verbe être pour faire disparaître une amphibologie.
C’est ainsi encore que j’ai complété quelques phrases non complètes. Milton parle des serpents qui bouclent Mégère : force est ici de dire qui forment des boucles sur la tête de Mégère.
Bentley prétend que, Milton étant aveugle, les éditeurs ont introduit dans le Paradis perdu des interpolations qu’il n’a pas connues : c’est peut-être aller loin ; mais il est certain que la cécité du chantre d’Éden a pu nuire à la correction de son ouvrage. Le poëte composait la nuit ; quand il avait fait quelques vers, il sonnait ; sa fille ou sa femme descendait ; il dictait : ce premier jet, qu’il oubliait nécessairement bientôt après, restait à peu près tel qu’il était sorti de son génie. Le poëme fut ainsi conduit à sa fin par inspirations et par dictées ; l’auteur ne put en revoir l’ensemble ni sur le manuscrit ni sur les épreuves. Or il y a des négligences, des répétitions de mots, des cacophonies qu’on n’aperçoit, et pour ainsi dire, qu’on n’entend qu’avec l’œil, en parcourant les épreuves. Milton isolé, sans assistance, sans secours, presque sans amis, était obligé de faire tous les changements dans son esprit, et de relire son poëme d’un bout à l’autre dans sa mémoire. Quel prodigieux effort de souvenir ! et combien de fautes ont dû lui échapper !
De là ces phrases inachevées, ces sens incomplets, ces verbes sans régimes, ces noms et ces pronoms sans relatifs, dont l’ouvrage fourmille. Le poëte commence une phrase au singulier et l’achève au pluriel, inadvertance qu’il n’aurait jamais commise s’il avait pu voir les épreuves. Pour rendre en français ces passages, il faut changer les nombres des pronoms, des noms et des verbes ; les personnes qui connaissent l’art savent combien cela est difficile. Le poëte ayant à son gré mêlé les nombres, a naturellement donné à ces mots la quantité et l’euphonie convenables ; mais le pauvre traducteur n’a pas la même faculté ; il est obligé de mettre sa phrase sur ses pieds : s’il opte pour le singulier, il tombe dans les verbes de la première conjugaison, sur un aima, sur un parla qui viennent heurter une voyelle suivante ; s’en tient-il au pluriel, il trouve un aimaient, un parlaient qui appesantissent et arrêtent la phrase au moment où elle devrait voler. Rebuté, accablé de fatigue, j’ai été cent fois au moment de planter là tout l’ouvrage. Jusqu’ici les traductions de ce chef-d’œuvre ont été moins de véritables traductions que des épitomés ou des amplifications paraphrasées dans lesquelles le sens général s’aperçoit à peine à travers une foule d’idées et d’images dont il n’y a pas un mot dans le texte. Comme je l’ai dit2, on peut se tirer tant bien que mal d’un morceau choisi ; mais soutenir une lutte sans cesse renouvelée pendant douze chants, c’est peut-être l’œuvre de patience la plus pénible qu’il y ait au monde.
Dans les sujets riants et gracieux, Milton est moins difficile à entendre, et sa langue se rapproche davantage de la nôtre. Toutefois les traducteurs ont une singulière monomanie : ils changent les pluriels en singuliers, les singuliers en pluriels, les adjectifs en substantifs, les articles en pronoms, les pronoms en articles. Si Milton dit le vent, l’arbre, la fleur, la tempête, etc., ils mettent les vents, les arbres, les fleurs, les tempêtes, etc. ; s’il dit un esprit doux, ils écrivent la douceur de l’esprit ; s’il dit sa voix, ils traduisent la voix, etc. Ce sont là de très-petites choses sans doute : cependant il arrive, on ne sait comment, que de tels changements répétés produisent à la fin du poëme une prodigieuse altération : ces changements donnent au génie de Milton cet air de lieu-commun qui s’attache à une phraséologie banale.
Je n’ai rien ajouté au texte ; j’ai seulement quelquefois été obligé de suppléer le mot collectif par lequel le poëte a oublié de lier les parties d’une longue énumération d’objets.
J’ai négligé çà et là des explétives redondantes qui embarrassaient la phrase sans ajouter à sa beauté, et qui n’étaient là évidemment que pour la mesure du vers : le sobre et correct Virgile lui-même a recours à ces explétives. On trouvera dans ma traduction synodes, mémoriaux, recordés, conciles, que les traducteurs n’ont osé risquer et qu’ils ont rendus par assemblées, emblèmes, rappelés, conseils, etc. ; c’est à tort, selon moi. Milton avait l’esprit rempli des idées et des controverses religieuses ; quand il fait parler les démons, il rappelle ironiquement dans son langage les cérémonies de l’Église romaine ; quand il parle sérieusement, il emploie la langue des théologues protestants. Il m’a semblé que cette observation oblige à traduire avec rigueur l’expression miltonienne, faute de quoi on ne ferait pas sentir cette partie intégrante du génie du poëte, la partie religieuse. Ainsi, dans une description du matin, Milton parle de la charmante heure de Prime : je suis persuadé que Prime est ici le nom d’un office de l’église ; il ne veut pas dire première ; malgré ma conviction je n’ai pas risqué le mot prime, quoique à mon avis il fasse beauté, en rappelant la prière matinale du monde chrétien.
L’astre avant-coureur de l’aurore,Du soleil qui s’approche annonce le retour,Sous le pâle horizon l’ombre se décolore :Lève-toi dans nos cœurs, chaste et bienheureux jour.
Racine.
Une autre beauté, selon moi, qui se tire encore du langage chrétien, c’est l’affectation de Satan à parler comme le Très-Haut ; il dit toujours ma droite au lieu de mon bras : j’ai mis une grande attention à rendre ces tours ; ils caractérisent merveilleusement l’orgueil du prince des ténèbres.
Dans les cantiques que le poëte fait chanter aux anges, et qu’il emprunte de l’Écriture, il suit l’hébreu, et il ramène quelques mots en refrain au bout du verset : ainsi praise termine presque toutes les strophes de l’hymne d’Adam et d’Ève au lever du jour. J’ai pris garde à cela, et je reproduis à la chute le mot louange : mes prédécesseurs n’ayant peut-être pas remarqué le retour de ce mot, ont fait perdre aux vers leur harmonie lyrique.
Lorsque Milton peint la création il se sert rigoureusement des paroles de la Genèse, de la traduction anglaise : je me suis servi des mots français de la traduction de Sacy, quoiqu’ils diffèrent un peu du texte anglais : en des matières aussi sacrées j’ai cru ne devoir reproduire qu’un texte approuvé par l’autorité de l’Église.
J’ai employé, comme je l’ai dit encore3, de vieux mots ; j’en ai fait de nouveaux, pour rendre plus fidèlement le texte ; c’est surtout dans les mots négatifs que j’ai pris cette licence ; on trouvera donc inadorée, imparité, inabstinence, etc. On compte cinq ou six cents mots dans Milton qu’on ne trouve dans aucun dictionnaire anglais. Johnson, parlant du grand poëte, s’exprime ainsi :
Through all his greater works there prevails an uniform peculiarity of DICTION, a mode and cast of expression which bears little resemblance to that of any former writer, and which is so far removed from common use, that an unlearned reader when he first opens his book, finds himself surprised by a new language… our language, says Addison, sunk under him.
« Dans tous les plus grands ouvrages de Milton prévalent une uniforme singularité de diction, un mode et un tour d’expression qui ont peu de ressemblance avec ceux d’aucun écrivain précédent, et qui sont si éloignés de l’usage ordinaire, qu’un lecteur non lettré, quand il ouvre son livre pour la première fois, se trouve surpris par une langue nouvelle… Notre langue, dit Addison, s’abat (ou s’enfonce ou coule bas) sous lui. »
Milton imite sans cesse les anciens ; s’il fallait citer tout ce qu’il imite, on ferait un in-folio de notes : pourtant quelques notes seraient curieuses et d’autres seraient utiles pour l’intelligence du texte.
Le poëte, d’après la Genèse, parle de l’esprit qui féconda l’abîme. Du Bartas avait dit :
D’une même façon l’esprit de l’Éternel
Semble couver ce gouffre.
L’obscurité ou les ténèbres visibles rappellent l’expression de Sénèque : non ut per tenebras videamus, sed ut ipsas.
Satan élevant sa tête au-dessus du lac de feu est une image empruntée à l’Énéide :
Pectora quorum inter fluctus arrecta.
Milton faisant dire à Satan que régner dans l’Enfer est digne d’ambition traduit Grotius : Regnare dignum est ambitu, etsi in Tartaro.
La comparaison des anges tombés aux feuilles de l’automne est prise de l’Iliade et de l’Énéide. Lorsque, dans son invocation le poëte s’écrie qu’il va chanter des choses qui n’ont encore été dites ni en prose ni en vers, il imite à la fois Lucrèce et Arioste :
Cosa non detta in prosa mai, ne in rima.
Le lasciate ogni speranza est commenté ainsi d’une manière sublime : Régions de chagrins, obscurité plaintive où l’espérance ne peut jamais venir, elle qui vient à tous : « hope never comes that comes to all. »
Lorsque Milton représente des anges tournant les uns sur la lance, les autres sur le bouclier, pour signifier tourner à droite et à gauche, cette façon de parler poétique est empruntée d’un usage commun chez les Romains : le légionnaire tenait la lance de la main droite et le bouclier de la main gauche : declinare ad hastam vel ad scutum ; ainsi Milton met à contribution les historiens aussi bien que les poëtes ; et en ayant l’air de ne rien dire, il vous apprend toujours quelque chose. Remarquez que la plupart des citations que je viens d’indiquer se trouvent dans les trois cents premiers vers du Paradis perdu : encore ai-je négligé d’autres imitations d’Ézéchiel, de Sophocle, du Tasse, etc.
Le mot saison dans le poëme doit être quelquefois traduit par le mot heure : le poëte, sans vous le dire, s’est fait Grec, ou plutôt s’est fait Homère, ce qui lui était tout naturel ; il transporte dans le dialecte anglais une expression hellénique.
Quand il dit que le nom de la femme est tiré de celui de l’homme, qui le comprendra si l’on ne sait que cela est vrai d’après le texte de la Vulgate, virago, et d’après la langue anglaise, woman, ce qui n’est pas vrai en français. Quand il donne à Dieu l’Empire carré et à Satan l’Empire rond, voulant par là faire entendre que Dieu gouverne le ciel et Satan le monde, il faut savoir que saint Jean dans l’Apocalypse dit : « Civitas Dei in quadro posita. »
Il y aurait mille autres remarques à faire de cette espèce, surtout à une époque où les trois quarts des lecteurs ne connaissent pas plus l’Écriture Sainte et les Pères de l’Église qu’ils ne savent le chinois.
Jamais style ne fut plus figuré que celui de Milton : ce n’est point Ève qui est douée d’une majesté virginale, c’est la majestueuse virginité qui se trouve dans Ève ; Adam n’est point inquiet, c’est l’inquiétude qui agit sur Adam ; Satan ne rencontre pas Ève par hasard, c’est le hasard de Satan qui rencontre Ève ; Adam ne veut pas empêcher Ève de s’absenter, il cherche à dissuader l’absence d’Ève. Les comparaisons, à cause même de ces tours, sont presque intraduisibles : assez rarement empruntées des images de la nature, elles sont prises des usages de la société, des travaux du laboureur et du matelot, des réminiscences de l’histoire et de la mythologie ; ce qui rappelle, pour le dire en passant, que Milton était aveugle, et qu’il tirait de ses souvenirs une partie de son génie. Une comparaison admirable, et qui n’appartient qu’à lui, est celle de cet homme sorti un matin des fumées d’une grande ville pour se promener dans les fraîches campagnes, au milieu des moissons, des troupeaux, et rencontrant une jeune fille plus belle que tout cela : c’est Satan échappé du gouffre de l’Enfer qui rencontre Ève au milieu des retraites fortunées d’Éden. On voit aussi par la vie de Milton qu’il remémore dans cette comparaison le temps de sa jeunesse : dans une des promenades matinales qu’il faisait autour de Londres s’offrit à sa vue une jeune femme d’une beauté extraordinaire : il en devint passionnément amoureux, ne la retrouva jamais, et fit le serment de ne plus aimer.
Au reste, Milton n’était pas toujours logique ; il ne faudra pas croire ma traduction fautive quand les idées manqueront de conséquence et de justesse.
Ce qu’il faut demander au chantre d’Éden, c’est de la poésie, et de la poésie la plus haute à laquelle il soit donné à l’esprit humain d’atteindre ; tout vit chez cet homme, les êtres moraux comme les êtres matériels : dans un combat ce ne sont pas les dards qui voûtent le ciel ou qui forment une voûte enflammée, ce sont les sifflements mêmes de ces dards ; les personnages n’accomplissent pas des actions, ce sont leurs actions qui agissent comme si elles étaient elles-mêmes des personnages. Lorsqu’on est si divinement poëte, qu’on habite au plus sublime sommet de l’Olympe, la critique est ridicule en essayant de monter là : les reproches que l’on peut faire à Milton sont des reproches d’une nature inférieure ; ils tiennent de la terre où ce dieu n’habite pas. Que dans un homme une qualité s’élève à une hauteur qui domine tout, il n’y a point de tache que cette qualité ne fasse disparaître dans son éclat immense.
Si Milton, très-admiré en Angleterre, est assez peu lu ; s’il est moins populaire que Shakespeare, qui doit une partie de cette popularité au rajeunissement qu’il reçoit chaque jour sur la scène, cela tient à la gravité du poëte, au sérieux du poëme et à la difficulté de l’idiome miltonien. Milton, comme Homère, parle une langue qui n’est pas la langue vulgaire ; mais avec cette différence que la langue d’Homère est une langue simple, naturelle, facile à apprendre, au lieu que la langue de Milton est une langue composée, savante, et dont la lecture est un véritable travail. Quelques morceaux choisis du Paradis perdu sont dans la mémoire de tout le monde ; mais, à l’exception d’un millier de vers de cette sorte, il reste onze mille vers qu’on a lus rapidement, péniblement, ou qu’on n’a jamais lus.
Voilà assez de remarques pour les personnes qui savent l’anglais et qui attachent quelque prix à ces choses-là ; en voilà beaucoup trop pour la foule des lecteurs : à ceux-ci il importe fort peu qu’on ait fait ou qu’on n’ait pas fait un contre-sens, et ils se contenteraient tout aussi bien d’une version commune, amplifiée ou tronquée.
On dit que de nouvelles traductions de Milton doivent bientôt paraître ; tant mieux ! on ne saurait trop multiplier un chef-d’œuvre : mille peintres copient tous les jours les tableaux de Raphaël et de Michel-Ange. Si les nouveaux traducteurs ont suivi mon système, ils reproduiront à peu ma traduction ; ils feront ressortir les endroits où je puis m’être trompé : s’ils ont pris le système de la traduction libre, le mot à mot de mon humble travail sera comme le germe de la belle fleur qu’ils auront habilement développée.
Me serait-il permis d’espérer que si mon essai n’est pas trop malheureux, il pourra amener quelque jour une révolution dans la manière de traduire ? Du temps d’Ablancourt les traductions s’appelaient de belles infidèles ; depuis ce temps-là on a vu beaucoup d’infidèles qui n’étaient pas toujours belles : on en viendra peut-être à trouver que la fidélité, même quand la beauté lui manque, a son prix.
Il est des génies heureux qui n’ont besoin de consulter personne, qui produisent sans effort avec abondance des choses parfaites : je n’ai rien de cette félicité naturelle, surtout en littérature ; je n’arrive à quelque chose qu’avec de longs efforts ; je refais vingt fois la même page, et j’en suis toujours mécontent : mes manuscrits et mes épreuves sont, par la multitude des corrections et des renvois, de véritables broderies, dont j’ai moi-même beaucoup de peine à retrouver le fil4. Je n’ai pas la moindre confiance en moi ; peut-être même ai-je trop de facilité à recevoir les avis qu’on veut bien me donner ; il dépend presque du premier venu de me faire changer ou supprimer tout un passage : je crois toujours que l’on juge et que l’on voit mieux que moi.
Pour accomplir ma tâche, je me suis environné de toutes les disquisitions des scoliastes : j’ai lu toutes les traductions françaises, italiennes et latines que j’ai pu trouver. Les traductions latines, par la facilité qu’elles ont à rendre littéralement les mots et à suivre des inversions, m’ont été très-utiles.
J’ai quelques amis que depuis trente ans je suis accoutumé à consulter : je leur ai encore proposé mes doutes dans ce dernier travail ; j’ai reçu leurs notes et leurs observations ; j’ai discuté avec eux les points difficiles ; souvent je me suis rendu à leur opinion ; quelquefois ils sont revenus à la mienne. Il m’est arrivé, comme à Louis Racine, que des Anglais m’ont avoué ne pas comprendre le passage sur lequel je les interrogeais. Heureux encore une fois ces esprits qui savent tout et n’ont besoin de personne ; moi, faible, je cherche des appuis, et je n’ai point oublié le précepte du maître :
Faites choix d’un censeur solide et salutaireQue la raison conduise et le savoir éclaire,Et dont le crayon sûr d’abord aille chercherL’endroit que l’on sent faible et qu’on se veut cacher.
Dans tout ce que je viens de dire, je ne fais point mon apologie, je cherche seulement une excuse à mes fautes. Un traducteur n’a droit à aucune gloire ; il faut seulement qu’il montre qu’il a été patient, docile et laborieux.
Si j’ai eu le bonheur de faire connaître Milton à la France, je ne me plaindrai pas des fatigues que m’a causées l’excès de ces études : tant il y a cependant que pour éviter de nouveau l’avenir probable d’une vie fidèle, je ne recommencerais pas un pareil travail ; j’aimerais mieux mille fois subir toute la rigueur de cet avenir.
VERS.
Le vers héroïque anglais consiste dans la mesure sans rime, comme le vers d’Homère en grec et de Virgile en latin : la rime n’est ni une adjonction nécessaire ni le véritable ornement d’un poëme ou de bons vers, spécialement dans un long ouvrage : elle est l’invention d’un âge barbare, pour relever un méchant sujet ou un mètre boiteux. À la vérité elle a été embellie par l’usage qu’en ont fait depuis quelques fameux poëtes modernes, cédant à la coutume ; mais ils l’ont employée à leur grande vexation, gêne et contrainte, pour exprimer plusieurs choses (et souvent de la plus mauvaise manière) autrement qu’ils ne les auraient exprimées. Ce n’est donc pas sans cause que plusieurs poëtes du premier rang, italiens et espagnols, ont rejeté la rime des ouvrages longs et courts. Ainsi a-t-elle été bannie depuis longtemps de nos meilleures tragédies anglaises, comme une chose d’elle-même triviale, sans vraie et agréable harmonie pour toute oreille juste. Cette harmonie naît du convenable nombre, de la convenable quantité des syllabes, et du sens passant avec variété d’un vers à un autre vers ; elle ne résulte pas du tintement de terminaisons semblables ; faute qu’évitaient les doctes anciens, tant dans la poésie que dans l’éloquence oratoire. L’omission de la rime doit être comptée si peu pour défaut (quoiqu’elle puisse paraître telle aux lecteurs vulgaires), qu’on la doit regarder plutôt comme le premier exemple offert en anglais de l’ancienne liberté rendue au poëme héroïque affranchi de l’incommode et moderne entrave de la rime.
1Avertissement de l’Essai.
2Avertissement de l’Essai.
3Avertissement de l’Essai.
4C’est l’excuse pour les fautes d’impression, si nombreuses dans mes ouvrages. Les compositeurs fatigués se trompent malgré eux, par la multitude des changements, des retranchements ou des additions.
Livre premier
Argument.
Ce premier livre expose d’abord brièvement tout le sujet, la désobéissance de l’homme, et d’après cela la perte du Paradis, où l’homme était placé. Ce livre parle ensuite de la première cause de la chute de l’homme, du serpent, ou plutôt de Satan dans le serpent qui, se révoltant contre Dieu et attirant de son côté plusieurs légions d’anges, fut, par le commandement de Dieu, précipité du ciel avec toute sa bande dans le grand abîme. Après avoir passé légèrement sur ce fait, le poëme ouvre au milieu de l’action : il présente Satan et ses anges maintenant tombés en enfer. L’enfer n’est pas décrit ici comme placé dans le centre du monde (car le ciel et la terre peuvent être supposés n’être pas encore faits et certainement pas encore maudits), mais dans le lieu des ténèbres extérieures, plus convenablement appelé Chaos. Là, Satan avec ses anges, couché sur le lac brûlant, foudroyé et évanoui, au bout d’un certain espace de temps revient à lui comme de la confusion d’un songe. Il appelle celui qui, le premier après lui en puissance et en dignité, gît à ses côtés. Ils confèrent ensemble de leur misérable chute. Satan réveille toutes ses légions, jusqu’alors demeurées confondues de la même manière. Elles se lèvent : leur nombre, leur ordre de bataille ; leurs principaux chefs, nommés d’après les idoles connues par la suite en Chanaan et dans les pays voisins. Satan leur adresse un discours, les console par l’espérance de regagner le ciel ; il leur parle enfin d’un nouveau monde, d’une nouvelle espèce de créatures qui doivent être un jour formées selon une antique prophétie ou une tradition répandue dans le ciel. Que les anges existassent longtemps avant la création visible, c’était l’opinion de plusieurs anciens Pères. Pour discuter le sens de la prophétie, et déterminer ce qu’on peut faire en conséquence, Satan s’en réfère à un grand conseil ; ses associés adhèrent à cet avis : Pandæmonium, palais de Satan, s’élève soudainement bâti de l’abîme : les pairs infernaux y siègent en conseil.
La première désobéissance de l’homme et le fruit de cet arbre défendu dont le mortel goût apporta la mort dans le monde, et tous nos malheurs, avec la perte d’Éden, jusqu’à ce qu’un homme plus grand nous rétablît et reconquît le séjour bienheureux, chante, Muse céleste ! Sur le sommet secret d’Oreb et de Sinaï tu inspiras le berger qui le premier apprit à la race choisie comment, dans le commencement, le Ciel et la Terre sortirent du chaos. Ou si la colline de Sion, le ruisseau de Siloë, qui coulait rapidement près de l’oracle de Dieu, te plaisent davantage, là j’invoque ton aide pour mon chant aventureux : ce n’est pas d’un vol tempéré qu’il veut prendre l’essor au-dessus des monts d’Aonie, tandis qu’il poursuit des choses qui n’ont encore été tentées ni en prose ni en vers.
Et toi, ô Esprit ! qui préfère à tous les temples un cœur droit et pur, instruis-moi, car tu sais ! Toi, au premier instant tu étais présent : avec tes puissantes ailes éployées, comme une colombe tu couvas l’immense abîme et tu le rendis fécond. Illumine en moi ce qui est obscur, élève et soutiens ce qui est abaissé, afin que de la hauteur de ce grand argument je puisse affirmer l’éternelle Providence, et justifier les voies de Dieu aux hommes.
Dis d’abord, car ni le ciel ni la profonde étendue de l’enfer ne dérobent rien à ta vue ; dis quelle cause, dans leur état heureux si favorisé du ciel, poussa nos premiers parents à se séparer de leur Créateur, à transgresser sa volonté pour une seule restriction, souverains qu’ils étaient du reste du monde. Qui les entraîna à cette honteuse révolte ? L’infernal serpent. Ce fut lui dont la malice animée d’envie et de vengeance trompa la mère du genre humain : son orgueil l’avait précipité du ciel avec son armée d’anges rebelles, par le secours desquels, aspirant à monter en gloire au-dessus de ses pairs il se flatta d’égaler le Très-Haut, si le Très-Haut s’opposait à lui. Plein de cet ambitieux projet contre le trône et la monarchie de Dieu, il alluma au ciel une guerre impie et un combat téméraire, dans une attente vaine.
Le souverain pouvoir le jeta flamboyant, la tête en bas, de la voûte éthérée ; ruine hideuse et brûlante : il tomba dans le gouffre sans fond de la perdition, pour y rester chargé de chaînes de diamant, dans le feu qui punit : il avait osé défier aux armes le Tout-Puissant ! Neuf fois l’espace qui mesure le jour et la nuit aux hommes mortels, lui, avec son horrible bande, fut étendu vaincu, roulant dans le gouffre ardent, confondu quoique immortel. Mais sa sentence le réservait encore à plus de colère, car la double pensée de la félicité perdue et d’un mal présent à jamais, le tourmente. Il promène autour de lui des yeux funestes, où se peignent une douleur démesurée et la consternation, mêlées à l’orgueil endurci et à l’inébranlable haine.
D’un seul coup d’œil et aussi loin que perce le regard des anges, il voit le lieu triste dévasté et désert : ce donjon horrible, arrondi de toutes parts, comme une grande fournaise flamboyait. De ces flammes point de lumière ! mais des ténèbres visibles servent seulement à découvrir des vues de malheur ; régions de chagrin, obscurité plaintive, où la paix, où le repos, ne peuvent jamais habiter, l’espérance jamais venir, elle qui vient à tous ! mais là des supplices sans fin, là un déluge de feu, nourri d’un soufre qui brûle sans se consumer.
Tel est le lieu que l’éternelle justice prépara pour ces rebelles ; ici elle ordonna leur prison dans les ténèbres extérieures ; elle leur fit cette part trois fois aussi éloignée de Dieu et de la lumière du ciel, que le centre de la création l’est du pôle le plus élevé. Oh ! combien cette demeure ressemble peu à celle d’où ils tombèrent !
Là bientôt l’archange discerne les compagnons de sa chute, ensevelis dans les flots et les tourbillons d’une tempête de feu. L’un d’eux se vautrait parmi les flammes à ses côtés, le premier en pouvoir après lui et le plus proche en crime : longtemps après connu en Palestine, il fut appelé Béelzébuth. Le grand ennemi (pour cela nommé Satan dans le ciel), rompant par ces fières paroles l’horrible silence, commence ainsi :
« Si tu es celui… Mais combien déchu, combien différent de celui qui, revêtu d’un éclat transcendant parmi les heureux du royaume de la lumière, surpassait en splendeur des myriades de brillants esprits !… Si tu es celui qu’une mutuelle ligue, qu’une seule pensée, qu’un même conseil, qu’une semblable espérance, qu’un péril égal dans une entreprise glorieuse, unirent jadis avec moi et qu’un malheur égal unit à présent dans une égale ruine, tu vois de quelle hauteur, dans quel abîme, nous sommes tombés ! tant il se montra le plus puissant avec son tonnerre ! Mais qui jusqu’alors avait connu l’effet de ces armes terribles ! Toutefois, malgré ces foudres, malgré tout ce que le vainqueur dans sa rage peut encore m’infliger, je ne me repens point, je ne change point : rien (quoique changé dans mon éclat extérieur) ne changera cet esprit fixe, ce haut dédain né de la conscience du mérite offensé, cet esprit qui me porta à m’élever contre le plus Puissant, entraînant dans ce conflit furieux la force innombrable d’esprits armés qui osèrent mépriser sa domination : ils me préférèrent à lui, opposant à son pouvoir suprême un pouvoir contraire ; et dans une bataille indécise, au milieu des plaines du ciel, ils ébranlèrent son trône.
« Qu’importe la perte du champ de bataille ! tout n’est pas perdu. Une volonté insurmontable, l’étude de la vengeance, une haine immortelle, un courage qui ne cédera ni ne se soumettra jamais, qu’est-ce autre chose que n’être pas subjugué ? Cette gloire, jamais sa colère ou sa puissance ne me l’extorquera. Je ne me courberai point ; je ne demanderai point grâce d’un genou suppliant ; je ne déifierai point son pouvoir qui, par la terreur de ce bras, a si récemment douté de son empire. Cela serait bas en effet : cela serait une honte et une ignominie au-dessous même de notre chute ! puisque par le destin, la force des dieux, la substance céleste ne peut périr ; puisque l’expérience de ce grand événement, dans les armes non affaiblies, ayant gagné beaucoup en prévoyance, nous pouvons, avec plus d’espoir de succès, nous déterminer à faire, par ruse ou par force, une guerre éternelle, irréconciliable, à notre grand ennemi, qui triomphe maintenant, et qui, dans l’excès de sa joie, régnant seul, tient la tyrannie du Ciel. »
Ainsi partait l’ange apostat, quoique dans la douleur ; se vantant à haute voix, mais déchiré d’un profond désespoir. Et à lui répliqua bientôt son fier compagnon :
« Ô prince ! ô chef de tant de trônes ! qui conduisis à la guerre sous ton commandement les séraphins rangés en bataille ! qui, sans frayeur, dans de formidables actions, mis en péril le Roi perpétuel des cieux et à l’épreuve son pouvoir suprême, soit qu’il le tînt de la force, du hasard ou du destin ; ô chef ! je vois trop bien et je maudis l’événement fatal qui, par une triste déroute et une honteuse défaite, nous a ravi le ciel. Toute cette puissante armée est ainsi plongée dans une horrible destruction, autant que des dieux et des substances divines peuvent périr ; car la pensée et l’esprit demeurent invincibles, et la vigueur bientôt revient, encore que toute notre gloire soit éteinte et notre heureuse condition engouffrée ici dans une infinie misère. Mais quoi ? Si lui notre vainqueur (force m’est de le croire le Tout-Puissant, puisqu’il ne fallait rien moins qu’un tel pouvoir pour dompter un pouvoir tel que le nôtre), si ce vainqueur nous avait laissé entiers notre esprit et notre vigueur, afin que nous puissions endurer et supporter fortement nos peines, afin que nous puissions suffire à sa colère vengeresse, ou lui rendre un plus rude service comme ses esclaves par le droit de la guerre, ici, selon ses besoins, dans le cœur de l’enfer, travailler dans le feu, ou porter ses messages dans le noir abîme ? Que nous servirait alors de sentir notre force non diminuée ou l’éternité de notre être, pour subir un éternel châtiment ? »
Le grand ennemi répliqua par ces paroles rapides :
« Chérubin tombé, être faible et misérable, soit qu’on agisse ou qu’on souffre. Mais sois assuré de ceci : faire le bien ne sera jamais notre tâche ; faire toujours le mal sera notre seul délice, comme étant le contraire de la haute volonté de celui auquel nous résistons. Si donc sa providence cherche à tirer le bien de notre mal, nous devons travailler à pervertir cette fin, et à trouver encore dans le bien les moyens du mal. En quoi souvent nous pourrons réussir de manière peut-être à chagriner l’ennemi et, si je ne me trompe, à détourner ses plus profonds conseils de leur but marqué.
« Mais vois ! le vainqueur courroucé a rappelé aux portes du ciel ses ministres de poursuite et de vengeance. La grêle de soufre lancée sur nous dans la tempête passée, a abattu la vague brûlante qui du précipice du ciel nous reçut tombants. Le tonnerre, avec ses ailes de rouges éclairs, et son impétueuse rage, a peut-être épuisé ses traits, et cesse maintenant, de mugir à travers l’abîme vaste et sans bornes. Ne laissons pas échapper l’occasion que nous cède le dédain ou la fureur rassasiée de notre ennemi. Vois-tu au loin cette plaine sèche, abandonnée et sauvage, séjour de la désolation, vide de lumière, hors de celle que la lueur de ces flammes noires et bleues lui jette pâle et effrayante ? Là, tendons à sortir des ballottements de ces vagues de feu ; là, reposons-nous, si le repos peut habiter là. Rassemblant nos légions affligées, examinons comment nous pourrons dorénavant nuire à notre ennemi, comment nous pourrons réparer notre perte, surmonter cette affreuse calamité ; quel renforcement nous pouvons tirer de l’espérance, sinon quelle résolution du désespoir. »
Ainsi parlait Satan à son compagnon le plus près de lui, la tête levée au-dessus des vagues, les yeux étincelants ; les autres parties de son corps affaissées sur le lac, étendues longues et larges, flottaient sur un espace de plusieurs arpents. En grandeur il était aussi énorme que celui que les fables appellent, de sa taille monstrueuse, Titanien, ou né de la Terre, lequel fit la guerre à Jupiter ; Briarée ou Tiphon, dont la caverne s’ouvrait près de l’ancienne Tarse. Satan égalait encore cette bête de la mer, Léviathan, que Dieu de toutes ses créatures, fit la plus grande entre celles qui nagent dans le cours de l’Océan : souvent la bête dort sur l’écume norwégienne ; le pilote de quelque petite barque égarée au milieu des ténèbres la prend pour une île (ainsi le racontent les matelots) : il fixe l’ancre dans son écorce d’écaille, s’amarre sous le vent à son côté, tandis que la nuit investit la mer, et retarde l’aurore désirée. Ainsi, énorme en longueur le chef ennemi gisait enchaîné sur le lac brûlant ; jamais il n’eût pu se lever ou soulever sa tête, si la volonté et la haute permission du régulateur de tous les cieux ne l’avaient laissé libre dans ses noirs desseins ; afin que par ses crimes réitérés il amassât sur lui la damnation, alors qu’il cherchait le mal des autres ; afin qu’il pût voir, furieux, que toute sa malice n’avait servi qu’à faire luire l’infinie bonté, la grâce, la miséricorde sur l’homme par lui séduit ; à attirer sur lui-même, Satan, triple confusion, colère et vengeance.
Soudain au-dessus du lac l’archange dresse sa puissante stature : de sa main droite et de sa main gauche, les flammes repoussées en arrière écartent leurs pointes aiguës, et, roulées en vagues, laissent au milieu une horrible vallée. Alors, ailes déployées, il dirige son vol en haut, pesant sur l’air sombre qui sent un poids inaccoutumé, jusqu’à ce qu’il s’abatte sur la terre aride, si terre était ce qui toujours brûle d’un feu solide, comme le lac brûle d’un liquide feu. Telles apparaissent dans leur couleur (lorsque la violence d’un tourbillon souterrain a transporté une colline arrachée du Pelore ou des flancs déchirés du tonnant Etna), telles apparaissent les entrailles combustibles et inflammables qui là concevant le feu, sont lancées au ciel par l’énergie minérale à l’aide des vents, et laissent un fond brûlé, tout enveloppé d’infection et de fumée : pareil fut le sol de repos que toucha Satan de la plante de ses pieds maudits. Béelzébuth, son compagnon le plus proche, le suit, tous deux se glorifiant d’être échappés aux eaux stygiennes, comme les dieux, par leurs propres forces recouvrées, non par la tolérance du suprême pouvoir.
« Est-ce ici la région, le sol, le climat, dit alors l’archange perdu ; est-ce ici le séjour que nous devons changer contre le ciel, cette morne obscurité contre cette lumière céleste ? Soit ! puisque celui qui maintenant est souverain peut disposer et décider de ce qui sera justice. Le plus loin de lui est le mieux, de lui qui, égalé en raison, s’est élevé au-dessus de ses égaux par la force. Adieu, champs fortunés où la joie habite pour toujours ! salut, horreurs ! salut, monde infernal ! Et toi, profond enfer, reçois ton nouveau possesseur. Il t’apporte un esprit que ne changeront ni le temps ni le lieu. L’esprit est à soi-même sa propre demeure, il peut faire en soi un ciel de l’enfer, un enfer du ciel. Qu’importe où je serai, si je suis toujours le même et ce que je dois être, tout, quoique moindre que celui que le tonnerre a fait plus grand ! Ici du moins nous serons libres. Le Tout-Puissant n’a pas bâti ce lieu pour nous l’envier ; il ne voudra pas nous en chasser. Ici nous pourrons régner en sûreté ; et, à mon avis, régner est digne d’ambition, même en enfer ; mieux vaut régner en enfer que servir dans le ciel.
« Mais laisserons-nous donc nos amis fidèles, les associés, les copartageants de notre ruine, étendus, étonnés sur le lac d’oubli ? Ne les appellerons-nous pas à prendre avec nous leur part de ce manoir malheureux, ou, avec nos armes ralliées, à tenter une fois de plus s’il est encore quelque chose à regagner au ciel ou à perdre dans l’enfer ? »
Ainsi parla Satan, et Béelzébuth lui répondit :
« Chef de ces brillantes armées, qui par nul autre que le Tout-Puissant n’auraient été vaincues, si une fois elles entendent cette voix, le gage le plus vif de leur espérance au milieu des craintes et des dangers ; cette voix si souvent retentissante dans les pires extrémités, au bord périlleux de la bataille quand elle rugissait ; cette voix, signal le plus rassurant dans tous les assauts, soudain elles vont reprendre un nouveau courage et revivre, quoiqu’elles languissent à présent, gémissantes et prosternées sur le lac de feu, comme nous tout à l’heure assourdis et stupéfaits : qui s’en étonnerait, tombées d’une si pernicieuse hauteur ! »
Béelzébuth avait à peine cessé de parler, et déjà le grand ennemi s’avançait vers le rivage : son pesant bouclier, de trempe éthérée, massif, large et rond, était rejeté derrière lui ; la large circonférence pendait à ses épaules, comme la lune, dont l’orbe, à travers un verre optique, est observé le soir par l’astronome toscan, du sommet de Fiesole ou dans le Valdarno, pour découvrir de nouvelles terres, des rivières et des montagnes sur son globe tacheté. La lance de Satan (près de laquelle le plus haut pin scié sur les collines de Norwége, pour être le mât de quelque grand vaisseau amiral, ne serait qu’un roseau) lui sert à soutenir ses pas mal assurés sur la marne brûlante ; bien différents de ses pas sur l’azur du ciel ! Le climat torride voûté de feu le frappe encore d’autres plaies : néanmoins il endure tout, jusqu’à ce qu’il arrive au bord de la mer enflammée. Là il s’arrête.
Il appelle ses légions, formes d’anges fanées qui gisent aussi épaisses que les feuilles d’automne jonchant les ruisseaux de Vallombreuse, où les ombrages étruriens décrivent l’arche élevée d’un berceau ; ainsi surnagent des varechs dispersés, quand Orion, armé des vents impétueux, a battu les côtes de la mer Rouge ; mer dont les vagues renversèrent Busiris et la cavalerie de Memphis tandis qu’ils poursuivaient d’une haine perfide les étrangers de Gessen, qui virent sur rivage les carcasses flottantes, les roues des chariots brisées : ainsi semées, abjectes, perdues, les légions gisaient, couvrant le lac, dans la stupéfaction de leur changement hideux.
Satan élève une si grande voix que tout le creux de l’enfer en retentit.
« Princes, potentats, guerriers, fleurs du ciel, jadis à vous, maintenant perdu ! une stupeur telle que celle-ci peut-elle saisir des esprits éternels, ou avez-vous choisi ce lieu après les fatigues de la bataille, pour reposer votre valeur lassée, pour la douceur que vous trouvez à dormir ici comme dans les vallées du ciel ? ou bien, dans cette abjecte posture, avez-vous juré d’adorer le vainqueur ? Il contemple à présent chérubins et séraphins roulant dans le gouffre armes et enseignes brisées, jusqu’à ce que bientôt ses rapides ministres découvrant des portes du ciel leurs avantages, et descendant, nous foulent aux pieds ainsi languissants, ou nous attachent à coups de foudre au fond de cet abîme. Éveillez-vous ! levez-vous ! ou soyez à jamais tombés ! »
Ils l’entendirent et furent honteux et se levèrent sur l’aile, comme quand des sentinelles accoutumées à veiller au devoir, surprises endormies par le commandant qu’elles craignent, se lèvent et se remettent elles-mêmes en faction avant d’être bien éveillées. Non que ces esprits ignorent le malheureux état où ils sont réduits, ou qu’ils ne sentent pas leurs affreuses tortures ; mais bientôt ils obéissent innombrables à la voix de leur général.
Comme quand la puissante verge du fils d’Amram, au jour mauvais de l’Égypte, passa ondoyante le long du rivage, et appela la noire nuée de sauterelles, touées par le vent d’orient, qui se suspendirent sur le royaume de l’impie Pharaon de même que la nuit, et enténébrèrent toute la terre du Nil : ainsi sans nombre furent aperçus ces mauvais anges, planant sous la coupole de l’enfer, entre les inférieures, les supérieures et les environnantes flammes, jusqu’à ce qu’un signal donné, la lance levée droite de leur grand sultan, ondoyant pour diriger leur course, ils s’abattent, d’un égal balancement, sur le soufre affermi, et remplissent la plaine. Ils formaient une multitude telle que le Nord populeux n’en versa jamais de ses flancs glacés pour franchir le Rhin ou le Danube, alors que ses fils barbares tombèrent comme un déluge sur le Midi, et s’étendirent, au-dessous de Gibraltar, jusqu’aux sables de la Libye.
Incontinent de chaque escadron et de chaque bande, les chefs et les conducteurs se hâtèrent là où leur grand général s’était arrêté. Semblables à des dieux par la taille et par la forme, surpassant la nature humaine, royales dignités, puissances, qui siégeaient autrefois dans le ciel, sur les trônes : quoique dans les archives célestes on ne garde point maintenant la mémoire de leurs noms, effacés et rayés par leur rébellion, du Livre de vie. Ils n’avaient pas encore acquis leurs noms nouveaux parmi les fils d’Ève ; mais lorsque, errant sur la terre, avec la haute permission de Dieu, pour l’épreuve de l’homme, ils eurent, à force d’impostures et de mensonges, corrompu la plus grande partie du genre humain, ils persuadèrent aux créatures d’abandonner Dieu leur créateur, de transporter souvent la gloire invisible de celui qui les avait faits, dans l’image d’une brute ornée de gaies religions pleines de pompes et d’or, et d’adorer les démons pour divinités : alors ils furent connus aux hommes sous différents noms et par diverses idoles, dans le monde païen.
Muse, redis-moi ces noms alors connus : qui le premier, qui le dernier se réveilla du sommeil sur ce lit de feu, à l’appel de leur grand empereur ; quels chefs, les plus près de lui en mérites, vinrent un à un où il se tenait sur le rivage chauve, tandis que la foule pêle-mêle se tenait encore au loin.
Ces chefs furent ceux qui, sortis du puits de l’enfer, rôdant pour saisir leur proie sur la terre, eurent l’audace, longtemps après, de fixer leurs sièges auprès de celui de Dieu, leurs autels contre son autel, dieux adorés parmi les nations d’alentour ; et ils osèrent habiter près de Jéhovah, tonnant hors de Sion, ayant son trône au milieu des chérubins : souvent même ils placèrent leurs châsses jusque dans son sanctuaire, abominations et avec des choses maudites, ils profanèrent ses rites sacrés, ses fêtes solennelles, et leurs ténèbres osèrent affronter sa lumière.
D’abord s’avance Moloch, horrible roi, aspergé du sang des sacrifices humains, et des larmes des pères et des mères, bien qu’à cause du bruit des tambours et des timbales retentissantes, le cri de leurs enfants ne fût pas entendu, lorsque, à travers le feu, ils passaient à l’idole grimée. Les Ammonites l’adorèrent dans Rabba et sa plaine humide, dans Argob et dans Basan, jusqu’au courant de l’Arnon le plus reculé : non content d’un si audacieux voisinage, il amena, par fraude, le très-sage cœur de Salomon à lui bâtir un temple droit en face du temple de Dieu, sur cette montagne d’opprobre ; et il fit son bois sacré de la riante vallée d’Hinnon, de là nommée Tophet et la noire Géhenne, type de l’enfer.
Après Moloch vint Chamos, l’obscène terreur des fils de Moab, depuis Aroer à Nébo et au désert du plus méridional Abarim ; dans Hesébon et Héronaïm, royaume de Séon, au-delà de la retraite fleurie de Sibma, tapissée de vignes, et dans Eléadé, jusqu’au lac Asphaltite. Chamos s’appelait aussi Péor, lorsqu’à Sittim il incita les Israélites dans leur marche du Nil, à lui faire de lubriques oblations qui leur coûtèrent tant de maux. De là il étendit ses lascives orgies jusqu’à la colline du Scandale, près du bois de l’homicide Moloch, l’impudicité tout près de la haine ; le pieux Josias les chassa dans l’enfer.
Avec ces divinités vinrent celles qui du bord des flots de l’antique Euphrate jusqu’au torrent qui sépare l’Égypte de la terre de Syrie, portent les noms généraux de Baal et d’Astaroth ; ceux-là mâles, celles-ci femelles ; car les esprits prennent à leur gré l’un ou l’autre sexe, ou tous les deux à la fois ; si ténue et si simple est leur essence pure : elle est ni liée ni cadenassée par des jointures et des membres, ni fondée sur la fragile force des os, comme la lourde chair ; mais dans telle forme qu’ils choisissent, dilatée ou condensée, brillante ou obscure, ils peuvent exécuter leurs résolutions aériennes, et accomplir les œuvres de l’amour ou de la haine. Pour ces divinités, les enfants d’Israël abandonnèrent souvent leur force vivante, et laissèrent infréquenté son autel légitime, se prosternant bassement devant des dieux animaux. Ce fut pour cela que leurs têtes inclinées aussi bas dans les batailles, se courbèrent devant la lance du plus méprisable ennemi.
Après ces divinités en troupe parut Astoreth, que les Phéniciens nomment Astarté, reine du ciel, ornée d’un croissant ; à sa brillante image nuitamment en présence de la lune, les vierges de Sidon payent le tribut de leurs vœux et de leurs chants. Elle ne fut pas aussi non chantée dans Sion, où son temple s’élevait sur le mont d’Iniquité : temple que bâtit ce roi, ami des épouses, dont le cœur, quoique grand, séduit par de belles idolâtres, tomba devant d’infâmes idoles.
À la suite d’Astarté vient Thammuz, dont l’annuelle blessure dans le Liban attire les jeunes Syriennes, pour gémir sur sa destinée dans de tendres complaintes, pendant tout un jour d’été ; tandis que le tranquille Adonis, échappant de sa roche native, roule à la mer son onde supposée rougie du sang de Thammuz, blessé tous les ans. Cette amoureuse histoire infecta de la même ardeur les filles de Jérusalem, dont les molles voluptés sous le sacré portique furent vues d’Ézéchiel, lorsque, conduit par la vision, ses yeux découvrirent les noires idolâtries de l’infidèle Juda.
Après Thammuz, il en vint un qui pleura amèrement, quand l’Arche captive mutila sa stupide idole, têtes et mains émondées, dans son propre sanctuaire, sur le seuil de la porte où elle tomba à plat, et fit honte à ses adorateurs : Dagon est son nom ; monstre marin, homme par le haut, poisson par le bas. Et cependant son temple, élevé haut dans Azot, fut redouté le long des côtes de la Palestine, dans Gath et Ascalon, et Accaron, et jusqu’aux bornes de la frontière de Gaza.
Suivait Rimmon, dont la délicieuse demeure était la charmante Damas sur les bords fertiles d’Abana et de Pharphar, courants limpides. Lui aussi fut hardi contre la maison de Dieu : une fois il perdit un lépreux et gagna un roi, Achaz son imbécile conquérant, qu’il engagea à mépriser l’autel du Seigneur et à le déplacer pour un autel à la syrienne, sur lequel Achaz brûla ses odieuses offrandes, et adora les dieux qu’il avait vaincus.
Après ces Démons parut la bande de ceux qui, sous des noms d’antique renommée, Osiris, Isis, Orus et leur train, monstrueux en figures et en sorcelleries, abusèrent la fanatique Égypte et ses prêtres qui cherchèrent leurs divinités errantes, cachées sous des formes de bêtes plutôt que sous des formes humaines.
Point n’échappa Israël à la contagion, quand d’un or emprunté il forma le veau d’Oreb. Le roi rebelle doubla ce péché à Béthel et à Dan, assimilant son Créateur au bœuf paissant ; ce Jéhovah qui, dans une nuit, lorsqu’il passa dans sa marche à travers l’Égypte, rendit égaux d’un seul coup ses premiers-nés et ses dieux bêlants.