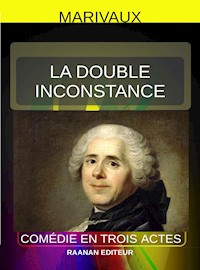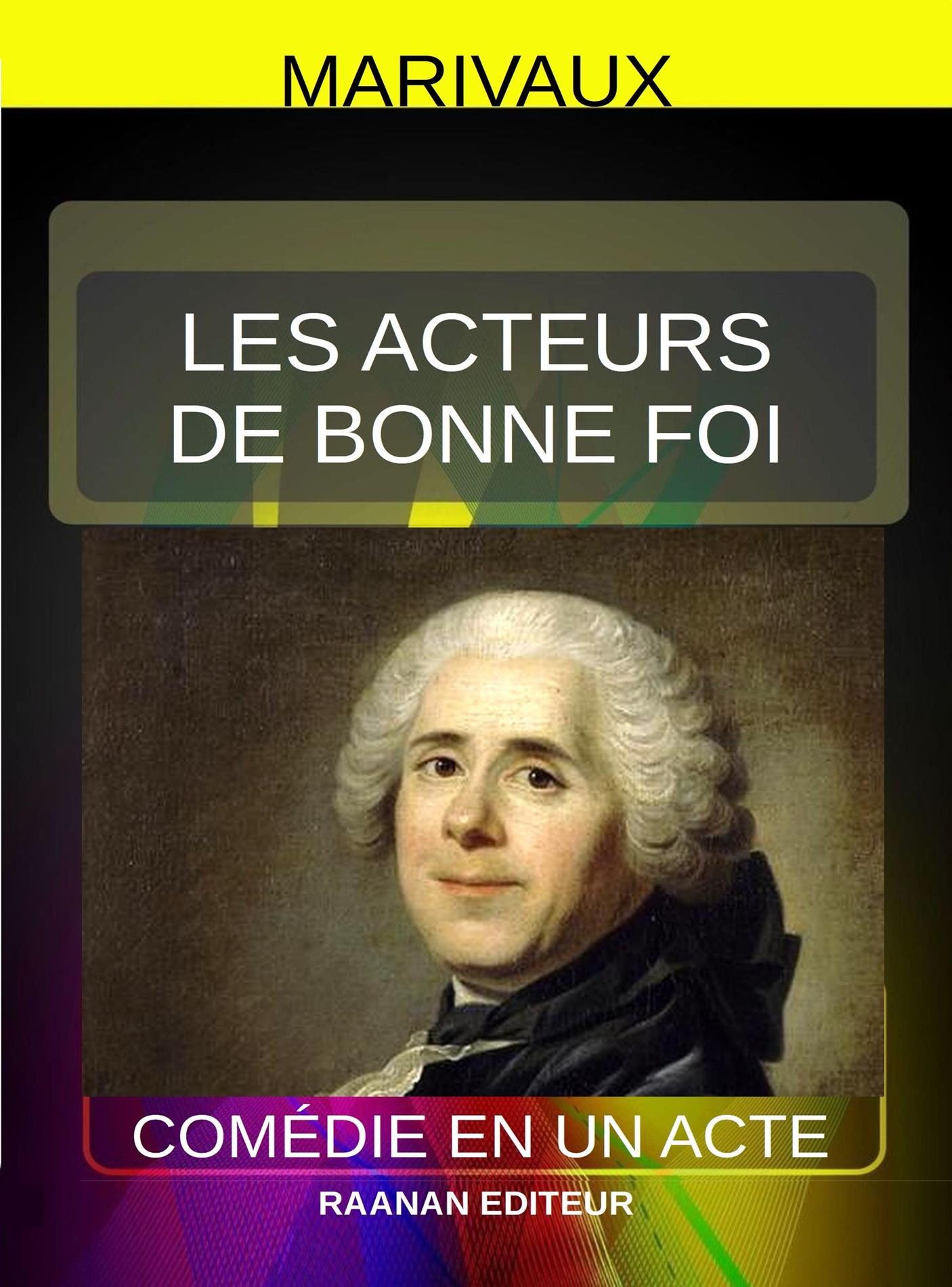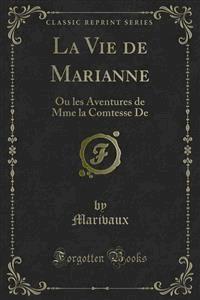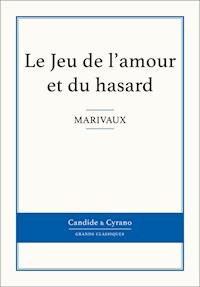1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Le Paysan parvenu est un roman-mémoires français en cinq parties de Marivaux, paru chez Pierre Prault de 1734 au début de 1735.
Psésentation
| À l’âge de dix-huit ans, Jacob est envoyé par son père pour conduire à Paris aux seigneurs du village le vin récolté sur leurs terres de Champagne. Ces seigneurs n’appartiennent pas à la noblesse. Ce sont des financiers enrichis, qui ont acquis récemment une terre nobiliaire. La dame veut voir Jacob et le reçoit à sa toilette. Il lui laisse comprendre qu’il la trouve jolie ; elle ne s’en offense pas, et le retient à son service. Une de ses femmes de chambre, une brune du nom de Geneviève, ne serait pas fâchée non plus de le prendre au sien. Geneviève raconte à Jacob que Monsieur lui a fait une cour acharnée avec accompagnement de présents, de bijoux et d’argent, mais non ce qui s’est ensuivi. Un beau matin, le financier fait venir Jacob. Il lui dit qu’il est un bon domestique, intelligent, spirituel et qu’il veut le récompenser en conséquence. Pour cela, il a résolu de le marier à Geneviève, à laquelle il donnera une dot convenable. Jacob refuse, le financier se fâche, Geneviève pleure. Pendant qu’on se querelle, on apprend que le financier est mort d’apoplexie et qu’il est ruiné...|
|Source Wikipédia|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
SOMMMAIRE
MARIVAUX
LE PAYSAN PARVENU
ROMAN-MÉMOIRES
Pierre Prault
Paris, 1735
Raanan Éditeur
Livre numérique 779 | édition 1
Le titre que je donne à mes Mémoires annonce ma naissance ; je ne l’ai jamais dissimulée à qui me l’a demandée, et il semble qu’en tout temps Dieu ait récompensé ma franchise là-dessus ; car je n’ai pas remarqué qu’en aucune occasion on en ait eu moins d’égard et moins d’estime pour moi.
J’ai pourtant vu nombre de sots qui n’avaient et ne connaissaient point d’autre mérite dans le monde, que celui d’être né noble, ou dans un rang distingué. Je les entendais mépriser beaucoup de gens qui valaient mieux qu’eux, et cela seulement parce qu’ils n’étaient pas gentilshommes ; mais c’est que ces gens qu’ils méprisaient, respectables d’ailleurs par mille bonnes qualités, avaient la faiblesse de rougir eux-mêmes de leur naissance, de la cacher, et de tâcher de s’en donner une qui embrouillât la véritable, et qui les mît à couvert du dédain du monde.
Or, cet artifice-là ne réussit presque jamais ; on a beau déguiser la vérité là-dessus, elle se venge tôt ou tard des mensonges dont on a voulu la couvrir ; et l’on est toujours trahi par une infinité d’événements qu’on ne saurait ni parer, ni prévoir ; jamais je ne vis, en pareille matière, de vanité qui fît une bonne fin.
C’est une erreur, au reste, que de penser qu’une obscure naissance vous avilisse, quand c’est vous-même qui l’avouez, et que c’est de vous qu’on la sait. La malignité des hommes vous laisse là ; vous la frustrez de ses droits ; elle ne voudrait que vous humilier, et vous faites sa charge, vous vous humiliez vous-même, elle ne sait plus que dire.
Les hommes ont des mœurs, malgré qu’ils en aient ; ils trouvent qu’il est beau d’affronter leurs mépris injustes ; cela les rend à la raison. Ils sentent dans ce courage-là une noblesse qui les fait taire ; c’est une fierté sensée qui confond un orgueil impertinent.
Mais c’est assez parler là-dessus. Ceux que ma réflexion regarde se trouveront bien de m’en croire.
La coutume, en faisant un livre, c’est de commencer par un petit préambule, et en voilà un. Revenons à moi.
Le récit de mes aventures ne sera pas inutile à ceux qui aiment à s’instruire. Voilà en partie ce qui fait que je les donne ; je cherche aussi à m’amuser moi-même.
Je vis dans une campagne où je me suis retiré, et où mon loisir m’inspire un esprit de réflexion que je vais exercer sur les événements de ma vie. Je les écrirai du mieux que je pourrai ; chacun a sa façon de s’exprimer, qui vient de sa façon de sentir.
Parmi les faits que j’ai à raconter, je crois qu’il y en aura de curieux : qu’on me passe mon style en leur faveur ; j’ose assurer qu’ils sont vrais. Ce n’est point ici une histoire forgée à plaisir, et je crois qu’on le verra bien.
Pour mon nom, je ne le dis point : on peut s’en passer ; si je le disais, cela me gênerait dans mes récits.
Quelques personnes pourront me reconnaître, mais je les sais discrètes, elles n’en abuseront point. Commençons.
Je suis né dans un village de la Champagne, et soit dit en passant, c’est au vin de mon pays que je dois le commencement de ma fortune.
Mon père était le fermier de son seigneur, homme extrêmement riche (je parle de ce seigneur), et à qui il ne manquait que d’être noble pour être gentilhomme.
Il avait gagné son bien dans les affaires ; s’était allié à d’illustres maisons par le mariage de deux de ses fils, dont l’un avait pris le parti de la robe, et l’autre de l’épée.
Le père et les fils vivaient magnifiquement ; ils avaient pris des noms de terres ; et du véritable, je crois qu’ils ne s’en souvenaient plus eux-mêmes.
Leur origine était comme ensevelie sous d’immenses richesses. On la connaissait bien, mais on n’en parlait plus. La noblesse de leurs alliances avait achevé d’étourdir l’imagination des autres sur leur compte ; de sorte qu’ils étaient confondus avec tout ce qu’il y avait de meilleur à la cour et à la ville. L’orgueil des hommes, dans le fond, est d’assez bonne composition sur certains préjugés ; il semble que lui-même il en sente le frivole.
C’était là leur situation, quand je vins au monde. La terre seigneuriale, dont mon père était le fermier, et qu’ils avaient acquise, n’était considérable que par le vin qu’elle produisait en assez grande quantité.
Ce vin était le plus exquis du pays, et c’était mon frère aîné qui le conduisait à Paris, chez notre maître, car nous étions trois enfants, deux garçons et une fille, et j’étais le cadet de tous.
Mon aîné, dans un de ces voyages à Paris, s’amouracha de la veuve d’un aubergiste, qui était à son aise, dont le cœur ne lui fut pas cruel, et qui l’épousa avec ses droits, c’est-à-dire avec rien.
Dans la suite, les enfants de ce frère ont eu grand besoin que je les reconnusse pour mes neveux ; car leur père qui vit encore, qui est actuellement avec moi, et qui avait continué le métier d’aubergiste, vit, en dix ans, ruiner sa maison par les dissipations de sa femme.
À l’égard de ses fils, mes secours les ont mis aujourd’hui en posture d’honnêtes gens ; ils sont bien établis, et malgré cela, je n’en ai fait que des ingrats, parce que je leur ai reproché qu’ils étaient trop glorieux.
En effet, ils ont quitté leur nom, et n’ont plus de commerce avec leur père, qu’ils venaient autrefois voir de temps en temps.
Qu’on me permette de dire sur eux encore un mot ou deux.
Je remarquai leur fatuité à la dernière visite qu’ils lui rendirent. Ils l’appelèrent monsieur dans la conversation. Le bonhomme à ce terme se retourna, s’imaginant qu’ils parlaient à quelqu’un qui venait et qu’il ne voyait pas.
Non, non, lui dis-je alors, il ne vient personne, mon frère, et c’est à vous à qui l’on parle. À moi ! reprit-il. Eh ! pourquoi cela ? Est-ce que vous ne me connaissez plus, mes enfants ? Ne suis-je pas votre père ? Oh ! leur père, tant qu’il vous plaira, lui dis-je, mais il n’est pas décent qu’ils vous appellent de ce nom-là. Est-ce donc qu’il est malhonnête d’être le père de ses enfants ? reprit-il ; qu’est-ce que c’est que cette mode-là ?
C’est, lui dis-je, que le terme de mon père est trop ignoble, trop grossier ; il n’y a que les petites gens qui s’en servent, mais chez les personnes aussi distinguées que messieurs vos fils, on supprime dans le discours toutes ces qualités triviales que donne la nature ; et au lieu de dire rustiquement mon père, comme le menu peuple, on dit monsieur, cela a plus de dignité.
Mes neveux rougirent beaucoup de la critique que je fis de leur impertinence ; leur père se fâcha, et ne se fâcha pas en monsieur, mais en vrai père et en père aubergiste.
Laissons là mes neveux, qui m’ont un peu détourné de mon histoire, et tant mieux, car il faut qu’on s’accoutume de bonne heure à mes digressions ; je ne sais pas pourtant si j’en ferai de fréquentes, peut-être que oui, peut-être que non ; je ne réponds de rien ; je ne me gênerai point ; je conterai toute ma vie, et si j’y mêle autre chose, c’est que cela se présentera sans que je le cherche.
J’ai dit que c’était mon frère aîné qui conduisait chez nos maîtres le vin de la terre dont mon père avait soin.
Or, son mariage le fixant à Paris, je lui succédai dans son emploi de conducteur de vin.
J’avais alors dix-huit à dix-neuf ans ; on disait que j’étais beau garçon, beau comme peut l’être un paysan dont le visage est à la merci du hâle de l’air et du travail des champs. Mais à cela près j’avais effectivement assez bonne mine ; ajoutez-y je ne sais quoi de franc dans ma physionomie ; l’œil vif, qui annonçait un peu d’esprit, et qui ne mentait pas totalement.
L’année d’après le mariage de mon frère, j’arrivai donc à Paris avec ma voiture et ma bonne façon rustique.
Je fus ravi de me trouver dans cette grande ville ; tout ce que j’y voyais m’étonnait moins qu’il ne me divertissait ; ce qu’on appelle le grand monde me paraissait plaisant.
Je fus fort bien venu dans la maison de notre seigneur. Les domestiques m’affectionnèrent tout d’un coup ; je disais hardiment mon sentiment sur tout ce qui s’offrait à mes yeux ; et ce sentiment avait assez souvent un bon sens villageois qui faisait qu’on aimait à m’interroger.
Il n’était question que de Jacob pendant les cinq ou six premiers jours que je fus dans la maison. Ma maîtresse même voulut me voir, sur le récit que ses femmes lui firent de moi.
C’était une femme qui passait sa vie dans toutes les dissipations du grand monde, qui allait aux spectacles, soupait en ville, se couchait à quatre heures du matin, se levait à une heure après-midi ; qui avait des amants, qui les recevait à sa toilette, qui y lisait les billets doux qu’on lui envoyait, et puis les laissait traîner partout ; les lisait qui voulait, mais on n’en était point curieux ; ses femmes ne trouvaient rien d’étrange à tout cela ; le mari ne s’en scandalisait point. On eût dit que c’était là pour une femme des dépendances naturelles du mariage. Madame, chez elle, ne passait point pour coquette ; elle ne l’était point non plus, car elle l’était sans réflexion, sans le savoir ; et une femme ne se dit point qu’elle est coquette quand elle ne sait point qu’elle l’est, et qu’elle vit dans sa coquetterie comme on vivrait dans l’état le plus décent et le plus ordinaire.
Telle était notre maîtresse, qui menait ce train de vie tout aussi franchement qu’on boit et qu’on mange ; c’était en un mot un petit libertinage de la meilleure foi du monde.
Je dis petit libertinage, et c’est dire ce qu’il faut ; car, quoiqu’il fût fort franc de sa part et qu’elle n’y réfléchît point, il n’en était pas moins ce que je dis là.
Du reste, je n’ai jamais vu une meilleure femme ; ses manières ressemblaient à sa physionomie qui était toute ronde.
Elle était bonne, généreuse, ne se formalisait de rien, familière avec ses domestiques, abrégeant les respects des uns, les révérences des autres ; la franchise avec elle tenait lieu de politesse. Enfin c’était un caractère sans façon. Avec elle, on ne faisait point de fautes capitales, il n’y avait point de réprimandes à essuyer, elle aimait mieux qu’une chose allât mal que de se donner la peine de dire qu’on la fît bien. Aimant de tout son cœur la vertu, sans inimitié pour le vice ; elle ne blâmait rien, pas même la malice de ceux qu’elle entendait blâmer les autres. Vous ne pouviez manquer de trouver éloge ou grâce auprès d’elle ; je ne lui ai jamais vu haïr que le crime, qu’elle haïssait peut-être plus fortement que personne. Au demeurant, amie de tout le monde, et surtout de toutes les faiblesses qu’elle pouvait vous connaître.
Bonjour, mon garçon, me dit-elle quand je l’abordai. Eh bien ! comment te trouves-tu à Paris ? Et puis se tournant du côté de ses femmes : Vraiment, ajouta-t-elle, voilà un paysan de bonne mine.
Bon ! madame, lui répondis-je, je suis le plus mal fait de notre village. Va, va, me dit-elle, tu ne me parais ni sot ni mal bâti, et je te conseille de rester à Paris, tu y deviendras quelque chose.
Dieu le veuille, madame, lui repartis-je ; mais j’ai du mérite et point d’argent, cela ne joue pas ensemble.
Tu as raison, me dit-elle en riant, mais le temps remédiera à cet inconvénient-là ; demeure ici, je te mettrai auprès de mon neveu qui arrive de province, et qu’on va envoyer au collège, tu le serviras.
Que le ciel vous le rende, madame, lui répondis-je ; dites-moi seulement si cela vaut fait, afin que je l’écrive à notre père ; je me rendrai si savant en le voyant étudier, que je vous promets de savoir quelque jour vous dire la sainte Messe. Hé ! que sait-on ? Comme il n’y a que chance dans ce monde, souvent on se trouve évêque ou vicaire sans savoir comment cela s’est fait.
Ce discours la divertit beaucoup, sa gaieté ne fit que m’animer ; je n’étais pas honteux des bêtises que je disais, pourvu qu’elles fussent plaisantes ; car à travers l’épaisseur de mon ignorance, je voyais qu’elles ne nuisaient jamais à un homme qui n’était pas obligé d’en savoir davantage, et même qu’on lui tenait compte d’avoir le courage de répliquer à quelque prix que ce fût.
Ce garçon-là est plaisant, dit-elle, je veux en avoir soin ; prenez garde à vous, vous autres (et c’était à ses femmes à qui elle parlait), sa naïveté vous réjouit aujourd’ hui, vous vous en amusez comme d’un paysan ; mais ce paysan deviendra dangereux, je vous en avertis.
Oh ! répliquai-je, madame, il n’y a que faire d’attendre après cela ; je ne deviendrai point, je suis tout devenu ; ces demoiselles sont bien jolies, et cela forme bien un homme ; il n’y a point de village qui tienne ; on est tout d’un coup né natif de Paris, quand on les voit.
Comment ! dit-elle, te voilà déjà galant ; et pour laquelle te déclarerais-tu ? (elles étaient trois). Javotte est une jolie blonde, ajouta-t-elle. Et Mlle Geneviève une jolie brune, m’écriai-je tout de suite.
Geneviève, à ce discours, rougit un peu, mais d’une rougeur qui venait d’une vanité contente, et elle déguisa la petite satisfaction que lui donnait ma préférence d’un souris qui signifiait pourtant : Je te remercie ; mais qui signifiait aussi : Ce n’est que sa naïveté bouffonne qui me fait rire.
Ce qui est de sûr, c’est que le trait porta ; et comme on le verra dans la suite, ma saillie lui fit dans le cœur une blessure sourde dont je ne négligeai pas de m’assurer ; car je me doutai que mon discours n’avait pas dû lui déplaire, et dès ce moment-là, je l’épiai pour voir si je pensais juste.
Nous allions continuer la conversation, qui commençait à tomber sur la troisième femme de chambre de madame, qui n’était ni brune ni blonde, qui n’était d’aucune couleur, et qui portait un de ces visages indifférents qu’on voit à tout le monde, et qu’on ne remarque à personne.
Déjà je tâchais d’éviter de dire mon sentiment sur son chapitre, avec un embarras maladroit et ingénu qui ne faisait pas l’éloge de ladite personne, quand un des adorateurs de madame entra, et nous obligea de nous retirer.
J’étais fort content du marché que j’avais fait de rester à Paris. Le peu de jours que j’y avais passé m’avait éveillé le cœur, et je me sentis tout d’un coup en appétit de fortune.
Il s’agissait de mander l’état des choses à mon père, et je ne savais pas écrire, mais je songeai à Mlle Geneviève ; et sans plus délibérer, j’allai la prier d’écrire ma lettre.
Elle était seule quand je lui parlai ; et non seulement elle l’écrivit, mais ce fut de la meilleure grâce du monde.
Ce que je lui dictais, elle le trouvait spirituel et de bon sens, et ne fit que rectifier mes expressions.
Profite de la bonne volonté de madame, me dit-elle ensuite ; j’augure bien de ton aventure. Eh bien ! mademoiselle, lui répondis-je, si vous mettez encore votre amitié par-dessus, je ne me changerai pas contre un autre ; car déjà je suis heureux, il n’y a point de doute à cela, puisque je vous aime.
Comment ! me dit-elle, tu m’aimes ! Et qu’entends-tu par là, Jacob ?
Ce que j’entends ? lui dis-je, de la belle et bonne affection, comme un garçon, sauf votre respect, peut l’avoir pour une fille aussi charmante que vous ; j’entends que c’est bien dommage que je ne sois qu’un chétif homme ; car, mardi, si j’étais roi, par exemple, nous verrions un peu qui de nous deux serait reine, et comme ce ne serait pas moi, il faudrait bien que ce fût vous : Il n’y a rien à refaire à mon dire.
Je te suis bien obligée de pareils sentiments, me dit-elle d’un ton badin, et si tu étais roi, cela mériterait réflexion. Pardi ! lui dis-je, mademoiselle, il y a tant de gens par le monde que les filles aiment, et qui ne sont pas rois ; n’y aura-t-il pas moyen quelque jour d’être comme eux ?
Mais vraiment, me dit-elle, tu es pressant ! où as-tu appris à faire l’amour ? Ma foi ! lui dis-je, demandez-le à votre mérite ; je n’ai point eu d’autre maître d’école, et comme il me l’a appris, je le rends.
Madame, là-dessus, appela Geneviève, qui me quitta très contente de moi, à vue de pays, et me dit en s’en allant : Va, Jacob, tu feras fortune, et je le souhaite de tout mon cœur.
Grand merci, lui dis-je, en la saluant d’un coup de chapeau qui avait plus de zèle que de bonne grâce ; mais je me recommande à vous, mademoiselle, ne m’oubliez pas, afin de commencer toujours ma fortune, vous la finirez quand vous pourrez. Cela dit, je pris la lettre, et la portai à la poste.
Cet entretien que je venais d’avoir avec Geneviève me mit dans une situation si gaillarde, que j’en devins encore plus divertissant que je ne l’avais été jusque-là.
Pour surcroît de bonne humeur, le soir du même jour on m’appela pour faire prendre ma mesure par le tailleur de la maison, et je ne saurais dire combien ce petit événement enhardit mon imagination, et la rendit sémillante.
C’était madame qui avait eu cette attention pour moi.
Deux jours après on m’apporta mon habit avec du linge et un chapeau, et tout le reste de mon équipage. Un laquais de la maison, qui avait pris de l’amitié pour moi, me frisa ; j’avais d’assez beaux cheveux. Mon séjour à Paris m’avait un peu éclairci le teint ; et, ma foi ! quand je fus équipé, Jacob avait fort bonne façon.
La joie de me voir en si bonne posture me rendit la physionomie plus vive et y jeta comme un rayon de bonheur à venir. Du moins tout le monde m’en prédisait, et je ne doutais point du succès de la prédiction.
On me complimenta fort sur mon bon air ; et, en attendant que madame fût visible, j’allai faire essai de mes nouvelles grâces sur le cœur de Geneviève qui, effectivement, me plaisait beaucoup.
Il me parut qu’elle fut surprise de la mine que j’avais sous mon attirail tout neuf ; je sentis moi-même que j’avais plus d’esprit qu’à l’ordinaire, mais à peine causions-nous ensemble, qu’on vint m’avertir, de la part de madame, de l’aller trouver.
Cet ordre redoubla encore ma reconnaissance pour elle ; je n’allai pas, je volai.
Me voilà, madame, lui dis-je en entrant ; je souhaiterais bien avoir assez d’esprit pour vous remercier à ma fantaisie ; mais je mourrai à votre service, si vous me le permettez. C’est une affaire finie ; je vous appartiens pour le reste de mes jours.
Voilà qui est bien, me dit-elle alors ; tu es sensible et reconnaissant, cela me fait plaisir. Ton habit te sied bien ; tu n’as plus l’air villageois. Madame, m’écriai-je, j’ai l’air de votre serviteur éternel, il n’y a que cela que j’estime.
Cette dame alors me fit approcher, examina ma parure ; j’avais un habit uni et sans livrée. Elle me demanda qui m’avait frisé, et me dit d’avoir toujours soin de mes cheveux, que je les avais beaux, et qu’elle voulait que je lui fisse honneur. Tant que vous voudrez, quoique vous en ayez de tout fait, lui dis-je ; mais n’importe, abondance ne nuit point. Notez que madame venait de se mettre à sa toilette, et que sa figure était dans un certain désordre assez piquant pour ma curiosité.
Je n’étais pas né indifférent, il s’en fallait beaucoup ; cette dame avait de la fraîcheur et de l’embonpoint, et mes yeux lorgnaient volontiers.
Elle s’en aperçut, et sourit de la distraction qu’elle me donnait ; moi, je vis qu’elle s’en apercevait, et je me mis à rire aussi d’un air que la honte d’être pris sur le fait et le plaisir de voir rendaient moitié niais et moitié tendre ; et la regardant avec des yeux mêlés de tout ce que je dis là, je ne lui disais rien.
De sorte qu’il se passa alors entre nous deux une petite scène muette qui fut la plus plaisante chose du monde ; et puis, se raccommodant ensuite assez négligemment : À quoi penses-tu, Jacob ? me dit-elle. Hé ! madame, repris-je, je pense qu’il fait bon vous voir, et que monsieur a une belle femme.
Je ne saurais dire dans quelle disposition d’esprit cela la mit, mais il me parut que la naïveté de mes façons ne lui déplaisait pas.
Les regards amoureux d’un homme du monde n’ont rien de nouveau pour une jolie femme ; elle est accoutumée à leurs expressions, et ils sont dans un goût de galanterie qui lui est familier, de sorte que son amour-propre s’y amuse comme à une chose qui lui est ordinaire, et qui va quelquefois au-delà de la vérité.
Ici ce n’était pas de même ; mes regards n’avaient rien de galant, ils ne savaient être que vrais. J’étais un paysan, j’étais jeune, assez beau garçon ; et l’hommage que je rendais à ses appas venait du pur plaisir qu’ils me faisaient. Il était assaisonné d’une ingénuité rustique, plus curieuse à voir, et d’autant plus flatteuse qu’elle ne voulait point flatter.
C’était d’autres yeux, une autre manière de considérer, une autre tournure de mine ; et tout cela ensemble me donnait apparemment des agréments singuliers dont je vis que madame était un peu touchée.
Tu es bien hardi de me regarder tant ! me dit-elle alors, toujours en souriant. Pardi, lui dis-je, est-ce ma faute, madame ? Pourquoi êtes-vous belle ? Va-t’en, me dit-elle alors, d’un ton brusque, mais amical, je crois que tu m’en conterais, si tu l’osais ; et cela dit, elle se remit à sa toilette, et moi, je m’en allai, en me retournant toujours pour la voir. Mais elle ne perdit rien de vue de ce que je fis, et me conduisit des yeux jusqu’à la porte.
Le soir même, elle me présenta à son neveu, et m’installa au rang de son domestique. Je continuai de cajoler Geneviève. Mais, depuis l’instant où je m’étais aperçu que je n’avais pas déplu à madame même, mon inclination pour cette fille baissa de vivacité, son cœur ne me parut plus une conquête si importante, et je n’estimai plus tant l’honneur d’être souffert d’elle.
Geneviève ne se comporta pas de même, elle prit tout de bon du goût pour moi, tant par l’opinion qu’elle avait de ce que je pourrais devenir, que par le penchant naturel qu’elle se sentit pour moi, et comme je la cherchais un peu moins, elle me chercha davantage. Il n’y avait pas longtemps qu’elle était dans la maison, et le mari de madame ne l’avait pas encore remarquée.
Comme le maître et la maîtresse avaient chacun leur appartement, d’où le matin ils envoyaient savoir comment ils se portaient (et c’était là presque tout le commerce qu’ils avaient ensemble), madame, un matin, sur quelque légère indisposition de son mari, envoya Geneviève pour savoir de ses nouvelles.
Elle me rencontra sur l’escalier en y allant, et me dit de l’attendre. Elle fut très longtemps à revenir, et revint les yeux pleins de coquetterie.
Vous voilà bien émerillonnée, mademoiselle Geneviève, lui dis-je en la voyant. Oh ! tu ne sais pas, me dit-elle d’un air gai, mais goguenard, si je veux, ma fortune est faite.
Vous êtes bien difficile de ne pas vouloir, lui dis-je. Oui, dit-elle, mais il y a un petit article qui m’en empêche, c’est que c’est à condition que je me laisserai aimer de monsieur, qui vient de me faire une déclaration d’amour.
Cela ne vaut rien, lui dis-je, c’est de la fausse monnaie que cette fortune-là, ne vous chargez point de pareille marchandise, et gardez la vôtre : Tenez, quand une fille s’est vendue, je ne voudrais pas la reprendre du marchand pour un liard.
Je lui tins ce discours parce que, dans le fond, je l’aimais toujours un peu, et que j’avais naturellement de l’honneur.
Tu as raison, me dit-elle, un peu déconcertée des sentiments que je lui montrais ; aussi ai-je tourné le tout en pure plaisanterie, et je ne voudrais pas de lui quand il me donnerait tout son bien.
Vous êtes-vous bien défendue, au moins, lui dis-je, car vous n’étiez pas fort courroucée quand vous êtes revenue. C’est, reprit-elle, que je me suis divertie de tout ce qu’il m’a dit. Il n’y aura pas de mal une autre fois de vous en mettre un peu en colère, répondis-je, cela sera plus sûr que de se divertir de lui ; car à la fin il pourrait bien se divertir de vous : En jouant, on ne gagne pas toujours, on perd quelquefois, et quand on est une fois en perte, tout y va.
Comme nous étions sur l’escalier, nous ne nous en dîmes pas davantage : elle rejoignit sa maîtresse, et moi mon petit maître qui faisait un thème, ou plutôt à qui son précepteur le faisait, afin que la science de son écolier lui fît honneur, et que cet honneur lui conservât son poste de précepteur, qui était fort lucratif.
Geneviève avait fait à l’amour de son maître plus d’attention qu’elle ne me l’avait dit.
Ce maître n’était pas un homme généreux, mais ses richesses, pour lesquelles il n’était pas né, l’avaient rendu glorieux, et sa gloire le rendait magnifique. De sorte qu’il était extrêmement dépensier, surtout quand il s’agissait de ses plaisirs.
Il avait proposé un bon parti à Geneviève, si elle voulait consentir à le traiter en homme qu’on aime : elle me dit même, deux jours après, qu’il avait débuté par lui offrir une bourse pleine d’or, et c’est la forme la plus dangereuse que puisse prendre le diable pour tenter une jeune fille un peu coquette, et, par-dessus le marché, intéressée.
Or, Geneviève était encline à ces deux petits vices-là : ainsi, il aurait été difficile qu’elle eût plaisanté de bonne foi de l’amour en question ; aussi ne la voyais-je plus que rêveuse, tant la vue de cet or, et la facilité de l’avoir la tentaient, et sa sagesse ne disputait plus le terrain qu’en reculant lâchement.
Monsieur (c’est le maître de la maison dont je parle) ne se rebuta point du premier refus qu’elle avait fait de ses offres ; il avait pénétré combien sa vertu en avait été affaiblie ; de sorte qu’il revint à la charge encore mieux armé que la première fois, et prit contre elle un renfort de mille petits ajustements, qu’il la força d’accepter sans conséquence ; et des ajustements tout achetés, tout prêts à être mis, sont bien aussi séduisants que l’argent même avec lequel on les achète.
De dons en dons toujours reçus, et donnés sans conséquence, tant fut procédé, qu’il devait enfin lui fonder une pension viagère, à laquelle serait ajouté un petit ménage clandestin qu’il promettait de lui faire, si elle voulait sortir d’auprès de sa maîtresse.
J’ai su tout le détail de ce traité impur dans une lettre que Geneviève perdit, et qu’elle écrivait à une de ses cousines, qui ne subsistait, autant que j’en pus juger, qu’au moyen d’un traité dans le même goût, qu’elle avait passé avec un riche vieillard, car cette lettre parlait de lui.
À l’esprit d’intérêt qui possédait Geneviève se joignait encore une tentation singulière, et cette tentation, c’était moi.
J’ai dit qu’elle en était venue à m’aimer véritablement. Elle croyait aussi que je l’aimais beaucoup, non sans se plaindre pourtant de je ne sais quelle indolence, où je restais souvent quand j’aurais pu la voir ; mais je raccommodais cela par le plaisir que je lui marquais en la voyant ; et du tout ensemble, il résultait que je l’aimais, comme c’était la vérité, mais d’un amour assez tranquille.
Dans la certitude où elle en était, et dans la peur qu’elle eut de me perdre (car elle n’avait rien, ni moi non plus), elle songea que les offres de monsieur, que son argent, et le bien qu’il promettait de lui faire, seraient des moyens d’accélérer notre mariage. Elle espéra que sa fortune, quand elle en jouirait, me tenterait à mon tour, et me ferait surmonter les premiers dégoûts que je lui en avais montrés.
Dans cette pensée, Geneviève répondit aux discours de son maître avec moins de rigueur qu’à l’ordinaire, et se laissa ouvrir la main pour recevoir l’argent qu’il lui offrait toujours.
En pareil cas, quand le premier pas est fait, on a le pied levé pour en faire un second, et puis on va son chemin.
La pauvre fille reçut tout ; elle fut comblée de présents ; elle eut de quoi se mettre à son aise : et quand elle se vit en cet état, un jour que nous nous promenions ensemble dans le jardin de la maison : Monsieur continue de me poursuivre, me dit-elle adroitement, mais d’une manière si honnête que je ne saurais m’en scandaliser ; quant à moi, il me suffit d’être sage, et, sauf ton meilleur avis, je crois que je ne ferais pas si mal de profiter de l’humeur libérale où il est pour moi ; il sait bien que son amour est inutile, je ne lui cache pas qu’il n’aboutira à rien : Mais n’importe, me dit-il, je suis bien aise que tu aies de quoi te ressouvenir de moi, prends ce que je te donne, cela ne t’engagera à rien. Jusqu’ici j’ai toujours refusé, ajouta-t-elle, et je crois que j’ai mal raisonné. Qu’en dis-tu ? C’est mon maître, il a de l’amitié pour moi ; car amitié ou amour, c’est la même chose, de la manière dont j’y réponds ; il est riche : eh ! pardi, c’est comme si ma maîtresse voulait me donner quelque chose, et que je ne voulusse pas. N’est-il pas vrai ? parle.
Moi ! répliquai-je, totalement rebuté des dispositions où je la voyais et résolu de la laisser pour ce qu’elle valait, si les choses vont comme vous le dites, cela est à merveille : on ne refuse point ce qu’une maîtresse nous donne, et dès que monsieur ressemble à une maîtresse, que son amour n’est que de l’amitié, voilà qui est bien. Je n’aurais pas deviné cette amitié-là, moi : j’ai cru qu’il vous aimait comme on aime à l’ordinaire une jolie fille ; mais dès qu’il est si sage et si discrète personne, allez hardiment ; prenez seulement garde de broncher avec lui, car un homme est toujours traître.
Oh ! me dit-elle, je sais bien à quoi m’en tenir ; et elle avait raison, il n’y avait plus de conseil à prendre, et ce qu’elle m’en disait, n’était que pour m’apprivoiser petit à petit sur la matière.
Je suis charmée, me dit-elle en me quittant, que tu sois de mon sentiment : adieu, Jacob. Je vous salue, mademoiselle, lui répondis-je, et je vous fais mes compliments de l’amitié de votre amant ; c’est un honnête homme d’être si amoureux de votre personne, sans se soucier d’elle : bonjour, jusqu’au revoir, que le ciel vous conduise.
Je lui tins ce discours d’un air si gai en la quittant, qu’elle ne sentit point que je me moquais d’elle.
Cependant l’amour de monsieur pour Geneviève éclata un peu dans la maison. Les femmes de chambre ses compagnes en murmurèrent, moins peut-être par sagesse que par envie.
Voilà qui est bien vilain, bien impertinent ! me disait Toinette, qui était la jolie blonde dont j’ai parlé. Chut ! lui répondis-je. Point de bruit, mademoiselle Toinette : que sait-on ce qui peut arriver ? Vous avez aussi bien qu’elle un visage fripon ; monsieur a les yeux bons ; c’est aujourd’hui le tour de Geneviève pour être aimée ; ce sera peut-être demain le vôtre ; et puis, de toutes les injures que vous dites contre elle, qu’en arrivera-t-il ? Croyez-moi, un peu de charité pour l’amour de vous, si ce n’est pas pour l’amour d’elle.
Toinette se fâcha de ma réponse et s’en alla plaindre à madame en pleurant ; mais c’était mal s’adresser pour avoir justice. Madame éclata de rire au récit naïf qu’elle lui fit de notre conversation ; la tournure que j’avais donnée à la chose fut tout à fait de son goût, il n’y avait rien de mieux ajusté à son caractère.
Elle apprenait pourtant par là l’infidélité de son mari ; mais elle ne s’en souciait guère : ce n’était là qu’une matière à plaisanterie pour elle.
Es-tu bien sûre que mon mari l’aime ? dit-elle à Toinette, du ton d’une personne qui veut n’en point douter pour pouvoir en rire en toute confiance ; cela serait plaisant, Toinette, tu vaux pourtant mieux qu’elle. Voilà tout ce que Toinette en tira, et je l’aurais bien deviné ; car je connaissais madame.
Geneviève, qui s’était méprise au ton dont je lui avais répondu sur les présents de monsieur, et qui alors en était abondamment fournie, vint m’en montrer une partie, pour m’accoutumer par degrés à voir le tout.
Elle me cacha d’abord l’argent, je ne vis que des nippes, et de quoi en faire de toutes sortes d’espèces, habits, cornettes, pièces de toile et rubans de toutes couleurs ; et le ruban lui seul est un terrible séducteur de jeunes filles aimables, et femmes de chambre !
Peut-on rien de plus généreux ? me disait-elle, me donner cela seulement parce que je lui plais !
Oh ! lui disais-je, je n’en suis pas surpris ; l’amitié d’un homme pour une jolie fille va bien loin, voyez-vous, vous n’en resterez pas là. Vraiment je le crois, me repartit-elle, car il me demande souvent si j’ai besoin d’argent. Eh ! pardi, sans doute vous en avez besoin, lui dis-je ; quand vous en auriez jusqu’au cou, il faut en avoir par-dessus la tête : prenez toujours, s’il ne vous sert de rien, je m’en accommoderai, moi, j’en trouverai le débit. Volontiers, me dit-elle, charmée du goût que j’y prenais, et des conjectures favorables qu’elle en tirait pour le succès de ses vues ; je t’assure que j’en prendrai à cause de toi, et que tu en auras dès demain peut-être ; car il n’y a point de jour où il ne m’en offre.
Et ce qui fut promis fut tenu ; j’eus le lendemain six louis d’or à mon commandement, qui joints à trois que madame m’avait donnés pour payer un maître à écrire, me faisaient neuf prodigieuses, neuf immenses pistoles ; je veux dire qu’ils composaient un trésor pour un homme qui n’avait jamais que des sous marqués dans sa poche.
Peut-être fis-je mal en prenant l’argent de Geneviève ; ce n’était pas, je pense, en agir dans toutes les règles de l’honneur ; car enfin, j’entretenais cette fille dans l’idée que je l’aimais et je la trompais : je ne l’aimais plus, elle me plaisait pourtant toujours, mais rien qu’aux yeux, et plus au cœur.
D’ailleurs, cet argent qu’elle m’offrait n’était pas chrétien, je ne l’ignorais pas, et c’était participer au petit désordre de conduite en vertu duquel il avait été acquis ; c’était du moins engager Geneviève à continuer d’en acquérir au même prix : mais je ne savais pas encore faire des réflexions si délicates, mes principes de probité étaient encore fort courts ; et il y a apparence que Dieu me pardonna ce gain, car j’en fis un très bon usage ; il me profita beaucoup : j’en appris à écrire et l’arithmétique, avec quoi, en partie, je suis parvenu dans la suite.
Le plaisir avec lequel j’avais pris cet argent ne fit qu’enhardir Geneviève à pousser ses desseins ; elle ne douta point que je ne sacrifiasse tout à l’envie d’en avoir beaucoup ; et dans cette persuasion, elle perdit la tête et ne se ménagea plus.
Suis-moi, me dit-elle un matin, je veux te montrer quelque chose.
Je la suivis donc, elle me mena dans sa chambre ; et là, m’ouvrit un petit coffre tout plein des profits de sa complaisance : à la lettre, il était rempli d’or, et assurément la somme était considérable ; il n’y avait qu’un partisan qui eût le moyen de se damner si chèrement, et bien des femmes plus huppées l’en auraient pour cela quitté à meilleur marché que la soubrette.
Je cachai avec peine l’étonnement où je fus de cette honteuse richesse ; et gardant toujours l’air gaillard que j’avais jusque-là soutenu là-dessus : Est-ce encore là pour moi ? lui dis-je. Ma chambre n’est pas si bien meublée que la vôtre, et ce petit coffre-là y tiendra à merveille.
Oh ! pour cet argent-ci, me répondit-elle, tu veux bien que je n’en dispose qu’en faveur du mari que j’aurai. Avise-toi là-dessus.
Ma foi ! lui dis-je, je ne sais où vous en prendre un, je ne connais personne qui cherche femme. Qu’est-ce que c’est que cette réponse-là ? me répliqua-t-elle : où est donc ton esprit ? Est-ce que tu ne m’entends pas ? Tu n’as que faire de me chercher un mari, tu peux en devenir un, n’es-tu pas du bois dont on les fait ? Laissons-là le bois, lui dis-je, c’est un mot de mauvais augure. Quant au reste, continuai-je, ne voulant pas la brusquer, s’il ne tenait qu’à être votre mari, je le serais tout à l’heure et je n’aurais peur que de mourir de trop d’aise. Est-ce que vous en doutez ? N’y a-t-il pas un miroir ici ? Regardez-vous, et puis vous m’en direz votre avis. Tenez, ne faut-il pas bien du temps pour s’aviser si on dira oui avec mademoiselle ? Vous n’y songez pas vous-même avec votre avisement. Ce n’est pas là la difficulté.
Eh ! où est-elle donc ? reprit-elle d’un air avide et content. Oh ! ce n’est qu’une petite bagatelle, lui dis-je ; c’est que l’amitié de monsieur pourrait bien me procurer des coups de bâton, si j’allais lui souffler son amie. J’ai déjà vu de ces amitiés-là, elles n’entendent pas raillerie ; et puis que feriez-vous d’un mari si maltraité ?
Quelle imagination vas-tu te mettre dans l’esprit ? me dit-elle, je gage que si monsieur sait que je t’aime, il sera charmé que je t’épouse, et qu’il voudra lui-même faire les frais de notre mariage.
Ce ne serait pas la peine, lui dis-je, je les ferais bien moi-même ; mais, par ma foi, je n’ose aller en avant, votre bon ami me fait peur ; en un mot, sa bonne affection n’est peut-être qu’une simagrée ; je me doute qu’il y a sous cette peau d’ami un renard qui ne demande qu’à croquer la poule ; et quand il verra un petit roquet comme moi la poursuivre, je vous laisse à penser ce qu’il en adviendra, et si cet hypocrite de renard me laissera faire.
N’est-ce que cela qui t’arrête ? Me dis-tu vrai ? me repartit-elle. Assurément ! lui dis-je. Eh bien ! je vais travailler à te mettre en repos là-dessus, me répondit-elle, et à te prouver qu’on n’a pas envie de te disputer ta poule. Je serais fâchée qu’on te surprît dans ma chambre, séparons-nous ; mais je te garantis notre affaire faite.
Là-dessus je la quittai un peu inquiet des suites de cette aventure, et avec quelque repentir d’avoir accepté de son argent ; car je devinai le biais qu’elle prendrait pour venir à bout de moi : je m’attendis que monsieur s’en mêlerait, et je ne me trompai pas.
Le lendemain un laquais vint me dire de la part de notre maître d’aller lui parler, je m’y rendis fort embarrassé de ma figure. Eh bien ! me dit-il, mons Jacob, comment se comporte votre jeune maître ? Etudie-t-il assidûment ? Pas mal, monsieur, repris-je. Et toi, te trouves-tu bien du séjour de Paris ?
Ma foi, monsieur, lui répondis-je, j’y bois et j’y mange d’aussi bon appétit qu’ailleurs.
Je sais, me dit-il, que madame t’a pris sous sa protection, et j’en suis bien aise : mais tu ne me dis pas tout ; j’ai déjà appris de tes nouvelles ; tu es un compère ; comment donc ! il n’y a que deux ou trois mois que tu es ici, et tu as déjà fait une conquête ? à peine es-tu débarqué, que tu tournes la tête à de jolies filles ; Geneviève est folle de toi, et apparemment que tu l’aimes à ton tour ?
Hélas ! monsieur, repris-je, que m’aurait-elle fait pour la haïr, la pauvre enfant ? Oh ! me dit-il, parle hardiment, tu peux t’ouvrir à moi ; il y a longtemps que ton père me sert, je suis content de lui, et je serai ravi de faire du bien au fils, puisque l’occasion s’en présente ; il est heureux pour toi de plaire à Geneviève, et j’approuve ton choix ; tu es jeune et bien fait, sage et actif, dit-on ; de son côté, Geneviève est une fille aimable, je protège ses parents, et ne l’ai même fait entrer chez moi que pour être plus à portée de lui rendre service, et de la bien placer. (Il mentait.) Le parti qu’elle prend rompt un peu mes mesures ; tu n’as encore rien, je lui aurais ménagé un mariage plus avantageux ; mais enfin elle t’aime et ne veut que toi, à la bonne heure. Je songe que mes bienfaits peuvent remplacer ce qui te manque, et te tenir lieu de patrimoine. Je lui ai déjà fait présent d’une bonne somme d’argent dont je vous indiquerai l’emploi ; je ferai plus, je vous meublerai une petite maison, dont je payerai les loyers pour vous soulager, en attendant que vous soyez plus à votre aise ; du reste, ne t’embarrasse pas, je te promets des commissions lucratives ; vis bien avec la femme que je te donne, elle est douce et vertueuse ; au surplus, n’oublie jamais que tu as pour le moins la moitié de part à tout ce que je fais dans cette occurrence-ci. Quelque bonne volonté que j’aie pour les parents de Geneviève, je n’aurais pas été si loin si je n’en avais pas encore davantage pour toi et pour les tiens.
Ne parle de rien ici, les compagnes de ta maîtresse ne me laisseraient pas en repos, et voudraient toutes que je les mariasse aussi. Demande ton congé sans bruit, dis qu’on t’offre une condition meilleure et plus convenable ; Geneviève, de son côté, supposera la nécessité d’un voyage pour voir sa mère qui est âgée, et au sortir d’ici, vous vous marierez tous deux. Adieu. Point de remerciements, j’ai affaire : va seulement informer Geneviève de ce que je t’ai dit, et prends sur ma table ce petit rouleau d’argent avec quoi tu attendras dans une auberge que Geneviève soit sortie d’ici.
Je restai comme un marbre à ce discours ; d’un côté, tous les avantages qu’on me promettait étaient considérables.
Je voyais que du premier saut que je faisais à Paris, moi qui n’avais encore aucun talent, aucune avance, qui n’étais qu’un pauvre paysan, et qui me préparais à labourer ma vie pour acquérir quelque chose (et ce quelque chose, dans mes espérances éloignées, n’entrait même en aucune comparaison avec ce qu’on m’offrait), je voyais, dis-je, un établissement certain qu’on me jetait à la tête.
Et quel établissement ? Une maison toute meublée, beaucoup d’argent comptant, de bonnes commissions dont je pouvais demander d’être pourvu sur-le-champ, enfin la protection d’un homme puissant, et en état de me mettre à mon aise dès le premier jour, et de m’enrichir ensuite.
N’était-ce pas là la pomme d’Adam toute revenue pour moi ?
Je savourais la proposition : cette fortune subite mettait mes esprits en mouvement ; le cœur m’en battait, le feu m’en montait au visage.
N’avoir qu’à tendre la main pour être heureux, quelle séduisante commodité ! N’était-ce pas là de quoi m’étourdir sur l’honneur ?
D’un autre côté, cet honneur plaidait sa cause dans mon âme embarrassée, pendant que ma cupidité y plaidait la sienne. À qui est-ce des deux que je donnerai gagné ? disais-je ; je ne savais auquel entendre.
L’honneur me disait : Tiens-toi ferme ; déteste ces misérables avantages qu’on te propose ; ils perdront tous leurs charmes quand tu auras épousé Geneviève ; le ressouvenir de sa faute te la rendra insupportable, et puisque tu me portes dans ton sein, tout paysan que tu es, je serai ton tyran, je te persécuterai toute ta vie, tu verras ton infamie connue de tout le monde, tu auras ta maison en horreur, et vous ferez tous deux, ta femme et toi, un ménage du diable, tout ira en désarroi ; son amant la vengera de tes mépris, elle pourra te perdre avec le crédit qu’il a. Tu ne seras pas le premier à qui cela sera arrivé, rêves-y bien, Jacob. Le bien que t’apporte ta future est un présent du diable, et le diable est un trompeur. Un beau jour il te reprendra tout, afin de te damner par le désespoir, après t’avoir attrapé par sa marchandise.
On trouvera peut-être les représentations que me faisait l’honneur un peu longues, mais c’est qu’il a besoin de parler longtemps, lui, pour faire impression, et qu’il a plus de peine à persuader que les passions.
Car, par exemple, la cupidité ne répondait à tout cela qu’un mot ou deux ; mais son éloquence, quoique laconique, était vigoureuse.
C’est bien à toi, paltoquet, me disait-elle, à t’arrêter à ce chimérique honneur ! Ne te sied-il pas bien d’être délicat là-dessus, misérable rustre ? Va, tu as raison ; va te gîter à l’hôpital, ton honneur et toi, vous y aurez tous deux fort bonne grâce.
Pas si bonne grâce, répondais-je en moi-même ; c’est avoir de l’honneur en pure perte que de l’avoir à l’hôpital ; je crois qu’il n’y brille guère.
Mais l’honneur vous conduit-il toujours là ? Oui, assez souvent, et si ce n’est là, c’est du moins aux environs.
Mais est-on heureux quand on a honte de l’être ? Est-ce un plaisir que d’être à son aise à contre-cœur ? quelle perplexité !
Ce fut là tout ce qui se présenta en un instant à mon esprit. Pour surcroît d’embarras, je regardais ce rouleau d’argent qui était sur la table, il me paraissait si rebondi ! quel dommage de le perdre !
Cependant monsieur, surpris de ce que je ne lui disais rien, et que je ne prenais pas le rouleau qu’il avait mis là pour appuyer son discours, me demanda à quoi je pensais ? Pourquoi ne me dis-tu mot ? ajouta-t-il.
Hé ! monsieur, répondis-je, je rêve, et il y a bien de quoi. Tenez, parlons en conscience ; prenez que je sois vous, et que vous soyez moi. Vous voilà un pauvre homme. Mais est-ce que les pauvres gens aiment à être cocus ? Vous le serez pourtant, si je vous donne Geneviève en mariage. Eh bien ! voilà le sujet de ma pensée.
Quoi ! me dit-il là-dessus, est-ce que Geneviève n’est pas une honnête fille ? Fort honnête, repris-je, pour ce qui est en cas de faire un compliment ou une révérence : mais pour ce qui est d’être la femme d’un mari, je n’estime pas que l’honnêteté qu’elle a soit propre à cela.
Eh ! qu’as-tu donc à lui reprocher ? me dit-il. Hé, hé, hé, repris-je en riant, vous savez mieux que moi les tenants et les aboutissants de cette affaire-là, vous y étiez et je n’y étais pas ; mais on sait bien à peu près comment cela se gouverne. Tenez, monsieur, dites-moi franchement la vérité ; est-ce qu’un monsieur a besoin de femme de chambre ? Et quand il en a une, est-ce elle qui le déshabille ? Je crois que c’est tout le contraire.
Oh ! pour le coup, me dit-il, vous parlez net, Jacob, et je vous entends ; tout paysan que vous êtes, vous ne manquez pas d’esprit. Écoutez donc attentivement ce que je vais vous dire à mon tour.