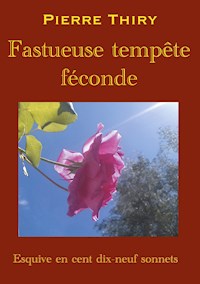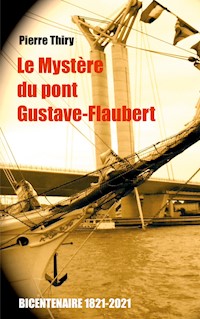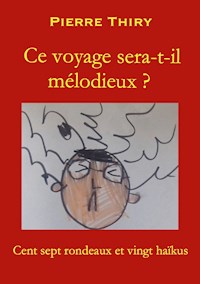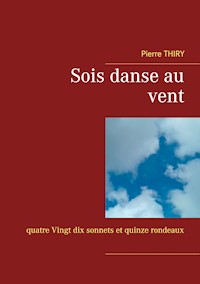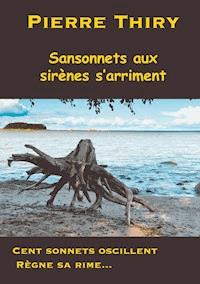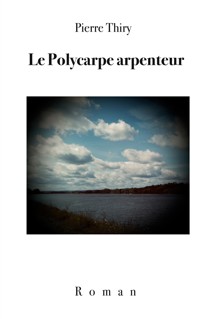
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Französisch
Ce livre est un R.O.M.A.N. d'amours, de mystères et d'aventures. Valche Eugnal et Elzbieta Gurnlang tombent amoureux. Ils se marient et s'embarquent à bord du luxueux voilier de la chanteuse Sophie Schapska et du compositeur de musique Philoxène Schapska, Le Polycarpe arpenteur. Mais comme dans la vie, rien ne se passe comme prévu. Sans labyrinthes, les voyages seraient-ils intéressants? "Les Barricades mystérieuses" de François Couperin ponctuent les actions et les drames de ce récit. Il y aura des pièges, un naufrage, une enquête, des accélérations imprévues, de la poésie, de l'humour, de la musique, des retournements vertigineux. Cette histoire nous mène de Poligny dans le Jura à la vallée de la Seine, en passant par Chalon-sur-Saône, Les Baléares et la Thrace occidentale. Ce voyage invite à rêver ouvertement, musicalement aux noeuds romanesques opaques, mais amplement naturels. Au coeur de l'énigme, il y a le R.O.M.A.N. (Rapide Objet Manipulable Aimant Naviguer): Le Polycarpe arpenteur...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pierre Thiry est également l’auteur de
Nouvelles
Valse froide (BoD 2022) élu par ses lecteurs sur Instagram Oscar AE 2022
Romans
Le Mystère du pont Gustave-Flaubert BoD 2021
Édition du bicentenaire 1821-2021(polar décalé)
Ramsès au pays des points-virgules BoD 2009
(fiction fantaisiste pour lecteurs de dix à cent-dix ans)
Recueils de poésie
Cinquante-deux reflets, BoD 2022
Fastueuse tempête féconde, BoD 2021
Ce voyage sera-t-il mélodieux, BoD 2021
Termine au logis, BoD 2020
(Cent rondeaux d’un été à savourer l’hiver en dégustant un thé)
Sois danse au vent, BoD 2020
(quatre-Vingt-dix sonnets et quinze rondeaux d’une année Vingt)
La Trilogie des Sansonnets (trois cents sonnets publiés de 2015 à 2019) :
Sansonnets un cygne à l’envers, BoD 2015
Sansonnets aux sirènes s’arriment, BoD 2018
Sansonnet sait du bouleau BoD 2019
Contes pour enfants
Isidore Tiperanole et les trois lapins de Montceau-les-Mines BoD 2011
La Princesse Élodie de Zèbrazur et Augustin le chien qui faisait n’importe quoi BoD 2017
Le Poète et la princesse Élodie de Zèbrazur (BoD) 2021
http://www.pierre-thiry.lr
« Est-ce la peine de tenir registre de ce que chacun peut voir tous les jours dans sa maison ou dans celle de son voisin ? »
Jean-Jacques Rousseau, Entretiens sur les romans, Julie ou La Nouvelle Héloïse (1761)
Les faits et les personnages de ce roman sont entièrement fantaisistes et imaginaires, toute ressemblance avec des faits existants ou ayant existé ne serait que pure coïncidence.
Sommaire
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
Chapitre 14
Épilogue : Vingt ans plus tard
Chapitre 1
Un souffle de vent décoiffe l’homme qui déambule sous son chapeau de paille. Il marche en admirant le ciel, en contemplant le décor qui l’entoure. Des carrés de salades succèdent aux carrés de tomates. L’homme déambule dans un potager riche en légumes : des courgettes, des carottes, des patates, des salades et des tomates. Il fait beau, trop chaud, une chaleur inquiétante, estivale, caniculaire.
L’homme s’amuse. Les carrés de laitues semblent fers de leurs angles droits, taillés au cordeau. Quelque chose d’industriel semble s’être glissé dans ce décor maraîcher. L’homme ne s’était jamais imaginé qu’un carré de laitues puisse exprimer un état d’âme, une humeur, un sens de l’humour. Mais aujourd’hui, cela lui paraît évident. Ces légumes sont doués de vie. Ce sont des êtres vivants. Ils éprouvent donc, sans doute, des sentiments, mais lesquels ?
Et comment en être sûr ? L’homme se révolte. Comment peut-on entamer un dialogue avec des laitues ou des tomates ? L’homme voudrait être à l’écoute de ce potager. Il voudrait pouvoir dire qu’il comprend les plantes qui vivent en silence dans ces carrés organisés par lui. Il en finirait presque par offrir une personnalité à ces quadrilatères.
Ah ! Toi, tu es fer de tes angles droits, abstraits carrés ; tu es fier de ta logique élégante ! lance l’homme à l’un de ces carrés de laitues. Il faut croire que c’est plus facile pour un être humain de concevoir un dialogue avec une forme abstraite dont il est le maître, plutôt que de converser avec des végétaux qui poussent en déployant leurs propres formes étonnantes, souvent difficiles à décrire. L’homme avance dans le potager.
Il admire ce travail de jardinage. Ce n’est pas lui le jardinier. C’est quelqu’un d’autre qui cultive ces légumes et ces fruits. L’homme est juste un passant, un promeneur, un spectateur, un dilettante, un esthète. Il regarde. Il écoute. Il observe.
Il ne se passe rien. Tout est silencieux. Une légère brise souffle par intermittence. Les légumes bougent légèrement. Les cheveux de l’homme flottent au vent. Mais son chapeau reste sur son crâne. Alors il crâne. Il se promène. Le vent souffle un peu plus fort.
Une femme passe. Elle transporte un théorbe.
Une sorte de tempête de sable métamorphose soudain le paysage. L’homme observe en se protégeant les yeux. Ce n’est ni un rêve ni un cauchemar. C’est la réalité. L’homme abaisse le rebord de son chapeau. Cela lui assure une protection modérée qu’il estime suffisante. Ce vent sec pique, chauffe et gratte. C’est désagréable. Les quadrilatères à angles droits ne sont bientôt plus que des espèces de vagues cercles émergeant d’une mince surface, d’une couverture de petites particules qui ressemblent à des grains de sable. Le désert semble vouloir envahir la verdure. C’est étrange et beau. Mais c’est un spectacle quelque peu angoissant pour l’homme.
Pourra-t-il lutter contre ce phénomène cataclysmique ? Le potager s’ensable et ce n’est ni du cinéma ni du théâtre. C’est un potager. L’homme en essayant de se protéger contemple ce phénomène. Il est témoin d’une sorte de catastrophe. Le potager était vert, organisé en carré, rationnel. À présent, il y a des sortes de petits cercles de légumes qui émergent ici et là au milieu d’une vague couche de sable. Des esquisses de dunes étranglent des carrés. L’homme essaie de se souvenir, si quelqu’un lui a déjà appris quelque chose à propos de ce phénomène. Sous l’assaut du vent de sable, il ne se souvient pas. Il voudrait prendre une photo, ou saisir des images vidéo. Mais il a peur d’abimer son appareil photo. C’est un modèle récent. Il lui a coûté cher.
Le vent continue à souffler en ignorant les réflexions de l’homme. Il continue à souffler avec une régularité impertinente. Le vent semble se moquer. Il semble dire à l’homme : creuse ton bureau de sable... Ou plutôt, l’homme croit entendre que le vent lui dit cela. Ça l’arrange de le croire. Il attend de la part du vent des propos qui ressemblent à ce qu’il entend habituellement dans son environnement quotidien.
Cet homme travaille souvent dans un bureau. Il réfléchit dans un bureau. Il organise l’avenir dans un bureau. Il essaie de comprendre le passé à partir de son bureau et d’imaginer l’avenir avec un stylo, du papier, un écran. Il aimerait même créer du rêve à partir de ses mots, ses raisonnements et ses déchiffrements. Alors face à l’attaque du vent contre le potager, l’homme éprouve soudain l’envie d’être à nouveau derrière son bureau. Et c’est pourquoi il imagine que le vent lui murmure : creuse ton bureau de sable.
Il n’est pas bête, ce vent, pense l’homme. Il m’amène du sable et me propose de construire ma fable. Ce n’est pas absurde.
C’est même plutôt sympathique. Le vent m’amène du sable pour que je me construise un bureau de sable. Il joue le rôle d’un associé. La nature est belle, inattendue et bonne.
L’homme pense cela et pourtant il est attaqué par le vent qui lui gratte la peau, la pique et l’irrite. L’homme observe les tomates en se questionnant. Ces légumes éprouvent-ils l’action du vent comme je la subis ?
Il essaie d’écouter les tomates assaillies par le sable. Elles restent muettes. Mais elles essaient de se défendre. Elles tirent leur eau de la terre. Elles tirent sur le sous-sol pour se nourrir. On dirait qu’elles essaient d’imiter les humains qui vont extraire du pétrole dans les profonds puits que la terre leur met à disposition.
Car les humains recherchent du pétrole sérieusement. Ils le font avec âpreté, professionnellement. Ils le font avec férocité. Parfois, ils font même la guerre quand ils imaginent que c’est indispensable. Ils tiennent à extraire du pétrole pour leur usage. Mais ils ne veulent pas que d’autres humains les privent de leur pétrole à eux.
Les légumes en puisant leur eau ne paraissent pas se compliquer autant la vie, ils semblent plutôt pacifques.
Les tomates parviennent à croître avec humour grâce à l’humidité du sous-sol. Impassibles, fraiches et rebondies, elles supportent le vent de sable. L’homme a du mal à garder son sang-froid. Il prend ce vent de sable au sérieux. Car ces petits grains qui arrivent par les airs désorganisent sa vie bien organisée. Quand on est pris au dépourvu, ce n’est pas si facile que cela de se construire un bureau, même à l’aide d’un simple tas de sable. Ça ne s’improvise pas durant une tempête. Ça ne s’improvise pas en s’amusant. Cela prend du temps de se construire un bureau. Il faut des machines, des ouvriers, des dessinateurs, des ingénieurs, des architectes, des entreprises.
En se promenant, tout seul dans la tempête de sable, l’homme peut imaginer. Mais il est peu probable qu’il parvienne à se construire, en improvisant ici et maintenant, son bureau. Alors il observe l’humour des tomates. Malgré l’ennui que leur procure cette tempête, elles ont gardé leur air spirituel, leur sens de la farce, leur tendresse juteuse.
Pourtant ce vent leur crée bien des ennuis aux tomates. Certaines sont écorchées, épluchées, lacérées, cabossées, déchiquetées, trouées. Certaines finissent par s’envoler, emportées par le vent avant de chuter burlesquement sur le sable rugueux. Et les tomates en s’ensablant perdent totalement leur sens de l’humour. Elles pourrissent et se dessèchent avant de pouvoir être savourées.
L’homme espère. Il l’espère, car il devient jaloux. À sa gauche, un pommier exhibe ses pommes encore un peu vertes. Elles contemplent l’homme avec leurs airs de pommes vertes. Elles semblent plaisanter. L’homme a l’impression que ces fruits se moquent de lui. Il les regarde et s’interroge...
Se moquent-elles vraiment de moi ? Qu’ai-je de si ridicule qui puisse occasionner le rire des pommes ? L’humour des pommes est parfois difficile à comprendre par les humains. Et l’homme continue son chemin.
Il a encore l’impression que derrière lui les fruits et légumes éclatent de rire. Un de ces petits rires silencieux et moqueurs dont on ne sait pas quoi penser. C’est un mouvement spasmodique entre sanglot et rire. L’homme se retourne : Creuse ton bureau de sable... Quelqu’un m’a-t-il parlé ? Se demande l’homme. Il n’ose pas s’exprimer à voix haute. Le rire des pommes l’impressionne. Il est intimidé par elles. Peut-être parce qu’elles sont vertes et qu’il n’est guère écologiste. Il se méfie. Il refuse d’admettre l’évidence. Il préfère croire à des idées carrées. Pourtant il vient de voir qu’un carré ne durait pas.
Un vent de sable peut tout remettre en cause. L’homme est inquiet. Il refuse de penser que ce sont les pommes qui se sont adressées à lui. Il refuse tout simplement d’approfondir l’idée que des pommes, comme des tomates, puissent avoir le sens de l’humour, puissent avoir l’envie de dialoguer, puissent avoir une capacité de raisonnement philosophique.
En avançant parmi les carrés de laitues, l’homme redresse la tête : J’ai quand même plus d’allure qu’une salade, se dit-il avec un peu d’orgueil. En marchant debout, j’ai l’air plus intelligent qu’elles. Ces laitues ensablées et ces pommes vertes devraient m’admirer.
Mais pourquoi de telles idées lui passent-elles par la tête ? Où va-t-il les chercher ? N’y a-t-il pas un risque qu’à force de penser ainsi, les légumes et les fruits se mettent à lui parler ?
Le monde est-il exactement comme il l’imagine ? Existe-t-il un risque à ce que le monde se mette réellement à ressembler à ce qu’il imagine ? L’homme marche en dressant la tête, mais il commence à avoir peur de ce qu’il imagine. Alors, il se réfugie dans ses raisonnements rationnels, géométriques : le triangle, le carré, le rectangle, le cercle et les formules mathématiques ; x+y=z. Ces formes, ces formules devraient m’aider à regarder la nature, songe-t-il. Mais il y a tant d’inconnu dans sa formule qu’il peine à imaginer la forme de son raisonnement.
Autour de lui, tout n’est que silence. Un oiseau commence à chanter. Mais il joue avec des sons que l’homme ne comprend pas. Et pourtant ce chant semble avoir une signifcation. Elle doit en avoir pour les oiseaux, puisque plus loin, un autre oiseau répond. Ces deux êtres vivants semblent dialoguer. Pensent-ils comme moi ? L’homme enfonce d’abord sa tête dans les épaules puis il la redresse, mais il est perplexe. Il aperçoit un des deux oiseaux, perché dans l’arbre. Lui aussi semble redresser la tête. Lui aussi semble regarder l’homme d’un air perplexe. Il semble dire à l’homme : Danse et plonge au flux des bruits. Il l’a dit en langage oiseau, en chantant. Mais il semble à l’homme que l’oiseau lui a parlé.
Des ronds, des triangles, des carrés, des rectangles, se dit l’homme, voilà ce qui devrait requérir toute mon attention. Je perds mon temps à vouloir traduire les chants d’oiseaux en x+y=z. Seuls les poètes peuvent se livrer à ce type de passe-temps. Moi je ne suis pas poète. Je ne devrais pas perdre mon temps à penser que l’oiseau me parle.
L’oiseau se remet à chanter : Lance un trait d’esprit qui ose ! semble dire l’oiseau. C’est troublant, tout de même, se dit l’homme. Il s’imagine à nouveau que l’oiseau veut absolument lui dire quelque chose. Mais que puis-je lui dire de rationnel ? Comment puis-je faire pour ramasser ma pensée dans un sifflement compréhensible par l’oiseau ? L’homme se questionne, mais il n’a pas de réponse.
Il marche en silence. Il ne répond pas à l’oiseau. Il entend des rythmes, des sons, le souffle du vent, le sable qui retombe après la tempête dans l’atmosphère sèche. Plus loin, indifférente au vent de sable, la femme au théorbe s’est assise. Elle a commencé à jouer Les Barricades Mistérieuses de François Couperin. C’est beau.
L’homme va-t-il esquisser un pas de danse ? Il se promène. Il respire. Il admire. Il plonge dans cette musique imprévue. Il fait chaud. Le temps est sec. Il ressent par tous les membres de son corps les effets du réchauffement climatique.
Comment traduire cela en géométrique explicatif ? se demande-t-il ? Si j’arrivais à traduire ces impressions en équations mathématiques, peut-être trouverais-je une solution ? L’homme doute et se questionne. Mais il ignore s’il parvient à poser le véritable problème. Autour de lui, les carrés de laitues sont ensablés. Peut-être devrai-je écrire une fable ? se demande l’homme. Mais par où commencer ? Ce paysage est si embrouillé. Ces oiseaux parlent un langage si intraduisible. Les laitues et les arbres fruitiers semblent muets, mais ils bavardent. Cette vie est épineuse. Et puis je ne dois pas oublier que je suis ici pour mener mon enquête.
Alors l’homme pense à la rose, à son parfum, à sa durée éphémère, à sa douceur, à ses épines acérées, redoutables. L’homme aime la rose. Mais la rose l’aime-t-elle ? Il se sent saisi par la fleur, comme un poète est attiré par sa muse. Il se laisse bercer par cette impression. Il se souvient qu’il a été amoureux. Il se croit heureux. Et si le bonheur était la rose ? se demande-t-il. La rose est dangereuse. Elle attire, mais elle pique. Elle invite à l’amour éternel, mais elle meurt éphémère. L’homme croit qu’elle va le caresser, mais elle va le griffer. Ce n’est pas la première fois que ça arrive. L’homme avait décidé d’oublier. Il a oublié la griffe de la rose sur sa peau, le trait rouge qu’elle dessine, le sang qui colore une gravure. L’homme a oublié que la rose se rêve artiste et chirurgienne. Qu’est-ce que « l’opération de la rose ? » une image de naufrage se présente à son esprit. Il pose la question à un poirier qui se dresse, l’air moqueur et philosophe.
À la férocité de la rose, l’homme préfère l’humeur des fruits. La rose est cruelle. La poire est humoriste. En goûtant à la poire, l’homme découvre un sirop de fables. Il mâche la poire. Il en naît une histoire. C’est une longue aventure qui naît du bruit du vent, des chants d’oiseaux et du goût d’une poire. L’homme mâche. La poire exprime son jus. L’homme imagine une fable. Il va rentrer dans la salle d’un bâtiment, au frais, pour écrire, puis il rangera sans doute sa fable dans son tiroir. L’aventure est un saut de phrase qui ruse espiègle enchante et va dans l’oreille en la berçant bas puis chuchote et réchauffe, embrase.
Les derniers accords des Baricades Mistérieuses résonnent sur le théorbe. La femme écoute l’accord disparaître dans le silence. Elle lève les yeux. Elle remet son instrument dans son étui. Avec une bandoulière, elle l’accroche à son épaule. Puis elle avance, balançant son théorbe tandis que le dernier accord s’est envolé dans le vent.
L’homme déambule seul dans le potager riche en légumes, en arbres fruitiers. Ce jardin ressemble à une oasis émergeant dans les dunes. Il fait beau, trop chaud, une chaleur inquiétante, estivale, caniculaire. Il marche en admirant le ciel, imprégné du décor qui l’entoure. Des carrés de salades ensablés succèdent aux carrés de tomates ensablés. Deux oiseaux chantent. Un souffle de vent décoiffe l’homme qui rêve tandis que son chapeau de paille semble prêt à s’envoler vers la dame au théorbe.
Chapitre 2
Originaire du Danube, elle est belle, immense par son sourire, superbe d’invention, proliférante d’imaginations. Elle est globe-trotteuse et sait brouiller les pistes, en dissimulatrice. Certains assurent qu’aujourd’hui, elle cultiverait des salades incognito à Poligny dans le Jura.
Il était vagabond, passionné d’équitation, incongru dans ses répliques. Il cravachait tellement son intellect qu’il avait le cerveau endormi. Alors il lançait parfois des mots en désordre. Mal articulé, son discours avait des allures comiques. Il était pourtant désastreux et cela l’avait conduit à collectionner les catastrophes tragiques.
Elle, c’est Elzbieta Gurnlang, lui, c’était Valche Eugnal.
Elle est née sur les rives du Danube dans une belle et vaste demeure aux fenêtres souvent ouvertes.
Il était né dans la banlieue de Leipzig, dans une famille de Roumains exilés, vivant aux franges de la légalité faute de moyens fnanciers.
Son père fut un temps mécanicien d’autocar avant de devoir vivre d’expédients, au hasard des vents plus ou moins favorables.
Sa maman était cruciverbiste amatrice. L’esprit vif, elle parlait peu. En faisant des mots croisés, elle se consolait de sa vie déplorable.
De son enfance, Valche avait retenu l’étroitesse de l’appartement familial, les regards muets, mais éloquents de sa maman, les bruits des voisins, le brouhaha des parcs d’immeuble, la laideur du béton, les scènes de ménage et le ménage mal fait.
Les soirs de pleine lune, il faisait des parties de chats perchés clandestines avec une bande de polissons incongrus. Ceux-ci n’étaient jamais à court d’idées quand il s’agissait d’en avoir de mauvaises. Leurs parties de chats perchés avaient fni par se transformer en séances de cambriolages acrobatiques. Les polissons furent bientôt très célèbres auprès de la police.
Elzbieta Gurnlang avait retenu de son enfance danubienne les vastes légendes mythologiques ; des récits à la durée interminable que l’on racontait près d’un âtre presque aussi grand qu’un porche.
C’était une enfance riche en couleurs, dans les labyrinthes fabuleux d’un parc où les fleurs sentaient toujours bon, où les oiseaux chantaient toujours juste. Elle prétendait même se souvenir du chant des cigales du Danube. Elle avait donc intitulé son premier roman ; Les Cigales du Danube. Elle avait un temps suivi des études de littérature française à l’université de la Sorbonne, à Paris.
Elle y avait appris la différence entre l’être et le paraître en étudiant les Aventures du baron de Faeneste d’Agrippa d’Aubigné. Le nom de Faeneste est issu du verbe utilisé pour les Grecs pour dire « paraître ». Dans ce livre, le baron est confronté à Monsieur d’Enay (dont le nom provient de la façon dont se dit le verbe être en langue grecque). Elzbieta avait beaucoup appris grâce à la littérature française. Mais elle avait également lu en grec les aventures d’Ulysse. Elle avait pris très tôt goût aux voyages et aux surprises qu’ils offrent.
Très tôt dans son existence Elzbieta avait pris conscience de l’importance de la littérature, de la maîtrise des langues et du langage. Elle avait conscience que la réussite ne venait pas toujours de longues études. La vie (telle qu’elle la concevait) était plutôt une forme de philosophie insouciante mêlée d’une confance détendue et souriante qui permettait de toujours trouver le mot juste : celui qui fait mouche à l’instant propice.
Elzbieta et Valche s’étaient rencontrés à La Forge, un café de Chalon-sur-Saône, tenu par Lola Diamant, une ancienne chanteuse au cabaret du Dindon Fou de Moulins-sur-Allier. Lola Diamant était collectionneuse de boîtes d’allumettes autrichiennes. Elle avait acheté La Forge en vendant sa collection de boîtes d’allumettes pour un bon prix. L’acheteur était administrateur à la retraite de chez Dechandel. C’était un industriel, un ami de son mari.
Lola avait réussi à faire attribuer à La Forge, une étoile au guide Michelin. Une récompense due à la qualité de son kouglof, mais également, susurraient certains, à cause de son passé de chanteuse, à moins que ce ne soit grâce à l’argent de son mari. Quelle que soit la vérité, ces commérages évoquaient l’ensemble de ces hypothèses avec une mine entendue qui entretenait une réputation.
Ce n’était que purs commérages, résultants de l’ennui de la frange aisée de la population de Chalon-sur-Saône. Une dame de la rue Grand Pont (qui n’avait jamais mis les pieds à Moulins-sur-Allier) avait en outre évoqué par allusions des choses louches à propos du cabaret du Dindon Fou. La rumeur était allée en s’amplifant. Avec une étoile au guide Michelin, La Forge était devenue le rendez-vous des anticonformistes énigmatiques (ceux dont on parlait avec des regards emplis de sous-entendus).
Mais le véritable attrait de La Forge de Lola Diamant, était évidemment la qualité de sa cuisine. Car le vrai kouglof n’est pas bourguignon, il est alsacien, faut-il vous l’apprendre ? Or, à Chalon, Lola le cuit fort tendre, savoureux à dérider les grognons. C’est un dessert de farine et levure avec amandes œufs et puis raisins, du sucre aussi, du lait puis du sel fn. Son moule alsacien sculpte sa fgure. Lola prend son temps (presque cinq heures) pour préparer, pétrir sa pâte au beurre, pour le cuire et poudrer son sucre glace. Ce fameux kouglof n’est pas bourguignon, mais à La Forge, on l’aime sans lorgnon, car à Chalon-sur-Saône il fuse audace.
Devant ce célèbre kouglof bière bourguignon, Elzbieta et Valche avaient débuté leur idylle. C’est cette relation qui les avait conduits à fgurer dans le présent récit. Épicée de grimaces et de calembours, de frustrations et de beaux voyages, de désirs contrariés et de coups de klaxons, de randonnées dans le désert et de lèche-vitrine, leur vie avait été active et, dans un certain sens, formidable.
Mais un jour était survenu ce drame dont peu de personnes se souviennent et dont il va sans doute être difficile de parler ici. La vie est déjà si sombre. Faut-il encore l’obscurcir par des récits tragiques ?
C’est Elzbieta qui avait entraîné Valche à La Forge. Valche était perdu, à l’angle du quai de la Poterne et de la rue des Cochons de Lait. Il cherchait le musée Nicéphore Niépce. Mais ce jour-là était un mardi. Le musée était fermé. Elzbieta avait donc entraîné Valche à La Forge.
Comme Valche Eugnal cherchait le musée Nicéphore Niépce, elle en avait conclu qu’il était photographe avec un regard artiste.
En réalité, il cherchait le musée pour s’y faire embaucher comme gardien. Mais cela Elzbieta ne l’avait appris que bien des années plus tard, car Valche Eugnal n’était pas très causant. Il était très beau, mais il était aussi peu bavard que sa mère. Il était timide, mais il n’avait pas hérité de la passion maternelle pour les mots croisés. Il lançait ses mots en désordre. Ils circulaient dans ses phrases, comme ils arrivaient, un peu par hasard, sans grand souci de cohérence.
Lors de leur première rencontre à La Forge, Elzbieta avait trouvé Valche étrange et comique. Lola Diamant aussi, semblait-il. Cette dernière n’arrêtait pas de glousser d’un petit rire nerveux et réjoui en les observant. La rencontre d’Elzbieta et Valche autour d’un kouglof bière à La Forge