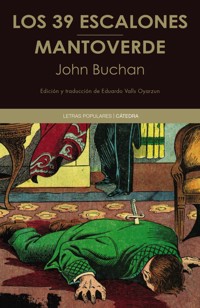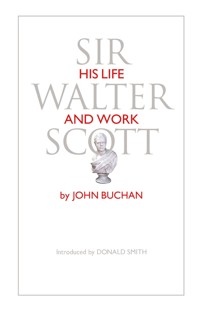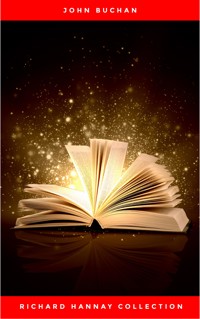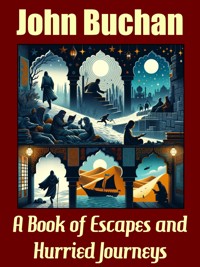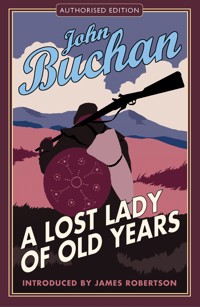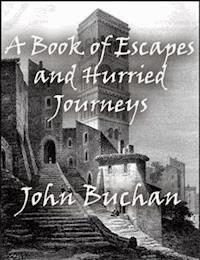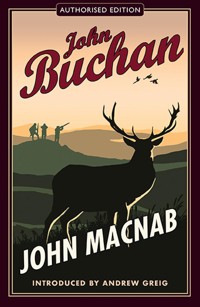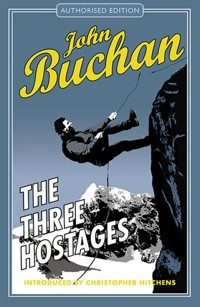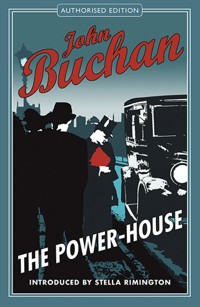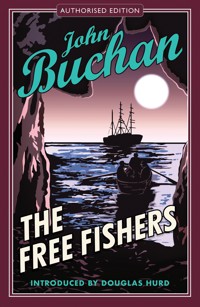0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Classica Libris
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Dick Hannay se voit confier une mission secrète de la plus haute importance : trouver ce qui se trame en Turquie, et qui pourrait changer la face de la Grande guerre. Aidé par trois personnes : d’un américain, d’un de ses amis Dick, et d’un vieux casseur Australien, ils doivent gagner la Turquie. Dick Hannay, quant à lui, se retrouve en Allemagne…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
John Buchan
LE PROPHÈTE AU MANTEAU VERT
Traduit de l’anglais par Marc Logé
Copyright
First published in 1916
Copyright © 2019 Classica Libris
1
Où il s’agit d’une mission
J’achevais de déjeuner et je bourrais ma pipe lorsqu’on me remit la dépêche de Bullivant.
Ceci se passait à Furling, la grande maison de campagne du Hampshire où j’étais venu terminer ma convalescence, après la blessure reçue à Loos. Sandy, qui s’y trouvait dans les mêmes circonstances que moi, était, à ce moment précis, à la recherche de la marmelade d’oranges. Je lui jetai le télégramme qu’il parcourut en sifflant.
– Eh bien ! Dick, vous voilà à la tête d’un bataillon... À moins que vous ne soyez versé dans un état-major ! Vous allez devenir un sale embusqué et vous dédaignerez les malheureux officiers de troupe ! Quand je songe à votre manière de traiter les embusqués autrefois !
Je demeurai songeur quelques instants. Le nom de Bullivant me reportait à dix-huit mois en arrière, à cet été brûlant qui précéda la guerre. Je n’avais pas revu Bullivant depuis, mais les journaux avaient souvent parlé de lui. Depuis plus d’un an, j’étais tout occupé de mon bataillon, n’ayant d’autre souci que de former de bons soldats. J’y avais assez bien réussi, et il n’y eut sûrement jamais d’homme plus fier que Richard Hannay lorsqu’il franchit les parapets des tranchées à la tête de ses Lennox Highlanders, par cette glorieuse et sanglante journée du 25 septembre. La bataille de Loos ne fut pas une partie de plaisir, et nous avions déjà connu quelques chaudes journées auparavant. Mais j’ose dire que les plus durs moments de la campagne traversés jusque-là étaient fort anodins, comparés à l’affaire à laquelle je m’étais trouvé mêlé en compagnie de Bullivant, au début de la guerre.
La vue de son nom au bas de ce télégramme sembla changer toute ma manière de voir. J’espérais être appelé à prendre le commandement d’un bataillon et je me réjouissais d’assister à la curée du Boche. Mais ce télégramme fit dévier mes pensées vers un nouvel ordre d’idées. Peut-être cette guerre comportait-elle d’autres devoirs que celui de se battre tout simplement ? Pourquoi, au nom du ciel, le Foreign Office désirait-il voir, dans le plus bref délai possible, un obscur major de la Nouvelle Armée ?
– Je prends le train de 10 heures pour Londres, déclarai-je. Je serai revenu pour le dîner.
– Je vous engage à faire l’essai de mon tailleur, me conseilla Sandy. Il dispose les galons rouges avec un goût très sûr. Allez le trouver de ma part.
Une idée me frappa soudain.
– Vous êtes à peu près guéri, lui dis-je. Si je vous télégraphiais, seriez-vous capable de boucler votre valise et la mienne et de me rejoindre ?
– C’est dit. J’accepte un poste dans votre état-major, au cas où l’on vous confierait un corps d’armée. Mais si par hasard vous revenez ce soir, soyez un chic type et rapportez-nous un baril d’huîtres de chez Sweeting.
Je voyageai jusqu’à Londres dans un vrai brouillard de novembre, qui se dissipa vers Wimbledon pour faire place à un soleil pluvieux. Londres est insupportable pendant la guerre. La grande ville semble avoir perdu tout sens de direction. Elle s’est affublée de toutes sortes d’uniformes et d’emblèmes, et cette mascarade ne s’accorde pas à l’idée que je m’en fais. On sent la guerre plus vivement dans les rues de Londres qu’au front, ou plutôt on y sent la confusion de la guerre sans en deviner le but. Toujours est-il qu’il ne m’est jamais arrivé, depuis août 1914, de passer un jour en ville sans rentrer chez moi avec le cafard.
Je pris un taxi qui me déposa devant le Foreign Office. Sir Walter ne me fit pas attendre longtemps.
Son secrétaire m’introduisit dans son bureau. Mais comment reconnaître l’homme que j’avais vu dix-huit mois auparavant ? Il avait maigri, ses épaules s’étaient cassées, voûtées. Son visage avait perdu sa fraîcheur et était plaqué de taches rouges, comme celui d’un homme qui ne prend pas assez l’air. Ses cheveux étaient très gris et clairsemés près des tempes, mais les yeux restaient les mêmes : vifs, perçants, et pourtant bienveillants. Sa mâchoire carrée était toujours vigoureuse.
– Veillez à ce qu’on ne nous dérange sous aucun prétexte, dit-il à son secrétaire.
Et lorsque le jeune homme fut sorti, il alla fermer les portes à clef.
– Eh bien, major Hannay, dit-il en se laissant tomber dans un fauteuil près du feu. Aimez-vous toujours la vie de soldat ?
– Beaucoup, répondis-je, bien que cette guerre ne soit pas tout à fait ce que j’aurais choisi ! C’est une aventure lugubre, sanglante. Mais nous avons la mesure du Boche, maintenant, et c’est la ténacité qui gagnera la guerre. Je compte retourner au front d’ici une semaine ou deux.
– Obtiendrez-vous votre bataillon ? demanda-t-il.
Il paraissait avoir suivi de près mes faits et gestes.
– Je crois avoir une assez bonne chance. Mais je ne me bats ni pour l’honneur ni pour la gloire. Je veux faire de mon mieux. Dieu sait si je souhaite voir la fin de cette guerre ! Je voudrais seulement ne pas y laisser ma peau.
Il rit.
– Vous vous faites injure. Que dites-vous de l’incident du poste d’observation de l’Arbre solitaire ? Ce jour-là, vous n’avez pas songé à votre peau.
Je me sentis rougir.
– Ce n’était rien, dis-je, et je ne puis comprendre qui a pu vous en parler. L’entreprise ne me souriait guère, mais il fallait bien m’y résoudre, si je voulais empêcher que mes hommes n’allassent en paradis. C’étaient un tas de jeunes fous, des cervelles brûlées. Si j’avais envoyé l’un d’eux à ma place, il se serait agenouillé devant la Providence et... n’en serait pas revenu.
Sir Walter souriait toujours.
– Je ne discute pas votre prudence. Vous l’avez prouvée, sans quoi nos amis de la Pierre Noire vous eussent cueilli lors de notre dernière rencontre. Je n’en doute pas plus que de votre courage. Ce qui me préoccupe, c’est de savoir si votre prudence trouve tout son emploi dans les tranchées ?
– Serait-on par hasard mécontent de moi au War Office ? demandai-je vivement.
– On est au contraire extrêmement satisfait de vous. On a même l’intention de vous donner le commandement d’un bataillon. Vous serez sans doute bientôt général de brigade, si vous échappez à quelque balle perdue. Cette guerre est merveilleuse pour la jeunesse et les débrouillards... Mais... Hannay, je présume que dans toute cette affaire, vous désirez surtout servir votre pays ?
– Évidemment, répliquai-je. Je n’y suis certainement pas pour ma santé !
Il considéra ma jambe où les médecins avaient été dénicher plusieurs fragments de shrapnell et eut un sourire railleur.
– Êtes-vous à peu près retapé ? me demanda-t-il.
– Je suis dur comme un sjambok. Je manie la raquette avec dextérité et je mange et dors comme un enfant.
Il se leva et demeura debout, le dos au feu, regardant d’un air distrait le parc hivernal que l’on apercevait par la fenêtre.
– La guerre est une belle partie, et vous êtes homme à la jouer. Mais d’autres que vous en savent les règles, car aujourd’hui, la guerre réclame plutôt des qualités moyennes qu’exceptionnelles. C’est comme une grande machine dont tous les rouages sont réglés. Vous ne vous battez pas parce que vous n’avez rien de mieux à faire, vous vous battez parce que vous désirez servir l’Angleterre. Mais que diriez-vous s’il vous était possible de l’aider plus efficacement qu’en commandant un bataillon, une brigade ou une division ? Que diriez-vous s’il existait une œuvre que vous seul puissiez accomplir ? Je ne parle pas d’une corvée d’embusqué dans un bureau, mais d’une tâche à côté de laquelle votre expérience de Loos ne serait qu’une plaisanterie. Vous ne craignez pas le danger ? Eh bien, dans l’affaire que je vous propose, vous ne vous battriez pas entouré d’une armée : vous vous battriez seul. Vous aimez jouer les difficultés ? Eh bien, je puis vous confier une mission qui mettra toutes vos facultés à l’épreuve. Avez-vous quelque chose à dire ?
Mon cœur battait à coups redoublés, car sir Walter n’était pas homme à exagérer.
– Je suis soldat, répondis-je, et j’obéis aux ordres qu’on me donne.
– C’est vrai. Mais ce que je vais vous proposer ne rentre en aucune façon dans les devoirs d’un soldat. Je comprendrais très bien que vous décliniez ma proposition. En le faisant, vous agiriez comme tout homme sain d’esprit agirait à votre place, comme j’agirais moi-même. Je ne veux exercer aucune pression sur vous. Et si vous le préférez, je ne vous dirai pas ma proposition, je vous laisserai partir à l’instant en vous souhaitant bonne chance ainsi qu’à votre bataillon. Je ne veux pas embarrasser un bon soldat en lui demandant de prendre des décisions impossibles.
Cette dernière phrase me piqua d’honneur.
– Je ne m’enfuis pas avant que les canons aient tiré, m’écriai-je. Dites-moi ce que vous me proposez.
Sir Walter se dirigea vers un secrétaire qu’il ouvrit avec une clef pendant à sa chaîne de montre, et dans un des tiroirs, il prit un morceau de papier.
– Je crois comprendre que vos voyages ne vous ont jamais mené en Orient, dit-il.
– Non, répondis-je, à l’exception d’une partie de chasse dans l’Est africain.
– Avez-vous par hasard suivi la campagne qui se poursuit là-bas en ce moment ?
– Je lis les journaux assez régulièrement depuis mon séjour à l’hôpital. J’ai des amis qui font campagne en Mésopotamie, et bien entendu, j’aimerais beaucoup savoir ce qui va se passer à Gallipoli et à Salonique. Il me semble que l’Égypte est assez tranquille.
– Si vous voulez bien m’écouter dix minutes, je compléterai vos lectures.
Sir Walter s’étendit dans un fauteuil et se mit à adresser des paroles au plafond. Il me fit la meilleure version, et aussi la plus détaillée et la plus claire, que j’eusse entendue d’aucune phase de la guerre. Il me dit pourquoi et comment la Turquie avait lâché prise. Il me parla des griefs qu’elle eut contre nous lorsque nous saisîmes ses cuirassés, du mal que fit la venue du Goeben ; il m’entretint d’Enver et de son Comité, et de la façon dont ils avaient serré les pouces aux Turcs.
Lorsque sir Walter eut parlé ainsi pendant quelques instants, il se mit à m’interroger.
– Vous êtes un garçon intelligent ; vous allez me demander comment un aventurier polonais (je veux parler d’Enver) et une collection de juifs et de romanichels ont pu asservir à ce point une race orgueilleuse. Un observateur superficiel vous affirmera qu’il s’agissait d’une organisation allemande soutenue par de l’argent allemand et des canons allemands. Vous me demanderez ensuite comment l’Islam a joué un si petit rôle dans tout cela, étant donné que la Turquie est avant tout une puissance religieuse. Le Cheik el Islam est très négligé et le Kaiser a beau proclamer la guerre sainte, s’appeler Hadji-Mohammed-Guillaume et déclarer que les Hohenzollern descendent du Prophète, tout cela semble être tombé à plat. L’observateur superficiel vous répondra encore qu’en Turquie, l’Islam tient le deuxième rang et qu’aujourd’hui les nouveaux dieux sont les canons Krupp. Et cependant, je ne sais ! Je ne crois pas tout à fait que l’Islam soit relégué au second plan.
» Considérons la chose d’un autre point de vue, continua-t-il. Si Enver et l’Allemagne étaient bien seuls à entraîner la Turquie dans une guerre européenne dont les Turcs se moquent comme d’une guigne, nous pourrions nous attendre à trouver l’armée régulière et Constantinople obéissants, mais il y aurait des troubles dans les provinces, là où l’Islam est encore très puissant. Nous avons même beaucoup compté sur cela, et nous avons été déçus. L’armée syrienne est aussi fanatique que les hordes du Mahdi. Les Senoussi se sont mis de la partie. Les musulmans perses sont très menaçants. Un vent sec souffle sur tout l’Orient et les herbes desséchées n’attendent que l’étincelle propice pour prendre feu. Et ce vent souffle vers la frontière des Indes... Dites-moi, d’où pensez-vous que vient ce vent ?
Sir Walter avait baissé la voix et parlait très bas, mais très distinctement. J’entendais la pluie qui dégouttait des bords de la fenêtre et, dans le lointain, les trompes des taxis remontant Whitehall.
– Pouvez-vous expliquer cela, Hannay ? me demanda-t-il une deuxième fois.
– On dirait que l’Islam a plus à voir dans tout ceci que nous ne le pensions, dis-je. Je m’imagine que la religion est le seul lien qui puisse unir un empire aussi disséminé.
– Vous avez raison, dit-il. Vous devez avoir raison. Nous nous sommes moqués de la guerre sainte, de la Djihad, prédite par le vieux Von der Goltz, mais je crois que ce stupide vieillard aux grandes lunettes avait raison. Une Djihad se prépare. Mais la question est : comment ?
– Je n’en sais rien, dis-je. Mais je parie qu’elle ne se produira pas par l’intermédiaire d’un tas de gros officiers allemands en pickelhaubes. Il ne me semble pas qu’on puisse fabriquer des guerres saintes simplement avec des canons Krupp, quelques officiers d’état-major et un cuirassé aux chaudières éclatées.
– D’accord. Pourtant, ce ne sont pas des imbéciles, bien que nous essayions de nous en persuader. Supposons donc qu’ils disposent de quelque objet saint, livre ou évangile, ou même quelque nouveau prophète venu du désert, enfin quelque chose qui jetterait sur tout le vilain mécanisme de la guerre allemande comme le mirage de l’ancien raid irrésistible qui fit crouler l’empire byzantin et trembler les murs de Vienne. Le mahométisme est une religion guerrière, et l’on voit encore le mullah debout dans la chaire, le Coran dans une main et l’épée dans l’autre. Admettons qu’ils aient conclu un pacte sacré qui affolera le moindre paysan mahométan avec des rêves du paradis. Qu’arriverait-il dans ce cas, mon ami ?
– Alors, l’enfer se déchaînerait bientôt dans ces parages.
– Un enfer qui risque de s’étendre. Rappelez-vous que l’Inde se trouve au-delà de la Perse.
– Vous vous bornez à des suppositions. Que savez-vous au juste ? demandai-je.
– Très peu de chose, à part un fait. Mais ce fait est indiscutable. Je reçois de partout des rapports de nos agents, colporteurs de la Russie du Sud, marchands de chevaux afghans, négociants musulmans, pèlerins sur la route de La Mecque, cheiks de l’Afrique du Nord, marins caboteurs de la mer Noire, Mongols vêtus de peaux de moutons, fakirs hindous, marchands grecs, aussi bien que de consuls fort respectables qui se servent de codes. Tous me racontent la même histoire : l’Orient attend une révélation qu’on lui a promise. Une étoile, un homme, une prophétie ou une amulette va faire son apparition venant de l’Occident. Les Allemands savent ceci et c’est l’atout avec lequel ils pensent surprendre le monde.
– Et la mission que vous me proposez ?... C’est d’aller m’assurer de cela...
Il hocha la tête gravement.
– Voilà précisément cette folle et impossible mission.
– Dites-moi une chose, sir Walter. Je sais qu’en Angleterre, la mode exige que si un homme possède quelques connaissances spéciales, on lui confie une tâche absolument opposée à ses aptitudes. Je connais bien le Damaraland, mais au lieu d’être nommé à l’état-major de Botha, comme je l’avais demandé, on m’a retenu dans la boue du Hampshire jusqu’à ce que la campagne de l’Afrique occidentale allemande fût terminée. Je connais un homme qui pourrait très bien passer pour un Arabe. Mais croyez-vous qu’on l’a envoyé en Orient ? Non, on l’a laissé dans mon bataillon, ce qui fut très heureux pour moi, car il me sauva la vie à Loos. Je sais bien que c’est la mode, mais n’est-elle pas un peu exagérée ? Il doit y avoir des milliers d’hommes qui ont vécu en Orient et qui parlent le turc ? Ils sont tout désignés pour cette affaire. Quant à moi, en fait de Turc, je n’ai jamais vu qu’un lutteur à Kimberley ! En me choisissant, vous êtes tombé sur l’homme le moins désigné pour entreprendre pareille mission.
– Vous avez été ingénieur des mines, Hannay, répondit sir Walter. Si vous vouliez envoyer un prospecteur d’or au Barotseland, vous demanderiez qu’il connaisse le langage et le pays, mais vous exigeriez avant tout qu’il ait le flair nécessaire pour dénicher l’or et qu’il sache son métier. Eh bien, voici précisément notre position. Je crois que vous possédez le flair qui nous permettra de découvrir ce que nos ennemis essayent de cacher. Je sais que vous êtes brave, doué de sang-froid, et très débrouillard. Voilà pourquoi je vous ai raconté cette histoire. D’ailleurs...
Il déroula une grande carte d’Europe accrochée au mur.
– Je ne puis vous dire où vous tomberez sur la piste du secret, mais je puis mettre une limite à vos recherches. Vous ne découvrirez rien à l’est du Bosphore, du moins, pas encore. Le secret se trouve toujours en Europe. Peut-être à Constantinople ou en Thrace, peut-être plus à l’occident, mais il se dirige vers l’orient. Si vous arrivez à temps, vous arrêterez sans doute sa marche sur Constantinople. Voilà tout ce que je puis vous dire. Le secret est connu également en Allemagne par qui de droit. C’est en Europe que le chercheur doit travailler... pour le moment.
– Dites-moi encore. Vous ne pouvez me donner ni détails ni instructions, et évidemment, vous ne pourrez m’aider si un malheur m’arrive ?
Il hocha la tête.
– Vous seriez hors la loi.
– Vous me donnez toute liberté d’action ?
– Absolument. Vous aurez tout l’argent que vous désirez et vous vous procurerez l’aide qu’il vous plaira. Suivez le plan qui vous sourit et allez où vous croyez nécessaire. Nous ne pouvons vous donner aucune direction.
– Une dernière question. Vous me dites que cette mission est importante. Donnez-moi au moins une idée du degré de cette importance.
– C’est la vie ou la mort, dit-il d’un ton solennel. Je ne puis l’exprimer autrement. Une fois que nous saurons ce qu’est cette menace, nous pourrons y faire face. Tant que nous l’ignorons, cette menace poursuit son travail sans être inquiétée, et nous arriverons peut-être trop tard pour la parer. Il faut évidemment que la guerre soit gagnée ou perdue en Europe. Fort bien. Mais si l’Orient s’enflamme, notre effort sera distrait de l’Europe et le coup peut manquer. Hannay, les enjeux de la mission ne signifient pas moins que la victoire... ou la défaite.
Je me levai de ma chaise et me dirigeai vers la fenêtre. Je vivais un des moments les plus critiques de ma vie. J’étais heureux dans ma carrière militaire et j’appréciais surtout la compagnie des officiers, mes frères d’armes. On me demandait de partir pour des pays ennemis, chargé d’une mission pour laquelle je persistais à me croire tout à fait incompétent, et qui comporterait bien des journées solitaires et une tension fort énervante, pendant qu’un péril mortel m’envelopperait de toutes parts comme un linceul. Je frémissais en regardant la pluie tomber. C’était là une tâche trop farouche, trop inhumaine pour un être de chair et de sang ! Mais sir Walter avait dit qu’il s’agissait d’une affaire de vie ou de mort, et je lui avais déclaré que je cherchais seulement à servir mon pays. Il ne pouvait me donner aucun ordre ; pourtant, n’étais-je pas sous des ordres encore plus élevés que ceux de mon général de brigade ? Je me croyais incompétent, mais certains hommes plus intelligents que moi me jugeaient suffisamment capable pour avoir une chance raisonnable de succès. Je savais en mon for intérieur que si je déclinais cette offre, je le regretterais toute ma vie.
Cependant sir Walter avait qualifié ce projet de « folie » et avait avoué qu’il ne l’aurait pas accepté si on le lui avait proposé.
Comment prend-on une grande décision ?
Je jure qu’au moment où je me retournai pour parler, j’avais l’intention de refuser. Pourtant je répondis : « Oui », et je franchis ainsi le Rubicon. Ma voix sonnait très lointaine et comme fêlée.
Sir Walter me serra la main et cligna des yeux.
– Je vous envoie peut-être à la mort, Hannay. Grand Dieu ! Quel sacré tyran que le devoir ! Si cela arrive, je serai hanté de regrets, mais vous ne vous repentirez jamais, ne craignez pas cela. Vous aurez choisi la route la plus dure, mais elle mène droit aux cimes.
Il me tendit la demi-feuille de papier. Trois mots y étaient inscrits : Kasredin, Cancer et v. I.
– Voilà le seul indice que nous possédions, dit-il. Je vais vous raconter l’histoire, bien que je ne puisse l’expliquer. Depuis des années, nos agents travaillent en Mésopotamie et en Perse. Ce sont pour la plupart de jeunes officiers appartenant à l’armée des Indes. Ils risquent leur vie continuellement. De temps à autre, l’un d’eux disparaît, et les égouts de Bagdad pourraient raconter bien des choses. Néanmoins, ces jeunes officiers font nombre de découvertes intéressantes, et ils estiment que le jeu vaut la chandelle. Ils nous ont tous parlé d’une étoile qui se levait à l’Occident, mais aucun ne put préciser de nom. Aucun sauf un, le meilleur. Il travaillait entre Mosul et la frontière perse en qualité de muletier, et avait pénétré bien au sud parmi les collines des Bakhtyiari. Il découvrit quelque chose, mais ses ennemis l’apprirent ; ils savaient qu’il savait, alors, ils se mirent à sa poursuite. Il y a environ trois mois, un peu avant l’affaire de Kut, il est arrivé en titubant dans le camp de Delamain, percé de dix balles et le front balafré. Il murmura son nom. Mais il ne put rien dire, sauf que Quelque Chose allait se lever à l’Occident. Il mourut quelques instants plus tard. On trouva ce papier sur lui, et avant de mourir, il s’écria : « Kasredin ! » Sans doute ce mot avait-il quelque rapport avec ses recherches. À vous maintenant d’en trouver la signification.
Je pliai la feuille de papier avec soin et la glissai dans mon portefeuille.
– Quel noble garçon ! m’écriai-je. Comment s’appelait-il ?
Sir Walter ne répondit pas immédiatement. Il regardait par la fenêtre. Enfin, il dit :
– Il s’appelait Harry Bullivant. C’était mon fils. Que Dieu bénisse son âme !
2
Le choix des missionnaires
Je rédigeai un télégramme pour Sandy, lui demandant de venir me rejoindre par le train de 2 h 15 et de me retrouver chez moi.
– J’ai choisi mon collègue, dis-je à sir Walter.
– Le fils de Billy Arbuthnot ? Son père était à Harrow en même temps que moi. Je le connais, car Harry l’amenait souvent pêcher chez nous. C’est un grand garçon au visage maigre, avec des yeux bruns de jolie fille. Je connais sa réputation. On a souvent parlé de lui dans ce bureau. Il a traversé le Yémen, ce qu’aucun Blanc n’avait réussi avant lui. Les Arabes l’ont laissé passer, car ils le croyaient fou, et ils déclarèrent que la main d’Allah pesait sur lui assez lourdement sans qu’il fût besoin de lui faire sentir le poids de la leur. Il est le frère de sang de toutes sortes de bandits arabes. Il se mêla aussi de politique turque et y acquit une véritable réputation. Un Anglais déplorait un jour devant le vieux Mahmoud Shevkat la rareté des hommes d’État en Europe occidentale, et Mahmoud lui répondit : « N’avez-vous pas l’Honorable Arbuthnot ? » Vous dites qu’il est de votre bataillon ? Je me demandais ce qu’il était devenu. Nous avons essayé plusieurs fois de nous mettre en rapport avec lui, mais il ne nous a pas laissé d’adresse. Ludovick Arbuthnot... Oui, c’est bien lui. Enterré dans les rangs de la Nouvelle Armée ! Eh bien, nous allons l’en faire sortir, et vite.
– Je savais que Sandy avait voyagé un peu partout en Orient, mais j’ignorais qu’il fût un numéro aussi exceptionnel. Il n’est pas homme à se vanter.
– Non, répondit sir Walter. Il a toujours été doué d’une réserve plus qu’orientale. Eh bien ! j’ai un autre collègue à vous proposer, s’il peut vous plaire.
Il regarda sa montre.
– Un taxi vous mènera au grill-room du Savoy en cinq minutes. Vous entrerez par la porte donnant sur le Strand ; vous tournerez à gauche et vous verrez dans le renfoncement, à votre droite, une table à laquelle sera assis un grand Américain. Il est bien connu au grill-room et il occupera seul la table. Je désire que vous alliez vous asseoir auprès de lui. Dites-lui que vous venez de ma part. Il s’appelle John Scantlebury Blenkiron, citoyen de Boston, mais né et élevé en Indiana. Mettez cette enveloppe dans votre poche, mais n’en lisez le contenu qu’après avoir eu une conversation avec Monsieur Blenkiron. Je veux que vous vous formiez une opinion personnelle sur lui.
Je sortis du Foreign Office l’esprit aussi embrouillé que celui d’un diplomate. Je me sentais atrocement déprimé. Pour commencer, j’avais une frousse intense. Je m’étais toujours cru aussi brave que la bonne moyenne des hommes ; mais il y a courage et courage, et le mien n’était certainement pas du genre impassible. Fourrez-moi dans une tranchée, j’y supporterai tout aussi bien que quiconque de servir de cible et je m’échaufferai vite à l’occasion. Sans doute avais-je trop d’imagination. Je n’arrivais pas à me débarrasser des pressentiments lugubres qui agitaient mon esprit.
Je calculai que je serais mort d’ici une quinzaine de jours, fusillé comme espion : une vilaine fin ! En ce moment, j’étais en sûreté, tandis que je cherchais un taxi au beau milieu de Whitehall, et néanmoins, la sueur perlait sur mon front. J’éprouvais une sensation analogue à celle que j’avais eue lors de mon aventure d’avant-guerre. Mais cette fois, c’était bien pis, car tout était prémédité et il ne me semblait pas que j’eusse la moindre chance. Je regardais les soldats en kaki passer sur les trottoirs et je songeai combien leur avenir était assuré comparé au mien, en admettant même qu’ils fussent la semaine prochaine à la redoute Hohenzollern, ou dans la tranchée de l’Épingle à Cheveux, parmi les Carrières, ou dans ce vilain coin près de Hooge. Je me demandais pourquoi je n’avais pas été plus heureux le matin même avant de recevoir cette maudite dépêche. Tout à coup, toutes les trivialités de la vie anglaise m’apparurent comme infiniment chères et très lointaines. Je fus furieux contre Bullivant jusqu’au moment où je me souvins combien il avait été juste. J’étais seul responsable de mon destin.
Pendant toutes mes recherches au sujet de la Pierre Noire, l’intérêt du problème à résoudre m’avait soutenu. Mais aujourd’hui, quel était ce problème ? Mon esprit ne pourrait travailler qu’à déchiffrer trois mots d’un jargon incompréhensible tracés sur une feuille de papier, et un mystère dont sir Walter était convaincu, mais auquel il ne pouvait donner de nom. Cela ressemblait un peu à la légende de sainte Thérèse partant, à l’âge de 10 ans, accompagnée de son petit frère, pour convertir les Maures ! Je demeurai assis dans un coin du taxi, le menton baissé, regrettant presque de n’avoir pas perdu la jambe à Loos, ce qui m’eût tiré d’affaire pour le restant de la guerre.
Je trouvai mon homme au grill-room. Il mangeait solennellement, une serviette nouée sous le menton. Il était grand et gros, gras de visage, imberbe et blafard.
J’écartai d’un geste le garçon qui s’était précipité à ma rencontre, et je m’assis à la petite table de l’Américain. Il tourna vers moi des yeux dont le regard nonchalant était pareil à celui d’un ruminant.
– Monsieur Blenkiron ? dis-je.
– C’est bien ça, monsieur, répondit-il. Mr John Scantlebury Blenkiron. Je vous souhaiterais volontiers le bonjour, si je voyais quoi que ce soit de bon dans ce sacré climat anglais.
– Je viens de la part de sir Walter Bullivant, continuai-je en parlant très bas.
– Vraiment ! Sir Walter est un de mes bons amis. Je suis heureux de vous rencontrer, monsieur, ou plutôt colonel...
– Hannay, dis-je. Major Hannay.
Je me demandai en quoi ce Yankee endormi pourrait bien m’aider.
– Permettez-moi de vous inviter à déjeuner, major. Garçon, la carte ! Je regrette de ne pouvoir échantillonner les efforts culinaires de cet hôtel. Je souffre de dyspepsie, monsieur, de dyspepsie duodénale. Cela me prend deux heures après les repas et me torture un peu au-dessous du sternum. Je suis donc obligé de suivre un régime. Croiriez-vous, monsieur, que je me nourris de poisson, de lait bouilli et d’un peu de toast très sec ? Cela me change bien mélancoliquement des jours où je faisais justice à un lunch chez Sherry et où je soupais de crabes farcis aux huîtres.
Et il poussa un soupir qui semblait sortir des profondeurs de sa vaste personne.
Je commandai une omelette et une côtelette de mouton. J’examinai de nouveau mon compagnon. Ses grands yeux paraissaient me regarder fixement sans me voir. Ils étaient aussi vides que ceux d’un enfant distrait. Cependant, j’éprouvai l’impression désagréable qu’ils voyaient beaucoup mieux que les miens.
– Vous vous êtes battu, major ? La bataille de Loos ? Ça devait barder ! Nous autres, Américains, nous respectons les qualités militaires du soldat britannique, mais la tactique de vos généraux nous échappe quelque peu. Nous sommes d’avis que vos grands chefs possèdent plus d’ardeur guerrière que de science. C’est exact ? Mon père s’est battu à Chattanooga, mais votre serviteur n’a rien vu de plus excitant qu’une élection présidentielle ! Dites, n’y aurait-il pas moyen d’assister à une scène de vrai carnage ?
Son sérieux me fit rire.
– On compte nombre de vos compatriotes dans la guerre actuelle, dis-je. La Légion étrangère est pleine de jeunes Américains, et aussi notre Army Service Corps. La moitié des chauffeurs militaires qu’on rencontre en France semblent venir d’Amérique.
Il soupira.
– Il y a un an, j’avais bien songé à me lancer dans la tourmente ; j’ai réfléchi que le bon Dieu n’avait pas doué John S. Blenkiron d’une silhouette qui ferait honneur aux champs de bataille. Puis je me suis souvenu que nous autres, Américains, nous étions neutres, des neutres bienveillants ! Il ne me convenait guère de m’immiscer dans les luttes des monarchies épuisées de l’Europe. Alors, je suis resté chez moi. Cela m’a coûté beaucoup, major, car, pendant toute l’affaire des Philippines, j’avais été malade et je n’ai encore jamais vu les passions déréglées de l’humanité déchaînée sur le théâtre de la guerre. Je désirerais vivement voir ce spectacle, car j’aime à étudier l’humanité.
– Alors, qu’avez-vous fait ? lui demandai-je.
Ce personnage flegmatique commençait à m’intéresser.
– Eh bien, j’ai attendu, tout simplement. Le Seigneur m’a gratifié d’une fortune à gaspiller, ce qui fait que je n’ai pas eu à me décarcasser pour contracter des engagements de guerre. Et puis je me disais que je serais certainement mêlé à la partie d’une façon ou d’une autre, et c’est ce qui est arrivé. Étant neutre, j’étais particulièrement bien placé pour faire mon jeu. Pendant quelque temps, ça a marché comme sur des roulettes. Alors, je me suis résolu à quitter le pays pour aller voir un peu ce qui se passait en Europe. Je me suis tenu à l’écart du carnage, mais, comme dit votre poète : « La paix compte des victoires non moins glorieuses que celles remportées par la guerre » ; ce qui veut dire, major, qu’un neutre peut se mêler à la lutte aussi bien qu’un belligérant.
– Voilà bien la meilleure sorte de neutralité dont j’aie jamais entendu parler, déclarai-je.
– C’est la vraie neutralité, dit-il solennellement. Voyons, major, pourquoi vous battez-vous, vous et vos copains ? Pour essayer de sauver vos peaux, votre empire et la paix de l’Europe. Eh bien, voilà des idéaux qui ne nous concernent aucunement. Nous ne sommes pas européens et, jusqu’à présent, il n’y a pas de tranchées boches sur Long Island. Vous avez dressé l’arène en Europe ; si nous venions nous y mêler, ce serait contre les règles, et vous ne nous feriez pas bon accueil ! Vous auriez sans doute raison. Notre délicatesse nous empêche d’intervenir, et voilà ce que voulait dire mon ami, le président Wilson, lorsqu’il a déclaré que l’Amérique était trop fière pour se battre. Donc, nous sommes neutres, mais nous sommes aussi des neutres bienveillants. D’après ce que je vois des événements, un putois en liberté parcourt en ce moment le monde, et son odeur va empuantir la vie jusqu’à ce qu’on ait réussi à l’abattre. Nous n’avons rien fait pour exciter ce putois, mais il nous faut tout de même aider à désinfecter la planète. Vous concevez. Nous ne nous battons pas, mais, Bon Dieu ! certains d’entre nous vont suer sang et eau jusqu’à ce que ce grabuge ait cessé. Officiellement, nous nous contentons de lâcher des notes, comme une chaudière qui fuit lâche la vapeur. Mais en tant qu’individus, nous nous sommes engagés dans la lutte corps et âme. Donc, me conformant à l’esprit de Jefferson Davis et de Wilson, je m’en vais être le plus neutre des neutres et je ferai si bien que le Kaiser regrettera bientôt de n’avoir pas déclaré la guerre à l’Amérique dès le début !
J’avais retrouvé toute ma bonne humeur. Ce personnage valait son pesant d’or et sa verve me redonnait de l’énergie.
– Vous autres, Anglais, vous étiez, je crois, des neutres de la même espèce, lorsque votre amiral prévint la flotte allemande de ne pas entraver les plans de Dewey dans la baie de Manille, en 98, ajouta Monsieur Blenkiron en buvant une dernière goutte de lait, après quoi, il alluma un mince cigare noir.
Je me penchai vers lui.
– Vous avez vu sir Walter ? dis-je.
– Je l’ai vu et il m’a donné à comprendre qu’il avait une affaire en train que vous alliez diriger. Ce grand homme n’exagère rien, et s’il dit que c’est sérieux, vous pouvez me compter de la partie.
– Vous savez qu’il s’agit d’une aventure très dangereuse ?
– C’est ce que j’avais compris. Mais il ne faut pas nous mettre à compter les risques. Je crois en une Providence d’une sagesse suprême et bienfaisante ; mais il faut nous fier à elle et la laisser agir. Qu’est-ce que la vie, après tout ? Pour moi, cela se traduit ainsi : observer un régime sévère et avoir de fréquentes douleurs d’estomac. Pourvu que le jeu en vaille la chandelle, ce n’est pas grand-chose après tout que de renoncer à la vie. D’ailleurs, le risque est-il tellement grave ? À 1 heure du matin, pendant une insomnie, il vous paraîtra haut comme le mont Blanc, mais si vous courez bravement à sa rencontre, il ne vous semblera plus qu’une colline que vous franchirez facilement. Vous jugez le grizzly bien effrayant quand vous prenez votre billet pour les montagnes Rocheuses, mais ce n’est qu’un ours tout comme un autre lorsque vous épaulez votre fusil pour le viser. Je ne songerai aux risques que lorsque j’y serai enfoncé jusqu’aux oreilles... sans savoir comment m’en dépêtrer.
J’écrivis mon adresse sur un morceau de papier que je tendis à ce gros philosophe.
– Venez dîner ce soir chez moi à 8 heures, lui dis-je.
– Avec plaisir. N’ayez pour moi qu’un peu de poisson bouilli et du lait chaud. Vous m’excuserez si je vous emprunte votre chaise longue après dîner, et si je passe la soirée étendu sur le dos, mais c’est ce que me conseille mon nouveau médecin.
Je sautai dans un taxi et me rendis à mon club. En chemin, j’ouvris l’enveloppe que sir Walter m’avait donnée. Elle contenait plusieurs fiches : le dossier de Monsieur Blenkiron. Il avait accompli des merveilles aux États-Unis en faveur des Alliés. Ce fut lui qui révéla le complot de Dumba et qui aida à la saisie du portefeuille du Dr Albert. Les espions de Von Papen avaient même essayé de l’assassiner, après qu’il eut déjoué un attentat contre une des grandes fabriques de munitions.
À la fin du dernier feuillet, sir Walter avait écrit ces mots : « C’est le meilleur de nos agents, meilleur que Scudder. Il sortirait de l’enfer muni d’une boîte de tablettes de bismuth et d’un jeu de patience. »
Je m’installai dans un petit fumoir. Après avoir ravivé le feu et emprunté une carte à la bibliothèque du club, je me mis à songer. Monsieur Blenkiron m’avait ragaillardi. Mon cerveau commençait à travailler et à entrevoir toute l’affaire. Je ne pouvais résoudre le mystère en demeurant à réfléchir assis dans un fauteuil, mais je commençais à bâtir un plan d’action. À mon grand soulagement, Blenkiron, en me faisant honte, m’avait empêché de songer davantage au danger. Je n’aurais pas moins de ressort qu’un dyspeptique sédentaire !
Je retournai à mon appartement à 5 heures. Paddock, mon valet de chambre, était parti à la guerre depuis longtemps, et j’avais emménagé dans une de ces nouvelles constructions de Park Lane où l’on fournit, en même temps que le logement, le service et la nourriture. Je conservais ce pied-à-terre afin d’avoir un lieu où descendre lorsque je revenais en permission ; car ce n’est pas drôle de passer sa perme à l’hôtel !
Je trouvai Sandy qui dévorait des biscuits chauds avec toute la résolution sérieuse d’un convalescent.
– Eh bien, Dick ! Quelles nouvelles ?
– Sachez que vous et moi, nous allons disparaître de l’armée de Sa Majesté. Nous sommes mobilisés pour le service spécial.
– Ô ma mère ! s’écria Sandy. De quoi s’agit-il ? Pour l’amour de Dieu, ne me faites pas languir. Devons-nous piloter des missions de neutres suspects à travers les fabriques de munitions, ou bien nous faut-il conduire en auto le journaliste frissonnant, là où il peut s’imaginer voir un Boche ?
– Les détails peuvent attendre. Je vous dirai toujours ceci : il n’y a pas plus de risques à se lancer à travers les lignes boches armé seulement d’une canne qu’à courir l’aventure que nous allons entreprendre.
– Tiens, ce n’est pas si mal ! dit Sandy.
Et il attaqua joyeusement les muffins.
Il faut que je présente Sandy au lecteur, car on ne peut lui permettre de rentrer dans cette histoire par la petite porte.
Consultez le Peerage et vous trouverez que Edward Cospatrick, quinzième baron Clanroyden, eut, en 1882, un fils cadet, Ludovick-Gustave Arbuthnot, appelé l’Honorable Arbuthnot. Ce fils fit ses études à Eton et au New Collège d’Oxford ; il devint ensuite capitaine dans un régiment du Tweeddale, et servit quelques années comme attaché dans plusieurs ambassades.
Le Peerage ne vous donnera pas d’autres renseignements. Pour connaître la fin de l’histoire, il faut vous adresser à des sources bien différentes. On voit parfois des hommes maigres et bruns, venus des confins de la terre, vêtus d’habits froissés, qui marchent du pas long et léger des montagnards, et se faufilent furtivement dans les clubs comme s’ils ne se rappelaient plus très bien s’ils en font ou non partie. Ils vous donneront des nouvelles de Sandy. On vous parlera encore de lui dans les petits ports de pêche oubliés, là où les montagnes de l’Albanie baignent dans l’Adriatique. Rencontrez-vous un pèlerinage sur le chemin de La Mecque ? Il est fort probable que vous trouverez plusieurs amis de Sandy parmi les pèlerins. Dans les huttes des bergers, au milieu des montagnes du Caucase, vous trouverez des lambeaux de ses vêtements, car il a la manie d’éparpiller ses costumes là où il passe. Il est connu dans les caravansérails de Bokhara et de Samarkand, et certains shikaris, parmi les Pamirs, parlent encore de lui lorsqu’ils s’assemblent autour de leurs feux... Si vous aviez l’intention de visiter Rome, Pétrograd ou Le Caire, il serait bien inutile de lui demander des lettres d’introduction, car s’il vous en donnait, elles vous mèneraient dans des repaires étranges. Mais si le destin vous obligeait à aller à Lhassa, à Yarkand ou à Seistan, il vous tracerait le plan de votre voyage et passerait le mot à des amis tout-puissants.
Nous autres, Anglais, nous nous appelons insulaires, mais en vérité, nous sommes la seule race qui produise des hommes capables de s’identifier aux autres peuples. Les Écossais excellent en cela peut-être plus encore que les Anglais ; mais nous sommes mille fois supérieurs à tous les autres. Sandy personnifiait l’Écossais errant à un degré de perfection frisant le génie. Dans les temps anciens, il eût certainement prêché une croisade ou découvert une nouvelle route menant aux Indes ; de nos jours, il avait erré au gré de sa fantaisie, jusqu’au moment où la guerre l’entraîna dans son tourbillon et le déposa dans mon bataillon.
Je tirai de mon portefeuille le papier que sir Walter m’avait remis. Ce n’était pas l’original du document (qu’il désirait très naturellement conserver), mais une copie très soignée. Je me dis qu’Harry Bullivant n’avait probablement pas pris ces notes pour son usage personnel. Les gens de sa carrière possèdent en général une bonne mémoire. Envisageant la possibilité de sa mort, il avait dû prendre ces précautions afin que ses amis eussent ainsi une indication au cas où son corps serait retrouvé. Je me dis donc que ces notes seraient sans doute intelligibles à quelqu’un de notre langue, mais qu’elles seraient le plus pur galimatias pour le Turc ou l’Allemand qui les liraient.
Je n’arrivai pas à comprendre le premier mot, « Kasredin ». J’en demandai la signification à Sandy.
– Vous voulez dire Nasr-ed-din, déclara-t-il tout en mangeant paisiblement des madeleines.
– Qu’est-ce que c’est ? demandai-je vivement.
– C’est le général qui commande, croit-on, les forces qui luttent contre nous en Mésopotamie. Je me rappelle l’avoir vu il y a très longtemps, à Alep. Il parlait un français exécrable et buvait le plus doux des champagnes.
J’examinai le papier attentivement.
Le K était tracé très clairement. On ne pouvait pas s’y méprendre.
– Kasredin ne signifie rien. En arabe, cela veut dire la maison de la foi, et cela peut s’appliquer à tout ce qu’on veut depuis Hagia Sofia jusqu’à une villa suburbaine. Voyons l’énigme suivante, Dick. Prenez-vous part à un concours de journaux ?
– C’est Cancer, dis-je.
– En latin, cela signifie crabe. C’est également le nom d’une pénible maladie, et c’est aussi un des signes du zodiaque.
– v. I., dis-je enfin.
– Ah ! là, vous m’arrêtez. On dirait le chiffre d’une auto. La police découvrirait cela pour vous. Il me semble qu’il s’agit d’un concours assez difficile ? Quel est le prix d’honneur ?
Je lui tendis le papier.
– Qui a écrit cela ? demanda-t-il. On dirait quelqu’un de bien pressé.
– C’est Harry Bullivant, dis-je.
Le visage de Sandy s’allongea.
– Ce vieil Harry ! Nous avions le même précepteur. C’était le meilleur garçon du monde. Oui, j’ai vu son nom dans la liste de nos pertes devant Kut... Harry ne faisait pas les choses sans raison. Quelle est l’histoire de ce papier ?
– Donnez-moi quelques heures, lui répondis-je. Je vais prendre un bain et me changer. J’attends un Américain pour dîner ; je vous dirai tout après. Il fait partie de la combinaison.
Mr Blenkiron arriva, ponctuel, vêtu d’un manteau de fourrure digne d’un grand-duc. Maintenant que je le voyais debout, je le jugeais plus facilement. Bien que son visage fût gras, il n’avait pas trop d’embonpoint et on devinait des poignets vigoureux sous ses manchettes. Je m’imaginais qu’il saurait se servir de ses mains si l’occasion s’en présentait.
Sandy et moi fîmes un repas solide, mais l’Américain s’amusa avec son poisson bouilli et but son lait goutte à goutte.
Lorsque le garçon eut débarrassé la table, Blenkiron tint parole et s’étendit sur le sofa. Je lui offris un bon cigare, mais il préféra fumer un des siens. Sandy s’installa à l’aise dans un fauteuil et alluma sa pipe.
– Et maintenant, Dick, nous attendons votre histoire, me dit-il.
Je commençai donc, à l’exemple de sir Walter, à leur parler du mystère de l’Orient. Je leur fis un exposé assez réussi, car j’y avais réfléchi longuement et le mystère de cette affaire m’attirait. Sandy fut vivement intéressé.
– Tout cela est fort possible. Je m’y attendais même, bien que je ne puisse imaginer quel atout les Allemands détiennent. Cela peut être vingt choses différentes. Il y a une trentaine d’années, une fausse prophétie a causé un beau gâchis dans le Yémen. Il s’agit peut-être d’un drapeau comme celui que possédait Ali-Wad-Helt ou d’un joyau comme le collier de Salomon en Abyssinie ? On ne sait jamais ce qui détermine une Djihad ! Mais je crois qu’il s’agit plutôt d’un homme.
– Mais d’où vient sa puissance ?
– C’est difficile à dire. S’il ne s’agissait que de tribus sauvages comme les Bédouins, cet homme aurait pu acquérir la réputation d’un saint et d’un faiseur de miracles. Mais n’est-ce pas plutôt quelque individu prêchant une religion pure, comme celui qui a fondé la secte des Senoussi ? Cependant, je serais porté à croire qu’il s’agit d’une personnalité douée d’une influence particulière, s’il peut jeter un sort sur le monde musulman tout entier. Le Turc et le Persan ne suivraient pas le nouveau truc théologique ordinaire. Il doit être du Sang. Les Mahdis, Mullahs et Imans étaient des rien du tout, car ils n’avaient qu’un prestige local. Pour captiver tout l’Islam (et c’est ce que nous craignons, n’est-ce pas ?), l’homme doit appartenir au Koreish, à la tribu même du Prophète.
– Mais comment un imposteur prouverait-il cela ?... Car je présume qu’il s’agit d’un imposteur.
– Il lui faudrait combiner pas mal de titres. D’abord, il faut que sa descendance soit à peu près établie, et rappelez-vous que certaines familles se réclament du sang des Koreishites. Ensuite, il lui faudrait être une personnalité assez remarquable, très saint, très éloquent, etc. Et sans doute devrait-il montrer un signe, mais je n’ai pas la moindre idée de ce que ce signe pourrait être.
– Mais vous qui connaissez l’Orient mieux que personne, croyez-vous pareille chose possible ? dis-je.
– Parfaitement, dit Sandy, avec un visage très grave.
– Eh bien ! voilà du moins le terrain préparé. Il y a ensuite les témoignages de presque tous ces agents secrets. Tout cela semble prouver le fait. Mais nous n’avons pas d’autres données, ni d’autres détails que ceux fournis par cette feuille de papier.
Sandy l’examina, les sourcils froncés.
– Cela me dépasse, mais c’est peut-être la clef du mystère, malgré tout. À Londres, tel indice peut être muet, et devenir lumineux à Bagdad.
– Voilà précisément où je voulais en venir. Sir Walter déclare que cette affaire est aussi importante pour la réussite de notre cause que le développement de notre artillerie lourde. Il ne peut me donner aucun ordre, mais il m’offre d’aller découvrir quel est le mal. Seulement, il faut agir au plus vite, car à tout moment la mine peut sauter. J’ai accepté. Voulez-vous m’aider ?
Sandy considérait attentivement le plafond.
– J’ajouterai que cette tâche présente à peu près autant de sûreté que si nous avions joué à pile ou face au carrefour de Loos, le jour où nous étions de la partie. Et en cas d’insuccès, personne ne pourra nous aider.
– Oh ! naturellement, répondit Sandy d’une voix distraite.
Ayant terminé sa sieste de digestion, Monsieur Blenkiron s’était assis et avait attiré un petit guéridon près de lui. Prenant un jeu de cartes dans sa poche, il se mit à faire une réussite. Il paraissait ne prendre aucun intérêt à notre conversation.
J’eus tout à coup l’impression que je m’embarquais dans une entreprise absolument folle. Nous voilà, tous trois réunis dans un appartement de Londres, projetant de nous rendre dans la citadelle de l’ennemi sans avoir une idée très nette de ce que nous devions y faire, ni de la manière dont nous procéderions. L’un des trois considérait le plafond, en sifflant doucement à travers ses dents, l’autre faisait une réussite ! Je fus si frappé par le comique de la situation que j’éclatai de rire.
Sandy me jeta vivement un regard.
– Vous avez ce sentiment ?... Moi aussi, c’est idiot – mais toute guerre est idiote – et c’est l’idiot le plus convaincu qui gagne. Il faut nous lancer sur cette folle piste là où nous pensons pouvoir la découvrir... Eh bien ! je suis des vôtres. Mais je veux bien vous avouer avoir une sale frousse. Je m’étais ajusté à la vie des tranchées et j’y étais très heureux. Et maintenant que vous m’en arrachez, je suis glacé !
– Je croyais que vous ignoriez la peur, dis-je.
– Vous vous trompez, Dick, répondit-il sérieusement. Tout homme qui n’est pas un maniaque connaît la peur. J’ai couru nombre de folles aventures, mais je ne les ai jamais entreprises sans souhaiter qu’elles fussent terminées. Une fois embarqué, je me sens plus à l’aise, et au moment de m’en tirer, je regrette que ce soit fini... mais au début, j’ai toujours les pieds gelés !
– Alors, si je comprends bien, vous me suivez ?
– Je vous crois, dit-il. Voyons, vous ne supposiez pas que j’allais vous lâcher ?
– Et vous, monsieur ? dis-je à Blenkiron dont la réussite touchait à sa fin.
Il complétait huit petits tas de cartes avec un grognement satisfait. En m’entendant, il leva ses yeux lourds vers moi et hocha la tête.
– Mais certainement, dit-il. J’espère que vous n’avez pas cru que je n’ai pas suivi votre intéressante conversation. Je n’en ai pas perdu un mot. À mon avis, les réussites stimulent la digestion après les repas, et aident à réfléchir tranquillement. John S. Blenkiron est des vôtres, soyez-en sûrs.
Il battit les cartes et les aligna ensuite de nouveau.
Je ne m’attendais pas à un refus de sa part. Toutefois, son assentiment spontané me rasséréna considérablement. Je n’aurais pas pu tenter l’aventure seul.
– Voilà qui est décidé. Maintenant, voyons les moyens et le chemin à suivre. Nous devons nous mettre en mesure de découvrir le secret de l’Allemagne... et aller là où le secret est connu. Il nous faut donc atteindre Constantinople – d’une façon quelconque – et, afin de battre la plus grande étendue de territoire possible, il faut y aller par trois routes différentes. Vous, Sandy, vous allez pénétrer en Turquie. Vous êtes le seul d’entre nous qui connaisse ce charmant peuple. Vous ne pourrez pas y pénétrer facilement par l’Europe ; il vous faut donc y aller par l’Asie. Que diriez-vous d’essayer la côte d’Asie Mineure ?
– Ça peut se faire, répondit-il. Mais laissez-moi décider tout cela. Je verrai le meilleur moyen. Je présume que le Foreign Office m’aidera à parvenir à mon point de départ ?
– Rappelez-vous qu’il est inutile de pénétrer trop avant en Orient, lui dis-je, car en ce qui nous concerne, le secret se trouve encore à l’ouest de Constantinople.
– C’est ce que je vois. Je remonterai le Bosphore par le chemin le plus court.
– Quant à vous, monsieur Blenkiron, dis-je me tournant vers lui, je vous conseillerai de suivre la route directe. Vous êtes américain, vous pouvez donc voyager directement via l’Allemagne. Mais je me demande pourtant jusqu’à quel point vos agissements à New York vous permettront de passer pour neutre ?
– J’ai réfléchi à cela, dit-il ; j’ai du reste accordé quelque réflexion à la psychologie particulière de la grande nation allemande. D’après mes déductions, les Boches sont malins comme des chats, et si vous essayez de ruser avec eux, ils vous rouleront à chaque coup. Oui, monsieur, ce sont des limiers de premier ordre. J’aurai beau acheter une paire de faux favoris, teindre mes cheveux, m’habiller comme un pasteur baptiste, et aller en Allemagne pour faire une propagande pacifiste, ils me dépisteront en deux temps et trois mouvements. Et je serai ou fusillé avant une semaine, ou au secret dans la prison Moabite. Mais les Allemands n’ont pas la vue large. On peut les bluffer. Donc, avec votre approbation, je visiterai le Vaterland tout bonnement comme John S. Blenkiron, dont le départ d’Amérique enleva jadis une épine du pied de leurs plus brillants partisans de là-bas. Mais ce sera un John S. Blenkiron très différent. Je crois qu’il aura éprouvé un revirement de sentiments. Il en sera venu à apprécier la grande âme pure et noble de l’Allemagne... et il regrettera amèrement son passé. Il sera, lui aussi, victime de la bassesse et de la perfidie du gouvernement britannique. Je m’en vais avoir une sale histoire avec votre Foreign Office au sujet de mon passeport, et je dirai volontiers, ouvertement, dans tout Londres, ce que je pense de cette institution. Je m’en vais être filé par vos limiers jusqu’à mon port d’embarcation, et sans doute me disputerai-je quelque peu avec les légations britanniques en Scandinavie. À ce moment, nos amis boches seront en train de se demander ce qui est arrivé à John S... et ils se diront qu’ils se sont peut-être trompés sur son compte.
» J’espère donc que lorsque je parviendrai en Allemagne, ils m’attendront les bras ouverts. Je leur confierai certains renseignements importants sur les préparatifs anglais et je dépeindrai le lion britannique comme étant le plus vil bâtard. Fiez-vous à moi. Je produirai une impression excellente. Après quoi, je me dirigerai vers l’Orient afin d’assister au dépouillement de la Grande-Bretagne dans cette partie du globe. À propos, où nous retrouverons-nous ?
– Nous sommes aujourd’hui le 17 novembre. Si d’ici deux mois nous n’arrivons pas à découvrir ce que nous cherchons, autant renoncer à l’affaire. Il faut nous réunir à Constantinople le 17 janvier. Le premier arrivé attendra les autres. Si à cette date nous ne sommes pas présents tous trois, les autres considéreront que le manquant se trouve empêché et renonceront à l’attendre. À propos, si jamais nous y parvenons, comme nous viendrons chacun de différents côtés et sous des aspects divers, il nous faut un lieu de réunion où s’assemblent d’ordinaire les gens les plus hétéroclites. Sandy, vous connaissez bien Constantinople. À vous de fixer notre rendez-vous.
– J’y ai déjà pensé, dit-il.
Il se leva, et allant vers mon bureau, il prit une feuille de papier et se mit à y tracer un petit plan.
– Voyez-vous cette allée ? Elle conduit du bazar kurde de Galata au bac de Ratchik. À mi-chemin, sur la gauche, se trouve un café tenu par un Grec nommé Kuprasso. Derrière le café, il y a un jardin entouré de murs très hauts qui appartenaient autrefois au vieux théâtre byzantin. Au bout du jardin s’élève un édifice appelé le Pavillon de Soliman le Rouge. Cela a été un lieu de danse, un tripot... et Dieu sait quoi ! Ce n’est certainement pas un endroit pour des gens respectables, mais les extrémités du monde semblent y converger et l’on n’y demande rien à personne. C’est le meilleur rendez-vous auquel je puisse songer.
La bouilloire chantait sur le feu. Il faisait une nuit claire et froide, et l’heure était propice au punch.
– Et quant au langage, dis-je, vous n’aurez pas de difficulté, Sandy ?
– Je connais l’allemand assez bien et parle couramment le turc. J’écouterai le premier, et parlerai le second.
– Et vous ? dis-je à Blenkiron.