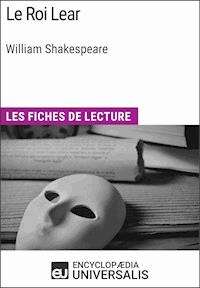
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Französisch
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalis
Publié pour la première fois en 1608,
Le Roi Lear, dont Victor Hugo admirait la « construction inouïe », est l’une des grandes tragédies de la maturité de William Shakespeare (1564-1616), l’une des plus intensément émouvantes aussi.
Une fiche de lecture spécialement conçue pour le numérique, pour tout savoir sur Le Roi Lear de William Shakespeare
Chaque fiche de lecture présente une œuvre clé de la littérature ou de la pensée. Cette présentation est couplée avec un article de synthèse sur l’auteur de l’œuvre.
A propos de l’Encyclopaedia Universalis :
Reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité incomparable de ses publications, Encyclopaedia Universalis met la connaissance à la portée de tous. Écrite par plus de 7 400 auteurs spécialistes et riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins…), l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable collection de référence disponible en français. Elle aborde tous les domaines du savoir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 51
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782852295858
© Encyclopædia Universalis France, 2019. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Nito/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Encyclopædia Universalis.
Ce volume présente des notices sur des œuvres clés de la littérature ou de la pensée autour d’un thème, ici Le Roi Lear, William Shakespeare (Les Fiches de lecture d'Universalis).
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
LE ROI LEAR, William Shakespeare (Fiche de lecture)
Publié pour la première fois en 1608, Le Roi Lear, dont Victor Hugo admirait la « construction inouïe », est l’une des grandes tragédies de la maturité de William Shakespeare (1564-1616), l’une des plus intensément émouvantes aussi. Inspirée entre autres du chroniqueur médiéval Holinshed, mais aussi d’une pièce anonyme jouée en 1590 (The True Chronicle History of King Leir), elle plonge dans les racines historiques de l’Angleterre préchrétienne pour en tirer une tragédie de dimension mythique.
• En chemin vers l’amer savoir
L’œuvre obéit à une structure d’une épure remarquable, mêlant habilement deux intrigues qui se complètent l’une l’autre. Le roi Lear, dès l’ouverture de la pièce, décide de se retirer et de partager son royaume entre ses trois filles : l’équité devra être parfaite, pour prévenir les possibles interférences passionnelles et assurer au royaume une succession pacifique. Mais le don de ce père, qui choisit d’anticiper l’heure de sa fin, n’est pas aussi désintéressé qu’il en a l’air : l’héritage se voit conditionné par l’expression à son égard d’une parole d’amour publique, à laquelle se prêtent avec trop de complaisance les deux filles aînées, Goneril et Régane. Quant à la jeune Cordélia, la préférée, elle refuse de recourir à la flatterie, qui confondrait les valeurs de l’être et de l’avoir : opposant le silence, le « rien », au désir de ce père trop aimant, elle provoque sa fureur ; en découlent son bannissement, ainsi que celui de Kent, serviteur fidèle qui a dénoncé l’aveuglement du roi. La pièce va mettre en lumière les conséquences de cette faute primordiale en montrant la justesse de la prophétie faite par Cordélia avant son départ pour la France : « Le Temps déploie les plis cachant la fourberie,/ Des forfaits qu’il voilait, la honte un jour se rit. » (acte I, scène 1) Dans l’intrigue secondaire, le noble Gloucester, véritable double de Lear, se méprend lui aussi sur la vraie nature de son fils illégitime Edmond, son préféré, qui médite la perte de son frère légitime Edgar, dont il finit par obtenir le bannissement. Toute la subtilité de la structure de la pièce réside dans l’entrecroisement entre l’intrigue principale, commentée par Edgar qui, déguisé en fou, est le témoin des errements du roi, et l’intrigue secondaire, à laquelle il participe, en conduisant son père rendu aveugle vers l’acceptation patiente de son sort.
Au cours des quatre actes suivants, le roi Lear, comme Gloucester, passe de l’égarement initial à la connaissance, après une suite d’épreuves : bafoué dans son autorité et son indépendance financière par ses filles, il découvre leur vraie nature et fuit dans la nuit, suivi de son fou et de Kent, revenu sous un déguisement pour le servir, à travers la lande battue par les vents. Là, dans une manière de « pastorale noire » qui oscille entre sublime et grotesque, il fait l’expérience de l’extrême dénuement. Soumis à l’épreuve des éléments déchaînés, il apprend trop tard de quel mensonge sont entourés les rois. Surtout, endossant tour à tour, au cours de ce voyage initiatique dans l’espace symbolique de la lande, les habits du roi, du mendiant, du bouffon pour enfin perdre la raison, il éprouve la misère humaine, celle de l’humaine condition, mais aussi celle des êtres dont il soupçonnait à peine l’existence, à l’image de ce « Pauvre Tom » – en fait Edgar déguisé –, réfugié dans une hutte, qui partage avec lui son abri. La mise en question de tout savoir et pouvoir sur le monde fait du roi autrefois tyrannique l’incarnation de la leçon ultime des grandes figures de satiristes du temps : face au monde, ce « grand théâtre de fous » (IV, 5), tout est vanité, et l’insignifiance règne. Seul résonne alors, dans le vide, le rire de Lear confronté à son double Gloucester, dont les orbites vides et martyrisées évoquent au roi un Cupidon grotesque et monstrueux, tout en renvoyant, en référence à Œdipe, à l’aveuglement des deux pères et à leur parcours vers la vérité : « Un homme peut voir comment va le monde sans ses yeux » (IV, 5).





























