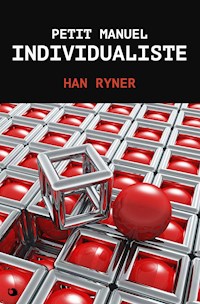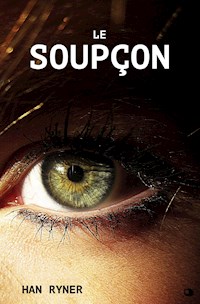
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alicia Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
♦ Cet ebook bénéficie d’une mise en page esthétique optimisée pour la lecture numérique. ♦
«
— Ne voyez-vous pas que nous sommes d' admirables machines à souffrance ! Une vie, c'est un long frémissement douloureux. Et ce n'est pas le monde extérieur qui nous fait souffrir ; nous nous faisons souffrir nous-mêmes. »
Han Ryner avec son style franc et efficace nous plonge dans l’histoire tragique de Stanislas, un homme en proie au pire des vices : le Soupçon. Essayant de lutter contre ses peurs et ses ruminations mentales, Stanislas nous raconte avec exactitude ses déboires amoureux, son funeste destin et son crime dans ce journal intime, journal qu’il nous livre tel un espoir de rédemption. Ce roman psychologique se révèle d’une grande force.
EXTRAIT : «
Les pages que je vais écrire ne ressemblent à rien d'écrit. Ce sont des confessions, d'une sincérité introuvable ailleurs. Jean-Jacques Rousseau a fait son apologie : le besoin de s'admirer en ses vertus et en ses vices, le besoin de reprocher les uns et les autres à la Société ont faussé tout ce qu'il dit de sa vie intérieure. Saint Augustin a retourné son orgueil de jeunesse en humilité. Il a fait par écrit la confession publique des premiers chrétiens : on ne raconte pas avec une exactitude qui me satisfasse des actes qu'on réprouve ; on ne se fait pas connaître en se reniant. Il faut s'exprimer soi-même sans repentir et sans complaisance, sans étonnement tardif, se revivre naïvement, laisser se teindre chaque récit des sentiments éprouvés à l'heure de l'acte.
Cette candeur n'est pas possible quand les aveux sont destinés à être lus par d'autres. Moi qui écris ceci pour le brûler aussitôt terminé, je ne m'en ferai pas accroire à moi-même. Mais pourquoi est-ce que j'entreprends cette œuvre vaine ? »
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Le Soupçon
Han Ryner
Alicia Editions
Table des matières
Avis de l’éditeur
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
Chapitre 14
Chapitre 15
Chapitre 16
A PAUL REDONNEL
Parce qu'il est le hautain et mâle poète des Chansons éternelles ;
Parce qu'il est le plus sûr des amis ;
Parce qu'il aime toutes les franchises et déteste toutes les hypocrisies ;
Je dédie ce livre que j'ai voulu sans recherche ni timidité, insoucieux des triviales convenances, tragique et fangeux comme la vie, brutal et simple comme une étude médicale.
H. Ryner
Avis de l’éditeur
Depuis quelques mois que j'habitais la petite villede L., je voyais sortir de ma maison toutes les après-midi, un vieillard très grand, mais déplorablement cassé qui, appuyé sur sa canne, se traînait, lent et douloureux, jusqu'à la promenade. Il partait toujours à deux heures, revenait toujours à quatre heures. On racontait sur lui des histoires dont la diversité prouvait qu'on ne savait rien. Les uns lui donnaient jusqu'à cent ans et le faisaient assister aux guerres de l'Empire : ce héros n'avait jamais été décoré, pour avoir montré sous tous les gouvernements, en des circonstances multiples et difficiles, une indépendance presque agressive. Pour d'autres, il était surtout vieilli de remords et de crimes : il n'avait guère que soixante ans, mais certaines de ses journées l'avaient chargé de tels forfaits que leur poids, à la longue, l'avait courbé, tout brisé.
Mon voisin vivait seul en très petit rentier. Personne n'entrait dans son appartement, pas même une femme de ménage ; pas même une blanchisseuse. Il se tenait très propre et se blanchissait lui-même. Il prenait ses repas chez lui, faisait lui-même sa cuisine sommaire. Il vivait de lait, de fruits, de quelques œufs, de très rares côtelettes.
Il se levait à cinq heures et, jusqu'à midi, s'occupait de son ménage de garçon. En mouvements lents, pénibles et qui paraissaient pourtant inconscients, il faisait son lit, balayait son appartement. Souvent il s'arrêtait, s'appuyait à un meuble ou s'asseyait sur une chaise et longuement rêvait. Tout à coup sa main passait sur son front dans le geste qui chasse les pensées, son bras avait un sursaut vaillant et son corps se levait, mécanique cassée que le ressort de la volonté redresse par petites secousses brusques.
Après déjeuner, sous le soleil ou sous la pluie, comme s'il ignorait le monde extérieur, il sortait. Aucune tempête ne l'eût arrêté, ne l'eût fait se lever de son banc ordinaire avant le quatrième coup de quatre heures. Alors,régulièrement, il revenait, s'enfermait dans sa bibliothèque et jusqu'à minuit lisait ou écrivait, interrompu quelquefois par de longues méditations qui s'emparaient de lui irrésistibles. Il se mettait à table une seule fois par jour, à midi, mais il avait toujours du lait auprès de lui et en buvait souvent, parfois sans le savoir, d'un geste machinal comme l'habitude, dans une sorte de somnambulisme.
Les légendes qui couraient sur lui, son isolement farouche, ce que je voyais et ce que je devinais de ses habitudes régulières, de l'automatisme de ses mouvements, de son âme tout entière envahie par quelque idée fixe : tout ce mystère m'attirait, me faisait désirer très vivement de connaître mon voisin. Mais comment apprendre la vie de ce muet ? Déjà d'autres curieux lui avaient fait des avances : d'un geste dédaigneux et d'un sourire railleur, il les avait écartés de sa route. Quel moyen d'entrer dans cette âme murée comme une tombe et où dormait quelque souvenir horrible et intrigant ?
Un jour, à deux heures, j'étais assis, curieux et inquiet, sur le banc où le vieillard venait s'asseoir tous les jours. Avec ma canne, je faisais dans le sable des ronds et des triangles. J'avais l'air aussi indifférent au monde extérieur qu'Archimède pendant la prise de Syracuse. Mais je regardais le mystère ambulant approcher de son pauvre tremblement lourd. Je craignais de le voir dépasser le premier banc, aller jusqu'au second ; je craignais que mon indiscrétion servît seulement à imposer à ce misérable chancelant un irritant surcroît de fatigue.
Mais non, le sauvage s'assit auprès de moi. Le muet me salua d'un : « Bonjour, Monsieur » plutôt aimable. Je l'interrogeai sur sa santé. Il me répondit : il se portait aussi bien qu'il pouvait encore le désirer. Puis, bienveillamment, il me demanda quels étaient mes projets d'avenir, — ou plutôt mes rêves, corrigea-t-il avec un sourire triste et désabusé. Je lui répondis, dans une gêne, à cause de ce sourire attristant et décourageant.
A quatre heures, quand le vieillard se leva, je lui offris mon bras, qu'il accepta.
Dès lors, tous les jours de beau temps, j'allai causer avec le vieillard, qui me resta pourtant énigmatique.
Au bout de deux mois, il m'invita à le visiter dans sa bibliothèque, qu'il mit aimablement à ma disposition. J'y passai de longues heures, lisant en face de lui, de l'autre côté d'une grande table noire.
Souvent, quand je prenais un livre, il me disait son opinion sur l'œuvre et sur l'auteur. Quelques mots seulement, mais très caractéristiques. Il s'irritait de ce que le livre ne ressemblait pas assez à celui qui l'écrivit, de ce qu'il n'était pas un simple miroir plan et bien net, reflétant une âme. Il n'aimait guère que Montaigne, et encore il lui reprochait d'avoir souvent menti et de n'avoir pas dit tout. D'ailleurs, si celui-là avait presque osé conter sa vie, c'est que, indifférent, simple curieux sans personnalité active, en réalité il n'avait point vécu. C'était un sage trop parfait et tranquille pour être un homme bien intéressant.
— Tous les livres sont des menteurs, s'écriait le vieuxStanislas. Tous voient la vie en beau ou en caricature, cachent les choses tristes ou les rendent ridicules.
J'objectais timidement :
— Pourtant il y a une littérature pessimiste. Et le vieillard s'irritait :
— Ne voyez-vous pas que se dire pessimiste c'est déclarer qu'on ne regarde qu'un côté des choses, c'est s'imaginer qu'il y en a un autre ! Se dire pessimiste, affirmer le mal universel, c'est croire à la possibilité du bien. Se dire pessimiste, c'est être optimiste.
Il ajoutait, tout tremblant d'une colère étrange :
— Ah ! les pessimistes ! Ils se lamentent parce que la femme est infidèle, parce que la vie est une course d'obstacles. Les heureux imbéciles ! Ils voient le mal en dehors d'eux-mêmes. Et ils se croient des êtres supérieurs, ils se croient bons. Comprenez-vous cela, Monsieur, des pessimistes orgueilleux ? Et ils le sont tous. Ils sont fiers de leur pessimisme qui n'est que l'affirmation de l'infériorité et de l'injustice de tout ce qui les entoure.
Et il concluait :
— Ne parlons plus de ces égoïstes idiots. Quelquefois je lui demandais :
— De quoi donc convient-il d'être triste ? Des exclamations me répondaient :
— Ne voyez-vous pas que nous sommes d' admirables machines à souffrance ! Une vie, c'est un long frémissement douloureux. Et ce n'est pas le monde extérieur qui nous fait souffrir ; nous nous faisons souffrir nous-mêmes.
— Il y a bien pourtant des douleurs qui viennent du dehors.
— Demandez à Épicure et à Montaigne si le monde extérieur pouvait les blesser. Ah ! Monsieur, nous sommes presque tous des malheurs intérieurs. Est-ce le dehors qui me tuera. Non, n'est-ce pas ? Puisque je suis né, je dois mourir : le monde extérieur me donnera peut-être un prétexte de mort, une raison de finir à tel moment plutôt qu'à tel autre : voilà tout. Mais c'est moi qui me tue à chaque instant par cela seul que je vis. Il en est de la souffrance comme de la mort. Êtres et choses nous donnent parfois des prétextes de douleur comme des prétextes de mort. Mais c'est ma vie même qui est un principe de mort et de souffrance.
Cette étrange philosophie m'angoissait parce que je la sentais l'expression de toute une vie mystérieuse et douloureuse. Ma jeune vaillance me l'affirmait : le vieillard avait tort d'universaliser son cas. Mais ce qu'il affirmait de tous était vrai sûrement de lui.
Un jour, j'osai l'interroger :
— Le livre sincère que vous ne trouvez nulle part, vous devez l'avoir écrit.
Il sourit, me répondit évasivement :
— Je n'ai rien publié.
J'eus l'audace de pousser plus loin ma reconnaissance :
— Vous avez sûrement en manuscrit cette œuvre profonde et vraie.
Toujours souriant, il repoussa la tentative indiscrète :
— Je n'ai rien écrit qui puisse intéresser les autres, déclara-t-il d'un ton ironique et sec.
Dès lors j'étais certain qu'il composait ses mémoires.
Mais, jusqu'au jour de sa mort, je connus l'appartement et les extériorités de la vie actuelle du vieillard, je connus son esprit puissant et âpre, son âme violemment triste; j'ignorai le passé, tragique sans doute, que son âme avait créé, d'après sa théorie, qui, me semblait-il plutôt, avait dû déterminer la tristesse farouche de son âme.
Un voyage m'éloigna quelque temps de ce problème. Plusieurs fois, pendant cette absence, je pensai au vieillard ; mais celui qui de près m'intéressait comme une énigme tragique, me parut de loin une grotesque et indifférente charade.
Je rentrais chez moi à la tombée de la nuit. Fatigué par dix heures de chemin de fer, j'allais me coucher, lorsqu'on vint m'appeler de la part de M. Stanislas : il était à l'agonie et désirait me voir avant de mourir. Ému par le voisinage de la mort, j'accourus. Le malade, très maigre, eut, à mon arrivée, un sourire des yeux plus que des lèvres et demanda qu'on nous laissât tous les deux seuls. D'une voix râlante et sifflante, me dit que j'étais son exécuteur testamentaire.
Les creux et les bosses que son corps desséché et tordu dessinaient sur le drap s'agitèrent en d'horribles efforts. Sous son chevet, le vieillard prit une clef, la souleva péniblement entre deux doigts ; et il essaya de parler, n'y parvint point.
Son visage exprima une grande anxiété. Devinerais-je ce qu'il ne pouvait dire ? Je pris la clef ; son regard eut une lueur contente et se dirigea, suppliant, vers le secrétaire.
J'ouvris le meuble. Dans les yeux du mourant, de nouveau fleurit une fleur de joie.
Il fit un nouvel effort pour se soulever, pour parler. Son râle ne put s'articuler, son corps refusa tout mouvement et les muscles de son visage se détendirent en un découragement.
Le secrétaire était encombré d'un amas de papiers dont l'ordre secret ne m'apparaissait pas, fouillis inextricable pour tout étranger.
J'aperçus enfoui sous ce monceau le dos verdâtre d'un énorme registre. Je le tirai de son enfouissement. Les yeux inquiets sourirent encore.
Sur le registre étaient écrites ces lettres :
Λε Σουπσον
Le gros cahier à la main, j'approchai du vieillard qui, visiblement, s'irritait en efforts inutiles pour me parler. Je mis l'oreille contre les lèvres sèches et brûlantes. Deux souffles vagues me parurent être ces deux syllabes étranges : « brû-blier ».
Et le vieillard se tut pour toujours.
Les deux syllabes, mal entendues peut- être, me tourmentèrent longtemps. Je finis par les traduire comme la première du mot « brûler » et la dernière du mot « publier ». Je crus que le vieillard, à une seconde d'intervalle, m'avait donné deux ordres contradictoires ; que l'agonisant avait eu presque simultanément les deux volontés qui luttaient en lui vivant.
Le testament ne faisait aucune mention du manuscrit.
En publiant ce livre, j'exécute peut-être la dernière volonté d'un mourant. Si je me trompe, quelqu'un osera-t-il me blâmer ?
Avant de quitter le lecteur, je dois l'informer que je ne me suis permis aucun changement au texte du vieux Stanislas. On trouvera ici, comme dans tout journal intime, quelques phrases négligées. Le Soupçon est une étude horriblement et naïvement sincère ; on dirait des notes d'un médecin prises pour lui seul sur sa propre maladie. Il y a des mots écrits en entier dont généralement nous n'imprimons, pudibonds, que la première lettre, suivie de points que les hésitants pourront compter. Il y a des termes qui seraient hardis s'ils n'étaient aussi tranquillement écrits : un auteur s'adressant au public les eût amortis en périphrases ou eût remplacé la matérialité grossière des mots propres par l'ombre légère des métaphores. Je ne prends pas la responsabilité de ces inconvenances.
M. Stanislas ne doit peut-être pas la porter non plus. S'il s'était décidé plus tôt à publier ce manuscrit, il aurait sans doute fait aux pudeurs extérieures du lecteur les concessions ordinaires.
Mais le travail qu'il n'a pas eu le temps de commencer, je n' avais pas le droit de l'essayer.
Ma part de collaboration à ce livre est faible et toute matérielle, analogue à celle du compositeur : je me suis borné à traduire en lettres latines les caractères grecs qui protégeaient ces mémoires contre les indiscrétions prématurées de quelque ignorant.
Chapitre 1
Cause et nature de ces confessions. — Ma naissance, mon enfance. — Mon premier caractère. — Mort de ma mère. — Rencontre de Gabrielle. — Émotion amoureuse. — Ma déclaration. — Mutuelles promesses d'amour éternel.
Les pages que je vais écrire ne ressemblent à rien d'écrit. Ce sont des confessions, d'une sincérité introuvable ailleurs. Jean-Jacques Rousseau a fait son apologie : le besoin de s'admirer en ses vertus et en ses vices, le besoin de reprocher les uns et les autres à la Société ont faussé tout ce qu'il dit de sa vie intérieure. Saint Augustin a retourné son orgueil de jeunesse en humilité. Il a fait par écrit la confession publique des premiers chrétiens : on ne raconte pas avec une exactitude qui me satisfasse des actes qu'on réprouve ; on ne se fait pas connaître en se reniant. Il faut s'exprimer soi-même sans repentir et sans complaisance, sans étonnement tardif, se revivre naïvement, laisser se teindre chaque récit des sentiments éprouvés à l'heure de l'acte.
Cette candeur n'est pas possible quand les aveux sont destinés à être lus par d'autres. Moi qui écris ceci pour le brûler aussitôt terminé, je ne m'en ferai pas accroire à moi-même. Mais pourquoi est-ce que j'entreprends cette œuvre vaine ?
Je veux revivre une bonne fois, en son entier, en son développement continu, ma vie passée dont les fragments reviennent me troubler à chaque heure du jour. Je fais un paquet bien en ordre de tout ce que je fus, pour le jeter, me délivrer de cette hantise. Je sourirai de mon effort heureux pour m'exprimer ; je ne sourirai pas moins de mon effort malheureux. La vanité d'écrire me soulagera de la vanité de me souvenir. Et puis le spectre regardé en face, courageusement, immobilisé devant mes yeux, mensuré suivant la méthode de M. Bertillon, ne résistera peut- être pas à cette épreuve. Tout au moins, lorsqu'il sera debout sous la toise, je verrai qu'il n'occupe pas tout l'espace, qu'il reste l'Infini à sa droite comme à sa gauche et au-dessus de lui et sous ses pieds cruels ; je le raillerai et me raillerai du peu de chose qu'est mon bourreau ; je changerai ma souffrance qui ne pleure même plus en souffrance qui éclate de rire. Et, si je parviens à le résoudre en chiffres, en lois, en quelque chose d'abstrait, ne sera-ce pas une façon de l'anéantir? Essayons de transformer la chose sensible et pénible en idée indifférente, amusante à regarder.
... Mais quelle étrange fantaisie, de justifier un geste humain, de chercher les raisons qui nous poussent à telle folie active, plutôt qu'à telle autre !
J'ai aujourd'hui soixante-deux ans. Je suis né dans un château, à une demi-lieue d'un petit village, le 7 juillet 1833. Mon père, magistrat démissionnaire, avait pris dans sa courte carrière un grand dégoût des hommes et s'était enfui loin d'eux dans la paix et la sérénité de la campagne. Extérieurement, il n'avait rien du misanthrope ; d'ordinaire, même, on ne lui trouvait pas la raideur d'un juge, mais plutôt un air de bienveillance presque indifférente, un sourire d'indulgence un peu railleur.
C'est lui qui m'apprit à lire et à écrire. Puis il me mit au latin, qu'il savait bien, et au grec, qu'il ignorait presque autant qu'un professeur de l'Université, mais qu'il eut la conscience d'apprendre pour me l'enseigner. Il y joignit un peu de mathématiques et me fit beaucoup lire les écrivains français du XVIIe et du XVIIIe siècles.
Il était le plus doucement patient, le plus dévoué, mais aussi le plus froid des précepteurs. Je me sentais toujours gêné près de lui. Je ne pouvais pas m'exprimer la cause de mon malaise, qui restait vague. Aujourd'hui, je me rends compte que, fort paternel pour un maître, il n'était pas assez expansif et familier pour un père. Il me donnait son esprit charmant et solide, mais ne me laissait pas voir son âme : des sourires presque toujours, jamais de caresses. J'étais le plus docile des élèves, et le plus respectueux, et le plus tremblant d'admiration devant le Maître ; mais mon cœur se fût desséché au contact exclusif de cet homme sec ou réservé.
Une fois, je ne sais plus pourquoi, je négligeai de faire un devoir qu'il m'avait donné : peut-être, par extraordinaire, l'exercice était-il peu proportionné à mes connaissances et à mon ouverture d'intelligence de ce moment ; peut-être m'étais-je trouvé mal disposé ce jour-là. Mon père se contenta de sourire avec dédain et de dire :
— Aujourd'hui, Stanislas, vous ne méritez pas qu'on s'occupe de vous. Retirez-vous. Faites ce qu'il vous plaira. Quand vous vous croirez digne des attentions de quelqu'un, vous me le ferez savoir.
Je sortis tout en larmes. Je passai une heure à pleurer, à étouffer des cris et des sanglots. Puis je me mis au travail avec une rage d'orgueil. Quand j'eus quatorze ans, mon père me lut le programme du baccalauréat.
— Vous savez tout cela, me dit-il. Mais il nous faut une année pour mettre de l'ordre dans vos connaissances. Vous vous présenterez l'an prochain.
Je me présentai, en effet, avec une dispense d'âge, et j'obtins la mention très bien.
Je crois que mon père, qui avait si parfaitement réussi à m'instruire, eût été un éducateur excellent pour tout autre que pour un fils. Mais, comme il était celui qui me devait le plus d'affection et comme jamais il ne me fit entendre un mot du cœur, il me pénétrait de cette idée que les tendresses sont honteuses chez un homme, et sa direction exclusive m'eût raidi le caractère en un orgueil de stoïcien et en une timidité farouche de jeune fille.
Parmi les sentiments profonds qu'il m'inspira, je dois indiquer la haine du mensonge. Je ne me rappelle plus quelle petite demi-vérité je m'étais permise, en garçon tremblant qui n'ose avouer une faute minuscule. Mon père me fit cet étrange sermon :
— Certes, Stanislas, le mouvement de la parole ne doit pas traduire tous les mouvements intérieurs de notre être : si nous souffrons, par exemple, nous ne devons imposer à personne l'ennui de connaître notre souffrance ; si nous avons un bonheur, soyons assez indulgents pour éviter au voisin l'envie pénible. Mais le mouvement de la parole ne doit traduire que des mouvements qui sont réellement en nous. Chercher à deviner le visage caché sous le masque ou la vérité cachée sous le mensonge, c'est l'horrible métier d'un juge d'instruction, ou l'enfantillage d'un imbécile. Vous venez de mentir, Stanislas. De quinze jours, je ne vous adresserai la parole. Si vous retombiez dans la même faute, je ne vous parlerais plus jamais. C'est compris ?... Allez, faites ce qu'il vous plaira et revenez prendre votre leçon dans quinze jours.
Ce fut une des douleurs les plus déprimantes de mon enfance. Un peu plus tard, je remarquai avec terreur que mon père ne parlait jamais à ma mère et j'eus à repousser souvent un rapprochement qui revenait, obstiné, ronger le bord de mon esprit, comme le flot revient éternellement ronger le rivage.
Combien le vague soupçon était douloureux à mon amour profond pour ma mère, pour ma mère dont l'âme valait l'esprit de mon père ! Je ne veux pas me dire tout haut ses mérites. Il me semblerait commettre une impiété : louer, c'est se croire le droit de juger. Comme j'admirais en un tremblement l'intelligence claire et ornée de mon père, j'admirais ma mère en un attendrissement souriant, mais voisin des larmes et qui parfois y tomba. Elle, m'aimait uniquement, et, quand elle m'en avait donné toutes les preuves possibles, quand elle était au bout des paroles tendres et des tendres caresses, quand elle me pressait contre elle, au point de presque me faire mal, quand je pleurais de bonheur, des larmes aussi quelquefois jaillissaient de ses yeux. Je lui demandais :
— Pourquoi pleurez-vous, maman ?
— Je pleure de me sentir impuissante à m'exprimer tout entière. Je pleure parce qu'on ne parvient jamais à dire à ceux qu'on aime combien on les aime.
— Ne pleurez plus, mère. Je sais combien vous m'aimez. Vous m'aimez comme je vous aime.
— Non, mon petit Stani, Vous m'aimez autant que peut aimer un enfant. Moi, je t'adore autant que peut adorer une femme, autant que peut sentir une mère !
Ma pauvre maman, mon seul souvenir presque pur, qu'un mot, mal compris sans doute, de mon père me fit presque soupçonner, oh ! si jamais tu as menti, c'est que le mensonge peut être chose sainte. Mais non, tu n'as point menti: mon père s'est trompé, ou son éloignement pour toi avait quelque autre cause. C'est plutôt lui qui était coupable, coupable d'une faute sans conséquence entre deux êtres moins purs que vous ; mais qui te torturait, ô jalouse adoratrice de ceux que tu aimais ! et qui l'éloignait, l'isolait dans son orgueil, dans sa terreur des attendrissements. Pardonnez mes pensées, père raidi dans un refus de pardon, ou dans un refus de comprendre, ou dans un refus d'être pardonné. Je suis vieux maintenant : je sais qu'il n'y a pas de fautes humaines; je sais qu'une fatalité intérieure est la cause unique de tous les malheurs et, si parfois j'ai la naïveté d'essayer de deviner, je n'ai plus jamais la folie de juger.
Ma mère mourut presque subitement, trois semaines après mon succès au baccalauréat, et ma première pauvre petite joie d'orgueil fut éteinte par le vent de ma première grande douleur.
En cette circonstance affreuse, mon père me donna une preuve d'amour de la sincérité dont la minutie me blessa.
Ma mère, depuis le jour de ma première communion, paraissait avoir renoncé à toute religion. Quelques heures avant sa mort, mon père rompit son silence tragique, pour lui dire :
— C'est de vous qu'il s'agit, Madame, non de moi. Malgré mes opinions personnelles, si vous désirez un prêtre, je vous prie de le dire : votre volonté sera faite.
Elle répondit, la bouche crispée d'un sourire douloureux :
— Non, Monsieur. Je n'ai rien à confesser.
Puis elle s'adressa à moi :
— Stanislas, asseyez-vous là, tout près. Donnez-moi la main. Quand je serai sur le point de mourir, si je ne puis plus parler, entendez l'appel de mes yeux et mettez vos lèvres sur ma pauvre joue. Je veux partir dans le baiser de mon fils. C'est le seul viatique dont j'aie besoin.
Quand elle fut morte dans ma caresse, dans mes larmes, mon père sortit, sans doute pour donner les ordres nécessaires.
Le lendemain matin, arrivèrent de la ville voisine les lettres de faire-part. Mon père, dans la chambre mortuaire, en lut une à haute voix. Rencontrant la mention « munie des sacrements de l'Église » :
— C'est faux, dit-il. Pas de mensonge !
D'un coup d'ongle, il raya ces mots.