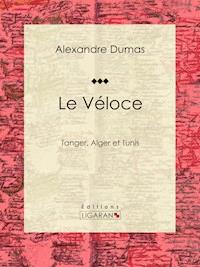
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Extrait : "Nous arrivâmes à Cadix le mercredi 18 novembre 1846. Nous étions assez inquiets. Il avait été convenu entre monsieur le ministre de l'instruction publique et moi, avant mon départ à Paris, qu'un bâtiment à vapeur nous attendrait à Cadix pour nous transporter à Alger : de Séville, où nous retenaient, et le bon accueil des habitants, et la promesse de Montès et du Chiclanero qui s'étaient engagés à nous donner une course de taureaux..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 758
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335050080
©Ligaran 2015
Nous arrivâmes à Cadix le mercredi 18 novembre 1846.
Nous étions assez inquiets. Il avait été convenu entre monsieur le ministre de l’instruction publique et moi, avant mon départ de Paris, qu’un bâtiment à vapeur nous attendrait à Cadix pour nous transporter à Alger : de Séville, où nous retenaient, et le bon accueil des habitants, et la promesse de Montès et du Chiclanero qui s’étaient engagés à nous donner une course de taureaux, j’avais écrit à monsieur Huet, consul à Cadix, pour lui demander s’il connaissait dans le port quelque paquebot de guerre stationnant à notre intention, et il nous avait répondu que depuis huit jours aucun paquebot de guerre d’aucune nation n’était entré à Cadix, ce qui ne nous avait point empêchés de partir, pour être fidèles à notre rendez-vous si notre bâtiment ne l’était pas au sien.
Seulement nous étions restés trois jours de plus à Séville que nous ne comptions y rester.
Ces trois jours de retard dans notre itinéraire avaient eu pour but, vous le savez, madame, d’attendre mon fils qui, un beau matin, avait disparu ; les renseignements recueillis sur lui m’avaient bien indiqué qu’il avait repris la route de Cordoue, mais ne m’en avaient point dit davantage ; or, comme il existe une route qui va directement de Cordoue à Cadix en laissant Séville à deux lieues sur la gauche, j’espérais, en arrivant dans la ville du Soleil, trouver mon paquebot et retrouver mon fils.
Le rendez-vous pour Alexandre était à l’hôtel de l’Europe ; ceux de mes lecteurs qui veulent tout savoir, et qui désireraient de plus amples renseignements sur cette absence, sont renvoyés à mes lettres sur l’Espagne.
Notre attention tout entière, en entrant dans le port de Cadix, n’était donc point pour cette charmante ville qui, comme le dit Byron :
Blanche, grandit aux yeux, fille du flot amer,
Entre l’azur du ciel et l’azur de la mer.
Notre attention était toute pour la rade.
Cette rade offrait aux regards une véritable forêt de mâts, au milieu desquels nous voyions avec joie s’élever deux cheminées, et flotter deux pavillons.
Ces deux pavillons étaient tous deux tricolores. Donc, au lieu d’un bâtiment français, il y en avait deux dans la rade.
Nous mîmes pied à terre sur la jetée, et, tandis que mes compagnons surveillaient le débarquement, je courus jusqu’à la douane pour y prendre des informations.
Ces deux bâtiments étaient l’Achéron et le Véloce.
L’Achéron, arrivé depuis trois jours, allait porter sur la côte du Maroc monsieur Duchâteau, notre consul à Tanger, chargé de présenter à Abd-el-Rhaman les présents du roi de France.
Le Véloce, arrivé depuis la veille seulement, n’avait point encore de destination connue.
Toute notre espérance se concentra donc sur le Véloce.
Après les difficultés habituelles, la douane nous laissa passer, et nous nous acheminâmes à travers des rues un peu plus larges mais aussi mal pavées que les rues de Séville, de Grenade et de Cordoue, vers l’hôtel de l’Europe.
Notre installation n’y était point faite encore, qu’on m’annonça monsieur Vial, second de la corvette le Véloce.
Au milieu de l’inquiétude générale, j’avais toujours gardé la sérénité qui convient aux chefs d’expéditions, je me retournai vers mes compagnons, restés dans les différentes attitudes où les avait surpris l’annonce du mosso, avec un regard qui leur disait clairement :
– Vous voyez que je n’avais pas eu tort de compter sur la promesse qui m’avait été faite.
Tous s’inclinèrent.
Monsieur Vial fut introduit.
Il était détaché du bâtiment par le commandant Bérart, et m’apportait une lettre.
Monsieur le ministre de la marine ayant dit à la tribune que le Véloce avait été mis à ma disposition par un malentendu, on me permettra de consigner ici cette lettre tout entière, elle donnera une idée du degré de croyance que l’on peut accorder à messieurs les ministres en général, et à monsieur le ministre de la marine en particulier.
Attention !
Gouvernement général de l’Algérie. – Cabinet.
Monsieur,
« Le maréchal n’est arrivé à Alger que le 6 de ce mois, et c’est en débarquant que j’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire de Madrid, nous recevions en même temps une lettre de monsieur de Salvandy, qui nous demandait de vous envoyer chercher à Cadix.
Je ne saurais vous dire, monsieur, combien le maréchal a été affligé de ce contretemps, qui nous prive de vous voir quelques jours plutôt. Un bateau à vapeur part ce soir pour Oran, et porte à la frégate le Véloce l’ordre d’aller vous chercher à Cadix, ou sur le point de la côte où vous pourriez vous trouver ; le commandant doit même s’informer si vous n’auriez pas fait une excursion dans les environs, et vous attendre là où vous pourriez vous embarquer. J’espère, monsieur, que le beau pays où vous vous trouviez vous aura fait prendre un peu en patience la quarantaine involontaire que nous vous faisons faire sur la côte d’Espagne.
Le Véloce vous ramènera à Oran en passant par Tanger ; de là vous gagnerez Alger, quand vous voudrez, par le bâtiment à vapeur qui part le samedi de chaque semaine ; là, nous vous recevrons avec tout votre état-major : nous désirons beaucoup vous voir le plutôt possible parmi nous ; c’est pourquoi je vous prie, en mon nom, de ne vous arrêter que le temps nécessaire à Oran, et de gagner vite la capitale de l’Algérie en gardant le droit de retourner sur vos pas si vous le jugez convenable.
Je n’ai pas besoin de vous dire, monsieur, que le maréchal sera très heureux de recevoir les compagnons, de voyage que vous vous êtes adjoints.
Je regrette bien, monsieur, de ne pas pouvoir aller au-devant de vous jusqu’à Cadix. J’aurais été heureux de me rapprocher plutôt de vous, mais je ne m’appartiens pas. Le maréchal est arrivé ici tout à fait malade, et n’a pas encore pu reprendre son commandement ; enfin, nous avons trouvé en arrivant une telle masse de travail arriéré, qu’il n’y a pas eu moyen de ne point se mettre à l’ouvrage.
Recevez, monsieur, avec l’expression de mes regrets pour tous vos accidents, l’assurance des vœux sincères que je forme pour votre heureux voyage, et de mes sentiments les plus distingués. »
Je m’attendais à la simple communication d’un ordre diplomatique ou militaire. Je recevais avec cet ordre une lettre charmante de goût et de politesse, c’était beaucoup plus que je n’espérais.
Je remerciai monsieur Vial de la peine qu’il avait bien voulu prendre, et comme on vint nous annoncer que la table était servie, bon gré, mal gré, je le retins à dîner avec nous.
Le dîner se passa en questions : le Véloce était-il bon marcheur ? le capitaine était-il bon compagnon ? le temps promettait-il d’être beau ?
Ce n’était point par la marche que brillait le Véloce. C’était un beau et brave bâtiment, tenant puissamment la mer, se comportant à merveille par un gros temps, sachant, grâce à l’expérience de son équipage, se tirer d’un mauvais pas, comme il l’avait prouvé à Dunkerque un jour qu’il avait l’honneur de porter le roi de France et une partie de la famille royale, mais il avait une chaudière trop petite pour sa taille, un mouvement trop faible pour sa corpulence ; enfin, ce n’était aucunement la faute du Véloce s’il était mauvais marcheur, seulement, il fallait bien l’avouer, le Véloce, dans ses beaux jours, ne filait que sept ou huit nœuds à l’heure, c’est-à-dire ne faisait que deux lieues à deux lieues et demie.
Quant au capitaine Bérard, c’était un homme de quarante à quarante-cinq ans, courtois comme le sont en général tous les officiers de marine, mais grave et silencieux ; rarement on l’avait vu rire à bord, et l’on doutait fort que, malgré la provision de gaîté que nous avions apportée de Paris, et que nous n’avions pas encore dépensée tout entière, nous parvinssions à dérider son front.
Quant au temps, il était inutile d’en parler, il serait beau.
Cette assurance éclaircit un peu l’avenir aux yeux de Maquet qui, ayant manqué de mourir du mal de mer sur le Guadalquivir, n’envisageait pas d’une façon riante un voyage dans le pays des Cimmériens, que les anciens regardaient comme le berceau des tempêtes.
Le dîner fut gai, et nous donnâmes à monsieur Vial un échantillon de ce que nous pouvions faire sous ce rapport-là : lui, de son côté, nous parut un excellent convive, et nous nous quittâmes enchantés les uns des autres.
Il avait été convenu que le lendemain à midi nous irions à bord du Véloce rendre visite au capitaine, et que le samedi 21, à huit heures du matin, nous appareillerions pour Tanger.
Ces trois jours avaient été réclamés par mes compagnons pour voir Cadix, et par moi pour donner à Alexandre le temps de nous rejoindre.
Le lendemain, à onze heures du matin, comme nous faisions nos préparatifs pour nous rendre à bord, on nous annonça le commandant Bérard.
C’était en effet le capitaine du Véloce qui prévenait notre visite en venant nous faire la sienne. Nous reconnûmes là, avec un peu de honte, cette extrême courtoisie de nos officiers de marine. Le commandant Bérard resta quatre heures avec nous, et je crois qu’à son retour à bord il était aussi charmé de nous avoir pour passagers que nous l’étions nous de l’avoir pour capitaine.
Il avait été arrêté que notre visite au Véloce serait remise au lendemain, et que dans cette visite nous prendrions connaissance de notre aménagement.
Nous fûmes exacts. Le Véloce nous attendait comme une coquette sous les armes ; le commandant était à l’escalier, tout l’équipage était sur le pont ; nous fûmes reçus au son du sifflet du contremaître.
Le commandant s’empara de nous et nous emmena dans l’entrepont. La salle à manger, que l’on nous indiqua tout d’abord, – le commandant ayant entendu dire que depuis Bayonne nous mourions de faim, – la salle à manger portait encore des traces des augustes passagers qu’elle avait reçus ; ses moulures étaient dorées ; et des rideaux de soie cerise servaient de portières aux chambres qui s’ouvraient sur elle.
Ces chambres étaient au nombre de cinq.
Celle de poupe, on y entrait par deux portes, tenait toute la largeur du bâtiment ; c’était la plus grande, mais aussi c’était celle où il y avait le plus de mouvement, surtout dans le tangage, cette chambre formant l’extrémité du navire.
Les quatre autres accompagnaient ses flancs.
Au nombre des quatre dernières était la chambre du capitaine. À la première ouverture qu’il fit de son désir de me la céder, je l’arrêtai court, et il fut convenu qu’autant que possible nous ne déplacerions personne.
Restaient donc trois chambres.
J’en pris une, Boulanger prit l’autre ; la troisième fut réservée à Alexandre.
Nous avions voulu faire à Maquet et à Giraud les mêmes politesses que le capitaine nous avait faites, mais Maquet et Giraud s’étaient déjà renseignés près de Vial, et ils déclarèrent qu’ils ne quitteraient pas le carré des officiers.
Le carré des officiers étant placé juste au centre du bâtiment, c’est de tout le navire l’endroit où le mouvement est le moins sensible.
Il leur fut donc montré à chacun une chambre excellente dans le susdit carré.
Quant à Desbarolles, il se vantait hautement d’être parfaitement familiarisé avec les caprices de Neptune, et il avait, en conséquence, désiré garder toute son indépendance relativement au lieu où il passerait la nuit.
Comme il restait cinq chambres vacantes, nous ne nous inquiétâmes point trop ; c’était plus qu’il n’en fallait pour le loger lui et sa carabine.
Vial mit en outre à notre disposition sa cabine du pont ; il y avait juste dans cette cabine la place d’une table, d’un lit et d’une chaise, mais c’était une véritable trouvaille, à cause de la localité qui permettait à l’air d’entrer par la porte et de sortir par la fenêtre, et vice versâ.
On nous présenta l’armurier, dont nos fusils avaient le plus grand besoin ; on devait faire un ballot de toutes les armes, et ce ballot lui serait remis directement ; je le nommai, séance tenante, mon armurier extraordinaire.
J’ai, déjà mon armurier ordinaire, dont j’aurai l’occasion, je l’espère bien, d’entretenir mes lecteurs pendant le cours de cet ouvrage.
Nous revînmes à Cadix, enchantés du bâtiment, du capitaine et de ses officiers. Tout en partageant notre enthousiasme, Giraud et Maquet exprimaient le leur plus froidement. J’ai déjà expliqué la cause de cette froideur.
Giraud, j’ai oublié de consigner la chose en son temps et lieu, Giraud n’avait échappé au mal de mer sur le Guadalquivir, qu’en se tenant couché sur le pont, de San-Lucar à Cadix.
Nous attendîmes vainement Alexandre pendant la journée du lendemain et celle du surlendemain ; non seulement Alexandre ne reparut point, mais les nouvelles qu’on recevait de lui par les conducteurs de diligence et les courriers de malle-poste, se formulaient d’une façon si fantastique, qu’il était impossible d’établir sur ces nouvelles aucune probabilité de retour.
Heureusement, un jeune Français que nous avions rencontré à Séville, monsieur de Saint-Prix, nous avait suivis jusqu’à Cadix. Il me promit d’y attendre Alexandre, et de me l’expédier à Gibraltar par un des bâtiments à vapeur faisant la traversée entre l’ancienne Gadès et l’ancienne Calpé.
Malgré toutes ces précautions prises pour l’heureux retour de l’enfant prodigue, je n’en quittai pas moins Cadix le cœur serré et l’esprit inquiet ; mais l’heure du départ avait été fixée au samedi 21, à huit heures du matin, et le samedi 21, à sept heures et demie, nous mettions le pied sur le canot envoyé par le commandant pour nous prendre sur le port, tandis que la yole, avec son équipage au grand complet, chargeait nos bagages.
Le Véloce était environné d’une nuée de mouettes, de margats et de goélands. En arrivant dans les eaux du bâtiment, je voulus donner à nos futurs compagnons un échantillon de mon savoir-faire, je lâchai mes deux coups de fusil sur deux margats qui tombèrent tous deux.
Les matelots de la yole allèrent les chercher, tandis qu’après ce coup d’éclat, nous marchions triomphalement à bord.
Le hasard avait fait que les deux margats n’étaient que démontés, on les apporta à leur tour ; le chirurgien leur fit l’opération à l’aide d’une paire de ciseaux, et on les lâcha sur le pont, où ils se mirent incontinent à courir et à manger, à la suprême joie de ces grands enfants qu’on appelle les matelots.
Tous deux furent baptisés à l’instant même, l’un reçut le nom du Véloce et l’autre de l’Achéron.
Paul apportait un troisième passager, démonté sur le Guadalquivir, c’était un goéland de la plus grosse espèce, et qui avait l’air d’un albatros, celui-là s’appelait déjà le Rapido, du nom du bâtiment qui nous avait transportés de Séville à Cadix.
La formalité voulait que nous remissions nos passeports entre les mains du capitaine ; nous nous empressâmes de remplir la formalité, afin de sortir le plus tôt possible de notre caractère officiel.
Comme monsieur le ministre de la guerre et monsieur le ministre des affaires étrangères ont dit tous deux à la tribune,
Le premier : Qu’on pouvait me croire effectivement chargé d’une mission, puisque je m’en vantais à tout propos,
Et le second : Qu’il ignorait complètement qu’une mission eût été donnée au monsieur dont il était question, mes lecteurs me permettront de mettre sous leurs yeux mon passeport, comme j’ai déjà fait de la lettre relative au Véloce.
Après quoi, j’en aurai fini avec ces messieurs.
« Au nom du roi des Français,
Nous, ministre secrétaire d’État des affaires étrangères, prions les officiers civils et militaires, chargés de maintenir l’ordre public, dans l’intérieur du royaume et dans tous les pays amis ou alliés de la France, de laisser passer librement monsieur Alexandre Dumas Davy de la Pailleterie, se rendant en Algérie par l’Espagne, chargé d’une mission du ministère de l’instruction publique.
Voyageant avec deux domestiques.
Et de lui donner aide et protection en cas de besoin.
Le présent passeport délivré à Paris, le 2 octobre 1846.
Signé GUIZOT.
Par le ministère,
Le chef de bureau de la chancellerie,
DE LAMARRE. »
On objectera que monsieur le ministre des affaires étrangères signe tant de passeports qu’il a bien pu oublier qu’il ait signé celui-là.
À l’objection, je répondrai qu’une circonstance toute personnelle aurait dû aider sa mémoire.
Le 2 octobre, à onze heures du matin, monsieur le ministre des affaires étrangères m’avait fait prier, par monsieur Génie, de venir en personne prendre mon passeport au ministère.
J’avais eu l’honneur de me rendre à cette invitation, et j’étais resté près de deux heures à l’hôtel du boulevard-des Capucines.
Si monsieur Guizot l’a oublié, monsieur de Salvandy, qui a déjà donné la preuve qu’il avait plus de mémoire que ses confrères, se le rappellera certainement.
Je vous ai déjà fait faire connaissance, madame, avec le commandant Bérard et le lieutenant Vial. Un mot maintenant sur le reste de l’état-major du Véloce.
Il se composait de quatre officiers :
Le second lieutenant, le deuxième enseigne, le chirurgien-major, et le commissaire.
Le second lieutenant, monsieur Salles, était un homme de trente-cinq ans à peu près, blond, d’une figure douce et agréable, fort instruit, et de relations charmantes ; mais d’une santé assez mauvaise pour lui donner des heures de mélancolie, pendant lesquelles il se tenait enfermé dans sa cabine, n’apparaissant sur le pont que pour son service. Lorsque nous nous séparâmes, nous l’avions à peu près guéri, non pas de sa maladie, mais de sa tristesse ; je crois qu’il nous a regrettés, ne fût-ce que comme révulsifs.
Le deuxième enseigne, monsieur Antoine, était un homme déjà âgé : pourquoi n’était-il encore que second enseigne ? personne n’eût pu le dire ; car il passait à bord pour un excellent officier. Cependant, quoiqu’il eût vingt ans de service, comme il n’était pas porté sur les cadres, il pouvait être renvoyé, sans retraite, au premier caprice passant dans la tête d’un chef de bureau du ministère de la marine. Cette position précaire l’inquiétait. Soit misanthropie, soit timidité, nous le vîmes peu.
Le chirurgien major, monsieur Marquès, était un jeune homme de vingt-cinq à vingt-six ans ; il faisait sur le Véloce l’intérim du chirurgien du bâtiment, en congé ou malade, je ne sais plus trop. Il appartenait à l’armée de terre ; il n’était pas encore familiarisé avec le perfide élément, comme on dit au palais de l’Institut. Maquet et Giraud lui furent spécialement recommandés.
Le commissaire, monsieur Rebec, arrivait de Marseille en droite ligne : non seulement il en arrivait, mais encore il y était né ; origine qui nous rapprocha à l’instant même. En effet, vous le savez, madame, Marseille est une seconde patrie pour moi, tant elle me fut hospitalière ; quelques-uns de mes meilleurs amis sont de Marseille : Méry, Autran. Quand j’ai voulu créer deux types : l’un de l’intelligence humaine portée au plus haut degré ; l’autre, de l’honneur commercial poussé aux dernières limites ; je les ai empruntés à cette fille de la vieille Phocée, que j’aime comme une mère ; et je les ai nommés Dantès et Morrel.
Le reste de l’équipage, sous-officiers et matelots, se composaient de cent vingt hommes à peu près.
Nous n’eûmes, pour le moment, que le temps de faire une connaissance toute superficielle ; aussitôt que nous fûmes à bord, on commença d’appareiller.
La prédiction de Vial à l’endroit du baromètre ne s’était point réalisée ; au lieu du beau fixe qui nous était promis, il tombait une pluie fine qui jetait un voile de brume sur cette ville d’azur, d’émeraude et d’or, que l’on nomme Cadix ; mais Vial n’en maintenait pas moins son dire ; il ne s’agissait que de sortir du port pour que le baromètre remontât ; et le vent de la pleine mer, chassant devant lui brouillard et nuages, devait, avant qu’il fût midi, nous rendre, en échange de ce soleil de novembre et de cette atmosphère d’occident, ce soleil toujours jeune et ce ciel toujours pur de l’Afrique.
Il y a dans ce mot Afrique quelque chose de magique et de prestigieux qui n’existe pour aucune des autres parties du monde. L’Afrique a été de tout temps la terre des enchantements et des prodiges ; demandez plutôt au vieil Homère, et il vous dira que c’est sur son rivage enchanté que poussait le lotus, ce fruit si doux qu’il faisait perdre aux étrangers qui le mangeaient le souvenir de la terre natale ; c’est à-dire le plus puissant de tous les souvenirs.
C’est en Afrique qu’Hérodote place le jardin des Hespérides, dont Hercule doit cueillir les fruits, et le palais des Gorgones, dont Persée doit forcer les portes.
C’est en Afrique qu’il faut chercher ce pays des Garamanthe où, au dire d’Hérodote encore, les bœufs sont obligés de paître à reculons, à cause de leurs cornes étranges qui s’allongent parallèlement à la tête et se courbent en avant de leur museau.
C’est en Afrique que Strabon place ces sangsues longues de sept coudées, dont une seule suffit pour sucer le sang de douze hommes.
Si l’on en croit Pomponius Méla, les satyres, les faunes et les égypans habitaient l’Afrique ; et c’était non loin des montagnes où bondissaient ces génies capripèdes que vivaient les Atlantes, derniers débris d’une terre disparue, et qui hurlaient au lever et au coucher du soleil.
Ces monocoles, qui, sur une seule jambe, couraient aussi vite que, l’autruche et que la gazelle ; ces léocrotes, qui ont les jambes du cerf, la tête du blaireau, la queue, le cou et la poitrine du lion ; ces psylles, dont la salive guérissait les morsures des serpents ; le caloplebas, qui tue aussi sûrement avec son regard que le Parthe avec sa flèche ; le basilic, dont l’haleine dissout la pierre la plus dure, étaient tous des animaux originaires d’Afrique.
« Et, dit Pline, il n’y a rien d’étonnant à ce que l’Afrique soit la terre des prodiges et des monstres, car l’eau y est si rare, qu’il y a toujours nombre de bêtes féroces auprès des sources et des lacs ; et là, de gré ou de force, les mâles s’accouplent avec les femelles de races différentes, et de cette façon produisent des êtres à noms inconnus, des individus à formes nouvelles. »
C’est en Afrique encore que régnait ce fameux Prête-Jean, que Marco Polo fait plus puissant que tous les autres princes de la terre, plus riche que tous les autres rois du monde, et qui tenait sous son empire plus de la moitié du cours du Nil.
C’est en Afrique aussi que l’aigle fécondait la louve, et que de ce rapprochement naissait le dragon, ce monstre qui fait éclater en naissant les entrailles de sa mère, qui porte le bec, les ailes de l’oiseau, qui a la queue du serpent, la tête du loup, la peau du tigre, et que Léon l’Africain eût vu sans doute, si la nature n’avait pas privé le monstre de paupières, ce qui le force de demeurer dans l’obscurité, le grand jour lui faisant mal aux yeux.
Le docteur Schaw, il y a à peine trois cents ans de cela, n’a-t-il pas rencontré, à Alger même, le fameux mulet produit de la vache et de l’âne, qui tient à la fois du père et de la mère, et qui s’appelle le kumrah ?
Il n’y a pas jusqu’aux tempêtes d’Afrique qui nous apparaissent sous un aspect plus effrayant que les autres tempêtes. Il n’y a pas jusqu’aux vents du désert qui ne prennent un nom mystérieux en soulevant cet océan de sable aux flots brûlants, qui, jaloux sans doute d’avoir vu la mer Rouge engloutir Pharaon et ses Égyptiens, étouffa Cambyse et son armée.
Nos paysans sourient quand on leur parle du vent du nord ou du vent du sud.
L’Arabe tremble quand on lui parle du simoun ou du khamsin.
Enfin, n’est-ce pas en Afrique que l’on a découvert, en l’an de grâce 1845, et que l’on a fait reconnaître à la commission scientifique en général, et au colonel Bory de Saint-Vincent en particulier, le fameux rat à trompe dont nous aurons l’honneur de vous entretenir plus tard ? Charmant petit animal, soupçonné par Pline, nié par monsieur Buffon, et retrouvé par les zéphirs, ces grands explorateurs de l’Algérie.
Ainsi vous le voyez, madame, depuis Homère jusqu’à nous, l’Afrique n’a pas cessé d’être un monde de plus en plus fabuleux, qui, aux yeux des voyageurs et des philosophes, doit doubler d’attrait, comparé surtout à notre monde qui, en devenant de plus en plus réel, a le malheur de devenir de plus en plus triste.
Heureusement, madame, que, pour le moment, nous flottions juste entre les deux mondes, ayant à bâbord, comme nous disons maintenant, le détroit de Gibraltar, qui se resserre et s’enfonce à l’orient ; à l’arrière, la terre d’Europe qui disparaît dans la pluie ; et à l’avant, les montagnes du Maroc qui apparaissent dans le soleil.
Maquet est déjà couché dans sa cabine : aux premiers mouvements du Véloce, la terre a paru littéralement manquer sous ses pieds, et il lui a fallu passer incontinent de la position perpendiculaire à la position horizontale.
Giraud est encore debout, si cela peut s’appeler debout ; mais il est enveloppé dans sa mante ; il ne dit pas une parole, tant sa crainte d’ouvrir la bouche est grande ; de temps en temps il s’assied, triste comme Jérémie au bord du Jourdain : Giraud pense à sa famille.
Desbarolles se promène à grands pas, de l’avant à l’arrière, avec Vial ; il cause et gesticule, racontant son voyage en Espagne, ses rixes avec les muletiers de la Catalogne, ses chasses avec les bandits de la Sierra-Morena, ses amours avec les manolas de Madrid, et ses combats avec les voleurs de Villa Mejor et du Malo Sitio. À chaque retour, il prend sur le cigare de son interlocuteur l’avantage du vent. Je ne crois pas que le voyage se termine, sans que Desbarolles éprouve quelques atteintes de ce mal sans remède qui tourmente Maquet et qui menace Giraud.
Boulanger et moi sommes montés sur un banc et accrochés d’une main aux cordages ; nous suivons les mouvements oscillateurs du bâtiment, en étudiant la gradation et la dégradation des teintes. À portée de la main, j’ai une carabine chargée à balle dans l’attente des marsouins, et un fusil chargé à plomb, en l’honneur des margats, des mouettes, des goélands, ou de tout autre volatile qui voudrait nous faire cette joie de passer à portée du coup.
Un quart de l’équipage est sur le pont, le reste vaque à ses affaires, c’est à-dire dort, joue ou bavarde dans les premiers dessous, comme on dirait à l’Opéra ; les vingt ou vingt-cinq hommes visibles sont pittoresquement groupés sur la gatte, au pied du cabestan, ou sur les canons.
Trois mousses jouent avec nos amputés, qui sautillent après les mies de pain qu’ils leur jettent, et qui continuent à affecter l’insouciance la plus complète pour le déplacement forcé qu’on leur impose.
Le bâtiment va tout seul, comme le navire Argos, sans qu’il y ait besoin, pour le diriger, d’autre puissance ou d’autre volonté que celle du timonier, qui, d’un air indolent, tourne une roue tantôt à droite, tantôt à gauche.
Il y a quelque chose de charmant à se sentir entraîner ainsi vers l’inconnu.
Cet inconnu est devant nous, et nous nous en rapprochons à chaque instant. Vial a dit vrai, le ciel s’éclaircit, et la mer se calme. Un courant visible existe de l’Océan à la Méditerranée. Mais vous comprenez que ce qui peut causer de graves inquiétudes à un navire à voiles ne préoccupe aucunement ces rois de la mer qui sillonnent leur empire assis sur un trône de flamme, avec une couronne de fumée au front.
On parle toujours de la longueur des traversées. Il est possible que dans les hautes latitudes, là où la terre a disparu complètement, là où l’on ne voit, aussi loin que le regard puisse s’étendre, autre chose que le ciel et l’eau, il est possible que l’ennui vienne avec le malaise, son précurseur ou son compagnon, s’asseoir côte à côte du passager ; mais, en vérité, pour le penseur, c’est-à-dire pour l’homme qui essaye de plonger ses regards dans les abîmes de la mer ou dans les profondeurs du ciel, ces deux emblèmes de l’infini, je ne sais pas de spectacle plus changeant, plus varié, et souvent plus sublime, que cet horizon désert à l’extrémité duquel semblent se toucher, le nuage, cette vague du ciel, la vague, ce nuage de la mer.
Je sais bien qu’on ne peut rêver éternellement ; qu’il y a des traversées de trois ou quatre mois, et qu’un rêve de trois ou quatre mois finit par sembler un peu long ; mais les Orientaux ne rêvent-ils pas toute leur vie, et quand par hasard ils se réveillent, ne se hâtent-ils pas d’avoir recours, pour se rendormir au plus vite, à l’opium ou au hatchich.
J’allais joindre l’exemple au précepte, et m’enfoncer jusqu’au cou dans ma rêverie, lorsqu’en passant à côté de moi, toujours causant avec Desbarolles, Vial me toucha l’épaule, et allongeant la main dans la direction d’un cap, sur lequel se jouait triomphalement un rayon de soleil vainqueur de la pluie.
– Trafalgar ! me dit-il.
Il y a des noms qui ont une singulière puissance, car ils portent en eux tout un monde d’idées, qui aussitôt qu’elles se présentent à notre esprit, viennent l’envahir et en chasser violemment les idées antérieures, au milieu desquelles notre esprit se reposait calme et serein comme un sultan dans son sérail.
Entre l’Angleterre et nous, il y a six mots qui résument toute notre histoire :
CRÉCY, – POITIERS, -AZINCOURT, – ABOUKIR, – TRAFALGAR ET WATERLOO.
Six mots exprimant chacun une de ces défaites dont on croit qu’un pays ne se relèvera jamais, une de ces blessures par lesquelles on croit qu’un peuple doit perdre tout son sang.
Et cependant la France s’est relevée, et cependant le sang est rentré dans les veines de son robuste peuple ; l’Anglais nous a toujours vaincus ; mais nous l’avons toujours chassé.
Jeanne d’Arc a reconquis à Orléans la couronne qu’Henri VI avait déjà posée sur sa tête ; Napoléon, avec l’épée de Marengo et d’Austerlitz, a gratté à Amiens les fleurs de lis dont s’écartelait depuis quatre cents ans le blason de Georges IV.
Il est vrai que les Anglais ont brûlé Jeanne d’Arc à Rouen et enchaîné Napoléon à Sainte-Hélène.
Nous nous en sommes vengés en faisant de l’une une martyre et de l’autre un Dieu.
Maintenant d’où vient cette haine, qui attaque sans cesse, cette force qui repousse éternellement ?
D’où vient ce flux qui, depuis cinq siècles, apporte l’Angleterre chez nous, et ce reflux qui, depuis cinq siècles, la remporte chez elle ?
Ne serait-ce pas que dans l’équilibre des mondes elle représenterait la force et nous la pensée, et que ce combat éternel, cette étreinte sans fin, ne serait rien autre chose que la lutte génésiaque de Jacob et de l’ange, qui luttèrent toute une nuit front contre front, flanc contre flanc, genou contre genou, et jusqu’à ce que vînt le jour.
Trois fois renversé, Jacob se releva trois fois ; et, resté debout enfin, devint le père des douze tribus qui peuplèrent Israël et se répandirent sur le monde.
Autrefois, aux deux côtés de la Méditerranée, existaient deux peuples personnifiés par deux villes qui se regardaient, comme des deux côtés de l’Océan se regardent la France et l’Angleterre ; ces deux villes étaient Rome et Carthage.
Aux yeux du monde, à cette époque, elles ne représentaient que deux idées matérielles : l’une le commerce, et l’autre l’agriculture ; l’une la charrue, l’autre le vaisseau.
Après une lutte de deux siècles, après Trébie, Cannes et Trasimène, ces Crécy, ces Poitiers, ces Waterloo de Rome, Carthage fut anéantie à Zama, et la charrue victorieuse passa sur la ville de Didon, et le sel fut semé dans les sillons de la charrue, et les malédictions infernales furent suspendues sur la tête de quiconque essayerait de réédifier ce qui venait d’être détruit.
Pourquoi fut-ce Carthage qui succomba et non point Rome ? Est-ce parce que Scipion fut plus grand qu’Annibal ? Non. Comme à Waterloo, le vainqueur disparaît tout entier dans l’ombre de vaincu.
Non, c’est que la pensée était avec Rome ; c’est qu’elle portait dans ses flancs féconds la parole du Christ, c’est-à-dire la civilisation du monde ; c’est qu’elle était, comme phare, aussi nécessaire aux siècles écoulés que l’est la France aux siècles à venir.
Voilà pourquoi la France s’est relevée des champs de bataille de Crécy, d’Azincourt, de Poitiers ou de Waterloo ! Voilà pourquoi la France n’a pas été engloutie à Aboukir et à Trafalgar !
C’est que la France catholique, c’est Rome ; c’est que l’Angleterre protestante n’est que Carthage.
L’Angleterre peut disparaître de la surface du monde, et la moitié du monde, sur laquelle elle pèse, battra des mains.
Que la lumière qui brille aux mains de la France, tantôt torche ou tantôt flambeau, s’éteigne, et le monde tout entier poussera, dans les ténèbres, un long cri d’agonie et de désespoir.
À six heures et demie du soir, c’est-à-dire à la nuit close, nous jetâmes l’ancre à une demi-lieue à peu près de Tanger.
Il ne fallait pas songer à y entrer le même soir, aussi, à l’annonce que le dîner était servi, descendîmes-nous dans la salle à manger sans difficulté aucune.
En sentant le mouvement cesser ou devenir presque insensible, Giraud sortit de sa cabine du pont, et Maquet se hasarda hors de la cabine du grand carré. Moins Alexandre, nous nous trouvâmes donc au grand complet.
Le lieutenant Vial dînait avec nous ; l’habitude du capitaine étant d’inviter chaque jour, à déjeuner et à dîner, un de ses officiers à tour de rôle.
À déjeuner, Desbarolles et moi avions seuls tenu bon, Boulanger s’était levé au rôti et était allé faire un tour sur le pont. Quant à Giraud et à Maquet, comme Brutus et Cassius, ils avaient brillé par leur absence.
Giraud avait demandé des comestibles à l’huile et au vinaigre, Maquet avait demandé du thé.
Vous pouvez suivre la gradation, madame, de moi à Maquet en passant par Boulanger.
Le souper était donc joyeux ; les crudités avaient creusé Giraud ; le thé avait affaibli Maquet ; Boulanger, qui n’avait déjeuné qu’à moitié, entassait sur son dîner incomplet ce qui lui revenait de son déjeuner ; chacun faisait de son mieux honneur à la table du capitaine, qui, bonne en réalité, nous semblait exquise par comparaison.
Au dessert, le qui-vive de l’officier de quart retentit sur le pont, et l’on vint nous annoncer la visite du chancelier français à Tanger.
Le chancelier était accompagné, nous dit-on, d’un de nos amis qui, apprenant notre arrivée en rade, s’était empressé de nous venir serrer la main.
Un de nos amis à Tanger, comprenez-vous, madame ? Ainsi, en mettant le pied sur la côte du Maroc, ce n’était pas un Marocain, ce n’était pas un Arabe, ce n’était pas un Juif que nous allions voir, c’était un chrétien, et un chrétien de nos amis.
J’ai dit quelque part que j’avais de par le monde trente mille amis au moins ; vous voyez bien, madame, que je n’ai point exagéré, il faut avoir au moins trente mille amis disséminés de par le monde, pour en trouver un ainsi tout grouillant, en arrivant à Tanger.
Nous attendions, la bouche béante et les yeux écarquillés, lorsque nous vîmes entrer le chancelier du consulat.
Derrière lui, brillait épanouie la figure ouverte de Couturier.
Vous vous rappelez Couturier, madame, notre hôte de Grenade, que nous avions laissé place des Cuchilleros, en face de cette fatale maison Contrairas d’où était partie la fameuse pierre qui avait failli substituer la dynastie des Dumas à la dynastie des Mohammed.
Eh bien ! c’était lui, lui que nous croyions dévoré à cette heure, et qui n’était qu’exilé, et même, il faut le dire, exilé volontaire. Monsieur Duchâteau, notre consul à Tanger, connaissant son talent sur le daguerréotype, lui avait fait offrir de le suivre au Maroc ; Couturier avait pris ses boîtes et ses plaques, et était accouru.
Seulement, il était arrivé deux jours après le départ de l’Achéron, qui devait venir le reprendre, et qu’il attendait d’un moment à l’autre.
Il connaissait déjà Tanger aussi bien que Grenade, et se chargeait de nous en faire les honneurs.
Le chancelier, monsieur Florat, venait nous faire toutes les offres de service. Tanger étant une des stations habituelles du Véloce le capitaine et monsieur Floral étaient de vieilles connaissances. Comme c’était à Tanger que le capitaine avait reçu l’ordre de venir nous prendre sur la côte d’Espagne, on s’était douté, en reconnaissant son bâtiment au large, qu’il nous ramenait, et voilà comment, le bruit de notre arrivée s’étant répandu dans la ville. Couturier était venu nous surprendre, au moment où, il faut l’avouer, nous étions loin de songer à lui.
Monsieur Floral était grand chasseur ; j’avais fort entendu parler des chasses d’Afrique ; je m’informai auprès de lui s’il n’y avait pas moyen d’en organiser une pour le lendemain ou le surlendemain.
Boulanger et Giraud, qui n’ont jamais été bons chasseurs, même autrefois, restaient, en ce cas, avec Couturier, et faisaient merveille dans la ville avec le crayon et le pinceau.
C’était une grande affaire qu’une chasse dans l’intérieur du pays, surtout peur des chrétiens ; mais enfin, monsieur Floral promit de s’informer et de nous rendre réponse le lendemain.
Nous remontâmes tous ensemble sur le pont, un janissaire les avait accompagnés, un bâton d’une main, une lanterne de l’autre.
Certainement les agents consulaires sont inviolables, comme les députés, et à la rigueur ils pourraient se passer d’un janissaire ; mais le fait est qu’ils ne s’en passent pas.
Celui qui accompagnait ces messieurs avait l’air fort misérable, et l’on ne se serait pas douté, à voir son costume, qu’il remplissait les fonctions de protecteur près de deux hommes qui ne l’eussent certes pas trouvé assez propre pour en faire leur domestique ; mais que voulez-vous, madame, au Maroc comme au Maroc. La chose était ainsi !
Au reste, c’était un fort brave homme. Si vous allez jamais à Tanger, je vous demande votre pratique pour lui. Il s’appelle El-Arbi Bernat : voilà pour le nom.
Il est borgne : voilà pour le signalement.
Ah ! un autre renseignement, si les deux que je vous donne ne suffisaient pas : dans ses moments perdus, il est bourreau.
Ces messieurs ne voulurent point rester avec nous trop tard. Comme représentant du gouvernement français, monsieur Florat pouvait se faire ouvrir les portes à toute heure, mais il préférait ne pas user de ce pouvoir.
À neuf heures, j’allais dire sonnant, par habitude, oubliant que sur la côte d’Afrique l’heure coule silencieusement et tombe sans bruit dans l’abîme de l’éternité ; à neuf heures, ces messieurs nous quittèrent.
La mer ressemblait fort à cet abîme dans lequel s’engloutissent les heures, les mois et les années. Le ciel était sombre. Quelques rares étoiles brillaient au ciel et se reflétaient dans les profondeurs de l’Océan, dont la surface était devenue invisible. Notre bâtiment, comme le tombeau de Mahomet, semblait suspendu et flottant au milieu de l’éther, entre deux immensités.
Lorsque nos visiteurs descendirent l’échelle, on eût dit qu’ils se précipitaient dans un gouffre.
Mais bientôt la lumière de la lanterne éclaira la barque et rayonna sur l’eau, nous montrant les yeux brillants et les bras nus des rameurs marocains ; puis la barque se détacha du bâtiment, comme une hirondelle d’un toit, et s’éloigna. Pendant quelque temps, les objets placés dans le cercle de lumière projeté par la lanterne restèrent visibles ; puis ce cercle se rétrécit peu à peu ; bientôt ce ne fut plus qu’une étoile détachée du ciel, et filant avec lenteur sur la surface de la mer ; enfin, cette étoile s’agita, traça quelques détours, qui, de la place où nous étions, semblaient les évolutions insensées d’un feu follet, disparut, reparut, gravit une pente, disparut de nouveau, reparut encore, et tout à coup sembla s’anéantir dans les entrailles de la terre.
Selon toute probabilité, la porte de la ville venait de se refermer sur monsieur Florat et son compagnon.
Au reste, il y avait cela de remarquable, que Tanger était le point le plus noir de la côte ; il fallait être prévenu pour se douter qu’il y avait là une ville, et dans cette ville sept mille habitants : là étaient la nuit et le silence du tombeau.
Derrière nous, au contraire, aux flancs de la montagne circulaire qui forme le golfe, brillaient quelques feux et retentissaient quelques cris ressemblant assez à des appels de voix humaines.
Ces feux étaient ceux de quelques pauvres douairs, invisibles le jour, cachés qu’ils sont dans ces taillis de cinq à six pieds qui forment, si l’on peut parler ainsi, le pelage de la montagne.
Ces cris étaient les vagissements des hyènes et des chacals.
Il n’y a rien d’étrange comme cette certitude qui existe en nous, d’être transportés dans un monde nouveau et inconnu, quand aucun de nos sens ne nous met visiblement en relation avec ce monde : à peine si, dans ce cas, l’esprit a la puissance de convaincre la matière qui est là, ne sentant rien de changé autour d’elle, et à qui l’intelligence dit cependant : ce matin tu quittas un pays ami, ce soir tu touches un pays hostile ; ces feux que tu vois sont allumés par une race d’hommes en tout opposée à ta race, ennemie mortelle de ta personne qui ne lui a jamais fait de mal, et qui n’a aucune intention de lui en faire jamais ; ces cris, enfin, sont ceux d’animaux féroces, inconnus à la terre que tu quittes, et qui, comme le lion de l’Écriture, vont cherchant qui dévorer.
Mets le pied sur cette terre, et si tu échappes aux animaux, tu n’échapperas pas aux hommes.
Et pourquoi cela ? Parce que cette terre est séparée par un courant d’eau de sept lieues de cette autre terre ; parce qu’elle se rapproche d’un quart de degré de l’équateur ; enfin, parce qu’elle s’appelle l’Afrique au lieu de s’appeler l’Espagne, l’Italie, la Grèce ou la Sicile.
Comme Vial m’assura que la lune ne se lèverait point pour me tirer de mes doutes, j’allai me coucher, en recommandant qu’on me réveillât au point du jour.
Je fus réveillé tout naturellement par le quart du matin qui faisait son service de nettoyage ; je me levai, et je grimpai sur le pont.
C’était juste à ce moment de l’aube où la nuit qui va fuir lutte encore un moment avec le jour ; le vaste bassin dans lequel nous avions passé la nuit, et qui forme un demi-cercle, réfléchissant je ne sais quelle lumière, semblait un lac d’argent fondu, dans son encadrement de montagnes noires. D’un côté, on voyait se détacher, sur les premières lueurs matinales, la tour qui couronne le cap Malabatta, tandis que de l’autre, à peine distinguait-on, au revers du cap Spartelle, Tanger encore endormie au bord de la mer.
Les feux brûlaient toujours dans la montagne ; les dernières étoiles tremblaient encore au ciel.
Bientôt un brouillard rose sembla venir par le détroit, marchant d’orient en occident, glissant entre l’Europe et l’Afrique, et jetant une teinte d’une douceur infinie et d’une transparence merveilleuse sur toute la côte d’Espagne, depuis la Sierra de San-Matéo jusqu’au cap Trafalgar.
À la lueur de cette atmosphère lumineuse, on voyait blanchir les villages, et jusqu’aux maisons isolées semées sur la côte européenne.
Bientôt, sans que l’on vit le soleil encore, des rayons brillèrent derrière la chaîne de montagnes qui nous enveloppait ; seulement ces rayons, au lieu de ruisseler de haut en bas, s’élançaient de bas en haut ; on eût dit qu’après avoir frappé violemment le versant opposé, ils bondissaient divergents au-dessus de la montagne.
Peu à peu cette lumière s’agrandit, perdant sa forme radiée pour prendre celle d’un immense globe de feu ; à l’instant même où le commencement de l’orbe flamboyant parut au-dessus du cap Malabatta, qui continua de demeurer dans une demi-teinte bleuâtre, le versant oriental du cap Spartelle s’éclaira, tirant Tanger de l’ombre où elle était plongée, et dessinant sa silhouette crayeuse entre le sable doré de la plage et la cime verdoyante de la montagne.
En même temps, la mer commença de se teindre en rose, dans toute la partie que les rayons du soleil purent atteindre ; tandis que, partout où le crépuscule ou la nuit régnait encore, cette teinte allait se dégradant du rose à la couleur de soufre, et de la couleur de soufre au froid reflet de l’étain.
Enfin, le soleil s’élança vainqueur dans le ciel, et le Matin, comme dit Shakespeare, les pieds encore tout humides de rosée, descendit dans la plaine, après s’être balancé un instant à la cime des monts.
En ce moment, une caravane d’une dizaine de chameaux, de sept ou huit mulets, et de cinq ou six ânes, déboucha d’une gorge de la montagne, s’allongea onduleuse sur le sable, et s’avança vers Tanger, pareille à un serpent.
Moins heureux que la caravane, sans doute, en notre qualité de chrétiens, nous ne pouvions entrer à Tanger qu’après avoir pris patente, c’est-à-dire, vers neuf heures du matin.
Le commandant, en attendant celle heure obligée, nous proposa une partie de pêche dans la rade ; la mer est à tout le monde ; quant au rivage, c’était à nous de le conquérir.
La proposition, comme vous le pensez bien, madame, fut acceptée avec reconnaissance, non seulement par nous, mais encore par l’équipage.
C’est que la pêche est une double fête pour le matelot : fête d’abord à cause du plaisir qu’il y prend, fête ensuite à cause du poisson qu’il en rapporte.
En effet, le poisson est un supplément de vivres frais : puis le moyen, quand des hommes ont été deux heures dans l’eau, de ne pas accompagner le supplément de poisson d’un supplément de vin. Il faudrait qu’un commandant fût bien barbare pour laisser sécher l’extérieur sans réchauffer un peu l’intérieur.
Aussi en un instant la baleinière fut-elle prête, et la seine tirée de l’entrepont. Tout l’équipage, à l’exception des hommes absolument nécessaires à bord, eut congé pour six heures : c’était plus de temps qu’il n’en fallait.
Nous montâmes dans la yole avec Vial, qui dirigeait l’expédition ; Maquet et Rebec nous accompagnaient ; chacun de nous avait un fusil à deux coups, et douze carabines avaient été portées dans la baleinière ; d’ailleurs, le cas échéant, la corvette pouvait nous protéger de son canon.
Au moment où nous descendions l’escalier de tribord, nous vîmes une barque qui venait à nous en forçant de rames, et en faisant des signaux ; comme il était évident qu’elle avait particulièrement affaire au Véloce, nous attendîmes ; elle était montée par notre janissaire de la veille, El Arbi-Bernat. Monsieur Florat, du haut de la terrasse du consulat avait vu avec une lunette d’approche nos préparatifs de pêche, et il nous l’envoyait. C’était jour de marché à Tanger, le rivage de la mer allait bientôt se couvrir d’Arabes venant à la ville, et il redoutait quelque conflit entre les burnous et les redingotes.
Tout ceci nous fut expliqué en mauvais espagnol par El-Arbi – Bernat lui-même, qui paraissait heureux et lier de la mission qui lui était confiée.
Quand notre protecteur fut installé à l’avant du canot, un coup de sifflet du contremaître donna le signal du départ ; les rames, levées verticalement, s’abaissèrent frappant la vague d’un seul coup, et notre barque, ouvrant la marche, s’achemina vers le rivage.
Nous avons dit que le Véloce était un habitué de Tanger. Vial était donc familier avec la rade ; il se dirigea vers la montagne où avaient brillé des feux, et derrière laquelle s’était levé le soleil. Je demandai son nom, elle s’appelle le Scharff.
Au pied de la montagne, à la droite de l’ancien Tanger, l’Oued-Echak vient se jeter à la mer ; nous nous dirigeâmes vers l’embouchure de la rivière, la marée se retirait.
Nous nous engageâmes dans le lit même de l’Oued, mais il nous fut impossible de remonter bien haut ; notre barque était très chargée, et tirait près de trois pieds d’eau.
Enfin elle toucha, et force fut de nous arrêter.
Nous n’avions pas même essayé de descendre sur une autre partie du littoral : quoique la mer fût calme au large, la vague brisait violemment contre la côte, et en nous en approchant, nous courions risque de chavirer.
Deux matelots sautèrent à l’eau sans même se donner la peine de relever leur pantalon, présentèrent leurs épaules réunies à Vial, qui s’y installa comme sur une selle de côté, les prit chacun par la cravate, et les dirigea vers le bord, où ils le déposèrent sans accident.
Chacun de nous arriva à son tour par la même route et par le même moyen.
Quant au canot, redevenu flottant par notre absence, on continua de le tirer dans l’intérieur des terres, en lui faisant toujours suivre le lit du fleuve, jusqu’à ce qu’il touchât de nouveau ; cette fois, on ne s’en inquiéta plus ; le fleuve, qui allait diminuant, grâce au reflux, n’aurait bientôt plus assez d’eau pour le repousser à la mer.
Quant à la baleinière, elle n’avait pas pris tant de précaution ; elle avait cinglé vers le premier point de la côte venu ; arrivés à une certaine distance de la côte, les matelots s’étaient jetés à la mer comme des cormorans, et avaient poussé la baleinière jusque sur le sable.
En ce moment, une hirondelle de mer passa. Je lui envoyai un coup de fusil, l’oiseau blessé alla tomber de l’autre côté de l’Oued.
Au moment où je m’approchai du rivage, hésitant à me mettre à l’eau pour un si maigre gibier, je vis poindre derrière une dune l’extrémité d’un long fusil, puis le capuchon d’un burnous, puis une tête bronzée, puis tout le corps d’un Arabe aux jambes nues.
Sans doute il avait cru que le coup de fusil qu’il venait d’entendre avait été tiré par un compatriote : en nous apercevant il s’arrêta.
Je n’avais jamais vu d’Arabe que dans les tableaux de Delacroix ou de Vernet, que dans les dessins de Raffet et de Decamps ; cette représentation vivante du peuple africain, qui s’était graduellement dressée devant moi, et qui, s’arrêtant à mon aspect, se tenait à trente pas de moi, immobile, le fusil sur l’épaule et la jambe en avant, pareille à la statue du Calme ou plutôt de la Circonspection, me produisit une impression profonde. Il était évident que si j’eusse été seul, il eût fort méprisé ma carabine de dix-huit pouces, qui lui eût paru bien peu de chose près de son fusil de cinq pieds ; mais j’avais derrière moi une cinquantaine d’hommes de mon espèce, vêtus à peu près comme moi, et le nombre lui donnait à penser.
Comme nous eussions pu rester chacun d’un côté de ce nouveau Rubicon, jusqu’au jour du jugement dernier, sans que ni lui ni moi fissions un pas en avant, j’appelai El-Arbi-Bernat pour qu’il dît à l’Arabe de passer l’Oued, et, en le passant, de m’apporter mon hirondelle.
Notre janissaire échangea avec son compatriote quelques mots, à la suite desquels l’Arabe n’hésita plus, et, ramassant l’oiseau, passa le fleuve.
Tout en passant le fleuve, il regardait l’hirondelle ; elle avait l’aile cassée, et un grain de plomb lui avait traversé la poitrine.
Il me donna l’oiseau sans me dire une seule parole, et continua son chemin ; mais en passant près de Bernat, il lui adressa quelques mots.
– Que dit-il ? lui demandai-je.
– Il demande si vous avez tiré l’oiseau au vol.
– Et que lui avez-vous répondu ?
– Je lui ai répondu que oui.
– Est-ce à cette réponse que je lui ai vu faire de la tête un mouvement de doute ?
– C’est à cette réponse.
– Il n’y croit donc pas ?
– Pas plus qu’il ne faut.
– Le connaissez-vous ?
– Oui.
– Tire-t-il bien ?
– Il passe pour un des bons tireurs des environs.
– Rappelez-le donc, alors.
Le janissaire le rappela.
L’Arabe revint avec plus d’empressement que je n’eusse cru ; il était évident qu’il s’éloignait à regret, et qu’il avait un vif désir de nous voir de plus près, ou plutôt de voir nos armes.
Il s’arrêta à cinq pas de moi, grave et immobile.
Giraud et Boulanger, qui le suivaient leur crayon à la main, s’arrêtèrent aussi ; c’était comme moi le premier Arabe qu’ils voyaient, et à leur avidité à le croquer, on eût dit qu’ils craignaient de n’en point retrouver d’autres.
– Voilà un Français, lui dit le janissaire en me montrant, qui prétend qu’il tire mieux que toi.
Un léger sourire de doute crispa les lèvres de l’Arabe.
– Il a tué cet oiseau au vol, et il dit que tu n’en ferais pas autant.
– J’en ferais autant, répondit l’Arabe.
– Eh bien ! cela tombe à merveille, continua le janissaire ; tiens, voilà un oiseau qui vient, tire dessus, et tue-le.
– Le Français n’a pas tué le sien à balle.
– Non.
– Que dit-il ? demandai-je.
– Il dit que vous n’avez pas tué votre oiseau à balle.
– C’est juste. Voilà du plomb.
Et je lui présentai une charge de plomb du numéro cinq.
Il secoua la tête, et prononça quelques mots.
– Il dit que la poudre est chère, et qu’il y a trop d’hyènes et de panthères dans les environs pour user sa poudre sur des oiseaux.
– Dis-lui que je lui donnerai autant de fois six charges de poudre qu’il tirera de coups en joutant avec moi.
Le janissaire transmit mes paroles à l’Arabe. Pendant ce temps, Giraud et Boulanger croquaient toujours.
On voyait que le désir d’acquérir trente ou quarante charges de poudre, sans bourse délier, luttait chez l’Arabe avec la crainte de ne pas soutenir dignement sa réputation ; enfin la cupidité l’emporta.
Il débourra son fusil, tira la balle dehors, et tendit sa main pour que j’y versasse une charge de plomb.
Je m’empressai de me conformer au geste.
Le fusil bourré, il visita l’amorce, et attendit.
L’attente ne fut pas longue ; toute cette côte d’Afrique abonde en gibier. Un pluvier passa au-dessus de nos têtes, l’Arabe le chercha longtemps au bout de son long fusil, et croyant enfin l’avoir trouvé, il tira.
L’oiseau continua son chemin sans avoir perdu une seule plume.
Une bécassine s’était levée au coup ; elle passa à portée, je l’abattis.
L’Arabe sourit.
– Le Français tire bien, dit-il ; mais ce n’est pas avec du plomb que tire un véritable chasseur, c’est avec une balle.
Le janissaire me traduisit ces paroles.
– C’est vrai, répondis-je ; dites-lui que je suis absolument de son avis, et que s’il veut choisir lui-même un but, je m’engage à faire ce qu’il fera.
– Le Français me doit six charges de poudre, dit l’Arabe.
– C’est encore vrai, répondis-je. Que l’Arabe tende sa main.
Il tendit sa main ; j’y vidai le tiers de ma poire, à peu près.
Il tira son récipient en corne dans lequel il introduisit la poudre depuis le premier jusqu’au dernier grain, avec une attention et une adresse qui tenaient presque du respect.
Cette opération terminée, il était évident que notre homme n’eût pas mieux demandé que de s’en aller ; mais ce n’était point l’affaire de Giraud et de Boulanger, qui n’avaient pas achevé leur croquis.
Aussi, au premier mouvement qu’il fit :
– Rappelez à votre compatriote, dis-je à El-Arbi-Bernat, que nous avons chacun une balle à envoyer quelque part, où il voudra.
– Oui, dit l’Arabe.
Il regarda autour de lui, et trouva une espèce d’échalas à terre.
Il le ramassa, et se mit à chercher de nouveau.
J’avais dans ma poche une lettre d’un de mes neveux employé au domaine privé de Sa Majesté. Cette lettre dormait paisiblement dans son enveloppe carrée, ornée de son cachet rouge ; je la donnai à l’Arabe, me doutant que c’était cela qu’il cherchait, ou quelque chose d’approchant.
En effet, cette lettre faisait une cible excellente.
L’Arabe le comprit.
Il fendit le bout de l’échalas avec son couteau, y introduisit la lettre, alla planter l’échalas dans le sable, et revint vers nous en comptant vingt-cinq pas.
L’Arabe chargea son fusil.
J’avais une carabine à deux coups, et toute chargée : c’était une excellente arme de Devisme ; il y avait, dans chacun de ses canons, une de ces balles pointues avec lesquelles on tue un homme à quinze cents mètres ; je la pris des mains de Paul, qui en était le gardien ordinaire, et j’attendis.
L’Arabe visa avec un soin qui prouvait l’importance qu’il attachait à ne pas être vaincu une seconde fois.
Le coup partit, et écorna un des angles de l’enveloppe.
Si maîtres que les Arabes soient d’eux, le nôtre ne put s’empêcher de pousser un cri de joie en montrant l’angle enlevé.
Je fis signe que je le voyais à merveille.
L’Arabe m’adressa quelques mots avec vivacité.
– Il dit que c’est à ton tour, interpréta le janissaire.
– Oui certainement, répondis-je ; mais dis-lui qu’en France nous ne tirons pas à la cible de si près.
Je mesurai une distance double.
Il me regardait faire avec étonnement.
– Maintenant, continuai-je, dis-lui que je vais toucher du premier coup le but plus près du centre qu’il ne l’a touché, et du second, couper le bâton qui le soutient.
Je visai à mon tour avec une attention réelle. Il ne s’agissait pas d’être venu en Afrique pour y laisser un faux prospectus ; j’avais annoncé un programme, c’était à moi de le tenir.
Le premier coup partit, il touchait la cire.
Le second le suivit presque immédiatement, et brisa l’échalas.
L’Arabe jeta son fusil sur son épaule, et reprit son chemin interrompu, sans réclamer les six coups de poudre auxquels il avait droit.
Il était évident qu’il s’éloignait écrasé sous le poids de son infériorité, et que, dans ce moment, il doutait de tout, et même du prophète.
Il suivit la plage circulaire qui le conduisait à Tanger, et arriva à la ville, j’en suis sûr, sans s’être retourné une seule fois.
Deux ou trois Arabes qui, sur ces entrefaites, avaient passé l’Oued à leur tour, et qui avaient assisté à la lutte, s’éloignèrent aussi silencieux et presque aussi consternés que lui.
Le Maroc tout entier était humilié dans la personne de son représentant.
Cependant la pêche était organisée, et l’on commençait à tirer la seine.
La pêche à la seine est de toutes la plus émouvante : le nombre des personnes qu’elle emploie à tirer le filet, le cercle qu’elle embrasse, l’inattendu de son résultat, en font une passion que je comprends mieux que celle de la pêche à la ligne, quoique celle-ci mette en face l’adresse de l’homme et l’instinct des animaux, et soit, pour ainsi dire, la lutte de la civilisation et de la nature.
Pendant que nos hommes, dans l’eau jusqu’au cou, tiraient à qui mieux mieux en s’encourageant par leurs cris, l’heure du marché s’avançait, et le rivage, désert à notre arrivée, se peuplait peu à peu d’Arabes, venant des goums voisins et se rendant à la ville.
Cette longue procession, suivant le rivage de la mer et marchant à distance, mais suivant invariablement la même trace, était curieuse à voir ; elle se composait de vendeurs se rendant à Tanger.
Mais quels vendeurs, madame ! et la singulière idée qu’ils vous eussent donnée du commerce africain.





























