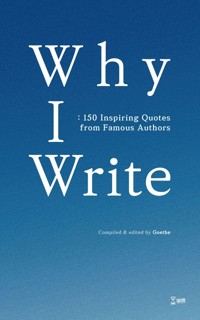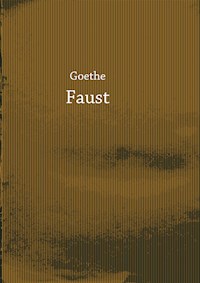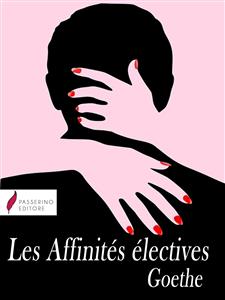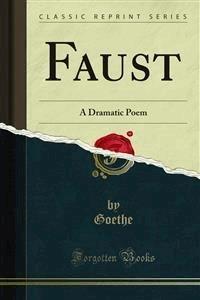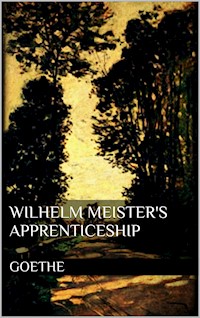2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alicia Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
♦ Cet ebook bénéficie d’une mise en page esthétique optimisée pour la lecture numérique. ♦
Ce magnifique roman de Goethe, le monstre sacré de la littérature allemande, nous plonge dans l’histoire funeste de riches aristocrates. L’auteur nous expose en chapitre 4 une théorie scientifique proche du
Traité de Bergman et de la
Théorie des
affinités chimiques des éléments entre eux d’Étienne-François Geoffroy. Il se base sur les rapports d’attirance et de répulsion entre les éléments chimiques pour expliquer les relations humaines. Sa fine connaissance de la tradition chimique et alchimique l’amène à considérer l’affinité comme une loi de la nature produisant aussi bien ses effets en chimie que chez les êtres vivants et dans le psychisme.
Goethe combine magistralement la science et le fantastique en attribuant aux objets des pouvoirs importants, illustrant ainsi les
liaisons entre les éléments humains. Bien que le fil rouge de l’ouvrage soit l’abnégation et le refoulement salvateur, le symbolisme est tel que chaque lecteur y trouvera sa propre interprétation.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Les Affinités électives
Goethe
Traduction parAloïse de Carlowitz
Table des matières
Vers inspirés par la vue du crâne de Schiller
Partie I
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
Chapitre 14
Chapitre 15
Chapitre 16
Chapitre 17
Chapitre 18
Partie II
Chapitre 19
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 22
Chapitre 23
Chapitre 24
Chapitre 25
Chapitre 26
Chapitre 27
Chapitre 28
Chapitre 29
Chapitre 30
Chapitre 31
Chapitre 32
Chapitre 33
Chapitre 34
Chapitre 35
Chapitre 36
Vers inspirés par la vue du crâne de Schiller
Au milieu d'un amas d'ossements humains j'appris comment les crânes alignés s'ajustent et s'accordent ; et je pensai au temps qui n'est plus, au temps qui s'est perdu dans le lointain grisâtre du passé. Les voila debout, étroitement rangés sur une même file, ceux qui naguère se haïssaient, et les bras robustes qui se sont porté des coups meurtriers, on les a entassés pêle-mêle, afin que, tranquilles et paisibles, ils puissent se reposer ici. Omoplates arrachées des épaules qui vous devaient leur vigueur, qui songe à vous demander quel fardeau il vous a fallu porter ? Et vous qui fûtes plus gracieusement actifs, vos mains, vos pieds délicats ont été jetés loin des sillons de la vie ! Pauvres pèlerins épuisés de fatigues, c'est en vain que vous avez espéré trouver le repos dans la nuit des sépulcres, on vous a fait revenir à la lumière du jour ! Quelque précieux qu'ait été le noyau, qui peut aimer l'écorce sèche et vide ? Elle a été tracée pour moi, adepte bienheureux, l'écriture dont le sens sacré ne se révèle pas à tout le monde ! Je l'ai saisi ce sens sacre lorsqu'au milieu d'une masse d'ossements inertes j'ai reconnu une image précieuse, inestimable. À son aspect, l'étroit espace qui renfermait ces ossements s'est élargi pour moi, ces murs glacés couverts de moisissures se sont échauffés, embaumés, et je me suis senti ranimé comme si une source de vie venait de s'échapper tout a coup du sein de la mort ! Comme elle m'enchantait mystérieusement la forme qui portait encore la trace de la pensée divine ! Son aspect m'a transporte sur les rives de cette mer dont les vagues agitées charrient sans cesse des creations éphémères et gonflées comme elle ! Vase mystérieux ! toi qui prononças des oracles, suis-je digne de te tenir dans ma main ? O toi, le plus grand des trésors, je veux te voler pieusement à la destruction, je veux te porter à l'air libre et me tourner dévotement avec toi vers les rayons du soleil. Quel plus grand bien l'homme peut-il espérer en ce monde, si ce n'est que la nature daigne se révéler a lui, en lui montrant comment elle fait s'évaporer en pur esprit ce qui était solide, et comment elle solidifie les productions du pur esprit.
Partie I
Chapitre 1
Un riche Baron, encore à la fleur de son âge et que nous appellerons Édouard, venait de passer dans sa pépinière les plus belles heures d’une riante journée d’avril. Les greffes précieuses qu’il avait fait venir de très-loin étaient employées, et, satisfait de lui-même, il renferma dans leur étui ses outils de pépiniériste. Le jardinier survint et admira très-sincèrement le travail de son maître.
— Est-ce que tu n’as pas vu ma femme ? lui demanda Édouard en faisant un mouvement pour s’éloigner.
— Si, Monseigneur, Madame est dans les nouvelles plantations. La cabane de mousse qu’elle fait faire sur la montagne, en face du château, sera terminée aujourd’hui. Quel délicieux point de vue vous aurez là ! Au fond, le village ; un peu à droite, l’église et le clocher, au-dessus duquel, de cette hauteur, le regard se glisse au loin. En face, le château et les jardins.
— C’est bien, répliqua Édouard. A quelques pas d’ici j’ai vu travailler les ouvriers.
— Et plus loin, à droite, continua le jardinier, s’ouvre la riche vallée avec ses prairies couvertes d’arbres, dans un joyeux lointain. Quant au sentier à travers les rochers, je n’ai jamais rien vu de mieux disposé. En vérité, Madame s’y entend, c’est un plaisir de travailler sous ses ordres.
— Va la prier de ma part de m’attendre ; je veux qu’elle me fasse admirer ses nouvelles créations.
Le jardinier s’éloigna en hâte. Le Baron le suivit lentement, visita en passant les terrasses et les serres, traversa le ruisseau et arriva bientôt à la place où la route se divisait en deux sentiers : l’un et l’autre conduisaient aux plantations nouvelles ; le plus court passait par le cimetière, le plus long par un bosquet touffu. Édouard choisit le dernier et se reposa sur un banc, judicieusement placé au point où le chemin commençait à devenir pénible, puis il gravit la montée qui, par plusieurs marches et points d’arrêts, le conduisit, par un sentier étroit et plus ou moins rapide, jusqu’à la cabane de mousse.
Charlotte reçut son époux à l’entrée de cette cabane, et le fit asseoir de manière qu’à travers la porte et les fenêtres ouvertes, les différents points de vue se présentèrent à lui dans toute leur beauté, mais resserrés dans des cadres étroits. Ces tableaux le charmèrent d’autant plus, que son imagination les voyait déjà parés de tout l’éclat printanier, que quelques semaines de plus ne pouvaient manquer de leur donner en effet.
— Je n’ai qu’une observation à faire, lui dit-il : la cabane me paraît un peu trop petite.
— Il y a assez de place pour nous deux, répondit Charlotte.
— Sans doute, peut-être même pour un troisième…
— Pourquoi pas ? à la rigueur, on pourrait encore admettre un quatrième. Quant aux sociétés plus nombreuses, nous avons pour elles d’autres points de réunion.
— Puisque nous voilà seuls, tranquilles et contents, dit Édouard, je veux te confier quelque chose qui, depuis longtemps, me pèse sur le cœur. Jusqu’ici j’ai vainement cherché l’occasion de te le dire.
— Je n’ai pas été sans m’en apercevoir.
— Je dois te l’avouer, mon amie, si j’avais pu retarder encore la réponse définitive qu’on me demande, si je n’étais pas forcé de la donner demain au matin, j’aurais peut-être encore continué à me taire.
— Voyons, de quoi s’agit-il ? demanda Charlotte avec une prévenance gracieuse.
— De mon ami, le capitaine ! Tu sais qu’il n’a pas mérité l’humiliation qu’on vient de lui faire subir, et tu comprends tout ce qu’il souffre. Être mis à la retraite à son âge, avec ses talents, son esprit actif, son érudition… Mais pourquoi envelopper mes vœux à son sujet dans un long préambule ? Je voudrais qu’il pût venir passer quelque temps avec nous.
— Ce projet, mon ami, demande de mûres réflexions ; il faut l’envisager sous ses différents points de vue.
— Je suis prêt à te donner tous les éclaircissements que tu pourras désirer. La dernière lettre du capitaine annonce une profonde tristesse. Ce n’est pas sa position financière qui l’afflige, ses besoins sont si bornés ! Au reste, ma bourse est la sienne, et il ne craint pas d’y puiser. Dans le cours de notre vie, nous nous sommes rendu tant de services, qu’il nous sera toujours impossible d’arrêter définitivement nos comptes. Son seul chagrin est de se voir réduit à l’inaction, car il ne connaît d’autre bonheur que d’employer utilement ses hautes facultés. Que lui reste-t-il à faire désormais ? se plonger dans l’oisiveté ou acquérir des connaissances nouvelles, quand celles qu’il possède si complètement lui sont devenues inutiles ? En un mot, chère enfant, il est très-malheureux, et l’isolement dans lequel il vit augmente son malheur.
— Mais je l’ai recommandé à nos connaissances, à nos amis ; ces recommandations ne sont pas restées sans résultat ; on lui a fait des offres avantageuses.
— Cela, est vrai ; mais ces offres augmentent son tourment, car aucune d’elles ne lui convient. Ce n’est pas l’utile emploi, c’est l’abnégation de ses principes, de ses capacités, de sa manière d’être qu’on lui demande. Un pareil sacrifice est au-dessus de ses forces. Plus je réfléchis sur tout cela, plus je sens le désir de le voir près de nous.
— Il est beau, il est généreux de ta part de t’intéresser ainsi au sort d’un ami ; mais permets-moi de te rappeler que tu dois aussi quelque chose à toi-même, à moi.
— Je ne l’ai pas oublié, mais je suis convaincu que le capitaine sera pour nous une société aussi utile qu’agréable. Je ne parlerai pas des dépenses qu’il pourrait nous occasionner, puisque son séjour ici les diminuerait au lieu de les augmenter. Quant à l’embarras, je n’en prévois aucun. L’aile gauche de notre château est inhabitée, il pourra s’y établir comme il l’entendra, le reste s’arrangera tout seul. Nous lui rendrons un service immense, et il nous procurera à son tour plus d’un plaisir, plus d’un avantage. J’ai depuis longtemps le désir de faire lever un plan exact de mes domaines, il dirigera ce travail. Tu veux faire cultiver toi-même nos terres, dès que les baux de nos fermiers seront expirés ; mais avons-nous les connaissances nécessaires pour une pareille entreprise ? lui seul pourra nous aider à les acquérir ; je ne sens que trop combien j’ai besoin d’un pareil ami. Les agronomes qui ont étudié cette matière dans les livres et dans les établissements spéciaux, raisonnent plus qu’ils n’instruisent, car leurs théories n’ont pas passé au creuset de l’expérience ; les campagnards tiennent trop aux vieilles routines, et leurs enseignements sont toujours confus, et souvent même volontairement faux. Mon ami réunit l’expérience à la théorie sur ce point, et sur une foule d’autres dont je me promets les plus heureux résultats, surtout par rapport à toi. Maintenant je te remercie de l’attention avec laquelle tu as bien voulu m’écouter ; dis-moi à ton tour franchement ce que tu penses, je te promets de ne pas t’interrompre.
— Dans ce cas, répondit Charlotte, je débuterai par une observation générale. Les hommes s’occupent surtout des faits isolés et du présent, parce que leur vie est tout entière dans l’action, et par conséquent dans le présent. Les femmes, au contraire, ne voient que l’enchaînement des divers événements, parce que c’est de cet enchaînement que dépend leur destinée et celle de leur famille, ce qui les jette naturellement dans l’avenir et même dans le passé. Associe-toi un instant à cette manière de voir, et tu reconnaîtras que la présence du capitaine chez nous, dérangera la plupart de nos projets et de nos habitudes.
— J’aime à me rappeler nos premières relations, continua-t-elle, et, surtout, à t’en faire souvenir. Dans notre première jeunesse, nous nous aimions tendrement ; et l’on nous a séparés parce que ton père, ne comprenant d’autre bonheur que la fortune, te fit épouser une femme âgée, mais riche ; le mien me maria avec un homme que j’estimais sans pouvoir l’aimer, mais qui m’assura une belle position. Nous sommes redevenus libres, toi le premier, et ta femme, qu’on aurait pu appeler ta mère, te fit l’héritier de son immense fortune. Tu profitas de ta liberté pour satisfaire ton amour pour les voyages ; à ton retour j’étais veuve. Nous nous revîmes avec plaisir, avec bonheur. Le passé nous offrait d’agréables souvenirs, nous aimions ces souvenirs, et nous pouvions impunément nous y livrer ensemble. Tu m’offris ta main, j’hésitai longtemps… Nous sommes à peu près du même âge ; les femmes vieillissent plus vite que les hommes ; tu me paraissais trop jeune… Enfin, je n’ai pas voulu te refuser ce que tu regardais comme ton unique bonheur… Tu voulais te dédommager des agitations et des fatigues de la cour, de la carrière militaire et des voyages ; tu voulais jouir enfin de la vie à mes côtés, mais avec moi seule.
Je me résignai à placer ma fille unique dans un pensionnat, où elle pouvait, au reste, recevoir une éducation plus convenable qu’à la campagne. Je pris le même parti pour ma chère nièce Ottilie, qui eût, peut-être, été plus à sa place près de moi et m’aidant à diriger ma maison. Tout cela s’est fait de ton consentement, et dans le seul but de pouvoir vivre pour nous seuls, et jouir dans toute sa plénitude du bonheur que nous avons vainement désiré dans notre première jeunesse, et que la marche des événements venait enfin de nous accorder. C’est dans ces dispositions que nous sommes arrivés dans ce séjour champêtre ; je me suis chargée des détails et de l’intérieur, et toi de l’ensemble et des relations extérieures. Je me suis arrangée de manière à prévenir chacun de tes désirs, et à ne vivre que pour toi. Laisse-nous essayer, du moins pendant quelque temps encore, jusqu’à quel point nous pourrons ainsi nous suffire à nous-mêmes.
— Il n’est que trop vrai, s’écria le Baron, l’enchaînement des événements, voilà l’élément des femmes, aussi ne faut-il jamais vous laisser enchaîner vos objections, où se résigner d’avance à vous donner gain de cause. Je conviens donc que tu as eu complètement raison jusqu’à ce jour. Tout ce que nous avons planté et bâti depuis notre séjour ici est bon et utile, mais n’y ajouterons-nous plus rien ? Tous ces beaux plans n’auront-ils pas d’autres développements ? Tout ce que je fais dans les jardins, tes embellissements dans le parc et les alentours, ne serviront-ils jamais qu’à la satisfaction de deux ermites ?
— Je te comprends, mon ami ; mais songe que nous devons, avant tout, éviter d’introduire dans notre cercle étroit, quelque chose d’étranger et par conséquent de nuisible. Tous nos projets ne peuvent se réaliser qu’à condition que nous ne serons jamais que nous deux. Tu voulais me communiquer avec suite ton journal de voyages, et y ajouter, à cette occasion, certains papiers qui en font partie. Encouragé par l’intérêt que m’inspirent ces précieuses feuilles, éparses et confuses, tu te proposais d’en faire un tout aussi agréable pour nous que pour les autres. J’ai promis de t’aider à copier, et nous étions déjà heureux par la pensée, en songeant que nous pourrions parcourir ainsi ensemble, commodément, mystérieusement et idéalement ce monde, dont nous nous sommes exilés par notre propre volonté. Et puis, n’as-tu pas repris ta flûte afin de m’accompagner sur le piano pendant les soirées ? Ne comptes-tu pour rien les voisins qui viennent nous voir souvent, et que nous visitons à notre tour ? Quant à moi, j’ai trouvé dans tout ceci des ressources suffisantes pour passer l’été le plus agréable de ma vie.
Édouard passa la main sur son front.
— Tout ce que tu me dis là est aussi sage qu’aimable, et cependant je ne puis m’empêcher de croire que la présence du capitaine, loin de troubler notre paisible bonheur, lui prêterait un charme nouveau. Il m’a suivi dans une partie de mes voyages, et il a recueilli, de son côté, des notes qui feraient de ma relation un ensemble aussi complet qu’amusant.
— Tu me forces à t’avouer toute la vérité, dit Charlotte avec un léger signe d’impatience, un secret pressentiment m’avertit qu’il ne résultera rien de bon de ton projet.
— Allons, répondit Édouard en souriant, il faut en prendre son parti, les femmes sont invulnérables : d’abord si sensées, qu’il est impossible de les contredire ; si aimantes, qu’on leur cède avec bonheur ; si sensibles, qu’on craint de les affliger ; elles finissent par devenir prophétiques au point de nous effrayer.
— Je ne suis pas superstitieuse, répliqua Charlotte, et je ne ferais aucun cas des vagues pressentiments, s’ils n’étaient que cela ; mais ils sont presque toujours un souvenir confus des conséquences heureuses ou malheureuses que nous avons vues découler, chez les autres, des actions que nous sommes sur le point de commettre nous-mêmes. Il n’y a rien de plus important dans la vie intérieure que l’admission d’un tiers. J’ai connu des parents, des époux, dont l’existence a été entièrement bouleversée par une pareille admission.
— Cela peut arriver chez des individus qui vivent au hasard, mais jamais chez des personnes qui, éclairées par l’expérience, ont la conscience d’elles-mêmes.
— Cette conscience, mon ami, est rarement une arme suffisante, et souvent même elle est dangereuse pour celui qui s’en sert. Au reste, puisque nous n’avons pu nous convaincre, ne précipitons rien, accorde-moi quelques jours.
— Au point où en sont les choses, ce délai n’empêcherait point la précipitation. Nous nous sommes exposé nos raisons, il s’agit de décider lesquelles méritent la préférence, et je crois que ce que nous aurions de plus sage à faire, serait de tirer au sort.
— Je sais que, dans les cas douteux, tu aimes à te confier aux chances d’un coup de des ; mais dans une circonstance aussi grave, un pareil moyen serait un sacrilège.
— Mais le messager attend, s’écria Édouard, que faut-il que je réponde au capitaine ?
— Une lettre calme, sage, amicale.
— C’est-à-dire des riens ?
— Il est des cas où il vaut mieux répondre des riens que de ne pas répondre du tout.
Chapitre 2
En rappelant à son mari les principaux événements de leur passé, et les plans qu’ils avaient arrêtés ensemble pour leur bonheur présent et à venir, Charlotte avait éveillé en lui des souvenirs fort agréables. Ce fut sous l’empire de ces souvenirs qu’il entra dans sa chambre pour répondre au capitaine. Forcé de convenir que jusqu’à ce moment il avait trouvé dans la société exclusive de sa femme, l’accomplissement parfait de ses vœux les plus chers, il se promit d’écrire à son ami l’épître la plus affectueuse et la plus insignifiante du monde. Lorsqu’il s’approcha de son bureau, le hasard lui fit tomber sous la main la dernière lettre de cet ami. Il la relut machinalement. La triste situation de cet homme excellent se présenta de nouveau à sa pensée, les sentiments douloureux qui l’assiégeaient depuis plusieurs jours se réveillèrent, et il lui parut impossible d’abandonner son ami à la cruelle position où il se trouvait réduit ; sans se l’être attirée par une faute ni même par une imprudence.
Le Baron n’était pas accoutumé à se refuser une satisfaction quelconque. Enfant unique de parents fort riches, tout avait constamment cédé à ses caprices et à ses fantaisies. C’était à force de les flatter qu’on l’avait décidé à devenir le mari d’une vieille femme, qui avait cherché à son tour à faire oublier son âge par des attentions et des prévenances infinies. Devenu libre par la mort de cette femme, et maître d’une grande fortune, naturellement modéré dans ses désirs, libéral, généreux, bienfaisant et brave, il n’avait jamais connu les obstacles que la société oppose à la plupart de ses membres. Jusqu’alors, tout avait marché au gré de ses désirs ; une fidélité opiniâtre et romanesque avait fini par lui assurer la main de Charlotte, et la première opposition ouverte qui se posait franchement devant lui et qui l’empêchait d’offrir un asile à l’ami de son enfance, et de régler ainsi les comptes de toute sa vie, venait de cette même Charlotte. Il était de mauvaise humeur, impatient, il prit et reprit plusieurs fois la plume, et ne put se mettre d’accord avec lui-même sur ce qu’il devait écrire. Contrarier sa femme, lui paraissait aussi impossible que de se contrarier lui-même ou de faire ce qu’elle désirait ; et dans l’agitation où il se trouvait, il lui était impossible d’écrire une lettre calme. Il était donc bien naturel qu’il cherchât à gagner du temps. A cet effet il adressa quelques mots à son ami, et le pria de lui pardonner de ne pas lui avoir écrit plus tôt et de ne pas lui en dire davantage en ce moment. Puis il promit de lui envoyer incessamment une lettre explicative et tranquillisante.
Le lendemain matin, Charlotte profita d’une promenade qu’elle fit avec son mari, pour faire revenir l’entretien sur le sujet de la veille ; car elle était convaincue que le meilleur moyen de combattre une résolution prise, était d’en parler souvent.
Édouard reprit cette discussion avec plaisir. D’un caractère impressionnable, il s’animait facilement, et la vivacité de ses désirs allait souvent jusqu’à l’impatience ; mais, craignant toujours d’offenser ou de blesser, il était encore aimable lors même qu’il se rendait importun. N’ayant pu convaincre sa femme, il parvint à la charmer, presque à la séduire.
— Je te devine ! s’écria-t-elle, tu veux que j’accorde aujourd’hui à l’amant ce que j’ai refusé hier au mari. Si j’ai encore la force de résister à des vœux que tu m’exprimes d’une manière si séduisante, il faut du moins que je te fasse une révélation à peu près semblable à la tienne. Oui, je me trouve dans le même cas que toi, et je me suis volontairement imposé le sacrifice que j’ai osé espérer de ta tendresse.
— Voilà qui est charmant, répondit Édouard, il paraît que, dans le mariage, rien n’est plus ut ile que les discussions, puisque c’est par elles que l’on apprend à se connaître.
— C’est possible. Apprends donc qu’Ottilie est pour moi ce que le capitaine est pour toi. La pauvre enfant est très-malheureuse dans son pensionnat. Ma fille Luciane, née pour briller dans un monde élégant, s’y forme pour ce monde. Elle apprend les langues étrangères, l’histoire, et autres sciences semblables, comme elle joue des sonates et des variations à livre ouvert. Douée d’une grande vivacité et d’une mémoire heureuse, on peut dire d’elle que, dans le même instant, elle oublie tout et se souvient de tout. Ses allures faciles et gracieuses, sa danse légère, sa conversation animée la distinguent de toutes ses compagnes, et un certain esprit de domination inné chez elle, en font la reine de ce petit cercle. La maîtresse du pensionnat voit en elle une petite divinité qui se développe sous sa main, et dont l’éclat rejaillira sur sa maison et y amènera une foule de jeunes personnes que leurs parents voudront faire arriver à ce même degré de perfection. Aussi les lettres que l’on m’écrit sur son compte, ne sont-elles que des hymnes à sa louange, qu’heureusement je sais fort bien traduire en prose. Quant à la pauvre Ottilie, on ne m’en parle que pour accuser la nature de n’avoir placé aucune disposition artistique, aucun germe de perfectionnement intellectuel dans une créature si bonne et si jolie. Cette erreur ne m’étonne point, car je retrouve dans Ottilie l’image vivante de sa mère, ma meilleure amie, qui a grandi à mes côtés. Je suis persuadée que sa fille serait bientôt une femme accomplie, s’il m’était possible de l’avoir sous ma direction.
Nos conventions ne me le permettent pas, et je sais qu’il est dangereux de tirailler sans cesse le cadre dans lequel on a cru devoir enfermer sa vie. Je me soumets à cette nécessité ; je fais plus : je souffre que ma fille, trop fière de ses avantages sur une parente qui doit tout à ma bienfaisance, en abuse parfois. Hélas ! qui de nous a réellement assez de supériorité pour ne jamais la faire peser sur personne ? et qui de nous est placé assez haut pour ne jamais être réduit à se courber sous une domination injuste ? Le malheur d’Ottilie la rend plus chère à mes yeux ; ne pouvant l’appeler près de moi, je cherche à la placer dans une autre institution. Voilà où j’en suis. Tu vois, mon bien-aimé, que nous nous trouvons dans le même embarras ; supportons-le avec courage, puisque nous ne pourrions sans danger le faire disparaître l’un par l’autre.
— Je reconnais bien là les bizarreries de la nature humaine, dit Édouard en souriant, nous croyons avoir fait merveille, quand nous sommes, parvenus à écarter les objets de nos inquiétudes. Dans les considérations d’ensemble, nous sommes capables de grands sacrifices ; mais une abnégation dans les détails de chaque instant, est presque toujours au-dessus de nos forces : ma mère m’a fourni le premier exemple de cette vérité. Tant que j’ai vécu près d’elle, il lui a été impossible de maîtriser les craintes de chaque instant dont j’étais l’objet. Si je rentrais une heure plus tard que je ne l’avais promis, elle s’imaginait qu’il m’était arrivé quelque grand malheur ; et quand la pluie ou la rosée avait mouillé mes vêtements, elle prévoyait pour moi une longue suite de maladies. Je me suis établi chez moi, j’ai voyagé, et elle a toujours été aussi tranquille sur mon compte que si je ne lui avais jamais appartenu.
— Examinons notre position de plus près, continua-t-il, et nous reconnaîtrons, bientôt qu’il serait aussi insensé qu’injuste de laisser, sans autre motif que celui de ne pas déranger nos petits calculs personnels, deux êtres qui nous regardent de si près, sous l’empire d’un malheur qu’ils n’ont pas mérité. Oui, ce serait là de l’égoïsme, ou je ne sais plus de quel nom il faudrait qualifier cette conduite. Fais venir ton Ottilie, souffre que mon Capitaine s’installe ici, et remettons-nous à la garde de Dieu pour ce qui pourra en résulter.
— S’il ne s’agissait que de nous, dit Charlotte, j’hésiterais moins ; mais songe que le Capitaine est à peu près de ton âge, c’est-à-dire à cet âge (il faut bien que je te dise cette flatterie en face) où les hommes commencent à devenir réellement dignes d’un amour constant et vrai. Est-il prudent de le mettre en contact avec une jeune fille aussi aimable, aussi intéressante qu’Ottilie ?
— En vérité, répondit le Baron, l’opinion que tu as de ta nièce me paraîtrait inexplicable, si je n’y voyais pas le reflet de ta vive tendresse pour sa mère. Elle est gentille, j’en conviens, je me rappelle même que le Capitaine me la fit remarquer, lorsque je la vis chez ta tante, il y a un an environ. Ses yeux, surtout, sont fort bien, et cependant ils ne m’ont nullement impressionné.
— Cela est très-flatteur pour moi, car j’étais présente. Ton amour pour ta première amie t’avait rendu insensible aux charmes naissants d’une enfant ; je sens le prix de tant de constance, aussi ne voudrais-je jamais vivre que pour toi.
Charlotte était sincère, et cependant elle cachait à son mari qu’alors elle avait eu l’intention de lui faire épouser Ottilie, et qu’à cet effet elle avait prié le Capitaine de la lui faire remarquer, car elle n’osait se flatter qu’il fût resté fidèle à l’amour qui les avait unis jadis. De son côté le Baron était tout entier sous l’empire du bonheur que lui causait la disparition inattendue du double obstacle qui l’avait séparé de Charlotte, et il ne songeait qu’à former enfin un lien qu’il avait pendant si longtemps vainement désiré.
Les époux allaient retourner au château par les plantations nouvelles, lorsqu’un domestique accourut au-devant d’eux et leur cria en riant :
— Revenez bien vite, Monseigneur ; M. Mittler vient d’entrer au galop dans la cour du château. Sans se donner le temps de mettre pied à terre, il nous a tous rassemblés par ses cris : Allez ! courez ! nous a-t-il dit, appelez votre maître et votre maîtresse, demandez-leur s’il y a vraiment péril dans la demeure, entendez-vous, s’il y a péril dans la demeure ? Vite, vite, courez !
— Le drôle d’homme, dit Édouard, il me semble pourtant qu’il arrive à propos, qu’en penses-tu, Charlotte ? Dis à notre ami, continua-t-il en s’adressant au domestique, qu’il y a, en effet, péril dans la demeure, et que nous te suivons de près. En attendant, conduis-le dans la salle à manger, fais-lui servir un bon déjeuner, et n’oublie pas son cheval.
Puis il pria sa femme de se rendre avec lui au château par le chemin le plus court. Ce chemin traversait le cimetière, aussi ne le prenait-il jamais que lorsqu’il y était forcé. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu’il vit que là, aussi, Charlotte avait su prévenir ses désirs et deviner ses sentiments ! En ménageant autant que possible les anciens monuments funéraires, elle avait fait niveler le terrain, et tout disposé de manière que cette enceinte lugubre n’était plus qu’un enclos agréable, sur lequel l’œil et l’imagination se reposaient avec plaisir.
Rendant à la pierre la plus ancienne l’honneur qui lui était dû, elle les avait fait ranger toutes, par ordre de date, le long de la muraille ; plusieurs d’entre elles même avaient servi à orner le socle de l’église. A cette vue, Édouard agréablement surpris pressa la main de Charlotte, et ses yeux se remplirent de larmes.
Leur hôte extravagant ne tarda pas à les faire partir de ce lieu. N’ayant pas voulu les attendre au château, il donna de l’éperon à son cheval, traversa le village et s’arrêta à la porte du cimetière d’où il leur adressa ces paroles en criant de toutes ses forces.
— Est-ce que vous ne vous moquez pas de moi ? y a-t-il vraiment péril ! en la demeure ? En ce cas je reste à dîner avec vous, mais ne me retenez pas en vain, j’ai encore tant de choses à faire aujourd’hui.
— Puisque vous vous êtes donné la peine de venir jusqu’ici, dit Édouard sur le même ton, faites quelques pas de plus, et voyez comment Charlotte a su embellir ce lieu de deuil.
— Je n’entrerai ici ni à pied, ni cheval, ni en carrosse, répondit le cavalier ; je ne veux rien avoir à démêler avec ceux qui dorment là, en paix ; c’est déjà bien assez que d’être obligé de souffrir qu’un jour on m’y porte les pieds en avant. Allons, voyons, avez-vous sérieusement besoin de moi ?
— Très-sérieusement, répondit Charlotte. C’est pour la première fois, depuis notre mariage, que mon mari et moi, nous nous trouvons dans un embarras dont nous ne savons comment nous tirer.
— Vous ne m’avez pas l’air d’être réduits à cette extrémité-là ; mais puisque vous le dites, je veux bien le croire. Si vous m’avez préparé une déception, je ne m’occuperai plus jamais de vous. Suivez-moi aussi vite que vous le pourrez ; je ralentirai le pas de mon cheval, cela le reposera.
Arrivés dans la salle à manger où le déjeuner était servi, Mittler raconta avec feu ce qu’il avait fait et ce qu’il lui restait encore à faire dans le courant de la journée.
Cet homme singulier avait été pendant sa jeunesse ministre d’une grande paroisse de campagne, où, par son infatigable activité, il avait apaisé toutes les querelles de ménage et terminé tous les procès. Tant qu’il fut dans l’exercice de ses fonctions, il n’y eut pas un seul divorce dans sa paroisse, et pas un procès ne fut porté devant les tribunaux. Pour atteindre ce but il avait été forcé d’étudier les lois, et il était devenu capable de tenir tête aux avocats les plus habiles. Au moment où le gouvernement venait d’ouvrir les yeux sur son mérite, et allait l’appeler dans la capitale, afin de le mettre à même d’achever, dans une sphère plus élevée, le bien qu’il avait commencé dans son modeste cercle d’activité, le hasard lui fit gagner à la loterie une somme qu’il employa aussitôt à l’achat d’une petite terre où il résolut de passer sa vie. S’en remettant, pour l’exploitation de cette terre, aux soins de son fermier, il se consacra tout entier à la tâche pénible d’étouffer les haines et les mésintelligences dès leur point de départ. A cet effet, il s’était promis de ne jamais s’arrêter sous un toit où il n’y avait rien à calmer, rien à apaiser, rien à réconcilier. Les personnes qui aiment à trouver des indices prophétiques dans les noms propres soutenaient q u’il avait été prédestiné à cette carrière parce qu’il s’appelait Mittler (_médiateur_).
On servit le dessert et Mittler pria sérieusement les époux de ne pas retarder davantage les confidences qu’ils avaient à lui faire, parce qu’immédiatement après le café, il serait forcé de partir.
Les époux s’exécutèrent alternativement et de bonne grâce. Il les écouta d’abord avec attention, puis il se leva d’un air contrarié, ouvrit la fenêtre et demanda son cheval.
— En vérité, dit-il, ou vous ne me connaissez point, ou vous êtes de mauvais plaisants. Il n’y a ici ni querelle ni division, et, par conséquent, rien à faire pour moi. Me croiriez-vous né, par hasard, pour donner des conseils ? Grand merci d’un pareil métier, c’est le plus mauvais de tous. Que chacun se conseille soi-même et fasse ce dont il ne peut s’abstenir : s’il s’en trouve bien, qu’il se félicite de sa haute sagesse et jouisse de son bonheur ; s’il s’en trouve mal, alors je suis là. Celui qui veut se débarrasser d’un mal quelconque, sait toujours ce qu’il veut ; mais celui qui cherche le mieux, est aveugle. Oui, oui, riez tant que vous voudrez, il joue à colin-maillard ; à force de tâtonner il saisit bien quelque chose, mais quoi ? Voilà la question. Faites ce que vous voudrez, cela reviendra au même ; oui, appelez vos amis près de vous ou laissez-les où ils sont, qu’importe ? J’ai vu manquer les combinaisons les plus sages, j’ai vu réussir les projets les plus absurdes. Ne vous cassez pas la tête d’avance ; ne vous la cassez même pas quand il sera résulté quelque grand malheur du parti que vous prendrez ; bornez-vous à me faire appeler, je vous tirerai d’affaire ; d’ici là, je suis votre serviteur.
A ces mots il sortit brusquement et s’élança sur son cheval, sans avoir voulu attendre le café.
— Tu le vois maintenant, dit Charlotte à son mari, l’intervention d’un tiers est nulle, quand deux personnes étroitement unies ne peuvent plus s’entendre. Nous voilà plus embarrassés, plus indécis que jamais.
Les époux seraient sans doute restés longtemps dans cette incertitude, sans l’arrivée d’une lettre du Capitaine qui s’était croisée avec celle du Baron.
Fatigué de sa position équivoque, ce digne officier s’était décidé à accepter l’offre d’une riche famille qui l’avait appelé près d’elle, parce qu’elle le croyait assez spirituel et assez gai pour l’arracher à l’ennui qui l’accablait. Édouard sentit vivement tout ce que son ami aurait à souffrir dans une pareille situation.
— L’y exposerons-nous, s’écria-t-il, parle ; Charlotte, en auras-tu la cruauté ?
— Je ne sais, répondit-elle ; mais il me semble que, tout bien considéré, notre ami Mittler a raison. Les résultats de nos actions dépendent des chances du hasard qu’il ne nous est pas donné de prévoir ; chaque relation nouvelle peut amener beaucoup de bonheur ou beaucoup de malheur, sans que nous ayons le droit de nous en accuser ou de nous en faire un mérite. Je ne me sens pas la force de te résister plus longtemps. Souviens-toi seulement que l’essai que nous allons faire n’est pas définitif ; j’insisterai de nouveau auprès de mes amis, afin d’obtenir pour le Capitaine un poste digne de lui et qui puisse le rendre heureux.
Édouard exprima sa reconnaissance avec autant d’enthousiasme que d’amabilité. L’esprit débarrassé de tout souci, il s’empressa d’écrire à son ami, et pria Charlotte d’ajouter quelques lignes à sa lettre. Elle y consentit. Mais au lieu de s’acquitter de cette tâche avec la facilité gracieuse qui la caractérisait, elle y mit une précipitation passionnée qui ne lui était pas ordinaire. Il lui arriva même de faire sur le papier une tache d’encre qui s’agrandit à mesure qu’elle cherchait à l’effacer, ce qui la contraria beaucoup.
Édouard la plaisanta sur cet accident, et, comme il y avait encore de la place pour un second _Post-Scriptum_, il pria son ami de voir dans cette tache d’encre, la preuve de l’impatience avec laquelle Charlotte attendait son arrivée, et de mettre autant d’empressement dans ses préparatifs de voyage qu’on en avait mis à lui écrire.
Un messager emporta la lettre, et le Baron crut devoir exprimer sa reconnaissance à sa femme, en l’engageant de nouveau à retirer Ottilie du pensionnat, pour la faire venir près d’elle. Charlotte ne jugea pas à propos de prendre une pareille détermination avant d’y avoir mûrement réfléchi. Pour détourner l’entretien de ce sujet, elle engagea son mari à l’accompagner au piano avec sa flûte, dont il jouait fort médiocrement. Quoique né avec des dispositions musicales, il n’avait eu ni le courage ni la patience de consacrer à ce travail le temps qu’exige toujours le développement d’un talent quelconque. Allant toujours ou trop vite ou trop doucement, il eût été impossible à toute autre qu’à Charlotte, de tenir une partie avec lui. Maîtresse absolue de l’instrument sur lequel elle avait acquis une grande supériorité, elle pressait et ralentissait tour à tour la mesure sans altérer la nature du morceau, et remplissait ainsi, envers son mari, la double tâche de chef d’orchestre et de femme de ménage, puisqu’il est du devoir de l’un et de l’autre de maintenir l’ensemble dans son mouvement régulier, en dépit des déviations réitérées des détails.
Chapitre 3
Le Capitaine arriva enfin, il s’était fait précéder par une lettre tellement sage et sensée, que Charlotte se sentit complètement rassurée. La justesse avec laquelle il envisageait sa position et celle de ses amis, leur permit à tous d’espérer un heureux avenir.
Pendant les premières heures la conversation fut animée, presque fatigante, comme cela arrive toujours entre amis qui ne se sont pas vus depuis longtemps. Vers le soir, Charlotte proposa d’aller visiter les plantations nouvelles. Le Capitaine se montra très-sensible aux diverses beautés de la contrée que les ingénieux plans de Charlotte faisaient ressortir d’une manière saillante. Son œil était juste et exercé, mais il ne demandait pas l’impossible ; et tout en ayant la conscience du mieux, il n’affligeait pas les personnes qui lui montraient ce qu’elles avaient fait pour embellir un site, en leur vantant les travaux supérieurs de ce genre qu’il avait eu occasion de voir ailleurs.
Lorsqu’ils arrivèrent dans la cabane de mousse, ils la trouvèrent agréablement décorée. Les fleurs et les guirlandes étaient artificielles ; mais des touffes de seigle vert et autres produits champêtres de la saison, entrecoupaient ces guirlandes avec tant d’adresse, qu’on ne pouvait s’empêcher d’admirer le sentiment artistique qui avait présidé à cette décoration.
— Je sais, dit Charlotte, que mon mari n’aime pas à célébrer les anniversaires de naissance ou de nom, j’espère cependant qu’il me pardonnera ces guirlandes et ces couronnes, en faveur de la triple fête que nous offre ce jour.
— Une triple fête ! s’écria le Baron.
— Sans doute. Est-ce que l’arrivée de ton ami n’est pas une fête, et ne vous appelez-vous pas tous deux Othon ? Si vous aviez regardé le calendrier, vous auriez vu que c’est aujourd’hui la fête de ce saint.
Les deux amis se donnèrent la main par-dessus la petite table qui se trouvait au milieu de la cabane.
— Cette aimable attention de ma femme, dit le Baron au Capitaine, me rappelle un sacrifice que je t’ai fait dans le temps. Pendant notre enfance nous nous appelions tous deux Othon ; mais arrivés au collège, cette conformité de noms fit naître une foule de quiproquos désagréables, et je te cédai avec plaisir celui d’Othon, si laconique et si beau.
— Ce n’était pas une grande générosité de ta part, dit le Capitaine, je me souviens fort bien que celui d’Édouard te paraissait plus beau. Je conviens au reste que ce nom n’est pas sans charme, surtout quand il est prononcé par une belle bouche.
Tous trois étaient assis très-commodément autour de cette même table auprès de laquelle, quelques jours plutôt, Charlotte avait si vivement protesté contre l’arrivée de leur hôte. Édouard se sentait trop heureux pour lui rappeler leurs discussions à ce sujet, mais il ne put s’empêcher de lui faire remarquer qu’il y avait encore de la place pour une quatrième personne.
Des cors de chasse, qui, en ce moment, se firent entendre dans la direction du château, semblaient applaudir aux sentiments et aux souhaits des amis qui écoutaient en silence, se renfermaient dans leurs souvenirs, et goûtaient doublement leur bonheur personnel dans cette heureuse réunion. Édouard prit le premier la parole, se leva et sortit de la cabane.
— Conduisons notre ami sur les hauteurs, dit-il à sa femme, car il ne faut pas qu’il s’imagine que cette étroite vallée est notre unique séjour et renferme toutes nos possessions. Sur ces hauteurs le regard est plus libre et la poitrine s’élargit.
— Je le veux bien, répondit Charlotte, mais il faudra vous décider à gravir le vieux sentier rapide et incommode ; j’espère que bientôt les degrés et la route que je me propose de faire faire nous y conduiront plus facilement.
Ils montèrent gaiement à travers les buissons, les épines et les pointes de rocher, jusqu’à la cime la plus élevée qui ne formait pas un plateau, mais la continuation d’une pente fertile. L’on ne tarda pas à perdre de vue le village et le château. Dans le fond on voyait trois larges étangs ; au-delà, des collines boisées qui se glissaient le long des rivages, puis des masses arides servant de cadre définitif au miroir des eaux, dont la surface immobile réfléchissait les formes imposantes de ces masses. A l’entrée d’un ravin d’où un ruisseau se précipitait dans l’étang avec l’impétuosité d’un torrent, on voyait un moulin qui, à demi caché par des touffes d’arbres, promettait un agréable lieu de repos. Toute l’étendue du demi-cercle qu’embrassait le regard offrait une variété agréable de bas-fonds et de tertres, de bosquets et de forêts, dont les feuillages naissants promettaient de riches masses de verdure. Ça et là, des touffes d’arbres isolés attiraient l’attention. Parmi ces derniers, se distinguait un groupe de peupliers et de platanes qui s’élevaient sur les bords de l’étang du milieu, et étendaient leurs vertes branches avec la vigueur d’une végétation puissante et robuste. Ce fut sur ce groupe qu’Édouard attira l’attention de son ami.
— Regarde ces beaux arbres, lui dit-il, je les ai plantés moi-même pendant mon enfance. Mon père les avait trouvés si faibles, qu’il ne voulut pas leur donner une place dans le grand jardin du château, dont il s’occupait alors. Il les avait fait jeter ; je les ramassai pour les planter sur les bords de cet étang. Ils me donnent chaque année une preuve nouvelle de leur reconnaissance en devenant toujours plus grands et plus beaux. J’espère que cette année, ils ne seront pas plus ingrats.
On retourna au château heureux et contents. L’aile gauche avait été mise à la disposition du Capitaine, qui s’y installa commodément avec ses papiers, ses livres et ses instruments de mathématiques, afin de pouvoir continuer ses occupations habituelles. Pendant les premiers jours Édouard cependant venait à chaque instant l’en arracher pour lui faire visiter ses domaines tantôt à pied et tantôt à cheval. Dans le cours de ces promenades, il lui parlait sans cesse de son désir de trouver un moyen d’exploitation plus avantageux.
— Il me semble, lui dit un jour le Capitaine, que tu devrais, avant tout, te faire une idée juste de l’étendue de tes possessions. A l’aide de l’aiguille aimantée, ce travail serait aussi facile qu’agréable ; si sous le rapport de l’exactitude, il laisse à désirer, il suffit pour un aperçu général. Nous trouverons toujours plus tard le moyen de faire un plan plus minutieusement exact.
Le Capitaine qui était très-versé dans ce genre d’arpentage, et avait apporté avec lui tous les instruments nécessaires, se mit aussitôt à l’œuvre. Les gardes-forestiers, les paysans et le Baron lui-même, le secondèrent de leur mieux en qualité d’aides à divers degrés. Cette occupation employait toutes les journées ; le soir le Capitaine passait ses dessins au lavis, et bientôt Édouard eut le plaisir de voir ses domaines reproduits sur le papier avec tant de vérité, qu’il croyait les avoir acquis de nouveau. Il comprit qu’en envisageant l’ensemble d’une terre, il était plus facile d’améliorer et d’embellir, que lorsqu’on est réduit à chercher, sur les lieux mêmes, les points susceptibles d’amélioration ou d’embellissement. Dans cette conviction, il pria son ami de décider sa femme à travailler de concert avec eux d’après un plan général, au lieu d’exécuter au hasard des travaux isolés.
Le Capitaine, naturellement sage et prudent, n’aimait pas à opposer ses convictions à celles d’autrui ; l’expérience lui avait appris qu’il y a dans l’esprit humain trop de manières de voir différentes, pour qu’il soit possible de les réunir toutes sur un seul et même point.
— Si je faisais ce que tu me demandes, dit-il, je jetterais du trouble et de l’incertitude dans les idées de ta femme, sans aucun résultat utile. C’est en amateur qu’elle s’occupe de l’embellissement de tes domaines ; l’important est donc pour elle, comme pour tous les amateurs, de faire quelque chose sans s’inquiéter de ce que pourra valoir la chose faite. Est-ce que tu ne connais pas les prétendus amis de la vie champêtre ? ils tâtent la nature, ils ont des prédilections pour telle ou telle petite place, ils manquent de hardiesse pour faire disparaître un obstacle, et de courage pour sacrifier un petit agrément à une grande beauté. Ne pouvant se faire d’avance une juste idée du résultat de leurs entreprises, ils font des essais : les uns manquent, les autres réussissent ; alors ils changent ce qu’il faudrait conserver, conservent ce qu’il faudrait changer, et n’arrivent jamais qu’à un rhabillage qui plaît et attire, mais qui ne satisfait point.
— Avoue-le sans détour, tu n’es pas content des plans de ma femme.
— Je le serais si l’exécution était au niveau de la pensée. Elle à voulu s’élever sur la cime de la montagne, cela est fort bien ; mais elle fatigue tous ceux qu’elle y fait monter avec elle. Sur ses routes, soit qu’on y marche côte à côte ou l’un après l’autre, on ne se sent pas indépendant et libre ; la mesure des pas est rompue à chaque instant… et… mais en voilà assez.
— Est-ce qu’elle aurait pu faire mieux ? demanda Édouard.
— Rien n’eût été plus facile. Il aurait fallu abattre un pan de rocher fort peu apparent, par là elle aurait obtenu une pente gracieusement inclinée, et les débris du rocher auraient servi pour donner des saillies pittoresques aux parties mutilées du sentier… Que tout ceci reste entre nous, mes observations la blesseraient sans l’éclairer ; en pareil cas, il faut laisser intact ce qui est fait : mais si tu avais encore du temps et de l’argent à consacrer à de pareilles entreprises, il y aurait une foule de belles choses à faire sur les hauteurs qui dominent la cabane de mousse.
C’est ainsi que le présent leur offrait d’intéressants sujets de conversation ; les joyeux souvenirs du passé ne leur manquaient pas davantage ; pour l’avenir, on se proposait la rédaction du journal de voyage, travail d’autant plus agréable que Charlotte devait y contribuer.
Quant aux entretiens intimes des époux, ils devenaient toujours plus rares et plus gênés, surtout depuis qu’Édouard avait entendu blâmer les travaux de sa femme. Après avoir longtemps renfermé en lui-même les remarques du Capitaine, qu’il s’était appropriées, il les répéta brusquement à Charlotte qui venait de lui parler des petits escaliers mesquins, et des petits sentiers fatigants qu’elle voulait faire construire pour arriver de la cabane de mousse sur le haut de la montagne. Cette critique la surprit et l’affligea en même temps, car elle en comprit la justesse et sentit que tout ce qu’elle avait fait jusque là, et qui lui avait paru si beau, n’était en effet qu’une tentative manquée. Mais elle se révolta contre cette découverte, défendit avec chaleur ses petites créations et accusa les hommes de voir tout en grand, et de vouloir convertir un simple amusement en œuvre importante et dispendieuse. Émue, embarrassée, contrariée même, elle ne voulait ni renoncer à ce qui était fait, ni rejeter ce qu’on aurait dû faire.
La fermeté naturelle de son caractère ne tarda pas à venir à son secours, elle renonça aux travaux projetés et interrompit tous ceux qui étaient commencés. Réduite à l’inaction par ce sacrifice, elle en souffrit d’autant plus, que les hommes la laissaient presque toujours seule pour s’occuper des vergers, des jardins et des serres, pour aller à la chasse ou faire des promenades à cheval, pour acheter ou troquer des équipages, essayer ou dresser des chevaux. Ne sachant plus comment occuper ses heures d’ennui, la pauvre Charlotte étendit ses correspondances, dont au reste le Capitaine était souvent l’objet ; car elle continuait à demander pour lui à ses nombreux amis et connaissances un emploi convenable.
Elle était dans cette disposition d’esprit, lorsqu’elle reçut une lettre détaillée du pensionnat, sur les progrès merveilleux de la brillante Luciane. Cette lettre était suivie d’un _post-scriptum_ d’une sous-maîtresse, et d’un billet d’un des professeurs de la maison. Nous croyons devoir insérer ici ces deux pièces.
POST-SCRIPTUM DE LA SOUS-MAITRESSE.
Pour ce qui concerne Ottilie, je ne puis que vous répéter, Madame, ce que j’ai déjà eu l’honneur de vous apprendre sur son compte. Je ne voudrais pas me plaindre d’elle, et cependant il m’est impossible de dire que j’en suis satisfaite. Elle est, comme toujours, modeste et soumise ; mais cette modestie, cette soumission ont quelque chose qui choque et déplaît. Vous lui avez envoyé de l’argent et des étoffes ; eh bien ! tout cela est encore intact. Ses vêtements lui durent un temps infini, car elle ne les change que lorsque la propreté l’exige. Sa trop grande sobriété me paraît également blâmable. Il n’y a rien de superflu sur notre table, mais j’aime à voir les enfants manger avec plaisir, et en quantité suffisante, des mets sains et nourrissants. Jamais Ottilie ne nous a donné cette satisfaction ; elle saisit au contraire les prétextes les plus spécieux pour se dispenser de recevoir sa part d’un plat ou d’un dessert. Au reste, elle a souvent mal au côté gauche de la tête. Cette incommodité, quoique passagère, revient souvent et parait la faire souffrir beaucoup, sans que l’on puisse en découvrir la cause. Voilà, Madame, ce que j’ai cru devoir vous dire, à l’égard de cette belle et bonne enfant.
BILLET DU PROFESSEUR.