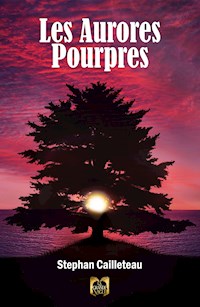
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Les Éditions La Grande Vague
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Französisch
Dès lors que la fuite devient une impérieuse nécessité, la désertion, un acte salvateur, plus rien ne peut entraver la volonté d’ailleurs. Fuir, déserter, partir pour une autre vie puisque celle qui vous est imposée n’en est plus une. Gabriel Mercier, homme bancal, type ordinaire parmi des millions, n’hésitera pas à prendre la mer depuis les docks du Havre vers sa terre de cœur qu’il connaît pourtant si mal. Durant son aventure, il connaîtra mille vies, mille sensations, tant d’âmes splendides et d’événements bouleversants. Seul ou presque, face à ses contradictions et ses angoisses, il découvrira une force intérieure insoupçonnée, une détermination hors du commun dans un « road trip » sans retour, si loin des chemins de la raison.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Stephan Cailleteau est né à Honfleur en 1970. Il réside à Bénouville, près du mythique Pegasus Bridge, haut symbole de liberté. Il exerce à ce jour le métier de cadre de santé dans un hôpital caennais. Passionné d'art, de littérature, de philosophie et de voyages, il se lance dans l'écriture et s'habille des honneurs du public dès son premier roman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stephan Cailleteau
Les aurores pourpres
Roman
Cet ouvrage a été composé et imprimé en France par les
Éditions La Grande Vague
Site : www.editions-lagrandevague.fr
3 Allée des Coteaux, 64340 Boucau
Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle réservés pour tous pays.
ISBN numérique :978-2-38460-021-2
Dépôt légal : Mai 2022
Les Éditions La Grande Vague, 2022
Pour Rudy. N
(1977-2021)
I
LE HAVRE PORTE-OCÉANE
Il avait toujours pensé qu’une poignée de minutes suffisait à bouleverser un destin. C’est du côté des docks, à la sortie de la ville, qu’il venait de se frotter à cet évident précepte. Les quelques centaines d’euros qu’il avait volontiers acquittés à un marin philippin allaient rebattre toutes les cartes. Il s’offrait enfin une seconde chance, un aller simple vers d’autres latitudes.
Dans ses mains froides, il agrippait fébrilement l’inestimable sésame, simple billet griffonné, rehaussé d’un tampon et d’une signature illisible, qui amenderait peut-être les actes manqués d’un passé inutile. Cette rédemption, il l’invoquait du fond de son âme depuis des mois, multipliant les pensées magiques, pariant sur la providence. La réalité ferait peut-être voler en éclats ses idéaux, mais pour l’heure, il révoquait cette probabilité.
Sur l’instant, une chaude étole d’espoir et de sérénité l’enveloppait, parfaite antithèse de la brise de nord-est qui lui cinglait la nuque. Ce soir, les pieds rivés sur le pont d’un porte-conteneurs battant pavillon chypriote, il se sentait soulagé, délesté d’un accablant fardeau. Il n’avait pas le souvenir d’avoir un jour éprouvé une telle sensation.
Scrutant les quais de chargement et les grands portiques à la manœuvre, il affichait un irrépressible sourire teinté de suffisance. Les éclats de voix réguliers des dockers sonnaient à ses oreilles comme des arpèges.
La rudesse du décor, embaumée d’odeurs industrielles aux fragrances mazoutées, n’entamait en rien l’enthousiasme nouveau qui le remplissait.
Une jubilation enfantine, tel un sursaut originel venu du fond des âges, venait de prendre possession de tout son être comme l’aurait fait un chaman.
Durant des années, il avait fait son job sans sourciller, sans jamais se plaindre. Son métier de programmeur informatique avait eu raison de son élan vital et même de sa santé mentale, pour ainsi dire, ça l’avait complètement laminé. Les soumissions récurrentes, et autres courses à la performance avaient sonné très tôt le glas de ses illusions. Les mois et les années s’étaient écoulés, vains et indolents, et il savait désormais, que de retour en arrière, il ne serait plus question.
Au fil des saisons, il s’était mué en un type transparent, pataugeant dans une disgrâce consentie, entre lignes de codes et algorithmes, perdant sa vie à tenter de la gagner. Les années qu’il avait sacrifiées à concevoir et à développer des logiciels sur mesure pour des clients despotiques et des supérieurs irascibles, lui instillaient, malgré tout, le sentiment du devoir accompli. Il pensait, à tort ou à raison, qu’il avait fait sa part.
En bon petit soldat et sans passion, il avait mené ses études dans une régularité métronomique : Bac scientifique obtenu avec mention, brevet de technicien supérieur décroché haut la main, puis l’institut universitaire technique, et tout cela sans le moindre accroc ni contretemps. Il avait ensuite assez logiquement décroché un job dans une boîte de développement d’applications, ce qui collait globalement à ses aspirations postuniversitaires. Ses aptitudes l’avaient vite propulsé parmi les meilleurs programmeurs de sa firme.
Dès lors, un vague sentiment de satisfaction suffisait à entretenir sa motivation et un salaire plus que convenable lui avait offert une vie paisible et confortable. Sur le plan professionnel, pas grand-chose à redire. Sur le plan social et affectif, c’était une affaire éminemment plus complexe.
Ainsi, les années se succédèrent sans joie ni peine, dans un ersatz de bien-être atone, mais rassurant.
Un matin qu’il s’apprêtait à quitter l’appartement, où il vivait seul la majeure partie de l’année, il se ravisa. Il demeura les pieds cloués devant sa porte d’entrée, mais n’eut pas, cette fois, la force d’en franchir le seuil. Il ne se rendit pas à son travail. Des frissons d’interdit lui parcoururent maintes fois l’échine cette journée-là, tel un collégien modèle séchant les cours pour la première fois.
Les heures qui s’écoulèrent n’y changèrent strictement rien. Il coupa simplement son portable afin que rien ne puisse venir entraver sa désertion. Ses collaborateurs avaient toujours eu le texto un peu trop lest. Il détestait ça, mais n’avait jamais ouvertement objecté jusqu’à lors contre ces effractions psychiques. Ce système insidieux constituait une menace sourde et évidente qui, s’il n’y avait pas pris garde, aurait fini par l’asphyxier. Lorsqu'un danger menace, soit on l’affronte soit on l’esquive et on s’en éloigne. La seconde solution lui convenait davantage.
Pour lui, la fuite ne suggérait ni l’abandon encore moins la lâcheté, elle était un art, une conjuration, un sursaut d’âme et d’orgueil. Quand il y réfléchissait un peu, il était clair que ses rares amis ou ses amours de passage ne pesaient guère dans la balance pour qu’elle puisse encore s’incliner du côté de la prudence ou de la sagesse. Le jour déclinait et ferait bientôt place au soir. Au terme de longues heures de réflexion, il sortit finalement de sa tanière et prit la direction du port et des docks d’un pas résolu.
La rumeur de la ville s’estompait au point de ne plus paraître qu’un lointain murmure. Appuyé sur le bastingage, il observait sereinement quelques lueurs orange pâle, que les vieux lampadaires des hangars faisaient onduler à la surface d’une mer noirâtre et glaciale. Il persista ainsi, un long moment sans bouger, fixant les eaux troubles, picoté par le doute. S’agissait-il uniquement des ultimes soubresauts d’une conscience qui lui susurrait à l’oreille la gravité de sa décision ? Il secoua la tête comme pour se défaire de cette idée, comme pour l’effacer. Il devrait batailler désormais pour se défaire d’un surmoi bien trop encombrant, qui risquait à tout moment de le ramener au point de départ. Le renoncement n’était plus une option. Poser un acte radical s’imposait.
Sa présence, ce soir frileux de novembre sur cet immense porte-conteneurs, signait la fin d’un itinéraire, mais surtout le début d’un nouveau qu’il lui restait à inventer, à incarner. Gabriel Mercier parvenait sur l’instant à ce qu’il avait toujours espéré et tellement redouté : la Liberté.
Ce soir, à bord de cet immense vaisseau, en dépit du caractère irrévocable de sa décision, il ne parvenait cependant à circonscrire l’immixtion de pensées cartésiennes et timorées même s’il luttait résolument à s’en affranchir. Une sorte de bilan s’imposait à lui sans qu’il n’y puisse rien changer. Il savait qu’un ingrédient avait toujours fait défaut à son parcours de vie, et ce, depuis le début. Un soupçon de piquant et un brin de légèreté auraient certainement changé bien des choses. Un peu comme s’il manquait une épice dans le plat d’un grand chef pour qu’il fût parfait. La difficulté, c’est que cette épice qui faisait défaut à sa vie, il n’avait jamais pu distinctement l’identifier. Il en avait, néanmoins, tout à fait conscience. Sa lucidité exacerbée exsudait et distillait une goutte de poison qu’il s’autoadministrait jour après jour. L’empoisonnement méticuleux et homéopathique de sa pensée, il en était l’ordonnateur. Rien ni personne ne l’y avait jamais obligé. L’antidote, il la fantasmait et l’appelait de tous ses vœux. Il finirait bien un jour par en trouver la formule. Elle portait un nom : Résistance.
Son interlocuteur philippin se dirigea vers lui d’un pas décidé, interrompant le cours de ses réflexions. Il le ramena à la réalité en quelques secondes. Dans un français plus que correct saupoudré d’un délicat accent asiatique, il l’informa :
Gabriel le remercia d’un signe de tête accompagné d’un discret sourire. Il s’aperçut au passage qu’il n’était pas l’unique « fugitif » à opter pour ce style de voyage. Il remarqua que l’homme avec lequel il avait négocié son périple échangeait à l’instant avec un passager qui paraissait se trouver dans une situation analogue. Du moins, c’est ce qu’il imagina. Les marins de ce navire semblaient d’ailleurs rompus à l’exercice. Ça rapportait un peu d’argent et ça améliorait leur quotidien. Combien seraient-ils à partir comme lui ce soir, impossible à dire ? Il se surprit même à espérer qu’il n’y en aurait pas trop. Il aspirait à une aventure, une équipée authentique, pas une croisière.
Les hommes d’équipage s’exprimaient indifféremment en anglais, espagnol, ou français. Les nationalités présentes à bord témoignaient de la vigueur multiculturelle de ce milieu-là. La mer et les océans ignoraient résolument les frontières. Il prit conscience des années-lumière qui séparaient son monde du leur, avec une once d’amertume fardée de regrets. Tellement de vies différentes s’offraient sur cette terre, pourquoi diable s’affubler d’une existence ennuyeuse et aliénante ? Cette question, il se la posait encore davantage à l’heure du grand départ.
Les manœuvres allaient bon train. Les hommes d’équipage s’affairaient sur le pont et dans la poste de commandement. Trois puissants remorqueurs se calèrent de part et d’autre du navire, créant d’éclatants bouillons d’écumes qui jaillirent des eaux troubles. Ils entamèrent un balai réglé au millimètre pour orienter le géant des mers en position de départ, la proue vers l’horizon.
Piloter un remorqueur, encore un job que j’aurais adoré fairesongea Gabriel. La vie de ces gars, il l’enviait vraiment. Ou peut-être de façon moins romanesque, vomissait-il la sienne ?
En un soir, il s’ouvrait enfin au monde, sortant de sa torpeur, réalisant de facto qu’il y avait un tas de métiers auxquels il aurait pu prétendre. Il se fit intimement la promesse qu’à partir de cet instant il s’efforcerait de vivre pleinement chaque minute pour ne plus jamais générer le moindre regret.
Le départ fut annoncé en anglais via une rangée de haut-parleurs cintrant la timonerie, haute comme un immeuble de cinq étages. En dépit d’un son nasillard accompagné d’un détestable effet larsen, cette annonce peu avenante scellait une ère nouvelle. Les marins s’activèrent encore davantage. Il consulta machinalement son portable, il était vingt heures pile. Il en fit une capture d’écran. La symbolique de cette nouvelle vie méritait la postérité. Cette photo c’était son nouvel acte de naissance, le visa pour l’eldorado.
Le titan des mers prit la direction du large entraîné par deux remorqueurs surpuissants qui bientôt le libérèrent de ses entraves, l’abandonnant aux eaux noires et turbulentes. Le départ de nuit conférait à cette scène un caractère intimidant, presque onirique. Les centaines de halos lumineux tout autour du navire donnaient l’impression d’une fresque peinte par des anges. Il y avait là-dedans une note quasi mystique. Gabriel ressentit une émotion indescriptible le submerger, il souriait tandis que ses yeux laissaient perler sur son visage, d’incontrôlables larmes de joie. Son émoi était à la hauteur du moment. Un instant d’infini, qui de toute évidence marquerait à jamais sa mémoire.
Son second désormais à la barre, le commandant put se rendre disponible et vint à sa rencontre pour échanger quelques minutes. Il lui transmit quelques consignes de sécurité et tint à le mener lui-même à sa cabine. L’endroit était bien peu spacieux, mais correctement aménagé. Gabriel fut agréablement surpris. Quoiqu’un peu spartiate, ce petit espace lui fit de suite bonne impression. Il remercia le commandant, qui se faisait appeler « Pacha », un homme d’une cinquantaine d’années, au regard bleu acier, dont on percevait aisément qu’il avait bourlingué sur tous les océans du globe. La rudesse des traits de son visage laissait entrevoir la rigueur du personnage. Ce dernier lui rappela au passage d’un ton un peu trop solennel, qu’il n’était pas officiellement habilité à l’accueil de passagers, mais qu’exceptionnellement il y avait consenti pour cette traversée. Il lui recommanda logiquement la plus grande discrétion. Il ajouta qu’un autre passager se trouvait dans une situation semblable, sans omettre de souligner que si, par malheur, il arrivait quelque chose, il nierait toute négociation, et que son statut resterait celui d’un clandestin aux yeux des autorités. Ayant mis les points sur les « i », il l’invita à prendre possession des lieux et se retira pour rejoindre la passerelle de commandement.
Gabriel s’étonna de cette mise au point qui, sur le moment, lui sembla superflu. Il était parfaitement conscient de son statut à bord puisque la transaction, avec ce marin quelques heures plus tôt, n’avait pu se faire qu’avec toutes les précautions d’usage, tapie derrière un conteneur, bien à l’abri des vigilances policières et douanières.
Cette combine qui lui avait permis d’obtenir sa place à bord, il la tenait d’un client pour lequel il avait travaillé quelques mois auparavant. Au décours d’échanges concernant l’élaboration d’une application de voyages maritimes, ce dernier l’avait affranchi sur de nouvelles possibilités de croisières à bord de cargos dont certaines demeuraient clandestines et peu onéreuses.
Ce tourisme d’un genre nouveau, commençait à sérieusement émerger, au point de devenir même assez tendance. Il s’était souvenu d’autre part que son client lui avait laissé entendre que c’était une pratique courante sur bon nombre de cargos. Faussement surpris, Gabriel qui souhaitait en savoir davantage l’interrogea ce jour-là sur le mode opératoire de ces voyages non officiels. Son interlocuteur lui révéla qu’il avait eu vent d’un type qui avait quitté Le Havre pour rallier les Bahamas tout simplement en se rendant sur les docks à la rencontre des équipages. Ce n’était pas encore un réel business, disons plutôt des deals d’opportunité. Et puis, ce commerce parallèle, il existait aussi au niveau des marchandises, c’était de notoriété publique. Tout le monde en croquait un peu du côté des docks.
Gabriel Mercier jeta un œil par une petite ouverture de sa cabine. Ce n’était pas un hublot comme il l’aurait espéré, juste une petite fenêtre rectangulaire qui ne devait pas mesurer plus de trente centimètres sur vingt. Il aperçut les lumières du Havre qui scintillaient et s’éloignaient telles des étoiles vagabondes dans l’immensité sidérale. Cette ville à l’inverse de beaucoup, il ne la détestait pas. Il l’avait même complètement adoptée. Il estimait qu’elle suggérait un côté « dernière terre avant l’aventure », d’ailleurs, ne la nommait-on pas parfois, Le Havre Porte-Océane ?
Cependant l’aventure, la vraie, il ne l’avait que rarement envisagée en réalité. Il se languissait la plupart du temps d’un hypothétique signe du destin, d’une opportunité, ce genre de champ des possibles que l’on ouvre parfois sans trop y croire, quand plus rien ne tourne rond.
Gabriel cultivait ce style de pensée magique qui le gardait en vie, qui lui murmurait de temps à autre que tout n’était peut-être pas complètement perdu, qu’un jour peut-être il monterait à bord d’un de ces géants des mers pour naviguer vers la vie. Souvent, dans les moments de vrai spleen, il franchissait le pont de Normandie et se réfugiait à Honfleur. Il aimait cet écrin de l’autre côté de l’estuaire.
La décision de mettre un terme à ce mode de vie qui ne lui convenait plus, il l’esquissa un dimanche après-midi peu de temps après s’être posé en terrasse de « l’Albatros » son bar de prédilection sur le Vieux-Bassin. Confortablement assis face aux voiliers amarrés sous un fier soleil de septembre, il n’envisagea pas de reprendre immédiatement, en sens inverse, ce pont qui le ramènerait chez lui réaffronter une nouvelle semaine.
Aux environs de quinze heures ce jour-là, il sentit qu’une page se tournait, qu’un bouleversement se profilait. Il se leva péniblement de sa chaise, quitta la terrasse et décida de flâner dans les rues alentour. Cette ville au charme indéfinissable l’inspirait autant qu’elle le rassurait. Il salua le patron du café d’un signe de la main et se remit en route le long du quai Sainte-Catherine. Il réfléchissait mieux en marchant. Les rayons du soleil et l’air doux salé enveloppaient son visage. La lumière de fin d’été se reflétait sur l’eau saumâtre du Vieux-Bassin en une multitude de confettis argentés. Il marqua soudain le pas devant une galerie d’art qu’il connaissait bien, se figeant un long moment complètement extasié devant une splendide statue de bronze de Bruno Catalano. Il admira cette sculpture étonnante intitulée « Le voyageur ». Il se questionna, immobile, planté devant le chef-d’œuvre : était-ce seulement une histoire de voyage, cet homme à la valise élimée avançant vers une destination inconnue ? S’agissait-il d’un voyage volontaire ou d’un exil forcé ? Le voyageur était-il heureux ou, au contraire, sentait-il l’univers se dérober sous ses pieds ? Son aspect morcelé, défragmenté, traduisait-il une souffrance ou bien le sentiment d’une symbiose avec le vent qui le traversait ? Sa maigre valise constituait-elle son unique richesse ou le passeport d’une inestimable liberté ?
Le déclic se produisit précisément à cet instant. Il sut alors qu’il partirait lui aussi, qu’il deviendrait, à son tour, ce voyageur énigmatique. Ce bronze de Catalano fut un déclencheur, une révélation, comme une évidence. Il quitta la « Galerie Bartoux », troublé et envahi d’un bien-être singulier et inédit. Il y avait foule le long du Vieux-Bassin comme tous les dimanches après-midi à Honfleur. Il choisit de bifurquer ensuite sur sa droite dans la « rue du Dauphin » pour cheminer sereinement vers l’église Sainte-Catherine. Il aimait cet endroit, non par conviction religieuse, mais pour la beauté de l’édifice et de son intérieur grandiose où se mêlaient parfums de bois anciens, volutes de cierges et fragrances d’encens. Cette église du cœur de la ville représentait beaucoup pour les gens d’ici. Elle était le cœur et l’âme du port de pêche.
Il s’assit un instant sur l’un des longs bancs cirés face à l’autel. Il prit une large inspiration, comme pour emplir ses poumons du parfum mystique qui embaumait tout l’espace. Il se fit l’intime promessequ’aujourd’hui serait le premier jour du reste de sa vie. L’endroit solennel et d’une fervente beauté venait donner force et corps à ce serment intérieur. Il ressortit de l’église en homme nouveau, lavé non pas de ses péchés, mais débarrassé de ses oripeaux psychiques qui, jusqu’à lors, l’avaient outrageusement freiné dans sa quête malhabile du bonheur. Il n’ignorait pas pour autant que le bonheur ne fût pas un état, qu’il ne serait jamais au mieux qu’un objectif, mais ce dimanche-là, Gabriel Mercier comprit qu’il s’attèlerait désormais à cet unique et salvateur dessein.
L’amateur d’art et de lettres qu’il était, se sentait à sa place dans ces ruelles qu’eussent foulées en leur temps, Éric Satie, Lucie Delarue-Mardrus ou encore le précurseur des impressionnistes Eugène Boudin. Il s’identifia humblement à ces artistes qui trouvèrent ici l’inspiration qui allait transcender leur talent et façonner leur existence. Après avoir foulé les pavés usés du parvis de l’église, il redescendit en direction du port. Il considéra quelques secondes la façade d’ardoises anthracite de la « Pharmacie du Passocéan » située « place Hamelin », sur laquelle on pouvait lire, en grandes lettres capitales noires : «Remède contre le mal de mer». Il ignorait, d’ailleurs, si lui-même était sujet à ce genre de désagrément. Il bifurqua finalement sous l’arche de « la Lieutenance », autre édifice symbolique de la ville et s’arrêta un instant devant une plaque, fixée sur sa vieille pierre, qui stipulait que Samuel de Champlain prit la mer depuis ce port avec des navires et des équipages honfleurais pour y fonder Québec en 1608. Il additionna ces signes qui s’imposèrent ce dimanche si particulier et en tira ses propres conclusions. Il croyait fermement aux signes et aux symboles, Gabriel.
L’avenir qu’il esquissa, cet après-midi ensoleillé de septembre, sur les quais d’Honfleur, prit ainsi sa tournure définitive, un soir pluvieux de novembre sur les docks du Havre, au terme d’une journée où il prit conscience de l’urgence à larguer les amarres qui le retenaient encore à son ancienne vie. Le jour de son départ, il ne l’avait jamais vraiment programmé, ni anticipé, il attendit seulement que ses tripes et son cœur lui ordonnent l’insoumission ultime, la désertion vitale.
L’immense bâtiment fendait puissamment l’écume vers le large dans la nuit épaisse et salée. Sensation étrange, songea Gabriel, que de faire route à l’aveugle dans ces ténèbres marines. Il se rassura un instant augurant de la haute technologie que requérait la navigation sur de tels navires. Il demanderait, sans doute plus tard, à visiter le poste de pilotage. Pour l’heure, on frappa sèchement, à trois reprises, à la porte de sa cabine. Il sursauta, puis ouvrit aussitôt. Le marin philippin revenait lui signifier de bien vouloir le suivre vers le mess où le repas allait être servi. Il appréciait la rigueur et le sérieux de l’homme avec lequel il avait négocié cette épopée depuis les docks du Havre. Gabriel le remercia et se permit de lui demander son nom.
Marvin précéda Gabriel et lui ouvrit une lourde porte de métal blanc donnant sur un escalier étroit en colimaçon qui menait au mess. Le marin ne lui posa aucune question quant à la nature de son voyage ni sur la raison de cette destination. Gabriel se sentit un peu frustré sur le moment, mais rassuré également de ne pas devoir se découvrir trop vite. Marvin se contenta de le mener vers son dîner. Il s’installa à l’écart des marins déjà attablés. Une subtile odeur de curry embaumait l’espace du mess. Les hommes d’équipage conversaient, riaient, visiblement satisfaits de ne plus être immobilisés à quai. De l’eau de mer coulait dans les veines de ces gars-là, ça crevait les yeux. Il les jalousait un peu et se sentait à des années-lumière de leur univers. Il ne possédait aucun de leurs codes. Un peu comme le premier jour où l’on entame son nouveau job et que l’on observe inquiet tous les gens qui sont dans la place depuis des lustres, qui savent quoi faire, communiquer, qui se reconnaissent. Le dépaysement se dessinait en quelque sorte. Il allait devoir faire preuve de pas mal d’adaptation. Il lui resterait une quinzaine de jours tout au plus pour organiser son arrivée sur Beyrouth. Il envisageait d’exploiter l’escale en Grèce pour peaufiner son débarquement et joindre son unique contact sur place. Beyrouth, il en avait toujours rêvé. Oui, Beyrouth, le Liban, comme d’autres fantasmaient sur les Seychelles ou les Bahamas. Ces choses-là ne s’expliquent pas toujours. De temps à autre, il levait le nez de son plateau pour tenter d’accrocher le regard d’un des marins de la grande tablée voisine. Mais en vain, pas un regard ne lui arrivait, pas un signe ne lui parvenait. La transparence de sa personne ne le surprit aussi, il cessa toute tentative de rapprochement dans l’immédiat et se focalisa sur son poulet au curry, accompagné d’un riz basmati tout à fait correct.
Le grand voyage prenait corps dans une ambiance particulière, mais le pressentiment que tout irait bien dépassait, malgré tout, ses appréhensions. Il se mit en tête néanmoins de se rapprocher de l’un de ces hommes durant la traversée. Il éprouvait la nécessité impérieuse de partager un peu le cataclysme auto-déclenché dans sa vie d’hier, pour évoquer enfin fièrement la nouvelle. Il n’était pas lui-même ce qu’il convenait d’appeler « un grand communicant », mais quand même, il y avait un minimum.
Son repas terminé, il remisa son plateau, remercia le cuistot d’un signe de tête et d’un discret pouce levé puis quitta le mess le regard baissé. Il se questionna quant à l’absence de l’autre passager à ce premier dîner. Il avait tout le temps de penser à ce genre de détail désormais. Au moment de reprendre l’escalier pour rejoindre sa cabine, il choisit de braver la nuit pour se remplir de l’air stimulant du large sur le pont arrière. Les éclairages de poupe permettaient de distinguer un impressionnant sillage d’écumes bouillonnantes, majestueuse traîne blanche déchirant la noirceur des eaux. Gabriel leva la tête vers le ciel. La pluie du départ avait cessé. Il considéra un instant les inscriptions du navire à l’arrière de l’immense timonerie sur laquelle figurait en grandes lettres noires le nom du bâtiment et son port d’attache : BLUE STAR — CYPRUS.
Un vent cinglant balayait le navire et les embruns emplissaient l’air d’une brumisation ininterrompue d’eau saline. Il ferma les yeux et respira à pleins poumons l’air iodé durant quelques secondes avant d’être interpellé de façon sèche, mais courtoise par le second passager. Le gars se présenta et lui asséna direct, sans autre forme de méfiance ou de retenue :
Gabriel bredouilla quelques mots vaporeux sur un ami qui l’attendait sur place, là-bas à Beyrouth. Il lui livra, sur l’instant, avant de prendre congé, qu’il était informaticien et qu’il partait dans le cadre d’un contrat de coopération, ce qui restait assez flou et crédible à la fois. Il salua cet autre passager, qui paraissait de prime abord être un chic type, une sorte d’hybride, du genre médecin-baroudeur-aventurier. Charles Aoun lui retourna la politesse, lui souhaitant une également une belle nuit, ajoutant qu’il était cassé de fatigue et qu’il profiterait de ce voyage pour essayer de récupérer un peu.
C’était quand même peu commun un médecin à la quarantaine bien cognée qui partait rejoindre une ONG à bord d’un porte-conteneur, pensa Gabriel. Ça l’intrigua pas mal au point qu’il ne put s’empêcher d’émettre quelques réserves quant aux paroles de son collègue de voyage. Pourquoi le gars ne prenait-il pas l’avion ? Phobique peut-être ? Passeport invalide ? Était-il vraiment médecin ?
Ces interrogations ne manqueraient pas d’occuper son esprit une partie de la soirée, c’était couru d’avance. Ces questionnements mettaient d’ores et déjà un peu plus de piment dans sa vie. L’aventure commençait à peine, que sitôt elle promettait de bouleverser ses horizons, ses repères, ses certitudes. En quelques heures sur le Blue Star, il côtoyait déjà davantage de gens intriguant qu’en bien des années dans sa boîte d’informatique. La trajectoire de vie des hommes d’équipage aux multinationalités, l’assurance de Marvin, ce marin philippin parlant couramment français et anglais, la gueule de baroudeur du capitaine, ce Charles Aoun,et tout ça ne faisait vraiment que commencer, songeait-il.
À peine eût-il refermé la porte de sa cabine derrière lui, qu’on y frappa sèchement à trois reprises. Charles Aoun passa la tête dans l’entrebâillement, l’air faussement navré du dérangement. Gabriel lui proposa d’entrer quelques minutes, le toubib ne se fit pas prier malgré l’épuisement dont il avait fait état quelques minutes auparavant. Ils s’assirent tous deux sur un bout de la couchette. Charles lui exposa assez spontanément les raisons de sa présence sur ce bateau et la teneur de ses projets au Liban. Rien de suspect, contrairement aux soupçons échafaudés par Gabriel. Il lui confia sans fard qu’il n’était plus en capacité de voyager par les airs. Deux ans auparavant, il avait été victime d’un accident lors d’une mission. Le bimoteur dans lequel il voyageait avait été pris pour cible, alors qu’il revenait d’un camp de réfugiés aux confins de la vallée de la Bekaa. L’avion avait été copieusement arrosé par les tirs d’une milice syrienne et s’était crashé au cours d’un atterrissage d’urgence dans lequel le pilote et une infirmière avaient trouvé la mort. Il en ressortit miraculeusement indemne, mais seul rescapé, maculé du sang de ses deux malheureux collègues. Plus jamais depuis, il ne fut en mesure de reprendre la voie des airs.
Il s’était remis du choc comme il avait pu, mais cette phobie aérienne le tenaillait très fort aujourd’hui encore. Son métier, il aurait largement pu l’exercer dans l’un des déserts médicaux de la campagne française, mais les déserts qui l’appelaient lui, c’était ceux des terres du Proche et du Moyen-Orient ou de l’Afrique. Il était issu d’une famille maronite du Liban et y était revenu dès ses études de médecine achevées en France, pour y exercer principalement dans des camps encadrés par différentes ONG sous l’égide du UNHCR. Son père, avocat réputé, avait dû quitter son pays en 1985 au pire moment de la guerre civile pour des raisons politiques et de survie, il s’était ensuite établi avec sa famille à Paris, épaulé d’un solide réseau « d’expat’ » chrétien libanais. Sa mère, qui à l’époque était professeure de français en lettres modernes à l’université de Beyrouth, ne s’était, quant à elle, jamais totalement remise de cet exil forcé.
Durant ses études à Beyrouth, Charles avait fréquenté une école et un collège français privés. Il parlait couramment arabe et anglais. Il avait conservé de nombreux amis au Liban avec qui il avait entretenu d’excellentes relations tout au long de son parcours en France. Son arrivée à l’âge de quinze ans à Paris, il l’avait plutôt bien vécue, abstraction faite des affres du climat parisien.
Gabriel l’écouta attentivement et fut rapidement conquis par l’authenticité du personnage et sa biographie hors-norme. Il comprenait aisément l’attachement viscéral de Charles pour ce pays aussi instable que fascinant. Cela le confortait dans l’idée qu’il se faisait du Liban depuis tant d’années, un pays instable souvent, dangereux, parfois, mais incontestablement fascinant. Gabriel, dans un souci de réciprocité, livra quelques brefs éléments factuels de sa vie et révéla que le Liban s’imposa comme une évidence à la suite d’une lecture d’un ouvrage de Raïf Shwayri, qui s’intitulait, « Nadim, un Liban généreux ». Cet ouvrage l’avait profondément ému et marqué, au point qu’il ne cessa ensuite de s’imprégner culturellement et intellectuellement du pays du cèdre. Il lut tout ce qu’il put, tout ce qui concernait de près ou de loin la société libanaise, la politique, la guerre civile de 1975.
Il fréquenta même de façon assidue un restaurant libanais de sa ville, savourant seul certains soirs, les mezzés, les mousses d’aubergines, les keftas et le traditionnel houmous de Beyrouth. Il justifia à son interlocuteur que certains pays pouvaient nous envoûter et nous attirer comme des aimants sans trop que l’on sache toujours pourquoi. Il passa rapidement en revanche sur les raisons profondes et personnelles de son départ aux parfums de désertion. Il éluda adroitement la question du fait social et existentiel. Après tout, le temps de la traversée et de l’escale grecque lui laisserait tout le loisir de revenir sur ses choix, sa vie, son parcours si tant est que le courant continue de passer avec Charles. Il pressentait, en outre, que ce dernier serait une précieuse ressource une fois sur place.
Gabriel s’allongea sitôt le retour de Charles vers ses quartiers. La machine à gamberger se mit en branle, le sommeil allait de toute évidence le fuir durant une partie de la nuit. Il jeta un bref coup d’œil sur son portable qui indiquait 23 h 45. Il se sentit subitement inconsistant, léger, sans âme, sans réel projet concret. Il enviait déjà la force, la rectitude et la cohérence du parcours de Charles. Leur arrivée respective en terres libanaises n’aurait rien de comparable. Il mit alors un point d’honneur à se recentrer et à réfléchir activement à ses plans lorsqu’il poserait les pieds sur les docks de Beyrouth. Le seul espoir romanesque d’une nouvelle vie dans un pays qu’il ne connaissait qu’au travers des livres et des guides de voyages revêtait quelque chose d’inabouti, d’idéaliste et même de chimérique quand on y pense. Il donnait l’impression d’un adolescent fugueur qui finirait, tôt ou tard, par devoir rentrer chez ses parents en s’excusant platement dans une effusion de honte et de contrition. La rencontre avec Charles l’avait enchantée autant qu’elle le mit à mal. Passé le bonheur de l’acte qu’il posait en quittant la France, l’heure serait incessamment à la mise en place de stratégies d’adaptations et d’intentions concrètes.
Cette entrevue avec Charles le remit amèrement en phase avec la réalité, elle portait même un sacré coup d’arrêt à ses aspirations utopistes. Paradoxalement, s’il désirait concrétiser ses intentions d’une vie nouvelle au Liban, il devrait dorénavant faire preuve de réalisme. Il demeurait néanmoins convaincu que la décision de partir ne souffrait aucune remise en cause. Cette nouvelle direction l’effrayait autant qu’elle le stimulait. Son ancienne vie, quant à elle, aurait fini par le noyer dans un océan d’ennui et de médiocrité. À choisir, il préférait nettement mourir vivant.
Le Blue Star faisait route, pleine puissance sur l’Atlantique. Le sommeil emporta finalement Gabriel, qui au terme d’une inéluctable et limpide réflexion prit une décision qui produisit sitôt l’effet d’un hypnotique. Il réussit enfin l’amalgame improbable du rêve insouciant allié à la nécessité impérieuse d’un dessein pragmatique. Il solliciterait, dès que possible, sa seule connaissance sur place dans le but d’anticiper au mieux les conditions de son arrivée et de son installation sur Beyrouth.
En cet unique contact résidait le seul véritable ami qu’il sut ou put conserver de ses années de collège et de lycée. Ils avaient été durant des années, voisins de palier d’un immeuble haussmannien de la rue Saint-Michel à Paris. Leurs parents respectifs qui n’eurent d’yeux que pour leurs carrières de médecins, d’agents immobiliers et de libraires avaient contribué au rapprochement des deux garçons, tous deux fils uniques. Le vide familial fut donc logiquement comblé par l’amitié. Ils fréquentèrent la même classe de Terminale et en gardaient tous deux des souvenirs sauvages et pétillants. Ils passèrent le plus clair de leur temps ensemble jusqu’à devoir scinder leurs trajectoires au moment où Gabriel dût partir exercer au Havre. Maxime Granger, son ami, avait quant à lui opté pour la faculté de médecine après le secondaire. Les études supérieures de chacun les mirent en stand-by de complicité, comme c’est souvent le cas.
Quelques mois avant le départ du Blue Star, Maxime reprit contact avec Gabriel pour lui annoncer qu’il avait pleinement réalisé ses vœux professionnels en partant bosser pour une association humanitaire sur la frontière turco-iraquienne. Ce destin ne fut naturellement pas étranger aux pérégrinations mentales de Gabriel. La cerise sur le gâteau fut encore que Maxime se retrouva finalement en poste au Liban quelques mois plus tard. Gabriel précipita inconsciemment ses mises en projet à cette époque parce qu’à compter de cet instant, tout y était, le combo parfait, comme un alignement des astres : le Liban, Maxime, l’atonie d’une existence qui l’oppressait, les signes du destin qui se multiplièrent un dimanche de septembre à Honfleur… Il n’en fallut pas davantage pour qu’il prenne enfin le taureau par les cornes, qu’il saisisse sa chance, pour qu’il s’arrache définitivement à son quotidien accablant.
Gabriel émergea du sommeil à la faveur de la clarté du jour qui caressait son visage. Il sourit une seconde. Il n’avait donc pas rêvé. Il se réveillait, bel et bien, dans la cabine d’un cargo qui faisait route vers le sud. Ses sens se mirent sitôt en éveil, ce qui prédomina fut d’abord une singulière odeur, mélange d’eau de mer, de carburant et de cambouis. Il resta allongé, immobile, scannant des yeux l’intégralité de la cabine. Il prit le temps de rassembler ses idées avant de se lever. Il se dirigea ensuite vers le mess dans l’espoir d’y trouver un café bien chaud et peut-être quelque chose de sucré à manger.
À son arrivée, il aperçut Charles et Marvin qui lui firent tous deux un signe de la main, l’invitant à les rejoindre. Il prit place à leurs côtés. La discussion des deux hommes s’interrompit brusquement à l’arrivée de Gabriel. Charles avait l’air plutôt frais, la nuit avait été réparatrice et un rasage de près lui donnait bonne mine. Il était beau gosse, Charles, des cheveux presque noirs aux larges boucles, le teint hâlé des méditerranéens et des yeux vert très clair, ce qui, en substance, renvoyait à Gabriel que certains avaient vraiment tout pour eux. Marvin, quant à lui, était impeccable dans sa chemisette blanche aux épaules ornées de galons noirs et dorés.
Marvin, sans même qu’on ne lui demande, donna spontanément quelques informations. Il précisa que le Blue Star se trouvait au large des côtes portugaises et que le bateau filait à dix-sept ou dix-huit nœuds malgré un vent et des courants défavorables. Gabriel, par politesse, s’enquit de savoir à quoi ça correspondait en km/h. Le marin, dans une formule assez magistrale, l’affranchit laconiquement :
Charles, d’un air détaché, en vieil habitué, éclaira Gabriel en avançant que ça devait faire un bon trente km/h, ce qui était phénoménal compte tenu du tonnage et de la dimension du navire. Marvin renchérit immédiatement, comme pour garder la main en bon professionnel :
Gabriel opina deux ou trois fois sans prononcer le moindre mot. Charles, un peu gêné par ce léger blanc, se sentit dans l’obligation d’une assertion quant au caractère impressionnant et exceptionnel de ces géants des mers, ce qui sembla ravir Marvin, qui n’était pas peu fier de sa condition de marin à bord d’un tel bâtiment. Gabriel, bien qu’authentiquement impressionné par la puissance, l’immensité et l’esthétique d’un tel cargo, restait pour l’heure, enclin à des préoccupations d’une tout autre nature. Il serait certainement capable de s’intéresser et de jouir de la traversée une fois son esprit libéré des entraves du stress et de la peur qui le nouaient tout à coup. Une bouffée d’angoisse l’étreignit en quelques secondes. Marvin se retira et les salua d’un signe de tête et d’un large sourire.
Charles releva le nez de son Smartphone et considéra un instant Gabriel pour s’enquérir de son état d’esprit. Ce dernier lui transmit, non sans peine, ses sensations de stress et d’oppression. Charles lui répondit loyalement que c’était perceptible et que s’il pouvait faire quelque chose… Gabriel le remercia en posant sobrement sa main sur son épaule avant de prendre congé. Il accéléra le pas pour sortir précipitamment du mess, Charles les yeux rivés sur son portable, ne s’apercevant même pas que Gabriel était déjà parti, lui marmonna :
De retour dans sa cabine, Gabriel s’assit sur la couchette, la tête dans ses mains, le corps tremblant. Il pesta contre lui-même, contre sa trouille, contre son air pincé, craintif, timoré, sans tripes. Il s’en voulait de ne pas savourer ces instants comme il aurait dû. Il se gâchait la vie avec ses frayeurs et ses angoisses permanentes. Il ne s’estimait pas à la hauteur de l’événement. Il aurait ardemment souhaité être un autre, tel que Charles, ou même Marvin pourquoi pas, ou encore le cuistot, être n’importe qui, enfin un gars qui n’ignorerait pas le « lâcher prise ». Il assimila froidement qu’il avait oublié de vivre, d’aimer, de savourer l’instant présent. Son handicap majeur, relevait d’une censure permanente qu’il s’infligeait malgré lui. Il serait vital de faire peau neuve une bonne fois pour toutes s’il ne voulait pas gâcher sa vie et trahir son serment de l’église Sainte-Catherine.
Quelques instants, il s’interrogea sur ce qui pouvait à ce point l’inhiber. Comment devenir cet autre qu’il appelait de tous ses vœux en hurlant silencieusement du fond des ténèbres, englué dans les marécages mentaux de ses vidanges maso-dépressives ? Comment déchirer ce si sombre costume psychique ? C’était toute la question. Pourquoi les autres semblaient si habités, si adroits, si solides, quand lui ne demeurait qu’un obscur pantin malheureux et hésitant ?
Toutes ces questions trouveraient leur réponse, si tant est qu’il parvienne un jour à s’accepter davantage, à se renarcissiser un peu. La résilience, il y croyait néanmoins. Il en connaissait bien les contours, les théories et les mécanismes psychologiques décrits par Boris Cyrulnik. Il avait un temps, authentiquement tenté de prendre le contre-pied de sa condition en pur autodidacte, s’imprégnant de méthodes d’autosuggestion et autres pensées positives. Ça n’avait pourtant pas donné grand-chose, le naturel était revenu au triple galop. De résilience, il aurait pu être question, à condition qu’un réseau existe autour de lui, car cette notion induisait nécessairement des interactions sociales. La résilience n’apparaîtrait jamais comme par magie, il ne suffisait pas de la désirer ou de l’invoquer. Elle se devrait être le fruit d’un processus psychique, pas seulement d’une idée ou d’un vague désir de changement. Or, Gabriel n’avait jamais bénéficié d’un réel réseau extérieur soutenant. Il ne mit néanmoins jamais rien en place pour qu’un tel réseau puisse voir le jour, grevant ainsi la moindre chance de recouvrer une once de légèreté ou de plaisir.
Les ouvrages de Laurent Gounelle l’accompagnèrent également quelques mois et lui permirent d’entrevoir des possibilités, des ailleurs psychologiques, ça l’avait momentanément aidé. Il estimait cet auteur qui semait du soleil et des parfums de bien-être dans son écriture. Il avait même ressenti une réelle frustration lorsqu’il en termina les lectures, comme un petit deuil supplémentaire à consentir, comme une béquille qu’il perdait. Il envisagea également une psychothérapie, non pour retrouver le goût des choses ou des autres, mais pour mieux identifier et appréhender ce qui clochait chez lui, nettoyer le sable qui grippait ses engrenages psychiques. Mais même cette idée, il y renonça. Il ne se sentait pas la vaillance d’ouvrir la boîte de Pandore, faire remonter à la surface les démons qui le tourmentaient, percer à jour des traumatismes certainement refoulés. Au final, peut-être que ce fut préférable ainsi. Enfin, c’est ce dont il se convainquait sans trop de certitude.
Il souffla en expirant un grand coup, sécha ses larmes de stress d’un revers de manche énergique puis se leva et se présenta face au petit miroir piqueté au-dessus de son lavabo. Il considéra quelques instants son visage marqué, ses yeux rougis et s’attardant sur son reflet, il prit le parti de recommencer à vivre.
Il prononça ces mots, comme un serment, un engagement conjuratoire définitif sur les fonts baptismaux de sa renaissance :
Stop…, ça suffit… Terminé tout ça. Je repars à zéro. À zéro…
Il pactisa avec lui-même que ces mots prononcés à voix haute, il ne reviendrait plus jamais dessus. Plus jamais. Soit il les exaucerait, soit il disparaîtrait de ce monde. À quoi bon vivre à genoux ? estima-t-il… Il eut une pensée furtive pour un poème d’Aragon appris au collège et qui l’avait marqué, au point qu’il n’en avait pas oublié le moindre vers, bien des années après. Ce fut à cela que le ramena cette réminiscence de l’expression « vivre à genoux ». Le poème s’intitulait « Ballade de celui qui chanta dans les supplices ». Il ne put s’empêcher de le scander intérieurement, « Et s’il était à refaire, je referais ce chemin, la voix qui monte des fers parle pour les lendemains ».
Repartir à zéro équivalait à une renaissance, il en avait ressenti les prémices à plusieurs reprises depuis son départ. Mais pas davantage que les prémices. Aujourd’hui, il était grand temps de passer à la vitesse supérieure. Il savait dès lors que cela suggérerait d’inévitables aménagements, et le premier d’entre eux consisterait à changer de numéro de portable dès l’escale maltaise. La raison qui le poussa à cette décision résidait dans le fait que son téléphone continuait de vibrer à échéances régulières. Les SMS de ses collaborateurs s’empilaient de façon stupide, comme si en envoyer un quinzième put motiver une réponse de sa part. Les mails professionnels continuaient également d’affluer. Aussi, lui était-il impossible de balancer l’appareil par-dessus bord pour que cesse ce harcèlement. Il y avait toute sa vie là-dedans, tous ses codes, ses photos, ses applications de comptes, ses mots de passe.
Une renaissance devait-elle mécaniquement rimer avec tout jeter, tout brûler, ou écraser son téléphone pour signifier au monde précédent qu’il devrait faire désormais sans lui ? Il prit son courage à deux mains et en trois minutes, il régla cette question. Il entreprit d’abord d’envoyer un mail succinct, mais sans équivoque au responsable de sa boîte informatique :
[Je ne viendrai pas travailler aujourd’hui ni demain… ni jamais. Je ne reviendrai plus. Je ne m’enfuis pas. Je déserte. Une nouvelle vie m’attend ailleurs. Ce serait trop long à expliquer pour moi et à comprendre pour vous. Bonne suite à vous. Sans rancune. Gabriel]
Il imagina la tête complètement ahurie de son chef qui lirait le message. Rien que cette perspective le ragaillardit et lui concéda la force de répondre à l’un des SMS d’une collègue qui lui demandait à quelle heure il comptait commencer à bosser aujourd’hui. Gabriel qui en saisit instinctivement le caractère narquois et limite agressif répondit :
[À toi et aux autres : pensez à arroser l’orchidée de l’open-space une fois par semaine. Il n’y a que moi qui le faisais. Respectez au moins ça. Ne m’envoyez plus de message. Inutile. Je bloque définitivement vos 06. Je ne vous hais pas. Vous n’existez pas. Adieu… Gabriel]
Et voilà, ça, c’était fait ! Gabriel avait toujours pris soin de ne jamais évoquer ses envies d’ailleurs avec aucun d’entre eux. Il comptait ménager un parfait effet de surprise au cas où ça arriverait. Ils ne méritaient pas autre chose, ces gens-là. Ses collègues ne lui avaient jamais voué aucune espèce de sympathie ou de considération. Ils le voyaient juste comme le type réservé, un peu bizarre, du fond de l’open-space. Le mec qui maîtrisait à bloc son job, mais qui ne présentait aucun autre intérêt. Son aptitude à ne jamais se livrer l’avait souvent fait passer pour un type méprisant. Ce qu’il n’était en aucun cas. Il cultivait bien autre chose, Gabriel. Il possédait une vie intérieure très riche et la plupart du temps ça lui suffisait, il n’attendait rien de personne. Via ce mail, et ce SMS, il venait de franchir un cap hautement symbolique qui lui fermerait à tout jamais les portes de son ancienne boîte et toute possibilité de battre en retraite. C’était précisément le but recherché au fond.. Tout ce qui concernait ses comptes bancaires, ses charges d’appartement, il pourrait aisément les gérer à distance grâce aux applications et à une simple connexion internet. De l’argent il n’en manquait pas non plus. L’avantage de cette vie atone depuis quelques années, s’il y en avait eu un seul, fut de lui permettre d’engranger assez d’argent pour vivre au minimum un an sans salaire.
Il quitta sa cabine, délesté d’un poids mort comme libéré d’une chape de plomb. Il exulta intérieurement en songeant à ses collègues restés à quai. Ils auraient désormais du grain à moudre, de quoi alimenter longtemps leurs conversations autour de la machine à café.
Le Blue Star poursuivait sa route, sillonnant l’océan dans une régularité parfaite. Le ronflement de ses moteurs surpuissants produisait de fines vibrations sous les pieds de Gabriel appuyé sur le bastingage. Il ne se lassait pas une seconde du spectacle qu’offrait l’immensité maritime contemplée depuis le pont d’un tel bâtiment. Au loin, les mouettes argentées, les goélands et les sternes tourbillonnaient en un ballet aérien d’une singulière légèreté. On s’approchait des côtes. La température extérieure s’affichait de plus en plus clémente au fur et à mesure que s’enchaînaient les heures de mer. Bientôt, le Blue Star franchirait le mythique détroit de Gibraltar. Marvin vint rejoindre Gabriel sans un mot, se cala à ses côtés dans la même position, les avant-bras appuyés sur les rambardes admirant l’horizon. Un troisième larron vint à son tour s’installer dans une position identique.
Ce petit moment parfaitement anodin et aussi naturel qu’il fut pour Charles compta vraiment pour Gabriel qui se sentit enfin considéré. Ce clin d’œil innocent revêtait une valeur dont lui seul pouvait mesurer l’importance. Depuis combien de temps n’avait-il plus éprouvé la sensation d’exister pour quelqu’un ?
Sur le moment, Charles ne saisit pas tout à fait à quelles attentions Gabriel faisait allusion. Le médecin répondit par un sourire et une petite tape dans le dos.





























