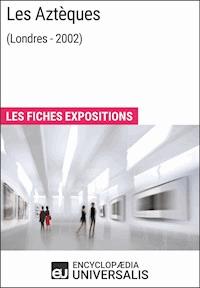
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
À de nombreux titres, l'exposition présentée à Londres, à la Royal Academy of Arts, du 16 novembre 2002 au 11 avril 2003, constitua un événement majeur pour la perception européenne des arts précolombiens...
À PROPOS DE L’ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS
Reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité incomparable de ses publications, Encyclopaedia Universalis met la connaissance à la portée de tous. Écrite par plus de 7 400 auteurs spécialistes et riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins…), l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable collection de référence disponible en français. Elle aborde tous les domaines du savoir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 55
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782341009867
© Encyclopædia Universalis France, 2019. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Bluraz/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Les grandes expositions sont l’occasion de faire le point sur l’œuvre d’un artiste, sur une démarche esthétique ou sur un moment-clé de l’histoire des cultures. Elles attirent un large public et marquent de leur empreinte l’histoire de la réception des œuvres d’art.
Sur le modèle des fiches de lecture, les fiches exposition d’Encyclopaedia Universalis associent un compte rendu de l’événement avec un article de fond sur le thème central de chaque exposition retenue : - pour connaître et comprendre les œuvres et leur contexte, les apprécier plus finement et pouvoir en parler en connaissance de cause ; - pour se faire son propre jugement sous la conduite de guides à la compétence incontestée.
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
Les Aztèques (Londres - 2002)
À de nombreux titres, l’exposition présentée à Londres, à la Royal Academy of Arts, du 16 novembre 2002 au 11 avril 2003, constitua un événement majeur pour la perception européenne des arts précolombiens. Tout d’abord, la qualité et la diversité des œuvres exposées, 359 au total dont beaucoup pour la première fois, permettaient d’aborder la civilisation aztèque avec un regard différent. Si nombre de musées européens ou nord-américains ont prêté des pièces de haute qualité déjà connues, l’essentiel des objets exposés constituaient une véritable révélation, car ils provenaient des réserves du musée d’Anthropologie de Mexico, et des fouilles récentes du Grand Temple (Templo Mayor) de Tenochtitlán. Il faut aussi souligner la présence du « Trésor du pêcheur », ces objets en or conservés à Veracruz, qui figurent à juste titre dans la salle des trésors de l’exposition. Les recherches du Templo Mayor de Mexico ont certes fait l’objet d’expositions antérieures, ainsi Mexique d’hier et d’aujourd’hui à Paris, en 1981. Toutefois, il n’est pas possible de comparer ces deux événements, l’exposition parisienne ayant eu lieu presque au début des fouilles. Le succès de celle de Londres reflète bien l’ampleur des progrès effectués dans les recherches et l’incroyable amélioration des connaissances sur l’art aztèque. Par ailleurs, son caractère d’événement vient de ce qu’elle succèdait, à Londres, à la première exposition d’art aztèque jamais organisée, près de deux siècles plus tôt. En 1824, William Bullock ouvre en effet à l’Egyptian Hall, face à la Royal Academy, la première présentation au monde d’art préhispanique du Mexique. Certaines des pièces prêtées à cette occasion, et conservées au British Museum, figurent à nouveau ici. L’initiative de Bullock, pionnière par bien des aspects, révélait au public européen un art inconnu. L’exposition Aztecs nous donnait une vision nouvelle, inédite du sujet.
Victimes directes de la Conquête, les Aztèques étaient connus surtout par les multiples écrits des conquérants et des évangélisateurs, qui ont donné naissance à de nombreuses études, souvent de très haute qualité, comme les travaux de Jacques Soustelle. Mais la civilisation aztèque demeurait ignorée pour quantité de domaines, comme l’art ou l’architecture. La capitale, rasée, gisait sous les monuments coloniaux et la ville moderne. Ce n’est que récemment, avec les fouilles menées dans l’enceinte du Grand Temple de Tenochtitlán, que toutes les facettes de l’art aztèque ont pu reprendre vie. Bijoux, sculptures, grandes statues de céramique, masques de pierre énigmatiques démontrent la richesse de l’artisanat et l’accomplissement artistique de cette civilisation. Il en ressort une image nouvelle des Aztèques, plus humaine, libérée des préjugés qui faisaient d’eux un peuple sanguinaire, uniquement préoccupé de sacrifices et de guerres. Les Aztèques apparaissent donc proches de leurs voisins mésoaméricains, avec des préoccupations similaires. Leurs profondes conceptions religieuses, leur volonté de construire un empire, mais également leur souci de comprendre leur passé, ou de s’inscrire dans une trajectoire historique longue, les rapprochent de nous. La beauté de leurs œuvres permet de mieux comprendre l’intérêt porté à leur art par Dürer ou Cellini, qui contemplèrent les objets expédiés par Cortés en Europe, au XVIe siècle.
Depuis quelques années, un changement de perspective se manifeste dans la perception des arts préhispaniques. À une vision globale de la Mésoamérique se substitue une image plus nuancée. Le monde mésoaméricain regroupe des civilisations dotées d’une base culturelle commune, mais très différentes les unes des autres. Cela découle naturellement de l’ampleur du territoire envisagé, comme de la profondeur chronologique qui couvre plus de trois millénaires, pour ne parler que des principales civilisations. Après les Mayas, toujours à l’honneur, et l’Occident du Mexique, illustré au Carrousel du Louvre, en 1997, à l’occasion d’une visite présidentielle mexicaine, c’était au tour des Aztèques de faire l’objet d’une présentation spécifique. Il n’était que temps, puisqu’ils constituaient la civilisation la plus célèbre.
Le catalogue de l’exposition la complétait fort heureusement, alliant la qualité de reproduction des pièces et celle des articles (une dizaine) qui les accompagnent. Certains d’entre eux, rédigés par Frances Berdan, Alfredo López Austin ou Miguel León-Portilla, couvrent des sujets déjà connus, mais dans une perspective renouvelée. D’autres, plus novateurs, comme ceux des responsables des fouilles Eduardo Matos Moctezuma et Leonardo López Luján, ou, dans le registre de l’art aztèque, celui de Felipe Solís Olguín, nous ouvrent des voies nouvelles en faisant découvrir des aspects inconnus de cette culture et en permettant au public d’accéder à des domaines de réflexion jusqu’alors réservés aux seuls spécialistes. Comme le souligne l’un des auteurs, l’ambition qu’avait Huitzilopochtli, le dieu tribal aztèque, de voir sa renommée s’étendre au monde trouve dans cette exposition son accomplissement. Le peuple mexica occupe enfin sa place dans l’histoire des hommes.
Rosario ACOSTA
AZTÈQUES
Quand les Espagnols abordèrent pour la première fois le





























