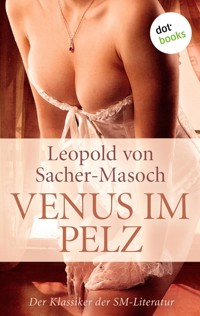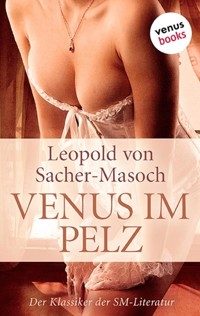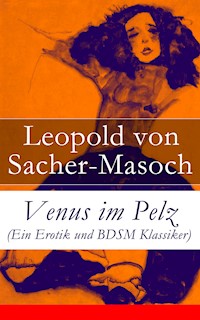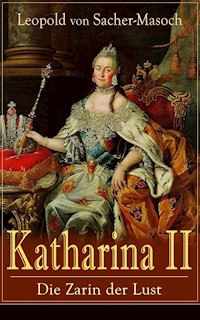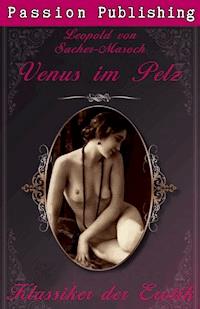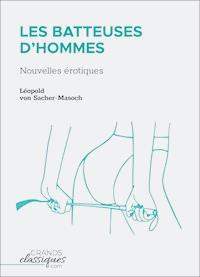
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GrandsClassiques.com
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Quand les femmes prennent le dessus...
POUR UN PUBLIC AVERTI. Dans ce recueil de nouvelles sont mises en scène des femmes dominatrices qui asservissent, souvent à coups de fouet, les amants ayant accepté de leur être entièrement soumis. Les neuf textes – dont
Les Batteuses d'hommes,
La Dompteuse,
Kasimira,
Krach en amour,
Un duel à l'américaine,
Martscha,
La Hyène de la Poussta,
La Dame blanche de Machow et
Warwara Pagadine – mélangent subtilement érotisme et masochisme, et s'inscrivent dans le contexte provincial et prude de l'Europe germano-slave du XIXe siècle.
Un classique de la littérature érotique, à découvrir ou redécouvrir !
EXTRAIT
Elle n’avait cependant rien de farouche ni de satanique cette petite Séraphita qui, avec des phases d’exaltation, des réticences mystérieuses d’initiée, nous racontait de si étranges choses en une de ces fins de dîner qui se prolongent dans la fumée des cigares.
Avec l’enveloppement de ses bouclettes de soie blonde qui mettaient autour de sa figure de gamine comme une auréole de lumière, son nez malicieux, ses joues veloutées qui se coloraient de brusques rougeurs, ses lèvres qu’entrouvraient des rires de joie et de moquerie, elle semblait à peine féminisée, une enfant plus grande qu’on ne l’est à son âge et qui n’a pas meurtri son cœur ingénu au contact de la vie, effeuillé au vent ses suprêmes illusions.
Seuls, les yeux aux luisances changeantes de pierre précieuse d’un bleu attirant d’abîme et aussi d’un bleu implacable de ciel d’été les prunelles qui s’illuminaient, qui se métallisaient, s’imprégnaient de cruautés, de ténébreuses chimères, de perverses souvenances, décelaient quelque détraquement, quelque complication anormale dans les rouages de cette âme simple, charmante de puérile pensionnaire dont la chair virginale sommeille encore impolluée.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Léopold von Sacher-Masoch (1836-1895) est un écrivain et historien né en Autriche et aux origines cosmopolites. Son œuvre est principalement constituée de contes nationaux et de romans historiques regroupés en cycles. Il s'y trouve généralement une héroïne dominatrice ou sadique, et le sens narratif vient des légendes et histoires du folklore slave, ayant bercé d'enfance de l'auteur. Le terme « masochisme » est forgé à partir du patronyme de Sacher-Masoch par le psychiatre Krafft-Ebing dans
Psychopathia Sexualis (publié en 1886), et est considéré par celui-ci comme une pathologie. Pour Gilles Deleuze, qui a analysé et popularisé l'auteur, son œuvre est pornologique, car projetant la pornographie dans le champ philosophique.
À PROPOS DE LA COLLECTION
Retrouvez les plus grands noms de la littérature érotique dans notre collection
Grands classiques érotiques.
Autrefois poussés à la clandestinité et relégués dans « l'Enfer des bibliothèques », les auteurs de ces œuvres incontournables du genre sont aujourd'hui reconnus mondialement.
Du Marquis de Sade à Alphonse Momas et ses multiples pseudonymes, en passant par le lyrique Alfred de Musset ou la féministe Renée Dunan, les
Grands classiques érotiques proposent un catalogue complet et varié qui contentera tant les novices que les connaisseurs.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 196
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les Batteuses d’hommes
… Elle n’avait cependant rien de farouche ni de satanique cette petite Séraphita qui, avec des phases d’exaltation, des réticences mystérieuses d’initiée, nous racontait de si étranges choses en une de ces fins de dîner qui se prolongent dans la fumée des cigares.
Avec l’enveloppement de ses bouclettes de soie blonde qui mettaient autour de sa figure de gamine comme une auréole de lumière, son nez malicieux, ses joues veloutées qui se coloraient de brusques rougeurs, ses lèvres qu’entrouvraient des rires de joie et de moquerie, elle semblait à peine féminisée, une enfant plus grande qu’on ne l’est à son âge et qui n’a pas meurtri son cœur ingénu au contact de la vie, effeuillé au vent ses suprêmes illusions.
Seuls, les yeux aux luisances changeantes de pierre précieuse d’un bleu attirant d’abîme et aussi d’un bleu implacable de ciel d’été les prunelles qui s’illuminaient, qui se métal-lisaient, s’imprégnaient de cruautés, de ténébreuses chimères, de perverses souvenances, décelaient quelque détraquement, quelque complication anormale dans les rouages de cette âme simple, charmante de puérile pensionnaire dont la chair virginale sommeille encore impolluée.
…Nous avions d’abord souri comme d’un intermède amusant tandis qu’elle appuyait de toute une mimique heurtée et violente ses théories sur l’Amour, qu’elle y ajoutait la saveur d’un accent guttural, traînant, rude et calme la fois, de nomade née sous la tente, qu’elle s’énervait, s’interrompait tout à coup les sourcils froncés, les dents crissantes en la bouche que crispe une moue querelleuse.
Et voici que chacun s’accoudait sur la nappe où courait une débandade de petits verres poisseux, de bouteilles, l’écoutait en un trouble instinctif, s’intéressait à ces dépravations ignorées dont elle se faisait l’apôtre, des mirages d’Eden, de terre promise dans son regard fixe, des séductions dans ses longues mains blanches, souples, impérieuses de sacrificatrice…
***
« Alors, disait Séraphita, ses pâles joues empourprées par les vibrations de son cœur, vous croyez être des amants, donner la preuve de votre amour à une femme parce que, pendant des semaines, des mois, des années même vous la recherchez plus qu’une autre, vous l’adulez, vous la suppliez en de sentimentales et ferventes lettres où l’on voudrait que les mots épandent des sortilèges, des griseries de parfums et de musiques, soient à l’unisson du désir qui vous aiguillonne sans trêve, de la passion qui vous ronge jusqu’aux mœlles comme cette tunique de trahison trempée dans le sang des monstres où se débattait le divin Héraclès, parce que votre bouche se rive à sa bouche, parce que vous l’emportez en de torpides extases, parce que vous lui obéissez, vous acceptez une sorte de servage, vous abdiquez toute volonté, vous vous agenouillez sous le joug qu’elle vous tend de ses doigts prometteurs, vous payez parfois en souffrances, en nostalgiques regrets, en larmes, ce que la trop Aimée vous accorda de béatitudes et d’ivresses ! Mais qu’est ce jeu de corruption ou le cœur n’apparaît qu’avili, que souillé, qu’étouffé en de bestiales pratiques, où pour atteindre le but l’on prend la même route que le commun des hommes, que ceux qui sont seulement des forces, qui n’ont aucune étincelle dans le cerveau, que si peu de chose différencie de l’animal, dressé au labeur, où l’on aboutit à l’anéantissement du stupre, que sont ces éphémères voluptés, ces comédies dérisoires à côté de ce que nos âmes inquiètes, inassouvissables, chercheuses de Slaves ont trouvé, de ces jouissances que nous offrent là-bas les raffinés pour qui la Femme la vierge est l’idole souveraine, de ces véritables supplices auxquels ceux-là se condamnent, s’abandonnent pour affirmer leur soumission, pour témoigner leur ferveur ! »
Elle eut dans ses claires prunelles bleues comme de radieuses passées de souvenirs et plus lentement, ainsi que pour nous enfoncer une à une ses paroles dans le cerveau et les y incruster à jamais, reprit :
« Vous avez lu quelquefois peut-être à la quatrième page des grands journaux hongrois ou russes d’énigmatiques annonces qui étaient libellées ainsi : “JEUNE FILLE JOLIE, batteuse”, puis une adresse quelconque. Cela signifiait que Mlle X. ou Y. est affiliée à notre secte, prête si l’homme qui lui écrira, qui l’implorera, vient au rendez-vous aussitôt accepté, l’intéresse, lui plaît, à devenir l’amie qui le dominera, qui lui donnera le délice de souffrir, le rêve du ciel, qui le rendra pareil à ces saints dont la chair se purifiait en d’incessantes macérations, qui le flagellera avec la frénésie d’un bourreau qui s’acharne sur sa victime.
« Ensuite, si cette façon de mariage se conclut, l’un et l’autre se retrouvent dans quelque appartement couvert d’épais tapis, tendu d’étoffes où se heurteront sans échos les clameurs et les plaintes. L’homme se déshabille à demi, s’étend, le torse nu, sur quelque peau de bête, tend ses poignets et ses chevilles à la femme pour qu’elle y rive des anneaux et des chaînes, qu’elle le réduise a l’impuissance absolue. Et, décolletée, en toilette de bai toute blanche, la pelisse de zibeline rejetée derrière soi, les doigts crispés au pommeau d’une cravache, la batteuse use ses forces sur l’être qui est maintenant en sa possession, frappe à tour de bras, frappe encore, frappe toujours, s’affole, se grise de ces cris d’éperdue tendresse, de ces sanglots d’adoration, de ces raies de souffrance qui montent vers sa beauté, de ce sang qui jaillit, qui emplit la chambre comme d’une odeur d’holocauste, a comme un délire sacré, plonge des yeux de flamme dans ces yeux de victime qui la contemplent, qui la dévorent, qui la caressent travers une buée de larmes, dans cette chair qu’elle sent sa merci, et dont l’âme tout entière, les pensées lui appartiennent. Et elle voudrait que son faible corps de femme, que ses bras, que ses muscles aient une vigueur formidable, que ses forces s’éternisent, se décuplent, frapper jusqu’à ce qu’il en meure, et retombe près d’elle, le cœur brisé, les prunelles éteintes ! »
***
« Malepeste, quelle conviction, mademoiselle, balbutia Laumières de ce ton pâteux qu’on a quand on s’éveille en sursaut au milieu de quelque cauchemar, voilà des turlutaines qui ne me tentent pas, mais pas du tout ! »
La Glandée, qui essuyait nerveusement le verre terni son monocle, se redressa et toujours désireux de se renseigner, d’aller, comme il dit, au fond des choses, demanda :
« Êtes-vous très nombreux dans votre petite confrérie fouetteuse ? »
Séraphita ne parut pas s’apercevoir de la pointe d’ironie qui perçait en cette question, répondit fiévreusement :
« Je ne sais, car nous ne nous réunissons jamais que par couples, qu’importe d’ailleurs et n’est-ce pas un de vos plus grands poètes qui a dit que ce qui ferait le bonheur du paradis serait le petit nombre des Élus… Cent ou mille ou plus et, chose bizarre, parmi les plus décidés, les plus exaltés, surtout des garçons robustes, sains, bâtis pour de terribles luttes, de ces beaux officiers blonds et roses aux épaules carrées, aux poitrines bombées comme des boucliers, oui, des tas d’officiers qui pourraient nous jeter bas d’une chiquenaude et qui vont au devant de ce martyre mystique, qui ne veulent plus d’autre amour, qui guettent avidement ces suggestives annonces dont je vous parlais tout à l’heure ! »
Et la jeune fille ajouta mélancoliquement :
— Hélas ! pas un de vous ne me trouve belle et ne m’aime, puisque ni monsieur de Laumières, ni vous, monsieur La Glandée, qui êtes pourtant si flirt, ni Georgie Vignolles, ne demandent à être mis à l’épreuve, ne s’offrent à ma cravache !
— C’est que voilà, opina La Glandée, mademoiselle Séraphita, petit ange délicieux, votre petite fête manque trop de…, comment vous dirais-je cela, de suite et fin… Nous ne sommes pas encore assez faisandés, voyez-vous, et quant à moi, vrai de vrai, j’aime mieux ma mie, gué, j’aime mieux ma mie !
Séraphita haussa les épaules.
La Dompteuse
Vers le commencement de l’hiver de 1859, la célèbre ménagerie Harsberg vint s’installer Bucarest pour la première fois. La ville entière s’émut à la vue d’un nombre d’animaux rares si grand qu’elle n’en avait jamais auparavant contemplé autant réunis à la fois. Chacun fut frappé de la beauté des lions et tout particulièrement de celle de la dompteuse qui leur faisait exécuter des tours invraisemblables.
C’était une jeune Suédoise. Elle se nommait Irma Dalstrem, était belle, distinguée, téméraire et inaccessible. Le bruit courait qu’elle était la fille bien-aimée du propriétaire de la ménagerie, mais les riches boyards qui l’assaillaient de leurs hommages ne rencontraient chez elle qu’une froide amabilité et une hautaine fierté qui les décourageait et ne leur laissait aucun espoir d’obtenir ses faveurs. Elle vivait avec la famille des Harsberg au premier hôtel de la ville, se rendait à la ménagerie dans leur propre équipage et rentrait à la maison également en leur compagnie, ne recevait aucune visite et ne se montrait jamais seule, soit dans la rue, soit autre part. Cette austérité de vestale et cette réserve excitait les sens des galants seigneurs et piquait davantage la curiosité du reste de la population, à tel point que la Suédoise devint bientôt aussi populaire à Bucarest que l’avaient été, avant elle, la Catalani et la Lola Montez.
Un certain soir, le prince Maniasko, la coqueluche des dames de Bucarest, précisément de retour d’une fugue faite à Paris, se rendit à la ménagerie. En compagnie de quelques amis, il visita les différents animaux, prit plaisir à les voir travailler et manger, et finalement alla se planter devant la cage aux lions, attendant, un sourire sceptique aux lèvres, l’arrivée de la célèbre Suédoise. Tout à coup, une petite porte, située au fond de la cage, s’ouvrit et, au milieu d’applaudissements frénétiques, apparut Irma ; d’un mouvement d’une fierté inimitable, elle rejeta la grande pelisse de velours fourré dont elle était recouverte, et, revêtue d’un costume de satin blanc bordé d’hermine rouge, légère et souriante, elle pénétra dans la cage des fauves, un fouet en fil d’archal à la main, droite, svelte, au visage le plus noble du monde auquel des cheveux blonds comme l’or et de fraîches couleurs imprimaient un charme fascinateur. Le prince fut pris en un clin d’œil, en proie à une émotion croissante, il suivit chacun des mouvements de la charmeuse, chacune de ses performances. Son cœur tressaillit, lorsqu’elle plaça son adorable tête entre les terribles mâchoires du lion, comme aussi poussa-t-il un soupir de soulagement lorsque la belle dompteuse, s’étant relevée, se mit à apostropher rudement le fauve, tout en le foulant aux pieds et en le rouant de coups de fouet.
La Suédoise avait à peine quitté la cage, qu’elle aperçut, l’attendant, et dressé devant elle, le prince Maniasko lentement, elle s’enveloppa de sa fourrure qu’Edgard, le superbe héritier des Harsberg, lui tendait, tandis qu’elle laissait tomber ses grands yeux bleus étonnés, presque effrayés, sur le visage idéal et séduisant de ce nouvel adorateur. Elle n’accueillit pas ses déclarations de l’air froid et hautain qui lui était habituel ; elle parut au contraire embarrassée et lui adressa un sourire indicible.
Soir après soir, la ménagerie reçut dès lors la visite du prince. Aussitôt qu’Irma pénétrait dans la cage des fauves, non seulement lui adressait-elle du regard le plus aimable des accueils, mais elle ne cessait autant que ses exercices le lui permettaient de lui lancer des coups d’œil, désireuse qu’elle était de s’assurer de sa présence, et, la séance terminée, trépignait d’impatience s’il n’était pas là pour lui passer sa fourrure. Mais tout se bornait là.
C’était tout ce qu’obtenait le prince et ses plus ardentes sollicitations ne rencontraient aucun autre encouragement, en sorte qu’il fut bientôt envahi du désir enragé de posséder, entièrement, cette femme étrange.
Sur ces entrefaites, un rival lui vint inopinément en aide. Un certain soir, avant qu’Irma ne pénétrât dans la cage, Edgard lui dit d’une voix frémissante :
— J’avais jusqu’ici pensé que tu étais la fille bien-aimée de mon père, puis, avec un soupir, il ajouta :
— Mais maintenant je te dis que je t’aime et que jamais je ne supporterai que tu cèdes aux obsessions de ce boyard qui, déjà fiancé à une princesse, ne cherche qu’à se jouer de toi !
Lorsqu’après la représentation, le prince vint chercher la Suédoise, celle-ci lui dit à brûle-pourpoint :
— Est-il vrai que vous avez une fiancée ?
— C’est vrai, répondit le prince, mais, si vous le désirez, ce roman assommant sera bientôt terminé, et, comme votre esclave, vous me verrez à vos pieds !
— Hélas ! vous ne m’aimez pas encore.
— Comment puis-je vous prouver le contraire ?
Elle le fixa attentivement, puis, vivement, à voix basse et d’un air plein de courage et de résolution, elle dit :
— Trouvez-vous à onze heures à la petite porte de derrière qui conduit à la ménagerie.
— J’y serai, fit le prince d’une voix ferme.
Il vint en effet, et, comme il cherchait la ménagerie dans les ténèbres de la nuit, deux bras mœlleux l’enlacèrent tendrement et deux lèvres brûlantes se collèrent aux siennes.
Il ne fut bientôt question dans tout le pays que de la liaison qui s’était établie entre Maniasko, la belle dompteuse et son père. Ce dernier plaignit le sort de son fils qui aimait, depuis son enfance, la princesse Agrafine Slobuda, laquelle allait bientôt se marier. Cette perspective donna lieu à une scène violente entre le père et le fils, et finalement ce dernier s’enfuit un beau soir et ne parut plus la ménagerie.
Ce même soir, Irma passa une nuit d’angoisse. Déjà, depuis deux jours, elle avait attendu son bien-aimé, puis, lui ayant écrit, n’en avait pas reçu de réponse.
Le quatrième soir, comme Irma quittait la cage des fauves, Edgard qui était reparu lui dit d’un air tendre et soucieux, tout en l’enveloppant de la mœlleuse pelisse :
— Irma, veux-tu que je te dise pourquoi le prince ne se montre plus ?
— Parle, fit-elle sourdement, je suis prête à tout entendre.
— D’ici trois jours, il doit célébrer sa noce.
— Tu mens.
— Pourquoi mentirais-je ?
— Comment se nomme sa fiancée ?
— La princesse Agrafine Slobuda.
— Est-elle belle ?
— Belle, jeune et riche.
Irma poussa un mauvais éclat de rire.
— Dis-moi que tu verseras une larme, une seule, si je meurs pour toi, s’écria Edgard, et j’irai te venger, je le tuerai…
— Non, Edgard, tu n’as pas agir, pas toi…
— Alors le polisson va demeurer impuni ?
— Certes non, répondit-elle d’un ton calme et résolu.
— Eh bien, laisse-moi le tuer, murmura Edgard de ses lèvres blêmes et frémissantes.
— Non, fit Irma, abandonne-le moi.
Edgard lança un regard qui éclaira de reflets haineux son visage diabolique, comme enserré et torturé dans les replis terribles des hideux serpents de la vengeance.
Le jour suivant, vers minuit, le prince Maniasko se trouvait assis dans le petit et coquet boudoir de sa fiancée, et, tandis que la princesse, avec un sourire hautain et railleur, exprimait le désir de voir, au moins une fois, cette dompteuse qui étonnait tout le monde, il roulait de ses fines mains la cigarette qu’il lui destinait. Le frêle rouleau de papier trembla entre ses mains et le tabac aux reflets d’or s’épandit sur ses doigts blancs.
« On m’a tant dit de choses remarquables de cette personne, fit Agrafine d’un ton malicieux, que je me suis mis en tête d’assister l’une des ses représentations, voire aujourd’hui même, en votre compagnie, prince. »
Comme ce soir-là la Suédoise pénétrait dans la cage aux lions, elle aperçut Maniasko ayant à son côté une jeune et séduisante dame qui la provoquait en la fixant de sa lorgnette. Ce ne pouvait être que la fameuse princesse, sa fiancée. Elle le sentit de suite et se mit à trembler. Néanmoins son émotion ne dura qu’une seconde, et, se ressaisissant, elle procéda froidement et courageusement au travail de ses fauves. Comme, après un tour d’adresse plus fatigant que les autres, elle se reposait sur le dos du plus fort de ses lions, tandis que les bêtes étaient étendues à ses pieds, la princesse lui adressa de sonores bravos et lança dans la cage sa bourse pleine d’or. Un murmure involontaire parcourut les rangs des spectateurs.
Là-dessus, Irma se prit à frémir, des larmes coulèrent de ses yeux, elle perdit tout contrôle sur elle-même ainsi que sur les fauves qui l’environnaient ; alors, le gros lion leva la tête, la regarda d’un air étonné, puis saisit tout à coup son bras gauche dans ses terribles mâchoires. Un cri d’horreur s’éleva de mille poitrines, mais, en ce même instant, Irma s’était ressaisie. Elle fixa le lion, lui adressa un commandement, et aussitôt le puissant fauve lâcha le bras. Se levant alors, elle empoigna l’indocile brute par la crinière, posa le pied sur elle et la frappa du fouet à fils d’archal jusqu’à ce qu’enfin domptée la bête vint d’elle-même s’étendre ses pieds. Un tonnerre d’acclamations et d’applaudissements vint récompenser la vaillante Suédoise.
— Quand se marie-t-il ? telle fut la question qu’Irma adressa Edgard en quittant la cage.
— Après-demain, fut la réponse.
— Veux-tu te charger toi-même d’une lettre pour lui ?
— Dès que tu m’en donneras l’ordre.
— Je te remercie ! Irma lui serra la main, mais Edgard la prit et la couvrit de baisers.
Le lendemain matin, la dompteuse écrivit au prince. Elle désirait une dernière fois le voir, et lui parler ; elle le priait ensuite de venir à la ménagerie à l’heure habituelle, en échange de quoi elle s’engageait à quitter Bucarest le jour même de son mariage. Edgard remit lui-même la lettre au prince. Ce dernier la parcourut, se mit à rire puis dit :
— J’irai !
À l’heure dite onze heures du soir le prince se présenta en effet à la porte de derrière de la ménagerie. Comme jadis, il n’eut aucune difficulté à l’ouvrir. Dans la lueur blafarde que les étoiles jetaient sur la neige, apparut Irma revêtue d’une courte jaquette de fourrure, elle lui prit la main et le conduisit avec précaution par le sombre passage. Comme autrefois, elle fit crier une seconde porte sur ses gonds, introduisit le prince dans un lieu complètement sombre puis, enlaçant le cou de Maniasko de ses beaux bras, elle le couvrit de tendres et ardents baisers.
Soudain, elle disparut. La porte était solidement fermée et le prince, en cherchant une issue, heurta du pied quelque être vivant qui se mit remuer. Qu’était-ce ? Irma ne l’aurait-elle pas, comme jadis, conduit dans sa loge ?…
Au même instant, une lueur rouge et crue inonda l’endroit où se trouvait Maniasko : Irma venait d’attacher une torche enflammée à l’un des barreaux de la cage aux lions, et c’est là, dans cette cage, au milieu de ces fauves, que se trouvait enfermé l’infortuné prince. Un effroi indicible s’empara de tout son être. Irma, les bras croisés sur la poitrine, se tenait devant la grille et, tout en le contemplant de ses yeux bleus et froids, poussait des éclats de rire saccadés et sataniques.
Le prince s’efforça vivement d’ouvrir la porte, mais en vain.
— Pour Dieu, Irma, que signifie cela ? fit-il, la voix pleine de sanglots.
— Je célèbre aujourd’hui mes noces avec toi et mes lions sont nos invités !
— As-tu perdu l’esprit ?…
— J’ai, au contraire, pleinement conscience de ce que je fais. Tu m’as trahie, or je t’ai condamné mort. Sus à lui, mes amis !
De son fouet, elle se mit réveiller et exciter les fauves assoupis, tandis que le prince appelait éperdument au secours. Affolés par ses cris perçants et par les encouragements d’Irma, les grands félins bondirent sur le malheureux. Sous leurs griffes et leurs puissantes mâchoires, bientôt son sang coula. Il implora et lutta en désespéré, tandis que, appuyée contre les froids barreaux, elle se repaissait de son agonie, de ses tortures.
Les lions mirent longtemps à accomplir leur cruelle besogne. Quand le prince fut mort et que son cadavre en lambeaux fut étendu sur le plancher de la cage, les fauves s’en éloignèrent craintifs et se mirent à lécher leurs pattes sanguinolentes.
Cette même nuit, la belle dompteuse disparut de Bucarest et personne n’a jamais su depuis ce qu’elle était devenue.
Kasimira
De temps immémorial, la belle femme hongroise a joué le premier rôle dans l’histoire du Tout-Vienne élégant. Cela tient à cette particularité de sa race et de son pays… La Hongroise est un composé de toutes les séductions dont une seule suffirait pour rendre une femme ravissante : beauté ardente, esprit vif, aptitude aux affaires publiques, magnanimité, générosité, amour de l’indépendance poussé jusqu’à la sauvagerie, tempérament d’amazone, fierté aristocratique, et piquante nonchalance de l’horizontale. En un mot, toutes les qualités et tous les défauts séduisants qui peuvent rendre un homme extrêmement heureux ou misérable. Une belle Hongroise sera la femme la plus vertueuse ou la plus malfaisante, selon le milieu où le hasard l’aura jetée, suivant les conditions d’existence que le destin lui aura faites, et la direction bonne ou mauvaise que les influences ambiantes auront imprimée l’un ou l’autre de ses penchants.
Kasimira, l’héroïne de cette histoire, avait en germe tout ce qu’il fallait, pour faire soit une madone, soit une Astarté. Si, bientôt, les sombres puissances l’emportèrent sur les influences célestes, c’est peut-être uniquement parce que sa famille donna à sa vie, dès le début, une direction pernicieuse.
À l’âge de seize ans, on la maria un vieillard qu’elle ne put ni aimer ni estimer et qui ne sut lui inspirer que de la crainte. Elle était de haute naissance mais pauvre. Pour ne pas la laisser déchoir davantage de son rang, on jugea qu’il fallait, à tout prix, lui faire faire un riche mariage.
Les conséquences de ce faux calcul furent ce qu’elles sont presque toujours. Lorsque des parents, croyant bien faire, foulent aux pieds l’idéal, latent dans le cœur de leur enfant, ils font, le plus souvent, naître à sa place le dégoût, la haine, le vice ; bien heureux quand l’existence dévoyée n’aboutit pas au crime, au lieu du bonheur calme et de l’estime générale.
Kasimira n’était pas d’un caractère et d’un tempérament à se résigner et à souffrir en silence. Ce mariage austère et sans joies fit promptement, de cette jeune fille précoce et ardente, une femme bizarre, capricieuse, positive, entêtée et orgueilleuse. Elle s’habitua vite à chercher au dehors les satisfactions dont elle était privée dans son intérieur. Mais elle était obligée à beaucoup de prudence afin de ne pas éveiller la jalousie de son vieux mari au tempérament bilieux et vindicatif ; elle tenait surtout à conserver le luxe et la splendeur asiatiques dont elle était entourée. La nécessité de dissimuler et de se contraindre la rendait chaque jour plus astucieuse, plus assoiffée de plaisirs et plus dépravée.
Kasimira était de cette race sauvage de femmes qui jouent un rôle typique dans l’histoire et dans les légendes de la Hongrie ; de ces femmes qui, pour se conserver éternellement fraîches et jeunes, éternellement belles, n’hésitaient pas à se baigner dans le sang humain, attelaient leurs amants à la charrue, et les accablaient de coups de fouet, qui les faisaient coudre dans des peaux d’ours, et lâchaient sur eux des meutes féroces.
Celle-ci possédait une beauté démoniaque. Sa taille haute et svelte révélait, à chacun de ses mouvements, la souplesse, l’élasticité et l’énergie de la race féline, si gracieuse et si cruelle. Des cheveux noirs comme l’aile du corbeau, et d’une rare abondance, encadraient son charmant visage, dont le teint un peu foncé et légèrement teinté de rouge rappelait l’Orient. Sous le voile mystérieux de longs et noirs cils, flamboyaient deux grands yeux énigmatiques.