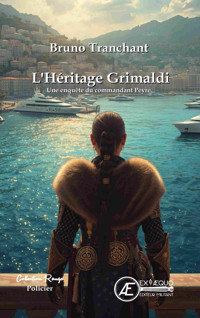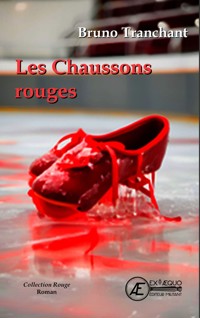
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ex Aequo
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Le capitaine Le Cornec et son collègue Marchand enquêtent sur une série de meurtres entre Tarbes et Toulouse. Les homicides sont signés par des chaussons rouges. Quel est le lien avec un vieux film éponyme de la fin des années 40 ? Pourquoi les corps sont-ils placés sur la glace ?
Les deux enquêteurs seront confrontés à une histoire d’enfance, à un secret-défense avec la CIA. De plus, le capitaine Le Cornec doit faire face à la déliquescence de son couple et pro-téger sa fille embarquée bien malgré elle dans cette histoire.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Bruno Tranchant, gignacois, est un auteur, engagé dans la vie culturelle, il a participé à la création — avec l’association Arts et Lettres de Rambouillet — du salon du livre de Rambouillet. Sa pièce de théâtre "Ryan et Jules" a eu le Prix « mention Théâtre » de l’association Arts et Lettres de France.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Bruno Tranchant
Les chaussons rouges
Roman policier
ISBN : 979-10-388-0881-2
Collection : Rouge
ISSN : 2108-6273
Dépôt légal : juin 2024
© Couverture Ex Aequo
© 2024Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle, réservés pour tous pays. Toute modification interdite
JOUR 1
— Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Kenza. Joyyeeeuux anniversaire, mon bébé !
— Je ne suis plus un bébé, papa ! J’ai 4 ans !
— Je sais, ma chérie, mais tu seras toujours mon bébé, mon bébé.
John lui frotte les cheveux. Elle essaie d’écarter la main paternelle comme on écarte une mouche, en vain.
— Arrête, papa !!
John et Julia avaient appelé leur fille Kenza, « trésor » en arabe, car elle était un cadeau du ciel : en effet, n’ayant pas pu avoir d’enfant, ils l’avaient adoptée. Cela avait été un parcours du combattant. Déjà qu’en temps normal, c’était un chemin de croix, mais en plus ils cumulaient les points noirs : en concubinage, plus de 45 ans tous les deux, et lui, policier. Heureusement, Julia avait des relations qui avaient aidé à surmonter certains de ces obstacles et ils s’étaient mariés, plus pour faciliter les démarches que par véritable envie. Depuis l’arrivée de leur précieux trésor, leur vie était un paradis.
John chahute avec Kenza et ses copines invitées pour l’occasion lorsque le téléphone sonne. Julia décroche, et en soupirant, se retourne vers son mari :
— Ton patron. Je croyais que tu avais pris ta journée.
Avec un haussement d’épaules, il tempère :
— Le boulot… Allô, commissaire…
— Il y a eu un homicide à Cantaous.
— Chef, j’ai pris ma journée. C’est l’anniversaire de ma fille. Vous ne pouvez pas envoyer l’officier de garde ?
— C’est toi que je veux. Tu verras, c’est particulier. J’ai besoin de ton expérience et de ta diplomatie sur cette affaire.
— OK, j’y vais.
Après avoir embrassé tendrement sa fille et s’être excusé d’un signe vers sa femme, partie rejoindre les enfants pour l’ouverture des cadeaux, John monte dans sa voiture et prend la direction de Cantaous.
*****
— Bonjour, capitaine. Désolé de vous avoir dérangé pendant vos congés, avec l’anniversaire de la petite…
— Merci, Marchand. Explique-moi ce qui justifie ma présence ?
— C’est par là. Ils viennent tout juste de finir l’installation de la patinoire.
La patinoire avait été installée, il y a quelques jours pour les fêtes de Noël, pour une durée de six à huit semaines. C’est une manifestation que les jeunes et les familles de la commune et des alentours attendent avec impatience. C’est un moment de joie, normalement.
La patinoire est de forme ovoïde avec un cabanon pour les patins et un Algeco pour l’accueil. La glace est synthétique, mais on s’y croirait.
Sur la surface gelée immaculée, on aperçoit la scientifique qui s’affaire à récolter le moindre indice. De l’autre côté de la structure, les agents de police retiennent un attroupement de badauds derrière les rubans délimitant la scène de crime. Et au milieu de la patinoire…
— … Sœur Marguerite, d’après un témoin qui l’a reconnue. Elle est sœur au couvent Saint-Joseph. J’ai prévenu la mère supérieure, là-bas.
Les deux policiers se sont approchés, non sans avoir enfilé les surchaussures réglementaires.
— Salut, Doc ! Qu’est-ce qui lui est arrivé ?
— Avant qu’elle meure, on a trempé ses doigts dans de l’azote liquide. Puis on les a brisés comme du verre. La douleur a entraîné une crise cardiaque.
— Elle a dû crier, j’imagine. Il y a des traces d’entrave dans la bouche et aux membres ?
— Non, rien dans la bouche, mais on l’a effectivement attachée. Il y a des marques de liens aux poignets et aux chevilles.
— Vu qu’on est en plein centre-ville, on n’est pas sur le lieu du crime, je suppose ?
— Vous supposez bien, il n’y a pas de sang ni de stigmates de lutte. Je pense qu’on l’a déplacée jusqu’ici.
— À quelle heure l’a-t-on trouvée et qui ?
— Un peu avant 14 heures. Ce sont l’exploitant et le chef de chantier, en faisant le tour de vérification avant l’ouverture au public pour le marché de Noël, qui sont tombés dessus.
John se penche sur le corps. Il remarque quelque chose qui dépasse.
— Qu’est-ce qu’elle a dans les mains ?
— Un porte-clés en forme de petits chaussons de danse rouges.
— C’est à elle ou c’est un message du tueur ?
— Je ne saurais le dire, mais je pencherais pour un message, vu le soin apporté à la mise en scène et le fait qu’il n’y ait pas de clés.
— On aurait pu les lui avoir volées.
— Mais pourquoi laisser le porte-clés ?
— Je vous l’accorde, Doc. J’attends votre rapport. Lieutenant Marchand, je veux les coordonnées de tous ces badauds. Et je voudrais interroger les témoins.
— Là-bas, près du chalet, vous avez le chef de chantier, Monsieur Marsillan, et l’exploitant, Monsieur Duvivier.
— Duvivier, le beau-frère du maire ?
— En personne. Petite rectification : ex-beau-frère, mais toujours en bons termes avec le maire. Il est la plus grande fortune du bourg. C’est lui qui a financé sa campagne.
— Je comprends de plus en plus pourquoi la diplomatie est nécessaire. Tu me fais son portrait ?
— Duvivier a la quarantaine, habillé comme s’il en avait vingt. Il regarde les filles, persuadé qu’elles attendent son regard concupiscent. Il a remplacé son 3008 par une AC Cobra de 1969, noir et jaune. Sa femme n’a pas supporté sa crise de la quarantaine et s’est barrée avec les enfants. Elle touche une pension alimentaire généreuse. Il a plusieurs hôtels et restaurants dans la région. Il sponsorise plusieurs clubs de rugby, dont le club de Tarbes. Une figure locale, quoi.
— Et Marsillan ?
— Rien de spécial. Il a monté sa boîte de location d’équipement pour événements sportifs et de loisirs il y a une quinzaine d’années. Il fait un chiffre d’affaires convenable, qui lui permet de bien vivre, mais sans excès. Il est marié depuis vingt ans avec Josiane Perrissieux. Elle est infirmière libérale.
Alors que John et Marchand se dirigent vers les deux témoins, Duvivier s’apprête à quitter les lieux. Il a l’air contrarié.
— Holà, Monsieur Duvivier, pas si vite ! Capitaine John Le Cornec, nous avons des questions à vous poser. Je vous promets que nous ne serons pas longs.
— Excusez-moi, mais j’ai une urgence dans un de mes hôtels. Je ne peux pas passer faire ma déposition à la PJ de Tarbes ?
— Je ne vous retiendrai pas longtemps, promis.
— Vous savez à qui vous vous adressez ? lance l’homme d’un ton suffisant.
— Je sais, Monsieur Duvivier, vous êtes un bon citoyen prêt à faire son devoir. Alors, qui a découvert le corps en premier ?
Face au mutisme de l’exploitant, le chef de chantier se permet de répondre à sa place.
— Monsieur Duvivier et moi sommes arrivés ensemble et c’est ensemble que nous avons découvert le corps.
— Vers quelle heure ?
— Vers 13 h 45.
— Vous étiez dans la même voiture ?
— Non.
— Alors qui a attendu l’autre ?
— Personne, nous sommes vraiment arrivés en même temps.
— Monsieur Duvivier, vous confirmez?
— Oui, je confirme. Vous voyez, vous n’avez pas besoin de moi.
Duvivier fait mine de partir. John, imperturbable, continue son interrogatoire.
— Quand vous êtes arrivé, vous avez vu quelque chose d’inhabituel ?
— À part le corps, je suppose. Parce que pour être inhabituel, c’est inhabituel.
— Oui, à part le corps. Une personne qui n’aurait pas dû se trouver sur le chantier, un objet pas à sa place…
— Non, rien, capitaine.
— Monsieur Duvivier ?
— Tout pareil. Bon, je peux partir maintenant ?
— L’un de vous connaissait la victime ou l’avait déjà vue ?
Tous deux font un non catégorique de la tête. Apparemment, il n’y a rien à en tirer de plus. John, se remémorant la nécessaire diplomatie, décide d’en rester là.
— Je vous demanderai de bien vouloir venir à la PJ signer vos dépositions. Marchand, prenez leurs coordonnées. Au revoir, Messieurs.
Pour seule réponse, il obtient un grommellement et un salut de la main.
John rejoint sans traîner son véhicule et prend la direction du couvent Saint-Joseph. À l’aide du Bluetooth, il appelle sa femme. Il va devoir lui dire qu’il ne rentre pas tout de suite. Kenza va être déçue, encore une fois. Quant à sa femme…
— Tu ne rentres pas, je suppose. Priorité à l’enquête, même en congé. Je te reconnais bien là. Tu sais que tu es mariée avec moi et non avec le commissariat !
— Désooolé, ma chériiie. Oui, tu as deviné. Je dois me rendre dans un couvent interroger la mère sup et promis, après, je rentre. Et non, je ne suis pas marié avec le commissariat, mais en m’épousant, tu savais que j’étais policier et qu’il y avait des contraintes.
— Avant, c’était en petits caractères en bas du contrat de mariage. Maintenant, il y a un avenant, non plutôt un préambule, une condition non négociable à notre contrat.
— Je ne t’ai jamais prise en traître là-dessus.
— Par contre, sur d’autres choses…
— On ne va pas revenir sur cette vieille histoire. Elle a plus de vingt ans, il y a prescription, tu ne crois pas ?
— Heureusement que nous avons eu Kenza, sinon…
— Tu m’aurais quitté, c’est cela. Écoute, j’arrive au couvent. Je dois te laisser.
— C’est cela !
Et elle raccroche aussi sec.
*****
Le couvent Saint-Joseph se situe sur un domaine de plusieurs hectares. Les bâtiments abritent un centre d’insertion ainsi qu’une maison de retraite anciennement gérée par les religieuses. Celles-ci sont au nombre de vingt, et n’occupent qu’une petite surface du domaine. Le reste n’est pas exploité et John a lu dans le journal local que la mairie et les sœurs étaient en négociation pour que les bâtiments non utilisés soient repris par la commune sous la condition de les consacrer à des œuvres sociales.
John se présente à l’accueil, et la mère supérieure, qui a été prévenue, rejoint le capitaine.
— Je suis sœur Marie-Joseph, se présente-t-elle. Veuillez me suivre dans mon bureau. C’est un grand malheur pour notre communauté.
— Capitaine John Le Cornec, PJ de Tarbes. Je vous suis.
Petite et menue, quand on la voit la première fois, on pourrait penser à une pauvre chose fragile. Mais à l’expression de son visage, à sa voix, on ressent, derrière les paroles de charité chrétienne, de la fermeté et une autorité sévère refusant toute contestation.
Sur les murs de l’entrée principale du bâtiment sont accrochés les portraits des six fondatrices de la communauté. Après une traversée des couloirs, ils arrivent dans le bureau de la mère supérieure. Partout sur les murs, outre les images pieuses, on peut voir des photos des actions de la communauté dans un pays africain. Sœur Marie Joseph lui présente un siège relativement spartiate.
— Que pouvez-vous me dire de sœur Marguerite, ma mère ? entame John sitôt assis.
— Elle est arrivée ici il y a une vingtaine d’années. Elle a vécu cloîtrée jusqu’à il y a quelques mois. Jusqu’ici, elle ne faisait que prier. Puis, au mois de février, elle est venue me voir et m’a demandé si elle pouvait être missionnée à la maison de retraite.
— Savez-vous ce qui a pu déclencher ce changement d’attitude au bout de vingt ans de vie recluse et le pourquoi de ce choix ?
— J’avoue que je fus surprise de ce revirement soudain. D’autant qu’elle n’en avait pas fait part auparavant. Elle m’a simplement dit que c’était le moment pour elle. C’était la dernière étape dans sa pénitence.
— Connaissez-vous l’origine de cette pénitence ?
— Aucune idée. Vous savez, on ne leur pose pas de questions. Elles arrivent. Elles prennent un nom de sœur et laissent leur vie derrière elle. C’est ce qu’elle a fait.
— Personne n’est venu la voir en vingt ans ? Pas de contacts avec l’extérieur ?
— Aucune visite et aucun contact à ma connaissance. Apparemment, elle n’avait pas de famille.
— Vous me dites qu’elle a pris son nom de sœur. Connaissez-vous son nom civil ?
— Attendez, laissez-moi rechercher dans le registre… Vous savez, j’étais une simple sœur quand elle est arrivée. Ce n’est pas moi qui l’ai reçue. On s’appelle toujours par notre nom de religieuse.
— Je comprends.
— Ah, voilà. Jeanne Beaulieu. Née le 3 juin 1977 à Dinard.
— Est-ce que je peux voir sa cellule et récupérer ses affaires personnelles ? C’est pour l’enquête.
— Bien entendu. Suivez-moi.
Après avoir longé les arcades du cloître, ils montent à l’étage où se trouvent les cellules. Dans celle de sœur Marguerite, pour seule décoration sur un des murs, une croix. Un lit, un bureau et des livres religieux dans une bibliothèque.
— Auriez-vous un carton ou une boîte dans laquelle je pourrais mettre ses affaires ?
La mère supérieure, après un acquiescement, s’enquiert de trouver une boîte suffisamment grande. Resté seul, John se met à fouiller le bureau. Rien de particulier à première vue. Il se dirige vers la bibliothèque, ouvre les livres les uns après les autres, rien de particulier non plus, si ce n’est des annotations en marge, pour certains, tels le missel et la Bible. Il se dirige vers la paillasse, quand une sœur entre avec un carton vide dans les mains.
— Bonjour, la mère supérieure m’a demandé de vous apporter ceci. Elle vous fait également savoir qu’elle est dans son bureau en cas de besoin.
— Merci, ma sœur. Dites-moi, que pouvez-vous m’apprendre sur sœur Marguerite ?
— Peu de choses… Longtemps elle a fait vœu de silence. Depuis peu, elle l’a rompu. Son seul sujet de conversation était la maison de retraite et son envie d’y être missionnée.
— Je vous remercie, sœur…
— Sœur Bernadette
— Inspecteur John Le Cornec. Tenez, voici ma carte. Si quelque chose vous revenait.
Sœur Bernadette se retire aussi discrètement qu’elle est arrivée. John se remet à fouiller la pièce et retourne la paillasse. Il aperçoit une déchirure formant un trou, duquel dépasse un papier épais. À première vue, il s’agit d’une photo. Il l’extrait en faisant attention de ne pas la déchirer. La déplie. On y voit des petites filles en costume, sur une scène, pour ce qui semble un spectacle de danse classique. Aucune indication au verso. John dépose les maigres affaires de la défunte dans le carton et met la photo dans sa poche. Puis il retourne voir la mère supérieure afin de signaler son départ.
— Ma Mère, avant de partir, puis-je vous poser une dernière question ?
— Faites donc.
— Vous a-t-elle dit pourquoi elle avait fait vœu de silence ?
— Non. Vous savez, ici, nous avons un point commun avec la Légion étrangère, c’est que nous ne demandons rien à ceux qui s’engagent sur la voie du Seigneur.
— Et vous ne savez pas pourquoi elle l’a rompu du jour au lendemain ?
— Pas plus.
— A-t-elle exprimé un quelconque intérêt pour les spectacles, ceux de danse plus particulièrement ?
— Non, elle est restée très discrète. Son seul intérêt était la maison de retraite.
— Y a-t-il parmi vos pensionnaires une ex-danseuse ou un membre du monde du spectacle ?
— Un instant, je regarde nos fiches, ça sera rapide… Pas le moins du monde.
— Je vous remercie. Pourrais-je avoir la liste des résidentsde la maison de retraite ?
— C’est délicat ce que vous me demandez là.
— S’il vous plaît, ma sœur, je voudrais éviter la paperasse et d’avoir à demander une commission rogatoire.
Après une hésitation, la religieuse se résout à lui donner la liste. Une trentaine de noms y figurent.
— Je vous laisse ma carte au cas où. Pas la peine de me raccompagner, je retrouverai le chemin.
*****
Quand John arrive chez lui, les cadeaux ont été déballés, le gâteau mangé, la décoration rangée et les camarades de sa fille sont rentrés chez eux. Kenza est dans sa chambre, où elle écoute de la K-Pop en regardant les derniers You Tubeurs à la mode. Elle a quatre ans, et se comporte comme une préadolescente de onze. Elle ne veut pas entendre parler de Walt Disney. Les cadeaux sont entassés dans un coin de la chambre. Les jouets et les livres offerts ne répondent pas à son appétit de tout savoir. Enfant précoce, son cerveau dévore les sujets de connaissance comme un ogre ingurgite les petits enfants. Ses parents essaient, grâce à ses anniversaires, de maintenir un lien social avec les enfants de son âge. Mais celui-ci se distend chaque année qui passe.
Sa femme est dans le jardin zen, dans un transat, lisant le dernier roman d’Amélie Nothomb. Julia est folle du Japon. Il y a plein de touches japonaises partout. Le rouge et le blanc sont omniprésents. John lui a abandonné la décoration de la maison. Avec son travail, il est peu présent, alors autant que sa femme se sente bien dans la demeure.
Dans la cuisine, une part de gâteau l’attend dans une assiette en carton illustrée par un dessin de cerisiers en fleurs. Il prend l’assiette et se dirige vers la chambre de sa fille pour s’excuser. Son portable sonne. Son chef.
— John, faites-moi un topo. J’ai le proc à mes basques.
— Commandant, vous pouvez éviter de m’appeler par mon prénom ?
John n’aime pas son prénom. Ses parents l’avaient choisi parce que c’était la mode des prénoms anglophones, comme Kevin ou Kimberley. John a toujours trouvé cela ridicule. Il n’est pas américain à ce qu’il sache, et aucune origine familiale ne justifiait ce choix. Alors au boulot, on l’interpellait soit par son grade, soit par son second prénom, Olivier. C’est son père qui lui avait donné ce prénom. Fan de manga, de football, il adorait Oliv’ et Tom. Une fille de quatre ans qui joue les ados et son père qui l’est resté. Ainsi va son monde…
— Bon… capitaine… Vous accouchez, là ?
John soupire puis se lance.
— C’est bien une sœur du couvent Saint-Joseph. Elle n’a pas été assassinée à la patinoire, mais son corps y a été déplacé. Elle a quitté sa vie de recluse il y a un mois pour travailler dans la maison de retraite de la congrégation, mais on ne comprend pas cet intérêt soudain, surtout après plusieurs années de silence et de prières. Il doit avoir un lien avec le monde du spectacle et de la danse puisque le tueur a laissé un porte-clés représentant des chaussons de danse et que j’ai trouvé, caché dans la paillasse de la sœur, une photo d’un ballet classique. Voilà tout ce que je sais pour l’instant.
— J’attends votre rapport demain matin. Désolé pour l’anniversaire de votre fille. Bonne fin de journée.
— Merci, patron.
Il reprend son ascension vers le pardon et arrive devant la chambre. Elle est fermée avec le panneau sens interdit complété de la mention « Ne pas déranger ». Il frappe. Personne ne répond. Il retoque. Toujours rien. Elle lui fait la tête, sans aucun doute. Le voilà persona non grata chez sa fille. Il redescend et laisse la part de gâteau à peine touché dans le frigo. Sa femme est toujours dans son transat. Elle ne l’a pas entendu ou l’ignore. D’elle aussi, il devrait se faire pardonner de l’avoir laissé gérer seule une colonie d’enfants courant partout dans la maison et de s’occuper de leur fille, observatrice de ce monde virevoltant autour d’elle, comme une étrangère. Mais ce soir, il n’a pas le courage. Il s’allonge dans le canapé, met une série puis s’endort.
JOUR 2
Six heures du matin, mal dormi. Le dîner de la veille a été silencieux. La rancœur, la déception et la culpabilité partageaient le repas. John prend une douche, un café, puis sa voiture, direction la PJ. Il n’a pas le temps de s’apitoyer. Un rapport et une enquête l’attendent.
Quand il arrive dans les locaux, il n’y a personne, si ce n’est la permanence de nuit. Il place le carton provenant du couvent sur le bureau de Marchand. Puis il scanne la photo trouvée dans le matelas et recherche sur Internet à quel événement elle pourrait correspondre.
Marchand arrive avec les croissants et, en découvrant le carton, il se retourne avec un sourire pince-sans-rire :
— Merci du cadeau !
— Ce sont les affaires de la sœur. Vois si cela peut nous être utile. On a le rapport préliminaire de la scientifique ?
— Pas encore, on l’attend en fin de journée ou demain matin.
Alors que le moteur de recherche s’évertue à trouver quelque chose, John se met en quête d’informations sur la victime. Rien dans les fichiers de la police sur une Jeanne Beaulieu. Rien dans la presse. Pas de réseaux sociaux. Le seul élément, c’est qu’elle a eu le permis de conduire à dix-neuf ans et, qu’à l’époque, elle vivait à Lourdes. Un fantôme. John note l’adresse. On ne sait jamais, si on se souvenait d’elle… en espérant trouver des voisins de cette époque. Puis il décide d’analyser la liste des pensionnaires, cherchant à comprendre ce qui a pu déclencher la volonté de la sœur de rompre son vœu de silence et de travailler à la maison de retraite. Il entreprend une recherche nom par nom pour voir s’il existe un lien de parenté avec la sœur ou si l’une des personnes âgées vivait à Lourdes à la même époque que Jeanne Beaulieu. Rien, nada, houaïlou, l’impasse.
« Putain, cette journée commence mal, bordel » se dit John.
Il regarde sa montre, il est treize heures passées.
— Marchand, on prend un casse-dalle et on retourne au couvent. On se fait le trajet à pied entre le couvent et la maison de retraite. C’est sur ce trajet qu’elle a été tuée ou en tout cas enlevée. Et on interrogera les vieux. On ne sait jamais, on pourra peut-être en tirer une info.
— Tant mieux, j’en avais marre de me taper l’inventaire du carton avant scellés.
— File-le à un brigadier, qu’il le finisse. Tu as trouvé quelque chose ?
— Que dalle !
*****
John et Marchand remontent la rue qui longe le couvent accolé au collège privé catholique, les menant vers la maison de retraite. En face, ce sont des champs. Pas pour longtemps. Un projet immobilier de résidence pavillonnaire devrait sortir de terre avant la fin du mandat du maire. Ils scrutent chaque centimètre à la recherche d’un indice, une trace de sang, un élément qui ne devrait pas être là. Rien. Ils arrivent à l’intersection dont la maison de retraite fait l’angle, face au collège. John se tourne vers Marchand et lui fait part de sa réflexion.
— Le trajet est court. La sœur a dû être enlevée avec rapidité et discrètement, entre deux sorties scolaires.
— Encore plus facilement que tu ne le penses. C’est les vacances, il n’y a pas cours.
— T’as raison. Même si elle avait crié ou s’était débattue, personne ne l’aurait entendue.