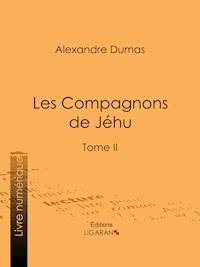
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Pendant que les événements que nous venons de raconter s'accomplissaient et occupaient les esprits et les gazettes de la province, d'autres événements, bien autrement graves, se préparaient à Paris qui allaient occuper les esprits et les gazettes du monde tout entier. Lord Tanlay était revenu avec la réponse de son oncle lord Grenville. Cette réponse consistait en une lettre adressée à M. de Talleyrand, et dans une note écrite pour le premier consul."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pendant que les évènements que nous venons de raconter s’accomplissaient et occupaient les esprits et les gazettes de la province, d’autres évènements, bien autrement graves, se préparaient à Paris qui allaient occuper les esprits et les gazettes du monde tout entier.
Lord Tanlay était revenu avec la réponse de son oncle lord Grenville.
Cette réponse consistait en une lettre adressée à M. de Talleyrand, et dans une note écrite pour le premier consul.
La lettre était conçue en ces termes :
« Downing-street, le 14 février 1800.
Monsieur.
J’ai reçu et mis sous les yeux du roi la lettre que vous m’avez transmise par l’intermédiaire de mon neveu lord Tanlay. Sa Majesté, ne voyant aucune raison de se départir des formes qui ont été longtemps établies en Europe pour traiter d’affaires avec les États étrangers, m’a ordonné de vous faire passer en son nom la réponse officielle que je vous envoie ci-incluse.
J’ai l’honneur d’être avec une haute considération, monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur,
GRENVILLE. »
La réponse était sèche, la note précise.
De plus, une lettre avait été écrite autographe par le premier consul au roi Georges, et le roi Georges, ne se départant point des formes établies en Europe pour traiter avec les États étrangers, répondait par une simple note de l’écriture du premier secrétaire venu.
Il est vrai que la note était signée Grenville.
Ce n’était qu’une longue récrimination contre la France, contre l’esprit de désordre qui l’agitait, contre les craintes que cet esprit de désordre inspirait à toute l’Europe, et sur la nécessité imposée, par le soin de leur propre conservation, à tous les souverains régnants de la réprimer. En somme, c’était la continuation de la guerre.
À la lecture d’un pareil factum les yeux de Bonaparte brillèrent de cette flamme qui précédait chez lui les grandes décisions, comme l’éclair précède la foudre.
– Ainsi, monsieur, dit-il en se retournant vers lord Tanlay, voilà tout ce que vous avez pu obtenir ?
– Oui, citoyen premier consul.
– Vous n’avez donc point répété verbalement à votre oncle tout ce que je vous avais chargé de lui dire ?
– Je n’en ai point oublié une syllabe.
– Vous ne lui avez donc pas dit que vous habitiez la France depuis deux ou trois ans, que vous l’aviez vue, que vous l’aviez étudiée, qu’elle était forte, puissante, heureuse, désireuse de la paix, mais préparée à la guerre ?
– Je lui ai dit tout cela.
– Vous n’avez donc pas ajouté que c’est une guerre insensée que nous font les Anglais ; que cet esprit de désordre dont ils parlent, et qui n’est, à tout prendre, que les écarts de la liberté trop longtemps comprimée, il fallait l’enfermer dans la France même par une paix universelle ; que cette paix était le seul cordon sanitaire qui pût l’empêcher de franchir nos frontières ; qu’en allumant en France le volcan de la guerre, la France, comme une lave, va se répandre sur l’étranger ?… L’Italie est délivrée, dit le roi d’Angleterre ; mais délivrée de qui ? De ses libérateurs ! L’Italie est délivrée, mais pourquoi ? Parce que je conquérais l’Égypte, du Delta à la troisième cataracte ; l’Italie est délivrée, parce que je n’étais pas en Italie… Mais me voilà : dans un mois, je puis y être, en Italie, et, pour la reconquérir des Alpes à l’Adriatique, que me faut-il ? Une bataille. Que croyez-vous que fasse Masséna en défendant Gênes ? Il m’attend… Ah ! les souverains de l’Europe ont besoin de la guerre pour assurer leur couronne ! eh bien, milord, c’est moi qui vous le dis, je secouerai si bien l’Europe, que la couronne leur en tremblera au front. Ils ont besoin de la guerre ? Attendez… Bourrienne ! Bourrienne !
La porte de communication du cabinet du premier consul avec le cabinet du premier secrétaire s’ouvrit précipitamment, et Bourrienne parut, le visage aussi effaré que s’il eût cru que Bonaparte appelait au secours.
Il vit celui-ci fort animé, froissant la note diplomatique d’une main et frappant de l’autre sur le bureau, et lord Tanlay calme, debout et muet à trois pas de lui.
Il comprit tout de suite que c’était la réponse de l’Angleterre qui irritait le premier consul.
– Vous m’avez appelé, général, dit-il.
– Oui, fit le premier consul ; mettez-vous là et écrivez.
Et, d’une voix brève et saccadée, sans chercher les mots, mais, au contraire, comme si les mots se pressaient aux portes de son esprit, il dicta la proclamation suivante :
« Soldats !
En promettant la paix au peuple français, j’ai été votre organe ; je connais votre valeur.
Vous êtes les mêmes hommes qui conquirent le Rhin, la Hollande, l’Italie, et qui donnèrent la paix sous les murs de Vienne étonnée.
Soldats ! ce ne sont plus vos frontières qu’il faut défendre, ce sont les États ennemis qu’il faut envahir.
Soldats ! lorsqu’il en sera temps, je serai au milieu de vous, et l’Europe étonnée se souviendra que vous êtes de la race des braves ! »
Bourrienne leva la tête, attendant, après ces derniers mots écrits.
– Eh bien, c’est tout, dit Bonaparte.
– Ajouterai-je les mots sacramentels : « Vive la République ? »
– Pourquoi demandez-vous cela ?
– C’est que nous n’avons pas fait de proclamation depuis quatre mois, et que quelque chose pourrait être changé aux formules ordinaires.
– La proclamation est bien telle qu’elle est, dit Bonaparte ; n’y ajoutez rien.
Et, prenant une plume, il écrasa plutôt qu’il n’écrivit sa signature au bas de la proclamation.
Puis, la rendant à Bourrienne :
– Que cela paraisse demain dans le Moniteur, dit-il.
Bourrienne sortit, emportant la proclamation.
Bonaparte, resté avec lord Tanlay, se promena un instant de long en large, comme s’il eût oublié sa présence ; mais, tout à coup, s’arrêtant devant lui :
– Milord, dit-il, croyez-vous avoir obtenu de votre oncle tout ce qu’un autre à votre place eût pu obtenir ?
– Davantage, citoyen premier consul.
– Davantage ! davantage !… qu’avez-vous donc obtenu ?
– Je crois que le citoyen premier consul n’a pas lu la note royale avec toute l’attention qu’elle mérite.
– Bon ! fit Bonaparte, je la sais par cœur.
– Alors le citoyen premier consul n’a pas pesé l’esprit de certain paragraphe, n’en a pas pesé les mots.
– Vous croyez !
– J’en suis sûr… et, si le citoyen premier consul me permettait de lui lire le paragraphe auquel je fais allusion…
Bonaparte desserra la main dans laquelle était la note froissée, la déplia et la remit à lord Tanlay, en lui disant :
– Lisez.
Sir John jeta les yeux sur la note, qui lui paraissait familière, s’arrêta au dixième paragraphe et lut :
– « Le meilleur et le plus sûr gage de la réalité de la paix, ainsi que de sa durée, serait la restauration de cette lignée de princes qui, pendant tant de siècles, ont conservé à la nation française la prospérité au-dedans, la considération et le respect au dehors. Un tel évènement aurait écarté, et dans tous les temps écartera les obstacles qui se trouvent sur la voie des négociations et de la paix ; il confirmerait à la France la jouissance tranquille de son ancien territoire, et procurerait à toutes les autres nations de l’Europe, par la tranquillité et la paix, cette sécurité qu’elles sont obligées maintenant de chercher par d’autres moyens. »
– Eh bien, fit Bonaparte impatient, j’avais très bien lu, et parfaitement compris. Soyez Monk, ayez travaillé pour un autre, et l’on vous pardonnera vos victoires, votre renommée, votre génie ; abaissez-vous, et l’on vous permettra de rester grand !
– Citoyen premier consul, dit lord Tanlay, personne ne sait mieux que moi la différence qu’il y a de vous à Monk, et combien vous le dépassez en génie et en renommée.
– Alors, que me lisez-vous donc ?
– Je ne vous lis ce paragraphe, répliqua sir John, que pour vous prier de donner à celui qui suit sa véritable valeur.
– Voyons celui qui suit, dit Bonaparte avec une impatience contenue.
Sir John continua :
– « Mais, quelque désirable que puisse être un pareil évènement pour la France et pour le monde, ce n’est point à ce mode exclusivement que Sa Majesté limite la possibilité d’une pacification solide et sûre… »
Sir John appuya sur ces derniers mots.
– Ah ! ah ! fit Bonaparte.
Et il se rapprocha vivement de sir John.
L’Anglais continua :
– « Sa Majesté n’a pas la prétention de prescrire à la France quelle sera la forme de son gouvernement ni dans quelles mains sera placée l’autorité nécessaire pour conduire les affaires d’une grande et puissante nation. »
– Relisez, monsieur, dit vivement Bonaparte.
– Relisez vous-même, répondit sir John.
Et il lui tendit la note.
Bonaparte relut.
– C’est vous, monsieur, dit-il, qui avez fait ajouter ce paragraphe ?
– J’ai du moins insisté pour qu’il fût mis.
Bonaparte réfléchit.
– Vous avez raison, dit-il, il y a un grand pas de fait ; le retour des Bourbons n’est plus une condition sine quâ non. Je suis accepté non seulement comme puissance militaire, mais aussi comme pouvoir politique.
Puis, tendant la main à sir John :
– Avez-vous quelque chose à me demander, monsieur ?
– La seule chose que j’ambitionne vous a été demandée par mon ami Roland.
– Et je lui ai déjà répondu, monsieur, que je vous verrais avec plaisir devenir l’époux de sa sœur… Si j’étais plus riche, ou si vous l’étiez moins, je vous offrirais de la doter…
Sir John fit un mouvement.
– Mais je sais que votre fortune peut suffire à deux, et même, ajouta Bonaparte en souriant, peut suffire à davantage. Je vous laisse donc la joie de donner non seulement le bonheur mais encore la richesse à la femme que vous aimez.
Puis, appelant :
– Bourrienne !
Bourrienne parut.
– C’est parti, général, dit-il.
– Bien, fit le premier consul ; mais ce n’est pas pour cela que je vous appelle.
– J’attends vos ordres.
– À quelque heure du jour ou de la nuit que se présente lord Tanlay, je serai heureux de le recevoir, et de le recevoir sans qu’il attende ; vous entendez, mon cher Bourrienne ? Vous entendez, milord ?
Lord Tanlay s’inclina en signe de remerciement.
– Et maintenant, dit Bonaparte, je présume que vous êtes pressé de partir pour le château des Noires-Fontaines ; je ne vous retiens pas, je n’y mets qu’une condition.
– Laquelle, général ?
– C’est que, si j’ai besoin de vous pour une nouvelle ambassade…
– Ce n’est point une condition, citoyen premier consul, c’est une faveur.
Lord Tanlay s’inclina et sortit.
Bourrienne s’apprêtait à le suivre.
Mais Bonaparte rappelant son secrétaire :
– Avons-nous une voiture attelée ? demanda-t-il.
Bourrienne regarda dans la cour.
– Oui, général.
– Eh bien, apprêtez-vous ; nous sortons ensemble.
– Je suis prêt, général ; je n’ai que mon chapeau et ma redingote à prendre, et ils sont dans mon cabinet.
– Alors, partons, dit Bonaparte.
Et lui-même prit son chapeau et son par-dessus, et, marchant le premier, descendit par le petit escalier, et fit signe à la voiture d’approcher.
Quelque hâte que Bourrienne eût mise à le suivre, il n’arriva que derrière lui.
Le laquais ouvrit la portière ; Bonaparte sauta dans la voiture.
– Où allons-nous, général ? dit Bourrienne.
– Aux Tuileries, répondit Bonaparte.
Bourrienne, tout étonné, répéta l’ordre et se retourna vers le premier consul comme pour lui en demander l’explication ; mais celui-ci paraissait plongé dans des réflexions, dont le secrétaire, qui à cette époque était encore l’ami, ne jugea pas à propos de le tirer.
La voiture partit au galop des chevaux, – c’était toujours ainsi que marchait Bonaparte, – et se dirigea vers les Tuileries.
Les Tuileries, habitées par Louis XVI après les journées des 5 et 6 octobre, occupées successivement par la Convention et le conseil des Cinq-Cents, étaient vides et dévastées depuis le 18 brumaire.
Depuis le 18 brumaire, Bonaparte avait plus d’une fois jeté les yeux sur cet ancien palais de la royauté, mais il était important de ne pas laisser soupçonner qu’un roi futur pût habiter le palais des rois abolis.
Bonaparte avait rapporté d’Italie un magnifique buste de Junius Brutus ; il n’avait point sa place au Luxembourg, et, vers la fin de novembre, le premier consul avait fait venir le républicain David et l’avait chargé de placer ce buste dans la galerie des Tuileries.
Comment croire que David, l’ami de Marat, préparait la demeure d’un empereur futur en plaçant dans la galerie des Tuileries le buste du meurtrier de César ?
Aussi, personne non seulement ne l’avait cru, mais même ne s’en était douté.
En allant voir si le buste faisait bien dans la galerie, Bonaparte s’aperçut des dévastations commises dans le palais de Catherine de Médicis ; les Tuileries n’étaient plus la demeure des rois, c’est vrai, mais elles étaient un palais national, et la nation ne pouvait laisser un de ses palais dans le délabrement.
Bonaparte fit venir le citoyen Lecomte, architecte du palais, et lui ordonna de nettoyer les Tuileries.
Le mot pouvait se prendre à la fois dans son acception physique et dans son acception morale.
Un devis fut demandé à l’architecte pour savoir ce que coûterait le nettoyage. Le devis montait à cinq cent mille francs. Bonaparte demanda si, moyennant ce nettoyage, les Tuileries pouvaient devenir palais du gouvernement.
L’architecte répondit que cette somme suffirait, non seulement pour les remettre dans leur ancien état, mais encore pour les rendre habitables.
C’était tout ce que voulait Bonaparte, un palais habitable. Avait-il besoin, lui, républicain, du luxe de la royauté ?… Pour le palais du gouvernement, il fallait des ornements graves et sévères, des marbres, des statues ; seulement, quelles seraient ces statues ? C’était au premier consul de les désigner.
Bonaparte les choisit dans trois grands siècles et dans trois grandes nations : chez les Grecs, chez les Romains, chez nous et chez nos rivaux.
Chez les Grecs, il choisit Alexandre et Démosthènes, le génie des conquêtes et le génie de l’éloquence.
Chez les Romains, il choisit Scipion, Cicéron, Caton, Brutus et César, plaçant la grande victime près du meurtrier, presque aussi grand qu’elle.
Dans le monde moderne, il choisit Gustave-Adolphe, Turenne, le grand Condé, Dugay-Trouin, Marlborough, le prince Eugène et le maréchal de Saxe ; enfin, le grand Frédéric et Washington, c’est-à-dire la fausse philosophie sur le trône et la vraie sagesse fondant un État libre.
Puis il ajouta à ces illustrations guerrières, Dampierre, Dugommier et Joubert, pour prouver que, de même que le souvenir d’un Bourbon ne l’effrayait pas dans la personne du grand Condé, il n’était point envieux de la gloire de trois frères d’armes victimes d’une cause qui d’ailleurs n’était déjà plus la sienne.
Les choses en étaient là à l’époque où nous sommes arrivés, c’est-à-dire à la fin de février 1800 ; les Tuileries était nettoyées, les bustes étaient sur leurs socles, les statues sur leurs piédestaux ; on n’attendait qu’une occasion favorable.
Cette occasion était arrivée : on venait de recevoir la nouvelle de la mort de Washington.
Le fondateur de la liberté des États-Unis avait cessé de vivre le 14 décembre 1799.
C’était à quoi songeait Bonaparte, lorsque Bourrienne avait reconnu à sa physionomie qu’il fallait le laisser tout entier aux réflexions qui l’absorbaient.
La voiture s’arrêta devant les Tuileries ; Bonaparte en sortit avec la même vivacité qu’il y était entré, monta rapidement les escaliers, parcourut les appartements, examina plus particulièrement ceux qu’avaient habités Louis XVI et Marie-Antoinette.
Puis, s’arrêtant au cabinet de Louis XVI :
– Nous logerons ici, Bourrienne, dit-il tout à coup comme si celui-ci avait pu le suivre dans le labyrinthe où il s’égarait avec ce fil d’Ariane qu’on appelle la pensée ; oui, nous logerons ici ; le troisième consul logera au pavillon de Flore ; Cambacérès restera à la Chancellerie.
– Cela fait, dit Bourrienne, que, le jour venu, vous n’en aurez qu’un à renvoyer.
Bonaparte prit Bourrienne par l’oreille.
– Allons, dit-il, pas mal !
– Et quand emménageons-nous, général ? demanda Bourrienne.
– Oh ! pas demain encore ; car il nous faut au moins huit jours pour préparer les Parisiens à me voir quitter le Luxembourg et venir aux Tuileries.
– Huit jours, fit Bourrienne ; on peut attendre.
– Surtout en s’y prenant tout de suite. Allons, Bourrienne, au Luxembourg.
Et, avec la rapidité qui présidait à tous ses mouvements, quand il s’agissait d’intérêts graves, il repassa par la file d’appartements qu’il avait déjà visités, descendit l’escalier et sauta dans la voiture en criant :
– Au Luxembourg !
– Eh bien, eh bien, dit Bourrienne encore sous le vestibule, vous ne m’attendez pas, général ?
– Traînard ! fit Bonaparte.
Et la voiture partit comme elle était venue, c’est-à-dire au galop.
En rentrant dans son cabinet, Bonaparte trouva le ministre de la police qui l’attendait.
– Bon ! dit-il, qu’y a-t-il donc, citoyen Fouché ? vous avez le visage tout bouleversé ! M’aurait-on assassiné par hasard ?
– Citoyen premier consul, dit le ministre, vous avez paru attacher une grande importance à la destruction des bandes qui s’intitulent les compagnies de Jéhu.
– Oui, puisque j’ai envoyé Roland lui-même à leur poursuite. A-t-on de leurs nouvelles ?
– On en a.
– Par qui ?
– Par leur chef lui-même.
– Comment, par leur chef ?
– Il a eu l’audace de me rendre compte de sa dernière expédition.
– Contre qui ?
– Contre les cinquante mille francs que vous avez envoyés aux pères du Saint-Bernard.
– Et que sont-ils devenus ?
– Les cinquante mille francs ?
– Oui.
– Ils sont entre les mains des bandits, et leur chef m’annonce qu’ils seront bientôt entre celles de Cadoudal.
– Alors, Roland est tué ?
– Non.
– Comment, non ?
– Mon agent est tué, le chef de brigade Saint-Maurice est tué, mais votre aide de camp est sain et sauf.
– Alors, il se pendra, dit Bonaparte.
– Pour quoi faire ? la corde casserait ; vous connaissez son bonheur.
– Ou son malheur, oui… Où est ce rapport ?
– Vous voulez dire cette lettre ?
– Cette lettre, ce rapport, la chose, enfin, quelle qu’elle soit, qui vous donne les nouvelles que vous m’apportez.
Le ministre de la police présenta au premier consul un petit papier plié élégamment dans une enveloppe parfumée
– Qu’est cela ?
– La chose que vous demandez.
Bonaparte lut : « Au citoyen Fouché, ministre de la police, en son hôtel, à Paris. »
Il ouvrit la lettre ; elle contenait ce qui suit :
« Citoyen ministre, j’ai l’honneur de vous annoncer que les cinquante mille francs destinés aux pères du Saint-Bernard sont passés entre nos mains pendant la soirée du 25 février 1800 (vieux style), et que, d’ici à huit jours, ils seront entre celles du citoyen Cadoudal.
La chose s’est opérée à merveille, sauf la mort de votre agent et celle du chef de brigade de Saint-Maurice ; quant à M. Roland de Montrevel, j’ai la satisfaction de vous apprendre qu’il ne lui est rien arrivé de fâcheux. Je n’avais point oublié que c’était lui qui m’avait introduit au Luxembourg.
Je vous écris, citoyen ministre, parce que je présume qu’à cette heure M. Roland de Montrevel est trop occupé de notre poursuite pour vous écrire lui-même.
Mais, au premier instant de repos qu’il prendra, je suis sûr que vous recevrez de lui un rapport où il consignera tous les détails dans lesquels je ne puis entrer, faute de temps et de facilité pour vous écrire.
En échange du service que je vous rends, citoyen ministre, je vous prierai de m’en rendre un autre : c’est de rassurer sans retard madame de Montrevel sur la vie de son fils.
MORGAN.
De la Maison-Blanche, route de Mâcon à Lyon, le samedi, à neuf heures du soir. »
– Ah ! pardieu, dit Bonaparte, voilà un hardi drôle !
Puis, avec un soupir :
– Quels capitaines et quels colonels tous ces hommes-là me feraient ! ajouta-t-il.
– Qu’ordonne le premier consul ? demanda le ministre de la police.
– Rien ; cela regarde Roland : son honneur y est engagé ; et, puisqu’il n’est pas mort, il prendra sa revanche.
– Alors, le premier consul ne s’occupe plus de cette affaire.
– Pas dans ce moment, du moins.
Puis, se retournant du côté de son secrétaire :
– Nous avons bien d’autres chats à fouetter, dit-il ; n’est-ce pas, Bourrienne ?
Bourrienne fit de la tête un signe affirmatif.
– Quand le premier consul désire-t-il me revoir ? demanda le ministre.
– Ce soir, à dix heures, soyez ici. Nous déménagerons dans huit jours.
– Où allez-vous ?
– Aux Tuileries.
Fouché fit un mouvement de stupéfaction.
– C’est contre vos opinions, je le sais, dit le premier consul ; mais je vous mâcherai la besogne et vous n’aurez qu’à obéir.
Fouché salua et s’apprêta à sortir.
– À propos ! fit Bonaparte.
Fouché se retourna.
– N’oubliez pas de prévenir madame de Montrevel que son fils est sain et sauf ; c’est le moins que vous fassiez pour le citoyen Morgan, après le service qu’il vous a rendu.
Et il tourna le dos au ministre de la police, qui se retira en se mordant les lèvres jusqu’au sang.
Le même jour, le premier consul, resté avec Bourrienne, lui avait dicté l’ordre suivant, adressé à la garde des consuls et à l’armée :
« Washington est mort ! Ce grand homme s’est battu contre la tyrannie ; il a consolidé la liberté de l’Amérique ; sa mémoire sera toujours chère au peuple français comme à tous les hommes libres des deux mondes, et spécialement aux soldats français qui, comme lui et les soldats américains, se battirent pour la liberté et l’égalité ; en conséquence, le premier consul ordonne que, pendant dix jours, des crêpes noirs seront suspendus à tous les drapeaux et à tous les guidons de la République. »
Mais le premier consul ne comptait point se borner à cet ordre du jour.
Parmi les moyens destinés à faciliter son passage du Luxembourg aux Tuileries, figurait une de ces fêtes par lesquelles il savait si bien, non seulement amuser les yeux, mais encore pénétrer les esprits ; cette fête devait avoir lieu aux Invalides, ou plutôt, comme on disait alors, au temple de Mars : il s’agissait tout à la fois d’inaugurer le buste de Washington, et de recevoir des mains du général Lannes les drapeaux d’Aboukir.
C’était là une de ces combinaisons comme Bonaparte les comprenait, un éclair tiré du choc de deux contrastes.
Ainsi il prenait un grand homme au monde nouveau, une victoire au vieux monde, et il ombrageait la jeune Amérique avec les palmes de Thèbes et de Memphis !
Au jour fixé pour la cérémonie, six mille hommes de cavalerie étaient échelonnés du Luxembourg aux Invalides.
À huit heures, Bonaparte monta à cheval dans la grande cour du palais consulaire, et, par la rue de Tournon, se dirigea vers les quais, accompagné d’un état-major de généraux dont le plus vieux n’avait pas trente-cinq ans.
Lannes marchait en tête ; derrière lui, soixante guides portaient les soixante drapeaux conquis ; puis venait Bonaparte, de deux longueurs de cheval en avant de son état-major.
Le ministre de la guerre, Berthier, attendait le cortège sous le dôme du temple ; il était appuyé à une statue de Mars au repos ; tous les ministres et conseillers d’État se groupaient autour de lui. Aux colonnes soutenant la voûte étaient suspendus déjà les drapeaux de Denain et de Fontenoy et ceux de la première campagne d’Italie ; deux invalides centenaires, qui avaient combattu aux côtés du maréchal de Saxe, se tenaient, l’un à la gauche, l’autre à la droite de Berthier, comme ces cariatides des anciens jours regardant par-dessus la cime des siècles ; enfin, à droite sur une estrade, était posé le buste de Washington que l’on devait ombrager avec les drapeaux d’Aboukir. – Sur une autre estrade, en face de celle-là, était le fauteuil de Bonaparte.
Le long des bas-côtés du temple s’élevaient des amphithéâtres où toute la société élégante de Paris, – celle du moins qui se ralliait à l’ordre d’idées que l’on fêtait dans ce grand jour, – était venue prendre place.
À l’apparition des drapeaux, des fanfares militaires firent éclater leurs notes cuivrées sous les voûtes du temple.
Lannes entra le premier, et fit un signe aux guides, qui, montant deux à deux les degrés de l’estrade, passèrent les hampes des drapeaux dans les tenons préparés d’avance.
Pendant ce temps, Bonaparte avait, au milieu des applaudissements, pris place dans son fauteuil.
Alors, Lannes s’avança vers le ministre de la guerre, et, de cette voix puissante qui savait si bien crier : « En avant ! » sur les champs de bataille :
– Citoyen ministre, dit-il, voici tous les drapeaux de l’armée ottomane, détruite sous vos yeux à Aboukir. L’armée d’Égypte, après avoir traversé des déserts brûlants, triomphé de la faim et de la soif, se trouve devant un ennemi fier de son nombre et de ses succès, et qui croit voir une proie facile dans nos troupes exténuées par la fatigue et par des combats sans cesse renaissants ; il ignore que le soldat français est plus grand parce qu’il sait souffrir que parce qu’il sait vaincre, et que son courage s’irrite et s’accroît avec le danger. Trois mille Français, vous le savez, fondent alors sur dix-huit mille barbares, les enfoncent, les renversent, les serrent entre leurs rangs et la mer, et la terreur que nos baïonnettes inspirent est telle, que les musulmans, forcés à choisir leur mort, se précipitent dans les abîmes de la Méditerranée.
« Dans cette journée mémorable furent pesés les destins de l’Égypte, de la France et de l’Europe, sauvés par votre courage.
Puissances coalisées, si vous osiez violer le territoire de la France et que le général qui nous fut rendu par la victoire d’Aboukir fît un appel à la nation, puissances coalisées, vos succès vous seraient plus funestes que vos revers ! Quel Français ne voudrait encore vaincre sous les drapeaux du premier consul, ou faire sous lui l’apprentissage de la gloire ? »
Puis, s’adressant aux invalides, auxquels la tribune du fond avait été réservée tout entière :
« Et vous, continua-t-il d’une voix plus forte, vous braves vétérans, honorables victimes du sort des combats, vous ne seriez pas les derniers à voler sous les ordres de celui qui console vos malheurs et votre gloire, et qui place au milieu de vous et sous votre garde ces trophées conquis par votre valeur ! Ah ! je le sais, braves vétérans, vous brûlez de sacrifier la moitié de la vie qui vous reste pour votre patrie et votre liberté ! »
Cet échantillon de l’éloquence militaire du vainqueur de Montebello fut criblé d’applaudissements ; trois fois le ministre de la guerre essaya de lui répondre, trois fois les bravos reconnaissants lui coupèrent la parole : enfin le silence se fit et Berthier s’exprima en ces termes :
« Élever aux bords de la Seine des trophées conquis sur les rives du Nil ; suspendre aux voûtes de nos temples, à côté des drapeaux de Vienne, de Pétersbourg et de Londres, les drapeaux bénits dans les mosquées de Byzance et du Caire ; les voir ici présentés à la patrie par les mêmes guerriers, jeunes d’années, vieux de gloire, que la victoire a si souvent couronnés, c’est ce qui n’appartient qu’à la France républicaine.
« Ce n’est là, d’ailleurs, qu’une partie de ce qu’a fait, à la fleur de son âge, ce héros qui, couvert des lauriers d’Europe, se montra vainqueur devant ces pyramides du haut desquelles quarante siècles le contemplaient, affranchissant par la victoire la terre natale des arts, et venant y reporter, entouré de savants et de guerriers, les lumières de la civilisation.
Soldats, déposez dans ce temple des vertus guerrières ces enseignes du croissant, enlevées sur les rochers de Canope par trois mille Français à dix-huit mille guerriers aussi braves que barbares ; qu’elles y conservent le souvenir de cette expédition célèbre dont le but et le succès semblent absoudre la guerre des maux qu’elle cause ; qu’elles y attestent, non la bravoure du soldat français, l’univers entier en retentit, mais son inaltérable constance, mais son dévouement sublime ; que la vue de ces drapeaux vous réjouisse et vous console, vous, guerriers, dont les corps, glorieusement mutilés dans les champs de l’honneur, ne permettent plus à votre courage que des vœux et des souvenirs ; que, du haut de ces voûtes, ces enseignes proclament aux ennemis du peuple français l’influence du génie, la valeur des héros qui les conquirent, et leur présagent aussi tous les malheurs de la guerre s’ils restent sourds à la voix qui leur offre la paix ; oui, s’ils veulent la guerre, nous la ferons, et nous la ferons terrible !
La patrie, satisfaite, contemple l’armée d’Orient avec un sentiment d’orgueil.
Cette invincible armée apprendra avec joie que les braves qui vainquirent avec elle aient été son organe ; elle est certaine que le premier consul veille sur les enfants de la gloire ; elle saura qu’elle est l’objet des plus vives sollicitudes de la République ; elle saura que nous l’avons honorée dans nos temples, en attendant que nous imitions, s’il le faut, dans les champs de l’Europe, tant de vertus guerrières que nous avons vu déployer dans les déserts brûlants de l’Afrique et de l’Asie.
Venez en son nom, intrépide général ! venez, au nom de tous ces héros au milieu desquels vous vous montrez, recevoir dans cet embrassement le gage de la reconnaissance nationale.
Mais, au moment de ressaisir les armes protectrices de notre indépendance, si l’aveugle fureur des rois refuse au monde la paix que nous lui offrons, jetons, mes camarades, un rameau de laurier sur les cendres de Washington, de ce héros qui affranchit l’Amérique du joug des ennemis les plus implacables de notre liberté, et que son ombre illustre nous montre au-delà du tombeau la gloire qui accompagne la mémoire des libérateurs de la patrie ! »
Bonaparte descendit de son estrade, et, au nom de la France, fut embrassé par Berthier.
M. de Fontanes, chargé de prononcer l’éloge de Washington, laissa courtoisement s’écouler jusqu’à la dernière goutte le torrent d’applaudissements qui semblait tomber par cascades de l’immense amphithéâtre.
Au milieu de ces glorieuses individualités, M. de Fontanes était une curiosité : moitié politique, moitié littéraire.
Après le 18 fructidor, il avait été proscrit avec Suard et Laharpe ; mais, parfaitement caché chez un de ses amis, ne sortant que le soir, il avait trouvé moyen de ne pas quitter Paris.
Un accident impossible à prévoir l’avait dénoncé.
Renversé sur la place du Carrousel par un cabriolet dont le cheval s’était emporté, il fut reconnu par un agent de police qui était accouru à son aide. Cependant Fouché, prévenu non seulement de sa présence à Paris, mais encore de la retraite qu’il habitait, fit semblant de ne rien savoir.
Quelques jours après le 18 brumaire, Maret, qui fut depuis duc de Bassano, Laplace, qui resta tout simplement un homme de science, et Regnault de Saint-Jean-d’Angély, qui mourut fou, parlèrent au premier consul de M. de Fontanes et de sa présence à Paris.
– Présentez-le-moi, répondit simplement le premier consul.
M. de Fontanes fut présenté à Bonaparte, qui, connaissant ce caractère souple et cette éloquence adroitement louangeuse, l’avait choisi pour faire l’éloge de Washington et peut-être bien un peu le sien en même temps.
Le discours de M. de Fontanes fut trop long pour que nous le rapportions ici ; mais ce que nous pouvons dire, c’est qu’il fut tel que le désirait Bonaparte.
Le soir, il y eut grande réception au Luxembourg. Pendant la cérémonie, le bruit avait couru d’une installation probable du premier consul aux Tuileries ; les plus hardis ou les plus curieux en hasardèrent quelques mots à Joséphine ; mais la pauvre femme, qui avait encore sous les yeux la charrette et l’échafaud de Marie-Antoinette, répugnait instinctivement à tout ce qui la pouvait rapprocher de la royauté ; elle hésitait donc à répondre, renvoyant les questionneurs à son mari.
Puis, il y avait une autre nouvelle qui commençait à circuler et qui faisait contrepoids à la première.
Murat avait demandé en mariage mademoiselle Caroline Bonaparte.
Or, ce mariage, s’il devait se faire, ne se faisait pas tout seul.





























