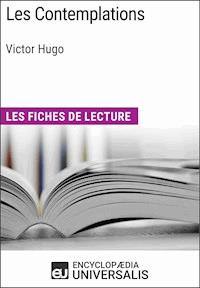
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalis
Depuis
Les Rayons et les Ombres (1840), Victor Hugo (1802-1885) n’avait pas publié de recueil lyrique. Certes
Les Châtiments (1853), violent libelle contre Napoléon III, marquaient un retour à la poésie, mais à une poésie tout entière au service de la politique.
Une fiche de lecture spécialement conçue pour le numérique, pour tout savoir sur Les Contemplations de Victor Hugo
Chaque fiche de lecture présente une œuvre clé de la littérature ou de la pensée. Cette présentation est couplée avec un article de synthèse sur l’auteur de l’œuvre.
A propos de l’Encyclopaedia Universalis :
Reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité incomparable de ses publications, Encyclopaedia Universalis met la connaissance à la portée de tous. Écrite par plus de 7 400 auteurs spécialistes et riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins…), l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable collection de référence disponible en français. Elle aborde tous les domaines du savoir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 72
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782852292246
© Encyclopædia Universalis France, 2019. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Monticello/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Encyclopædia Universalis.
Ce volume présente des notices sur des œuvres clés de la littérature ou de la pensée autour d’un thème, ici Les Contemplations, Victor Hugo (Les Fiches de lecture d'Universalis).
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
LES CONTEMPLATIONS, Victor Hugo (Fiche de lecture)
Depuis Les Rayons et les Ombres (1840), Victor Hugo (1802-1885) n’avait pas publié de recueil lyrique. Certes Les Châtiments (1853), violent libelle contre Napoléon III, marquaient un retour à la poésie, mais à une poésie tout entière au service de la politique. Dans la Préface aux Contemplations, publiées à Paris en 1856 alors que le poète est en exil à Guernesey, Hugo affirme : « Vingt-cinq années sont dans ces deux volumes [...]. L’auteur a laissé, pour ainsi dire, ce livre se faire en lui. La vie, en filtrant goutte à goutte à travers les événements et les souffrances, l’a déposé dans son cœur. » La souffrance est bien le thème central du recueil, liée à la mort de sa fille Léopoldine en 1843, qui a entraîné un profond bouleversement intérieur de l’homme et du poète.
• « Les mémoires d’une âme »
Le recueil est divisé en deux parties : Autrefois (1830-1843) et Aujourd’hui (1843-1855), soit les douze années qui précèdent la mort de sa fille, et les douze années qui la suivent. Hugo l’indique dans sa Préface, « Ce livre doit être lu comme on lirait le livre d’un mort », et précise aussitôt sa pensée : « Qu’est-ce que Les Contemplations ? C’est ce qu’on pourrait appeler, si le mot n’avait quelque prétention, Les Mémoires d’une âme. » Chacune des deux parties est divisée à son tour en trois livres : « Aurore », « L’Âme en fleur », « Les Luttes et les rêves » pour la première ; « Pauca Meae », « En marche », « Au bord de l’infini » pour la seconde. La première partie évoque davantage les moments de bonheur, de confiance, dépeint parfois la souffrance mais pour laisser l’espoir d’un apaisement compensateur. Dans la seconde, au contraire, la poésie soutient une méditation philosophique sur le deuil et l’injustice du monde. Hugo peint dans Les Contemplations la totalité de l’âme – amour, tristesse, deuil, éblouissements et mystères de la nature, pensée sociale, politique et religieuse – grâce à l’étendue de son registre lyrique qui allie le badinage léger, la plainte désolée, à l’éloquence et au pittoresque des descriptions. Les Contemplations, chef-d’œuvre poétique de Hugo, preuve éclatante de la maturité du génie, offrent un véritable panorama de la conscience : « Ce sont, en effet, toutes les impressions, tous les souvenirs, toutes les réalités, tous les fantômes vagues, riants ou funèbres, que peut contenir une conscience, revenus et rappelés, rayon à rayon, soupir à soupir, et mêlés dans la même nuée sombre. »
• De l’opposant politique au mage romantique
Les Contemplations reflètent aussi les préoccupations politiques de Hugo homme d’action. Pair de France depuis 1843, maire du VIIIe arrondissement de Paris, député à la Constituante en 1848, il soutient Louis-Napoléon Bonaparte avant de devenir son plus farouche opposant, et de s’exiler en Belgique puis en Angleterre jusqu’à la chute du second Empire en 1870. En témoigne le magistral poème « Écrit en 1846 » (livre V, 3) dans lequel Hugo explique son évolution. L’action politique se prolonge à travers la question sociale : à l’époque où il achève « Melancholia » (livre III, 2), Hugo écrit Les Misérables, et le poème devient dénonciation de l’intolérable travail des enfants : « Ils s’en vont travailler quinze heures sous des meules ;/ Ils vont, de l’aube au soir, faire éternellement/ Dans la même prison le même mouvement » (« Écrit sur un exemplaire de la Divina Commedia »).
Sa vie intime fournit également, avec la mort tragique de Léopoldine, l’inspiration de nombreux poèmes, évocations de scènes familières : « Elle avait pris ce pli dans son âge enfantin/ De venir dans ma chambre un peu chaque matin » (« Pauca meae », V)
La méditation philosophique sur la mort, enfin, tient une place centrale dans le recueil, récit du deuil. Si Hugo reprend, dans « Mors » (livre IV, 16), l’image classique de la faucheuse, il la transforme par la pensée consolante d’une âme recueillie par un ange souriant. Les Contemplations exaltent également la tâche surhumaine, mais revendiquée, du poète parmi les hommes. Déçu dans ses ambitions politiques, Hugo se veut le porte-parole de l’humanité entière ; exilé, il se confie à Dieu ; désespéré, il peint la souffrance et laisse espérer une contemplation future.
Le poète devient le « mage », celui « qui marche devant tous, éclairant ceux qui doutent », celui qui en écoutant « ce que dit la bouche d’ombre » accède à une réalité interdite aux hommes : « Sache que tout connaît sa loi, son but, sa route ;/ Que, de l’astre au ciron, l’immensité s’écoute ;/ Que tout a conscience en la création ;/ Et l’oreille pourrait avoir sa vision,/ Car les choses et l’être ont un grand dialogue. »
Les Contemplations peuvent alors exalter la grandeur cosmique de la nature, immense, sauvage, qui offre à l’âme désolée une consolation, sous toutes ses formes, « Arbres religieux, chênes, mousses, forêt » (« Les Luttes et les rêves », XXIV). La poésie devient religion universelle, hymne à la fraternité d’une destinée commune : « Nul de nous n’a l’honneur d’avoir une vie qui soit à lui. Ma vie est la vôtre, votre vie est la mienne, vous vivez ce que je vis » (Préface). Car le projet hugolien est bien d’embrasser tous les aspects de la vie, naissance et mort, joies et peines, luttes et douleurs, dans une continuité qui va de la joie de la jeunesse à l’espérance après le deuil, selon un parcours menant d’« Autrefois » à « Aujourd’hui ». C’est là le cheminement indiqué par les deux volumes, que sépare le deuil : « Un abîme les sépare, le tombeau » (Préface aux Contemplations).
Jean-François PÉPIN
Études
J. GAUDON, Le Temps de la contemplation, Nizet, Paris, 1969C. GELY, Victor Hugo, poète de l’intimité, Nizet, 1969.HUGO VICTOR (1802-1885)
Roman, critique, voyages, histoire dialoguent dans l’œuvre de Victor Hugo avec le lyrisme, l’épopée, le théâtre en un ensemble dont le « poète » a souvent proposé des articulations historiques, géographiques ou idéologiques plutôt qu’une périodisation. En règle générale, l’œuvre en prose a pour fonction de recueillir les éléments les plus secrets de l’œuvre poétique, de les composer en architectures prospectives ; plus neuve et plus audacieuse ainsi, elle peut servir de préface à toute la création hugolienne. Elle se distribue pourtant en trois masses : la mort de Léopoldine, en 1843, entre l’Académie (1841) et la Chambre des pairs (1845), marque une première rupture ; vers 1866-1868, c’est le tournant proprement historique et politique. Chacune de ces masses est caractérisée par la présence de romans ou quasi-romans (Han d’Islande, Bug-Jargal, Le Dernier Jour d’un condamné, Notre-Dame de Paris, Claude Gueux, pour la première ; Les Misérables, Les Travailleurs de la mer, pour la deuxième ; L’Homme qui rit et Quatrevingt-Treize, pour la troisième), de textes mêlés d’histoire, de politique et de voyages (pour l’essentiel, respectivement : Le Rhin ; Choses vues et Paris ; Actes et Paroles et Histoire d’un crime) et enfin d’essais critiques, qui se fondent avec l’histoire militante dans la troisième période, en une vue rétrospective qu’annonçaient déjà Littérature et philosophie mêlées dans la première période et la somme du William Shakespeare dans la deuxième. La poétique de l’œuvre en prose s’inscrit donc dans un espace à quatre dimensions : le romanesque, le voyage, la politique, la réflexion critique sur le génie. À côté de l’évolution biographique et historique, c’est le William Shakespeare qui forme le centre de gravité du colosse. Poète usé par l’école de la IIIe





























