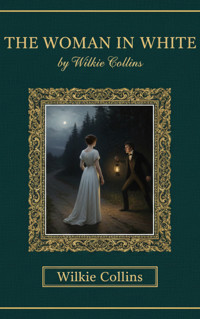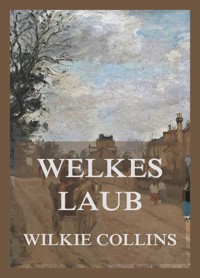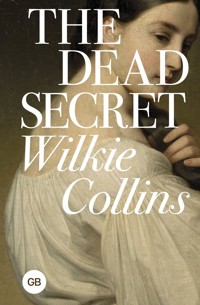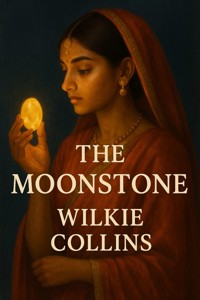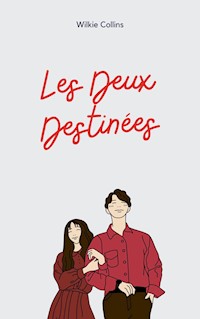
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
George, petit collégien, est très amoureux de Mary, la fille du régisseur. Mais les parents de George les séparent, malgré les sombres prédictions de la vieille grand-mère de Mary. En effet, le bonheur fuit les deux jeunes gens, aussi bien pour Mary, mariée contre son gré, que pour George qui ne peut l'oublier. Des circonstances dramatiques les rapprochent cependant, mais c'est sans se reconnaître qu'ils s'aimeront...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des matières
LE PRÉLUDE LE CONVIVE RACONTE L’HISTOIRE DU DÎNER
LE RÉCIT GEORGE GERMAINE ÉCRIT ET RACONTE L’HISTOIRE DE SON AMOUR
CHAPITRE PREMIER GREEN WATER BROAD
CHAPITRE II DEUX JEUNES CŒURS
CHAPITRE III SWEDENBORG ET LA SIBYLLE
CHAPITRE IV LE RIDEAU TOMBE
CHAPITRE V MON HISTOIRE
CHAPITRE VI SON HISTOIRE
CHAPITRE VII LA FEMME SUR LE PONT
CHAPITRE VIII LES ÂMES-SŒURS
CHAPITRE IX NATUREL ET SURNATUREL
CHAPITRE X LE PUITS DE SAINT-ANTOINE
CHAPITRE XI LA LETTRE D’INTRODUCTION
CHAPITRE XII LES MALHEURS DE MME VAN BRANDT
CHAPITRE XIII INCURABLE
CHAPITRE XIV MADAME VAN BRANDT CHEZ ELLE
CHAPITRE XV JE SUIS VAINCU PAR L’OBSTACLE
CHAPITRE XVI JOURNAL DE MA MÈRE
CHAPITRE XVII HOSPITALITÉ SHETLANDAISE
CHAPITRE XVIII LA CHAMBRE ASSOMBRIE
CHAPITRE XIX LES CHATS
CHAPITRE XX LE PAVILLON VERT
CHAPITRE XXI ELLE S’INTERPOSE ENTRE NOUS
CHAPITRE XXII ELLE ME RÉCLAME DE NOUVEAU
CHAPITRE XXIII LE BAISER
CHAPITRE XXIV À L’OMBRE DE SAINT-PAUL
CHAPITRE XXV JE ME TROUVE AU RENDEZ-VOUS
CHAPITRE XXVI CONVERSATION AVEC MA MÈRE
CHAPITRE XXVII CONVERSATION AVEC MME VAN BRANDT
CHAPITRE XXVIII AMOUR ET ARGENT
CHAPITRE XXIX NOS DESTINÉES NOUS SÉPARENT
CHAPITRE XXX UN REGARD EN ARRIÈRE
CHAPITRE XXXI MADEMOISELLE DUNROSS
CHAPITRE XXXII L’OPINION DU MÉDECIN
CHAPITRE XXXIII UN DERNIER REGARD SUR GREENWATER-BROAD
CHAPITRE XXXIV UNE VISION DE LA NUIT
CHAPITRE XXXV PAR TERRE ET PAR MER
CHAPITRE XXXVI SOUS LA FENÊTRE
CHAPITRE XXXVII AMOUR ET ORGUEIL
CHAPITRE XXXVIII LES DEUX DESTINÉES
LE FINALE LA FEMME ÉCRIT ET TERMINE L’HISTOIRE
Mentions légales
LE PRÉLUDELE CONVIVE RACONTE L’HISTOIRE DU DÎNER
Bien des années se sont écoulées depuis que ma femme et moi nous quittâmes les États-Unis pour rendre notre première visite à l’Angleterre.
Nous étions munis, cela va sans dire, de lettres d’introduction, parmi lesquelles il y en avait une écrite pour nous par le frère de ma femme. Elle nous présentait à un gentleman anglais qui occupait le premier rang sur la liste de ses anciens et précieux amis.
« Vous ferez la connaissance de M. George Germaine, » me dit mon beau-frère, lorsque nous prîmes congé de lui, « à une époque très-intéressante de sa vie. Les dernières nouvelles que j’en ai reçues m’apprennent qu’il vient de se marier. Je ne connais ni la dame ni les circonstances qui l’ont mise en rapport avec mon ami, mais ce dont je suis certain, c’est que, marié ou célibataire, George Germaine, par égard pour moi, vous accueillera cordialement en Angleterre, vous et votre femme. »
Le lendemain de notre arrivée à Londres, nous déposâmes notre lettre d’introduction chez M. Germaine.
Le lendemain matin, nous allâmes visiter un objet favori de la curiosité américaine, dans la métropole d’Angleterre, la Tour de Londres. Les citoyens des États-Unis trouvent cette relique des bons vieux temps fort utile à l’accroissement de leur appréciation nationale de la valeur des institutions républicaines. En rentrant à l’hôtel, les cartes de M. et Mme Germaine nous apprirent qu’ils nous avaient déjà rendu notre visite. Le même soir nous reçûmes une invitation à dîner chez les nouveaux mariés. Elle était jointe à un petit billet de Mme Germaine à ma femme, pour nous avertir que nous ne devions pas nous attendre à trouver une nombreuse société.
« C’est le premier dîner que nous donnons depuis notre retour de notre voyage de noces, » écrivait la dame, « et vous ne serez présentés qu’à quelques vieux amis de mon mari. »
En Amérique, et, m’assure-t-on, sur le continent d’Europe également, lorsque votre hôte vous invite à dîner à une heure précise, vous lui faites la politesse d’arriver ponctuellement chez lui. Ce n’est qu’en Angleterre que prévaut l’incompréhensible et discourtoise coutume de faire attendre l’hôte et le dîner pendant une demi-heure et plus, sans raison plausible, et sans meilleure excuse que l’apologie de pure forme impliquée dans ces mots :
« Désolé d’être en retard. »
Arrivés à l’heure fixée chez M. et Mme Germaine, nous n’eûmes qu’à nous féliciter de l’ignorante ponctualité qui nous avait introduits dans leur salon une demi-heure avant les autres convives.
En premier lieu, il y eut tant de cordialité et si peu de cérémonie dans l’accueil qu’on nous fit, que nous nous imaginâmes presque être de retour dans notre patrie. En second lieu, le mari et la femme nous intéressèrent à première vue. La dame, en particulier, bien qu’elle ne fût pas, strictement parlant, jolie, nous fascina complètement. Il y avait dans sa figure et ses manières un charme naïf, dans tous ses mouvements une simplicité gracieuse, dans sa voix une grave et délicieuse mélodie qui nous parurent, à nous Américains, simplement irrésistibles. Et de plus, il était si facile et si agréable de constater que c’était là un heureux couple ! Nous avions devant les yeux deux individus qui avaient mis en commun leurs plus chères espérances, leurs désirs et leurs sympathies, et qui, si je puis me permettre cette expression, paraissaient nés pour être mari et femme. À l’expiration du retard à la mode d’une demi-heure, nous causions ensemble aussi familièrement et aussi intimement que si nous avions été de vieux amis.
Huit heures sonnèrent et le premier des convives anglais parut.
Comme j’ai oublié le nom de ce gentleman, on me permettra de le désigner par une lettre de l’alphabet. Appelons-le donc M. A. Quand il entra seul dans le salon, notre hôte et notre hôtesse tressaillirent et parurent tous deux étonnés. Évidemment, ils s’attendaient à le voir accompagné d’une autre personne. M. Germaine adressa une singulière question à son ami.
« Où est votre femme ? » demanda-t-il.
M. A répondit pour la dame absente par une simple petite excuse exprimée par ces paroles :
« Elle a un fort rhume. Elle est très-désolée. Elle m’a prié de vous présenter ses excuses. »
À peine avait-il articulé ces mots, que parut un autre gentleman, seul également. Ayant encore recours à l’alphabet, je l’appellerai M. B. Je remarquai de nouveau que notre hôte et notre hôtesse tressaillirent lorsqu’ils le virent entrer seul dans le salon. Et, à ma grande surprise, j’entendis M. Germaine adresser au nouveau convive cette curieuse question :
« Où es votre femme ? »
La réponse, – avec une légère modification, – fut la simple petite excuse de M. A, répétée par M. B :
« Je suis très-désolé. Mme B a une forte migraine. Elle est sujette aux migraines. Elle m’a prié de vous présenter ses excuses. »
M. et Mme Germaine se regardèrent. Le visage du mari exprimait clairement le soupçon que cette seconde excuse avait éveillé dans son esprit. La femme demeura ferme et calme. Un intervalle s’écoula, un intervalle silencieux. M. A et M. B se retirèrent, comme deux coupables, dans un coin. Nous nous mîmes, ma femme et moi, à regarder les tableaux.
Mme Germaine, la première, rompit notre intolérable silence. Il paraît qu’on attendait encore deux convives pour compléter la société.
« Dînerons-nous de suite, George ? » dit-elle à son mari, « ou attendrons-nous M. et Mme C ?
– Nous attendrons cinq minutes, » répondit-il brièvement, avec l’œil fixé sur M. A et M. B, honteusement confinés dans leur coin.
La porte du salon s’ouvrit. Nous savions tous qu’on attendait une troisième dame mariée. Nous regardâmes tous la porte avec une anxiété indicible. Notre espérance muette reposait silencieusement sur l’apparition possible de Mme C. Cette femme admirable, mais inconnue, allait-elle à la fois nous charmer et nous soulager par sa présence ? Je frémis en l’écrivant, M. C. entra dans le salon, – et y entra seul.
M. Germaine varia subitement la formule de sa demande, en recevant le nouveau convive.
« Votre femme est-elle malade ? » demanda-t-il.
M. C était un homme âgé ; M. C avait vécu, à en juger par les apparences, à l’époque où les lois surannées de la politesse étaient encore en vigueur. Il découvrit dans leur coin ses deux confrères mariés sans leurs femmes, et il excusa lasienne de l’air d’un homme franchement honteux.
« Mme C est si désolée. Elle a un fort rhume. Elle regrette tant de n’avoir pu m’accompagner. »
À cette troisième excuse, l’indignation de M. Germaine se fit jour par ces paroles :
« Deux rhumes et une migraine, » dit-il, avec une politesse ironique. « J’ignore, messieurs, comment s’accordent vos femmes quand elles se portent bien. Mais, lorsqu’elles sont malades, leur unanimité est merveilleuse ! »
On annonça le dîner au moment où ce sarcasme s’échappait de ses lèvres.
J’eus l’honneur de conduire Mme Germaine dans la salle à manger. La perception de l’insulte tacite à elle adressée par les femmes des amis de son mari ne se traduisit que par un tremblement, un très-léger tremblement, de la main qui reposait sur mon bras. Mon intérêt pour elle s’en décupla. Une femme accoutumée à souffrir, brisée et disciplinée jusqu’à se maîtriser, pouvait seule supporter comme elle, depuis le commencement jusqu’à la fin de la soirée, le martyre moral infligé à cette femme.
Est-ce que j’exagère en appliquant ces termes à mon hôtesse ? Considérez les circonstances telles qu’elles nous frappèrent, ma femme et moi, deux étrangers !
C’était le premier dîner que donnaient M. et Mme Germaine depuis leur mariage. Trois des amis de M. Germaine, tous trois mariés, avaient été invités avec leurs femmes, et ils avaient évidemment accepté l’invitation sans réserve. Quelles révélations s’étaient donc produites entre l’envoi de l’invitation et le dîner ? Il était impossible de le dire. Mais ce qui était évident, c’est que, dans l’intervalle, les trois femmes s’étaient entendues pour laisser à leurs maris le soin de les représenter à la table de Mme Germaine, et ce qui était encore plus étonnant, c’est que les maris avaient approuvé la conduite grossièrement impolie de leurs femmes jusqu’à consentir à offrir, pour leur absence, les excuses les plus insolemment triviales. Quel affront plus cruel pouvait-on adresser à une femme, au début de son mariage, à la face de son mari, et en présence de deux étrangers d’un autre pays ? le mot martyre est-il trop fort pour exprimer ce qu’une personne sensible devait souffrir d’un pareil traitement ? Je ne le pense pas.
Nous prîmes place à table. Ne me demandez pas de vous décrire la plus misérable des réunions humaines, la plus fatigante et la plus lugubre des fêtes mondaines. C’est déjà trop que de se rappeler cette soirée, en vérité, c’est trop !
Nous fîmes, ma femme et moi, de notre mieux, pour maintenir la conversation sur un terrain aussi aisé et aussi inoffensif que possible. Je peux dire en toute vérité que nous nous y employâmes ferme. Et pourtant notre succès n’était pas encourageant. Malgré nos efforts pour n’y point prendre garde, les trois places vides des femmes absentes parlaient d’elles-mêmes dans leur lugubre langage. Malgré nos efforts pour la repousser, nous nous sentions envahis par la triste conclusion que ces places vides persistaient à imposer à nos esprits. Il n’était que trop évident que quelque terrible bruit concernant la réputation de la malheureuse femme qui occupait le haut bout de la table avait éclaté inopinément, et, d’un coup, l’avait détruite dans l’estime des amis de son mari. En présence des excuses du salon, en présence des places vides de la table de la salle à manger, que pouvaient utilement faire les convives les plus bienveillants pour assister le mari et la femme dans leur cruelle et soudaine affliction ? Ils ne pouvaient que leur souhaiter le bonsoir le plus tôt possible, et livrer miséricordieusement à eux-mêmes les deux époux.
Qu’il soit au moins constaté à la décharge des trois gentlemen désignés par les lettres A B C, qu’ils se sentirent assez honteux d’eux-mêmes et de leurs femmes pour être les premiers de la société à quitter la maison. Quelques minutes après, nous nous levâmes pour suivre leur exemple. Mme Germaine nous pria instamment de retarder notre départ.
« Attendez quelques minutes, » murmura-t-elle en regardant son mari. « J’ai quelque chose à vous dire avant que nous ne partiez. »
Elle nous quitta, et, prenant le bras de M. Germaine, elle le conduisit à l’autre bout du salon. Ils eurent ensemble, à voix basse, un petit entretien que le mari termina en portant la main de sa femme à ses lèvres.
« Agissez comme il vous plaira, mon amour, » lui dit-il, « je vous laisse entièrement libre. »
Il s’assit tristement, perdu dans ses pensées. Mme Germaine ouvrit un petit meuble placé à l’extrémité du salon et revint vers nous avec un petit portefeuille à la main.
« Je ne trouve point de mots pour vous exprimer combien je vous suis reconnaissante de votre bonté, » dit-elle avec une simplicité et une dignité parfaites. « Dans des circonstances extrêmement délicates, vous m’avez traitée avec la tendresse et la sympathie que vous auriez témoignées à une vieille amie. Le seul retour dont je puisse payer tout ce que je vous dois, c’est de vous admettre dans mon entière confidence, et de vous permettre de juger par vous-même si je mérite le traitement que j’ai reçu ce soir. »
Ses yeux se remplirent de larmes. Elle s’arrêta pour se maîtriser. Nous la priâmes tous les deux de ne pas ajouter un mot, et son mari joignit ses instances aux nôtres. Elle nous remercia, mais elle voulut continuer. Comme la plupart des personnes douées de sensibilité, elle savait être résolue quand elle le croyait nécessaire.
« J’ai quelques mots à ajouter, » reprit-elle en s’adressant à ma femme. « Vous êtes la seule femme mariée qui soit venue à notre petit dîner. L’absence marquée des autres femmes s’explique d’elle-même. Il ne m’appartient pas de décider si elles ont eu tort ou raison de refuser de s’asseoir à notre table. Mon cher mari, – qui connaît ma vie entière aussi bien que moi-même, – avait désiré que nous invitassions ces dames. Il espérait à tort que son estime pour moi serait partagée par ses amis ; et ni lui ni moi nous n’avions présumé que les malheurs de ma vie passée viendraient à être révélés par quelques personnes au fait de ces malheurs, et dont il nous reste à découvrir la trahison. Le moins que je puisse faire, en retour de votre bonté, c’est de vous placer vis-à-vis de moi dans la même position qu’occupent aujourd’hui les autres dames. Les circonstances qui m’ont amenée à devenir la femme de M. Germaine sont, à certains égards, très remarquables. Elles se trouvent racontées, sans suppression ni réserve, dans un petit récit que mon mari écrivit à l’époque de notre mariage pour l’édification d’un de ses parents absent dont il ne se souciait pas de surprendre la bonne opinion. Le manuscrit de ce récit se trouve dans ce portefeuille. Après ce qui vient d’arriver, je vous supplie, comme une faveur personnelle, de le lire tous les deux. Vous déciderez, quand vous connaîtrez tout, si je suis, oui ou non, une personne avec laquelle puisse se lier une femme honnête. »
Elle nous tendit la main avec un doux et triste sourire et nous souhaita le bonsoir. Ma femme, avec sa nature impulsive, oublia les cérémonies d’usage, et l’embrassa en partant. Devant ce petit témoignage de sympathie sororale, la fermeté d’âme que la pauvre créature avait conservée toute la soirée, s’évanouit en un instant. Elle fondit en larmes.
Je me sentis aussi tendre et aussi affligé pour elle que ma femme. Mais, malheureusement, je ne pouvais me prévaloir du privilége de ma femme de l’embrasser. En descendant, je trouvai l’occasion d’adresser un mot de consolation à son mari qui nous avait accompagnés jusqu’à la porte.
« Avant d’ouvrir ceci, » dis-je en désignant le portefeuille placé sous mon bras, « mon opinion est faite, monsieur, sur un point. Si je n’étais déjà marié, je vous déclare que je vous envierais votre femme. »
Il désigna à son tour le portefeuille.
« Lisez ce que j’ai écrit là, » dit-il, « et vous comprendrez ce que mes faux amis m’ont fait souffrir ce soir. »
Le lendemain matin, nous ouvrîmes, ma femme et moi, le portefeuille, et nous lûmes l’étrange histoire du mariage de George Germaine.
LE RÉCITGEORGE GERMAINE ÉCRIT ET RACONTE L’HISTOIRE DE SON AMOUR
CHAPITRE PREMIERGREEN WATER BROAD
Regarde en arrière, ô ma mémoire ! à travers l’obscur labyrinthe du passé, à travers le mélange des joies et des chagrins de vingt années. Ressuscitez, ô mes jours d’enfance ! aux bords verts et sinueux du petit lac. Reviens à moi, amour de mon enfance, dans l’innocente beauté de tes dix premières années. Revivons, mon ange, comme nous avons vécu dans notre premier paradis, avant que le péché et le chagrin, tirant leurs épées flamboyantes, nous eussent chassés dans le monde.
C’était en mars. Les derniers oiseaux sauvages de la saison nageaient sur les eaux du lac que, dans notre idiome de Suffolk, nous appelions Green Water Broad.
Où que soufflât le vent, les bords herbeux et les arbres penchés sur lui coloraient le lac de cette douce teinte verte à laquelle il devait son nom. Les bateaux étaient abrités dans une anse à l’extrémité sud du lac, – et mon joli bateau à voiles occupait à lui seul un petit port naturel. Dans une anse, à l’extrémité nord, se trouvait le grand piège (dit le leurre), employé à attraper les oiseaux sauvages qui, chaque hiver, affluaient par milliers à Green Water Broad.
Ma petite Marie et moi, nous sortîmes, la main dans la main, pour voir les derniers oiseaux de la saison se faire prendre dans le leurre.
La partie extérieure de cet étrange piège à oiseaux s’élevait des eaux du lac en une série d’arches circulaires formées de branches élastiques d’une courbe voulue et couvertes de filets leur servant de voûte. Rapetissées peu à peu, les arches et leurs filets suivaient jusqu’au bout les sinuosités secrètes de l’anse. Derrière les arches, du côté de la terre, s’élevait une palissade en bois assez haute pour dérober à la vue des oiseaux nageant sur le lac un homme agenouillé derrière. À certains intervalles était pratiquée une ouverture assez large pour livrer passage à un chien terrier ou à un épagneul. Et là commençait et finissait le simple mécanisme du leurre.
J’avais alors treize ans et Marie dix. Pour nous rendre au lac, nous avions avec nous, comme guide et compagnon, le père de Marie. Le brave homme était régisseur de la propriété de mon père. Il était, en outre, maître expert dans l’art d’attraper au piège les canards. Le chien qui l’aidait (on ne se servait pas de canards apprivoisés comme leurres dans le Suffolk) était un petit terrier noir : un maître expert également dans son genre ; et une créature qui possédait, à proportions égales, les qualités enviables d’une bonne humeur et d’un bon sens parfaits.
Le chien suivait le régisseur, et nous suivions le chien.
Arrivé à la palissade qui entourait le leurre, le chien s’assit en attendant qu’on eût besoin de lui. Le régisseur et les enfants se glissèrent derrière la palissade et regardèrent à travers l’ouverture la plus avancée, qui dominait en plein sur le lac. Il n’y avait pas un souffle de vent ; pas une ride ne sillonnait la surface de l’eau ; de doux et gris nuages remplissaient le ciel et nous cachaient le soleil.
Nous regardâmes à travers l’ouverture de la palissade. Les canards sauvages étaient là réunis à portée du leurre, et nettoyant tranquillement leurs plumes sur la calme surface du lac.
Le régisseur regarda le chien et lui fit un signe. Le chien regarda le régisseur, et, s’avançant tranquillement, sortit par l’ouverture de manière à se montrer sur l’étroite langue de terrain descendant en pente de la palissade au lac.
D’abord un canard, puis deux, enfin une demi-douzaine de canards aperçurent le chien.
Un nouvel objet, apparaissant tout à coup sur la scène solitaire, devint immédiatement un sujet d’intense curiosité pour les canards. Les plus avancés commencèrent à nager lentement vers l’étrange créature à quatre pattes plantée immobile sur le bord. Deux par deux, trois par trois, le gros de la troupe des oiseaux aquatiques suivit graduellement l’avant-garde. En approchant de plus en plus du chien, les canards prudents s’arrêtèrent tout à coup, et, en arrêt sur l’eau ils considérèrent, à une sûre distance, le phénomène placé sur la terre.
Le régisseur, agenouillé derrière la palissade, murmura : « Trim ! »
En s’entendant appeler, le terrier se retourna, et, rentrant par l’ouverture, disparut à la vue des canards. Immobiles sur l’eau, les oiseaux sauvages s’étonnèrent et attendirent. Au bout d’une minute, le chien avait trotté autour de la palissade et avait reparu à travers la seconde ouverture pratiquée à l’endroit où le lac pénétrait dans les circuits les plus avancés de l’anse.
La seconde apparition du terrier produisit immédiatement un second accès de curiosité parmi les canards. D’un commun accord, ils avancèrent en nageant pour voir le chien de plus près ; puis, se jugeant de nouveau à une sûre distance, ils s’arrêtèrent une seconde fois sous l’arche la plus avancée du leurre. Le chien disparut encore, et les canards, intrigués, attendirent. Il s’écoula un intervalle, – et la troisième apparition du terrier eut lieu à travers la troisième ouverture de la palissade pratiqué plus avant au-dessus de l’anse. Pour la troisième fois, une curiosité irrésistible poussa les canards à avancer de plus en plus sous les arches fatales du leurre. Le jeu continua une quatrième et une cinquième fois, jusqu’à ce que le chien eût attiré, de place en place, les oiseaux aquatiques dans les retraits les plus profonds du leurre. Là, Trim fit une dernière apparition. Les canards avancèrent et s’arrêtèrent prudemment une dernière fois. Le régisseur toucha le ressort. Le filet plombé s’abattit verticalement dans l’eau et ferma le leurre. Les canards s’y trouvèrent pris par douzaines, grâce à leur propre curiosité et sans autre appât qu’un petit chien ! Quelques heures après, ils étaient morts et en route pour le marché de Londres.
À la fin du dernier acte de la curieuse comédie du leurre, la petite Marie posa la main sur mon épaule, et, se soulevant sur la pointe du pied, elle murmura à mon oreille :
« George, venez avec moi à la maison. J’ai à vous montrer quelque chose de mieux que les canards.
– Qu’est-ce que c’est ?
– C’est une surprise. Je ne veux pas vous le dire.
– Voulez-vous me donner un baiser ? »
La charmante petite créature posa ses bras grêles et hâlés par le soleil autour de mon cou, et répondit :
« Autant de baisers que vous voudrez, George. »
Ses paroles étaient aussi innocentes que mes baisers. Le brave et facile régisseur, négligeant pour l’instant ses canards, nous aperçut nous livrant à nos amours enfantins dans les bras l’un de l’autre. Il nous menaça de son gros index avec un sourire triste et équivoque.
« Ah ! maître George ! maître George ! » dit-il. « Quand votre père arrivera, pensez-vous qu’il approuve que son fils embrasse la fille de son régisseur ?
– Quand mon père arrivera, » répondis-je avec une grande dignité, « je lui dirai la vérité. Je lui déclarerai que je veux épouser votre fille. »
Le régisseur éclata de rire et retourna à ses canards.
« Bien ! bien ! » l’entendîmes-nous se dire à lui-même. « Ce sont des enfants. Il n’y a pas nécessité, pauvres petits, de les séparer encore. »
Marie et moi, nous détestions qu’on nous traitât d’enfants. À proprement parler, l’un de nous était une dame de dix ans, et l’autre un gentleman de treize. Nous quittâmes le régisseur, indignés, et nous nous dirigeâmes, la main dans la main, vers le cottage.
CHAPITRE IIDEUX JEUNES CŒURS
« Il grandit trop vite, » dit le médecin à ma mère ; « et il est beaucoup trop avancé pour un garçon de son âge. Retirez-le de pension, madame, pendant six mois ; laissez-le courir au grand air chez vous ; et, si vous lui voyez un livre à la main, ôtez-le-lui de suite. Voilà mon ordonnance ! »
Ces paroles décidèrent de ma destinée.
Pour obéir à l’avis du médecin, on me laissa, enfant désœuvré, – sans frères ni sœurs, ni compagnons de mon âge, – vagabonder sur les dépendances de notre maison de campagne isolée. La fille du régisseur était, comme moi, enfant unique, et, comme moi, elle n’avait pas de camarades de jeu. Nous nous rencontrâmes dans nos promenades sur les bords solitaires du lac. Nous commençâmes par être des compagnons inséparables, et nous finîmes par devenir de véritables amoureux. Les préliminaires de nos amours terminés, nous nous proposions (avant ma rentrée à la pension) d’arriver à maturité complète en devenant mari et femme.
Je ne plaisante pas. Si absurde que cela puisse paraître aux « âmes sensibles », bien qu’enfants, nous étions deux amants, si jamais il a existé des amants.
Nous n’avions d’autres plaisirs que celui, bien suffisant, que nous trouvions dans la société l’un de l’autre. Nous détestions la nuit parce qu’elle nous séparait. Nous suppliâmes, chacun de notre côté, nos parents de nous laisser coucher dans la même chambre. J’en voulus à ma mère, et Marie à son père, lorsqu’ils se moquèrent de nous et nous demandèrent ce que nous exigerions après. En me reportant au temps écoulé depuis mes jours d’enfance jusqu’à ceux de ma virilité, je puis évoquer vivement les instants de bonheur qui me sont échus en partage. Mais je ne me rappelle, de cette dernière époque, aucune joie comparable au plaisir exquis et constant qui remplissait mon jeune être lorsque je me promenais avec Marie dans les bois ; lorsque je naviguais dans mon bateau, avec Marie, sur le lac ; lorsque je retrouvais Marie après la cruelle séparation de la nuit, et que je me précipitais dans ses bras ouverts, comme si nous avions été séparés pendant des mois entiers.
Quel attrait nous poussait si vivement l’un vers l’autre, à un âge où les sympathies, qui naissent de la différence des sexes, sommeillaient encore chez elle et chez moi ?
Nous l’ignorions et ne cherchions pas à le savoir. Nous obéissions à l’impulsion d’un amour réciproque, comme l’oiseau obéit à l’impulsion du vol.
N’allez pas supposer que nous possédions quelques qualités qui nous distinguassent ostensiblement des autres enfants de notre âge. Il n’en était rien. On m’avait appelé un garçon distingué, à la pension ; mais il y avait des milliers d’autres garçons dans des milliers d’autres pensions qui marchaient à la tête de leurs classes et remportaient des prix comme moi. Personnellement parlant, je n’avais de remarquable que d’être, comme on dit vulgairement, « grand pour son âge. » De son côté, Marie ne possédait aucun attrait frappant. C’était une enfant délicate, aux yeux gris et doux, au teint pâle, et singulièrement réservée et silencieuse, sauf quand elle se trouvait seule avec moi. Toute sa beauté, dans ces jours d’enfance, résidait dans une certaine pureté et une tendresse d’expression naïves, et dans la charmante teinte brun-rouge de ses cheveux qui variait bizarrement et agréablement, selon les diverses expositions de la lumière. Bien qu’à en juger par l’apparence, nous fussions deux enfants parfaitement ordinaires, nous étions mystérieusement unis par une parenté d’âme dont le secret nous échappait à nous-mêmes, et qui, par sa profondeur, se dérobait également à l’investigation de têtes plus vieilles et plus sages que les nôtres.
On se demandera naturellement si nos parents ne tentèrent rien pour combattre notre attachement réciproque, alors qu’il n’était encore qu’une innocente amourette entre un petit garçon et une petite fille.
Mon père ne s’en occupa point, – par la raison fort simple qu’il était absent.
C’était un homme d’une tournure d’esprit inquiète et spéculatrice. Héritier d’un domaine surchargé de dettes, sa grande ambition était d’augmenter son mince revenu disponible par ses propres efforts, de s’établir à Londres, et d’arriver à une position politique par la voie du parlement. Un ancien ami qui avait émigré en Amérique lui avait proposé, dans l’un des États de l’Ouest, une entreprise agricole qui devait les enrichir tous les deux. L’imagination excentrique de mon père s’était coiffée de cette idée. Il nous avait quittés depuis plus d’un an pour se rendre aux États-Unis ; et tout ce que nous savions de lui, par ses lettres, c’était que nous pouvions nous attendre à le voir revenir prochainement près de nous dans la situation enviable d’un des hommes les plus riches de l’Angleterre.
Quant à ma mère, – la plus douce et la plus tendre des femmes, – tout ce qu’elle désirait, c’était de me voir heureux.
Les singulières amourettes des deux enfants l’amusaient et l’intéressaient. Elle plaisantait avec le père de Marie à propos de la future alliance entre les deux familles, sans aucune préoccupation de l’avenir, – sans le moindre pressentiment de ce qui pourrait arriver au retour de mon père. « À chaque jour suffit sa peine (ou sa joie), » avait été, toute sa vie, la devise de ma mère. Elle partageait la philosophie facile du régisseur déjà mentionnée ici : « Ce sont des enfants. Il n’y a pas nécessité, pauvres petits, de les séparer encore ! »
Toutefois, un membre de la famille envisagea raisonnablement et sérieusement la chose.
Lors d’une visite qu’il nous rendit dans notre solitude, le frère de mon père remarqua ce qui se passait entre Marie et moi, et, tout d’abord, se montra naturellement disposé à se moquer de nous. Mais une attention plus sérieuse le fit changer de manière de voir. Il acquit la conviction que ma mère agissait comme une sotte ; que le régisseur (un fidèle serviteur, s’il en fut jamais) cherchait adroitement à améliorer sa position à l’aide de sa fille ; et que j’étais un jeune idiot dont la dose naturelle d’imbécillité s’était développée à une époque singulièrement prématurée de la vie. En causant avec ma mère, sous l’influence de cette vive persuasion, mon oncle offrit de m’emmener avec lui à Londres, et de m’y garder, jusqu’à ce que je fusse revenu à la raison, dans la société de ses enfants, et grâce à une surveillance rigoureuse exercée sous son toit.
Ma mère hésita à accepter cette offre ; elle avait sur mon oncle l’avantage de connaître mon caractère. Pendant qu’elle flottait encore et que mon oncle attendait impatiemment sa décision, je résolus la question pour mes parents en prenant la fuite.
Pour me représenter pendant mon absence, je laissais derrière moi une lettre dans laquelle je déclarais que nulle puissance humaine ne me séparerait de Marie, et je promettais de revenir demander pardon à ma mère dès que mon oncle aurait quitté la maison. On me chercha rigoureusement sans pouvoir trouver la trace de mon refuge. Mon oncle partit pour Londres en prédisant que je serais la honte de la famille, et en annonçant qu’il allait transmettre son opinion sur moi à mon père, en Amérique, par le premier paquebot.
Le secret de l’asile dans lequel j’avais imaginé de défier toute découverte ne sera pas long à dévoiler.
J’étais caché (à l’insu du régisseur) dans la chambre à coucher de sa mère.
« Eh ! » me demanderez-vous, « la mère du régisseur le savait-elle ? »
À quoi je réponds :
« Oui, elle le savait, et, qui plus est, elle s’en glorifiait, – non pas, remarquez-le bien, comme d’un acte d’hostilité envers mes parents, mais simplement comme d’un devoir de conscience ! »
Mais alors, au nom de tout ce qui est prodigieux, quelle espèce de vieille femme était-ce donc ? Qu’elle paraisse et réponde elle-même, l’étrange et fatidique grand’mère de la gentille petite Marie, la Sibylle des temps modernes, célèbre au loin, dans notre pays de Suffolk, sous le nom de dame Dermody.
En écrivant, je la vois encore assise dans la salle du joli cottage de son fils, près de la fenêtre, et la lumière tombant sur ses épaules, tandis qu’elle tricotait, ou lisait. Dame Dermody était une vieille femme maigre et sèche, – aux yeux noirs et farouches, surmontés de sourcils blancs touffus, d’un front haut et ridé, et de cheveux blancs épais, proprement rassemblés sous sa cornette surannée. Le bruit courait (et c’était vrai) qu’elle était de bonne naissance et qu’elle avait reçu une éducation distinguée, mais qu’elle avait résolûment sacrifié son avenir en épousant un homme d’un rang très-inférieur au sien dans la société. Quelle qu’ait été l’opinion de sa famille sur son mariage, elle ne l’avait jamais regretté. La mémoire de son mari lui était sacrée, et elle croyait que, comme un ange gardien, son esprit veillait sur elle dans la veille et le sommeil, le jour et la nuit.
Imbue de cette croyance, elle n’avait été nullement influencée par ces idées grossièrement matérielles du jour qui associent la présence des êtres spirituels à d’inhabiles tours de sorcellerie et à des singeries opérées sur des tables et des chaises. La noble superstition de dame Dermody faisait partie intégrante de ses convictions religieuses, qui, depuis longtemps, reposaient volontairement sur les doctrines mystiques d’Emmanuel Swedenborg. Les seuls livres qu’elle lût étaient les œuvres du prophète suédois. Elle mélangeait les enseignements de Swedenborg sur les anges et les âmes des trépassés, sur l’amour du prochain et la pureté de la vie, avec ses idées bizarres et ses croyances analogues personnelles, et les chimériques doctrines religieuses qu’elle s’était ainsi formées, elle les prêchait non-seulement au logis du régisseur, mais encore dans les visites de propagande qu’elle rendait, au près ou au loin, à ses humbles voisins.
Après la mort de la femme de son fils, elle exerça un pouvoir suprême sous son toit, et elle se faisait également gloire de son attention scrupuleuse à remplir ses fonctions domestiques et de ses communications privilégiées avec les anges et les esprits. Elle avait avec l’âme de son défunt mari, devant n’importe qui, des entretiens qui rendaient muets de terreur les simples spectateurs. À son point de vue mystique, l’amour qui nous unissait, Marie et moi, était trop sacré et trop beau pour pouvoir être apprécié d’après le simple critérium pratique adopté par la société. Elle avait écrit pour nous de petites formules de prières et d’oraisons dont nous devions nous servir, jour par jour, en nous abordant et en nous quittant. Elle avait engagé solennellement son fils à nous considérer comme deux jeunes créatures consacrées qui cheminaient à leur insu par un sentier personnel à elles réservé et qui, commençant sur la terre, aboutissait brillamment dans un monde meilleur, au milieu des anges. Voyez-moi arrivant auprès de cette femme et lui déclarant que j’étais résolu à mourir plutôt qu’à permettre à mon oncle de me séparer de la petite Marie, – et vous ne vous étonnerez plus de l’hospitalité qui m’ouvrit le sanctuaire de la chambre de dame Dermody.
Lorsque le moment fut arrivé de quitter sans danger mon asile, je commis une sérieuse maladresse. En remerciant, au départ, la vieille femme, je lui dis avec un sentiment d’honneur enfantin :
« Je ne vous dénoncerai pas, dame ; ma mère ignorera que vous m’avez caché dans votre chambre à coucher. »
La Sibylle posa sa main sèche et décharnée sur mon épaule et me poussa rudement sur la chaise d’où je venais de me lever :
« Enfant ! » dit-elle en me regardant de part en part avec ses farouches yeux noirs, « osez-vous supposer que j’aie jamais commis quelque action dont j’eusse à rougir ? Pensez-vous que je rougisse de ce que je viens de faire ? Attendez ici. Votre mère pourrait, elle aussi, me méjuger. Je vais lui écrire. »
Elle mit ses grandes lunettes rondes à branches d’écaille et commença sa lettre. Toutes les fois que sa pensée vacillait ou que l’expression lui faisait défaut, elle regardait par-dessus son épaule, comme si elle avait eu derrière elle quelque créature invisible épiant ce qu’elle écrivait. – Elle consultait l’esprit de son mari absolument comme elle eût consulté un homme vivant. – Elle se souriait à elle-même, – et elle continuait à écrire.
« Voilà ! » dit-elle en me tendant la lettre terminée avec un geste de royale indulgence. « Sa pensée et la mienne sont transcrites là. Allez, enfant, je vous pardonne. Remettez ma lettre à votre mère. »
Elle s’exprimait toujours avec la même dignité grave et réservée de manières et de langage.
Je remis la lettre à ma mère. Nous la lûmes et nous nous en émerveillâmes ensemble. Conseillée par l’âme toujours présente de son mari, dame Dermody avait écrit :
« Madame,
« J’ai pris ce que vous pouvez être disposée à appeler une grande liberté. J’ai aidé votre fils George à braver l’autorité de son oncle. J’ai encouragé votre fils George dans sa résolution de rester fidèle, dans le temps et dans l’éternité, à ma petite-fille, Marie Dermody.
« Je vous dois et me dois à moi-même de vous faire connaître les motifs qui m’ont fait agir ainsi.
Je crois fermement que tout amour véritable est préordonné et consacré dans le ciel. Les âmes destinées à s’unir dans le monde supérieur sont divinement chargées de se trouver l’une l’autre, et de commencer leur union dans ce monde. Les seuls mariages heureux sont ceux dans lesquels les deux âmes prédestinées sont parvenues à se rencontrer dans cette sphère de la vie.
« Une fois réunies, nulle puissance humaine ne peut réellement séparer les âmes-sœurs. Tôt ou tard, elles doivent, en vertu de la loi divine, se retrouver et s’unir de nouveau. La sagesse humaine peut leur imposer des genres de vie complétement différents ; la sagesse humaine peut les abuser ou les faire s’abuser elles-mêmes jusqu’à contracter une union terrestre et fragile. Peu importe. Il arrivera certainement un moment où cette union se montrera terrestre et fragile ; et les deux âmes désunies, se retrouvant, s’uniront ici-bas pour l’éternité, – s’uniront, je vous dis, en dépit de toutes les lois et de toutes les notions humaines du juste et de l’injuste.
« Telle est ma foi. Je l’ai confessée toute ma vie. Fille, épouse et veuve, je m’y suis conformée et m’en suis bien trouvée.
« Je suis née, madame, dans les rangs de la société à laquelle vous appartenez. J’ai reçu l’instruction purement matérielle que comporte la notion mondaine de l’éducation. Grâce à Dieu, mon âme-sœur rencontra mon âme pendant ma jeunesse. Je connaissais le véritable amour et la véritable union avant d’avoir vingt ans. Je me suis mariée, madame, dans la classe où le Christ choisit ses apôtres, – j’épousai un ouvrier. Nul langage humain ne pourrait peindre mon bonheur pendant le temps que nous avons vécu unis ici-bas. Sa mort ne nous a pas séparés. Il m’aide à écrire cette lettre. À ma dernière heure, je le verrai debout parmi les anges, m’attendant sur les rives du fleuve éclatant.
« Vous comprendrez maintenant comment j’envisage le lien qui unit les jeunes âmes de nos enfants au début brillant de leur vie.
« Croyez-moi, ce que le frère de votre mari vous proposait de faire était un sacrilége et une profanation. Je vous avoue franchement que je regarde comme un acte de vertu ce que j’ai fait pour contrecarrer votre parent dans cette affaire. Vous ne pouvez supposer que je considère comme un obstacle sérieux à une union préordonnée dans le ciel que votre fils soit l’héritier du propriétaire et ma petite-fille l’enfant du régisseur. Chassez de votre esprit, je vous en supplie, les indignes préjugés antichrétiens de classes. Ne sommes-nous pas tous égaux devant Dieu ? Ne sommes-nous pas tous égaux (même en ce monde) devant la maladie et la mort ? Ce n’est point seulement le bonheur de votre fils, mais c’est votre propre tranquillité d’esprit qui est intéressée à ce que vous preniez en considération mes paroles. Je vous avertis, madame, que vous ne pouvez empêcher ces deux âmes enfantines prédestinées de s’unir plus tard comme mari et femme. Séparez-les aujourd’hui, et vous serez responsable des sacrifices, de la dégradation et des malheurs par lesquels votre George et ma Marie pourront être condamnés à passer avant de se retrouver plus tard.
« Maintenant, mon esprit est soulagé ; maintenant, j’ai fini.
« Si j’ai parlé trop franchement, ou si, de quelque autre façon, je vous ai offensée involontairement, je vous en demande pardon, et je suis, madame, votre fidèle et dévouée servante.
« HÉLÈNE DERMODY. »
Ainsi se terminait la lettre.
Pour moi, j’y vois quelque chose de plus qu’un spécimen curieux de composition épistolaire. J’y lis la prophétie, – singulièrement accomplie plus tard, – des événements de la vie de Marie et de la mienne que les pages suivantes vont avoir à raconter.
Ma mère se décida à laisser cette lettre sans réponse. Comme beaucoup de ses plus humbles voisins, elle avait un peu peur de dame Dermody, et, de plus, elle était habituellement ennemie de toute discussion sur les mystères de la vie spirituelle. Je fus grondé, sermonné et pardonné, – et ce fut tout.
Pendant quelques heureuses semaines, Marie et moi, nous revînmes, sans empêchement et sans interruption, à notre ancienne intimité. La catastrophe allait venir cependant au moment où nous nous y attendions le moins. Ma mère fut surprise, un matin, par une lettre de mon père qui lui annonçait qu’il s’était vu inopinément forcé de partir de suite pour l’Angleterre, et qu’il était arrivé à Londres où il était retenu par des affaires qui ne souffraient pas de retard. Nous devions nous attendre à le voir arriver à la maison dès qu’il serait libre.
Cette nouvelle éveilla dans l’esprit de ma mère des craintes sur la solidité de la grande spéculation de son mari en Amérique. Son départ subit des États-Unis et son mystérieux séjour à Londres lui paraissaient annoncer quelque malheur. Le sombre passé auquel je me reporte appartient à une époque où les chemins de fer et le télégraphe électrique n’existaient encore que dans l’imagination des inventeurs. Toute communication rapide avec mon père, alors même qu’il eût consenti à nous admettre dans sa confidence, nous était impossible. Nous n’avions donc qu’à attendre et à espérer.
Les fastidieuses journées s’écoulaient, et les courtes lettres de mon père continuaient à nous le présenter retenu à Londres par ses affaires. Arriva le matin où Marie et moi nous sortîmes avec le régisseur, Dermody, pour aller voir prendre au leurre les derniers oiseaux sauvages de la saison, – et la bienveillante maison attendait encore son maître, et l’attendait en vain.
CHAPITRE IIISWEDENBORG ET LA SIBYLLE
Je puis reprendre mon récit au point où je l’ai laissé dans le premier chapitre.
Marie et moi (vous vous le rappelez), nous avions laissé le régisseur seul auprès du leurre, et nous nous étions dirigés ensemble vers le cottage de Dermody.
En approchant de la porte du jardin, j’aperçus un domestique de la maison qui attendait. Il était chargé d’un message pour moi de la part de ma mère.
« Ma maîtresse vous prie, maître George, de revenir à la maison le plus tôt possible. Il est arrivé une lettre par la voiture. Mon maître compte prendre une chaise de poste à Londres, et il nous prévient que nous pouvons l’attendre dans la journée. »
Le visage attentif de Marie s’assombrit à ces paroles.
« Faut-il réellement que vous vous en alliez, George, » murmura-t-elle, « avant d’avoir vu ce qui vous attend chez nous ? »
Je me rappelai la promesse de Marie d’une surprise dont le secret ne devait m’être révélé que lorsque nous serions arrivés au cottage. Pouvais-je la désappointer ? Ma pauvre petite amoureuse paraissait prête à pleurer devant cette simple perspective.
Je renvoyai le domestique avec une réponse conciliante : mes tendresses à ma mère et la promesse d’être à la maison dans une demi-heure.
Nous entrâmes dans le cottage.
Dame Dermody était assise, comme d’habitude, à la lumière de la fenêtre avec un des livres mystiques d’Emmanuel Swedenborg ouvert sur ses genoux. À notre entrée, elle leva solennellement la main pour nous signifier d’avoir à occuper notre coin habituel sans lui parler. C’était un acte de haute trahison domestique que d’interrompre la Sibylle dans ses lectures. Nous gagnâmes tranquillement nos places. Marie attendit que sa grand’mère eût abaissé sa tête grise et que ses sourcils touffus se fussent contractés sous l’attention qu’elle prêtait à sa lecture. Alors, et seulement alors, la discrète enfant se leva sur la pointe des pieds et disparut sans bruit dans la direction de sa chambre à coucher. Puis elle revint vers moi en portant quelque chose soigneusement enveloppé dans son plus beau mouchoir de batiste.
« Est-ce là la surprise ? » murmurai-je.
Marie me répondit tout bas :
« Devinez ce que c’est ?
– Quelque chose pour moi ?
– Oui. Devinez. Qu’est-ce que c’est ? »
Je devinai trois fois, et trois fois je me trompai. Marie se décida à m’aider par une indication.
« Appelez vos lettres, » me dit-elle ; « et allez jusqu’à ce que je vous arrête. »
Je commençai :
« A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. » Là, elle m’arrêta.
« C’est le nom d’un objet, » me dit-elle. « Et il commence par un P. »
Je devinai :
« Pavot, Plume, Pipeau, » et, là, ma perspicacité me fit défaut.
Marie soupira et hocha la tête.
« Vous ne vous donnez pas de mal, » dit-elle. « Vous avez trois ans de plus que moi, et, après toute la peine que j’ai prise pour vous plaire, vous allez sans doute vous trouver trop grand pour vous soucier de mon cadeau, quand vous le verrez. Devinez encore.
– Je ne puis deviner.
– Il le faut.
– J’y renonce. »
Marie refusa de me laisser renoncer. Elle m’aida par une nouvelle indication.
« Qu’avez-vous dit, un jour, que vous désiriez avoir dans votre bateau ? » me demanda-t-elle.
« Y a-t-il longtemps de cela ? » lui dis-je, à court d’une réponse.
« Oui, très-longtemps, avant l’hiver, lorsque les feuilles d’automne tombaient, et que vous m’aviez emmenée promener sur l’eau. Ah ! George, vous l’avez oublié ! »
Ce n’est que trop vrai, pour moi et mes frères ; vieux ou jeunes, c’est tout un ! C’est toujours son amour, à lui, qui oublie, et son amour, à elle, qui se souvient. Nous n’étions que deux enfants, mais nous représentions déjà les types de l’homme et de la femme !
Marie perdit patience. Oubliant la terrible présence de sa grand’mère, elle bondit et arracha du mouchoir l’objet qu’il cachait.
« Voilà » s’écria-t-elle vivement ; « et maintenant, savez-vous ce que c’est ? »
La mémoire me revint enfin. Ce que j’avais désiré pour mon bateau, quelques mois auparavant, c’était un pavillon neuf. Et ce pavillon, il était là, confectionné en secret pour moi par les mains de Marie ! Le champ en était de soie verte avec une colombe brodée dessus en blanc et qui portait la branche d’olivier symbolique, exécutée en fil d’or. C’était l’œuvre indécise et tremblée des doigts d’une enfant. Mais comme ma petite chérie s’était rappelé fidèlement mon désir, – avec quelle patience elle avait appliqué l’aiguille sur les lignes indicatives du patron, – comme elle avait laborieusement travaillé pendant les tristes journées d’hiver ; et tout cela, pour l’amour de moi ! Quels mots pourraient peindre mon orgueil, ma reconnaissance, mon bonheur ? Oubliant à mon tour la présence de la Sybille penchée sur son livre, je saisis ma petite ouvrière dans mes bras, et je l’embrassai jusqu’à ce que l’haleine me manquât et que je ne pusse plus continuer.
« Marie ! » m’écriai-je dans le premier feu de mon enthousiasme, « mon père arrive aujourd’hui, je vais lui parler ce soir, et je vous épouserai demain.
– Enfant ! » dit une voix imposante, à l’autre bout de la chambre. « Venez ici. »
Le livre mystique de dame Dermody était fermé ; les yeux noirs fatidiques de dame Dermody nous épiaient dans notre coin. Je m’approchai d’elle, et Marie me suivit timidement pas à pas.
« Faites-vous cas de ce jouet ? » me demanda-t-elle, en regardant le pavillon. « Cachez-le ! » s’écria-t-elle, avant que j’eusse pu répondre. « Cachez-le, ou bien on vous le prendra.
– Pourquoi le cacherais-je ? » lui demandai-je. « J’entends l’arborer au mât de mon bateau.
– Vous ne l’arborerez jamais au mât de votre bateau ! » Et en parlant, elle me prit le pavillon et le fourra avec impatience dans la poche de côté de ma veste.
« Ne le chiffonnez pas, grand’mère, » dit Marie plaintivement.
Je répétai ma question.
« Pourquoi ne l’arborerai-je jamais au mât de mon bateau ? »
Dame Dermody posa la main sur le volume de Swedenborg fermé sur ses genoux.
« J’ai ouvert trois fois ce livre depuis ce matin, » dit-elle. « Trois fois les paroles du Prophète m’ont avertie qu’un malheur approchait. Enfants ! c’est pour vous que le malheur approche. Si je regarde là, » dit-elle en désignant l’endroit par lequel un rayon de soleil pénétrait obliquement dans la chambre, « j’aperçois mon mari dans la lumière céleste. Il incline la tête avec tristesse, et il dirige sa main infaillible vers vous. George et Marie, vous êtes consacrés l’un à l’autre ! Soyez toujours dignes de cette consécration, soyez toujours dignes de vous-mêmes. »
Elle s’arrêta. Sa voix trembla. Elle nous considéra avec des yeux attendris comme font ceux qui prévoient tristement qu’ils vont être séparés.
« Agenouillez-vous, » dit-elle à voix basse et d’un ton lugubre et triste. « C’est peut-être la dernière fois que je vous bénirai, c’est peut-être la dernière fois que je prierai pour vous dans cette maison. Agenouillez-vous ! »
Nous nous mîmes à genoux à ses pieds. Je sentais les battements du cœur de Marie à mesure qu’elle se pressait contre moi. Je sentais mon propre cœur précipiter ses palpitations sous l’empire d’une terreur mystérieuse pour moi.
« Que Dieu bénisse et garde George et Marie dans le présent et dans l’avenir ! Que Dieu favorise, dans l’avenir, l’union que la sagesse de Dieu a décidée ! Amen. Ainsi soit-il. Amen. »
Au moment même où ces derniers mots tombaient de ses lèvres, la porte du cottage s’ouvrit avec fracas. Mon père entra dans la chambre, suivi du régisseur.
Dame Dermody se dressa lentement sur ses pieds, et le regarda d’un œil scrutateur.
« Le malheur est venu, » se dit-elle à elle-même. « Il regarde par les yeux, il va parler par la voix de cet homme. »
Mon père rompit le silence qui suivit ces paroles en s’adressant au régisseur.
« Vous le voyez, Dermody, » dit-il, « voici mon fils chez vous, alors qu’il devrait être chez moi. »
Il se retourna et me vit le bras passé autour de la taille de la petite Marie, et attendant patiemment l’occasion de parler.
« George, » dit-il avec le sourire sardonique qui lui était habituel lorsqu’il était en colère et qu’il cherchait à le dissimuler, « vous faites le sot ici. Quittez cette enfant et venez avec moi. »
C’était le moment ou jamais de me montrer. À en juger par l’apparence, j’étais encore un enfant. À en juger par mes propres sensations, j’étais devenu un homme instantanément.
« Papa, » dis-je, « je suis heureux de vous voir de retour. Voici Marie Dermody. Je l’aime et elle m’aime. Je désire l’épouser aussitôt que cela vous conviendra, à ma mère et à vous. »
Mon père éclata de rire, mais son humeur changea avant qu’il eût repris la parole. Il avait remarqué que Dermody, lui aussi, se permettait de rire. Il parut devenir fou de colère en un moment.
« On m’avait parlé de cette infernale sottise, » dit-il. « Mais je n’avais pu y croire. Qui donc a troublé la faible tête de ce garçon ? Qui donc l’a encouragé à embrasser ainsi cette petite fille ? Si c’était vous, Dermody, ce serait la pire action de votre vie. » Il se tourna de nouveau vers moi avant que le régisseur eût pu se défendre. « M’entendez-vous ? Je vous dis de quitter la fille de Dermody et de revenir à la maison avec moi. »
« Oui, papa, » répondis-je. « Mais je reviendrai trouver Marie, s’il vous plaît, après avoir été avec vous. »
Malgré sa colère, mon père fut positivement stupéfait de mon audace.
« Jeune idiot, » s’écria-t-il, « votre insolence dépasse toute croyance. Je vous déclare que vous ne repasserez jamais cette porte ! On vous a appris à désobéir ici. On vous a mis en tête des choses qu’un garçon de votre âge devrait ignorer, je dirai plus, des choses que des personnes honnêtes n’auraient pas voulu vous apprendre.
– Je vous demande pardon, monsieur, » dit Dermody en l’interrompant très-respectueusement, mais très-fermement à la fois. « Il est certaines choses qu’un maître en colère a le droit de dire à l’homme qui le sert, mais vous avez outre-passé votre droit. Vous m’avez diffamé, monsieur, en présence de ma mère, à la portée de l’oreille de mon enfant. »
Mon père l’arrêta là.
« Vous pouvez vous épargner le reste, » dit-il. « Nous ne sommes plus ni maître ni serviteur. Lorsque mon fils venait flâner autour de votre cottage et jouer à l’amoureux avec votre fille, votre devoir était de lui fermer la porte au nez. Vous avez manqué à votre devoir. Je n’ai plus confiance en vous. Je vous donne congé un mois d’avance, Dermody. Vous quitterez mon service. »
Le régisseur fit face à mon père sur son propre terrain. Ce n’était plus l’homme facile, doux et modeste de mes souvenirs.
« Je refuse votre congé un mois d’avance, monsieur, » répondit-il. « Vous n’aurez plus l’occasion de répéter ce que vous venez de me dire. Je vous enverrai mes comptes ce soir, et je quitterai votre service demain.