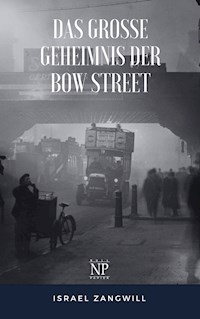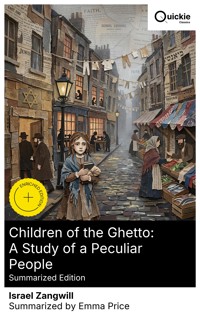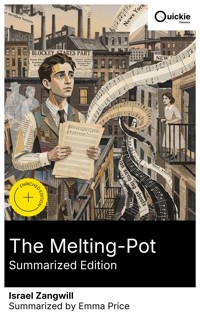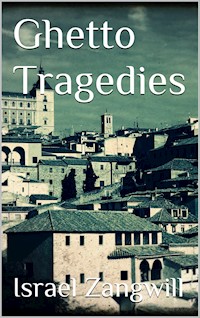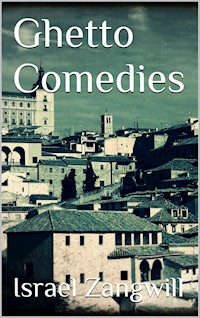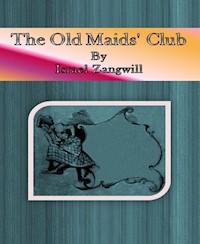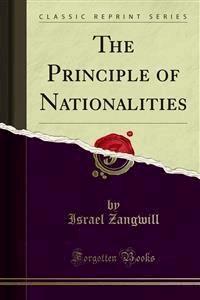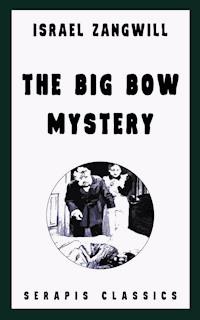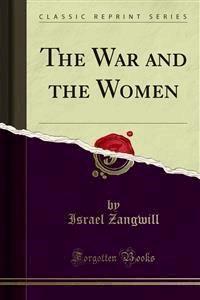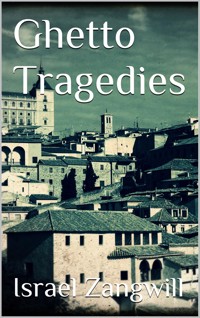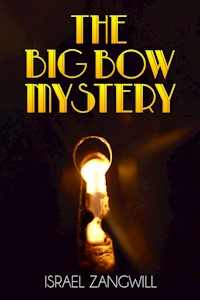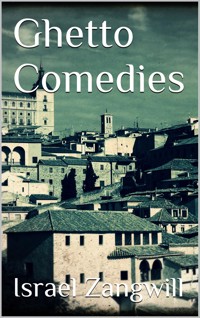0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
A une époque morte et oubliée un mauvais plaisant avait appelé cette rue Fashion Street — la rue à la mode. — La plupart des gens qui y vivent aujourd’hui ne peuvent même pas se rendre compte de l’ironie de ce nom : c’est, dans l’East End de Londres, une voie sombre, étroite et sordide, qui relie Spitalfields à Whitechapel, et se ramifie en nombreuses impasses. Du temps où la petite Esther Ansell en foulait le pavé malpropre, les deux extrémités de cette rue étaient à portée de voix des bouges les plus sales et les plus infâmes de la capitale du monde civilisé. Quelques-unes de ces toiles d’araignée ont été depuis lors balayées par les réformateurs municipaux : les araignées se sont réfugiées en des recoins plus sombres encore.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2026
Ähnliche
ISRAËL ZANGWILL
LES Enfants du Ghetto
Traduction française de Pierre Mille
© 2026 Librorium Editions
ISBN : 9782387410399
LES Enfants du Ghetto
II LE SWEATER
III MALKA
IV LA RÉDEMPTION DU FILS ET DE LA FILLE
V L’IMMIGRANT PAUVRE
VI REB SHEMUEL
VII PINCHAS, LE POÈTE
VIII ESTHER ET SES ENFANTS
X UNE FAMILLE TACITURNE
XI LE BAL DU POURIM
XII L’ESPOIR DE LA FAMILLE
XIII LA LIGUE DE LA TERRE-SAINTE
XIV SHOSSHI SHMENDRIK FAIT SA COUR
XV LA LUNE DE MIEL DES HYAMS
XVI LE VENDREDI SOIR DES HÉBREUX
XVII CHEZ LES GRÉVISTES
XVIII L’ESPOIR QUI S’ÉTEINT
XIX « FOR AULD LANG SYNE, MY DEAR »
XX LE SINGE MORT
XXI L’OMBRE DE LA RELIGION
XXII LE SOIR DU SEDER
I
A une époque morte et oubliée un mauvais plaisant avait appelé cette rue Fashion Street — la rue à la mode. — La plupart des gens qui y vivent aujourd’hui ne peuvent même pas se rendre compte de l’ironie de ce nom : c’est, dans l’East End de Londres, une voie sombre, étroite et sordide, qui relie Spitalfields à Whitechapel, et se ramifie en nombreuses impasses. Du temps où la petite Esther Ansell en foulait le pavé malpropre, les deux extrémités de cette rue étaient à portée de voix des bouges les plus sales et les plus infâmes de la capitale du monde civilisé. Quelques-unes de ces toiles d’araignée ont été depuis lors balayées par les réformateurs municipaux : les araignées se sont réfugiées en des recoins plus sombres encore.
A l’heure où Esther Ansell se hâtait à travers le brouillard glacé d’un soir de décembre, un bidon rougeâtre à la main — silhouette orientale qui semblait la miniature d’une Rébecca allant à la fontaine — ce paysage londonien présentait ses caractéristiques les plus ordinaires. Une chanteuse des rues, traînant une séquelle d’enfants dont elle était plus ou moins la mère, troublait l’air d’une mélodie perçante. Deux mégères, les poings sur les hanches, injuriaient leurs ancêtres respectifs, un ivrogne décrivait des zigzags en marmottant d’un air aimable ; et un joueur d’orgue, le nez plus violet que celui de son singe, faisait danser des gamins haillonneux sous la lueur embrumée d’un réverbère.
Esther serrant étroitement sur elle son petit châle écossais, passa sans accorder la moindre attention à ces détails familiers. Par les semelles usées de ses lourdes chaussures, ses pieds s’imprégnaient de boue glaciale. C’étaient de très vieux souliers, abandonnés sans doute un jour par quelque ivrogne vagabond, et ramassés par le père d’Esther. Mosès Ansell avait assez l’habitude de ces trouvailles, sans doute parce qu’il avait coutume de marcher en baissant la tête comme s’il avait toujours à ployer physiquement sous le joug de la captivité. De cette attitude humiliée la providence le récompensait parfois par des aubaines. Esther, quelques semaines auparavant, avait reçu à l’école une paire de bottines neuves. En vendant celles-ci, et en les remplaçant par les chaussures du vagabond, on avait réalisé un bénéfice d’une demi-couronne, qui avait fourni du pain pendant une semaine aux frères et sœurs de la fillette. A l’école, durant quinze jours, Esther prit grand soin de dissimuler ses extrémités. Mais la crainte de voir découvrir la substitution s’étant progressivement affaiblie, le profit fait par son estomac avait fini par imposer silence aux reproches de sa conscience.
On distribuait aussi, à l’école, du pain et du lait. Mais Esther et ses frères et sœurs n’en avaient jamais accepté. Ils ne voulaient point paraître en avoir besoin. Les airs de supériorité d’un camarade de classe sont durs à supporter, et un enfant qui a le cœur bien placé n’avoue pas facilement qu’il meurt de faim, en présence d’une chambrée de bambins dont certains ont la bourse garnie au point de pouvoir dépenser en pures superfluités jusqu’à un farthing par jour.
Mosès Ansell eût été mortifié s’il eût appris que ses enfants refusaient ainsi le pain qu’il ne pouvait leur donner. Les affaires ne marchaient pas, à ce moment, dans les ateliers des sweaters[1]. Mosès n’avait jamais fait que vivre au jour la journée ; et à présent il n’avait pas souvent lieu de rapprocher sa main de sa bouche. Il avait sollicité des secours au bureau israélite de bienfaisance. Mais la routine de cette institution l’empêche de fonctionner aussi rapidement que se vide l’estomac de sa clientèle. Et puis, à ce tribunal de la charité, Mosès était un tel récidiviste !
[1] On nomme ainsi les petits patrons qui se disputent au rabais et se partagent les commandes de vêtements et de chaussures soumissionnées en gros par des maisons plus importantes. Souvent juifs et fort misérables eux-mêmes, ils exploitent de la façon la plus dure, malgré les lois sanitaires aisément tournées, leurs ouvriers, qui sont pour la plupart juifs comme eux, et travaillent jusqu’à dix-huit heures par jour pour un salaire dérisoire. Il y a une quinzaine d’années, on comptait dans l’East End de Londres environ 50 000 Israélites récemment émigrés.
Il y avait, heureusement, un genre de secours qu’on ne pouvait lui refuser, et dont Esther ne pouvait dissimuler l’existence, comme elle lui dissimulait les déjeuners distribués aux enfants pauvres de l’école. Tout le monde venait d’apprendre que trois fois par semaine on allait donner de la soupe et du pain au fourneau philanthropique de Fashion Street. Dans la famille Ansell, l’ouverture de cet établissement avait été considérée comme le début d’un âge d’or, où il deviendrait impossible de passer plus d’un jour sans rien manger. Le parfum presque oublié de la soupe, répandit dès ce moment une espèce de poésie sur l’hiver commençant.
Depuis la mort de la mère Ansell, c’était toujours Esther qui allait aux provisions ; Mosès, le seul des autres membres de la famille qui eût été capable de la remplacer, était constamment occupé à prier quand il n’avait rien autre à faire. Et voilà pourquoi, ce soir-là, Esther se hâtait vers le fourneau philanthropique une cruche rouge à la main. Dans sa prestesse d’enfant, elle dépassa une quantité de femmes dont le but était le même et qui portaient comme elle le grossier bidon de fer blanc fourni par l’Assistance. Esther, par un instinct personnel de propreté, préférait d’habitude un ustensile appartenant à son ménage. Mais aujourd’hui, il n’était pas permis de choisir, et le récipient administratif, timbré et numéroté, devait servir de bon de soupe.
Quand elle arriva à la porte du Fourneau de Charité, une foule nombreuse s’y pressait déjà. Quelques ventres peut-être étaient remplis, mais en majorité ils étaient vides, et les corps grelottaient. L’élément féminin noyait l’autre. Cependant on voyait aussi quelques enfants et une douzaine d’hommes — étranges créatures, basanées, rabougries, poilues, avec des teints boueux, qu’illuminaient des yeux noirs et brillants. Quelques-uns, pourtant, de stature imposante, portaient des chapeaux melons pleins de poussière, ou des feutres cabossés ; des cravates-plastrons fanées ou des barbes incultes cachaient leur gorge. Çà et là, parmi les femmes, on distinguait une figure ou une taille agréable. Pour le reste, c’était un ramassis de mégères prématurément vieillies, aux traits blêmes et usés, traînant savate, crottées jusqu’à l’échine, nu-tête, ou bien portant en guise de chapeaux des marmottes faites avec des fichus rouges, gris, couleur de brique, couleur de boue. Et malgré tout, dans ce clinquant, dans les laideurs de ces fées-carabosses, il y avait une indéfinissable touche de romanesque et de pitoyable ; une irrécusable parenté s’accusait entre ces Juives polonaises, russes, allemandes, hollandaises qui ne se parlaient pourtant guère, et se poussaient durement les unes les autres. Quelques-unes portaient, accroché à leur sein nu, un enfant qui tétait placidement, s’interrompant parfois pour vagir comme par acquit de conscience. Les femmes à tête nue n’avaient rien autour du cou pour se protéger du froid. Leurs gorges brunes s’étalaient, et certaines n’avaient même pas songé à fermer les agrafes ou les boutons du haut de leur corsage. La majorité portaient des boucles d’oreille de pacotille et des perruques noires d’un éclat peu naturel. Celles qui n’avaient pas de perruque avaient les cheveux crespelés.
A cinq heures et demie, la claire-voie fut ouverte, et la foule s’engouffra dans un corridor long, étroit, blanchi à la chaux et de là dans une espèce de grange dont le plafond également blanchi à la chaux, était traversé de solives de bois.
Les murs étaient isolés du centre de la salle par des barrières, et c’est dans cette sorte de parc à bestiaux que les pauvres gens s’entassaient, énervés et bavards, attendant le moment divin. Un seul bec de gaz, au plafond, éclairait ces étranges faces, leur prêtant des reliefs dont se fût réjoui Gustave Doré.
Mais ils mouraient de faim, ces gens pittoresques, et tout ce qu’ils avaient de plus proche et de plus cher au monde, mourait de faim au logis. Ils savouraient voluptueusement la soupe par avance. Ils oubliaient que cette soupe n’était considérée, par ceux qui la préparaient, que comme une sorte d’appoint au salaire ; ils n’avaient pas la moindre conscience de la grande théorie économique d’après laquelle secourir les pauvres est augmenter le paupérisme, ni d’ailleurs de n’importe quelle autre théorie ; ils étaient disposés à noyer leur indépendance dans la soupe. Esther elle-même qui avait lu beaucoup, qui était douée d’instincts délicats, partageait sans hésiter la conception de l’univers professée par la majeure partie de ceux qui l’entouraient : à savoir que l’espèce humaine se distingue des animaux en ce qu’il lui faut terriblement trimer pour se procurer une maigre nourriture, mais que sa destinée est embellie par l’existence d’une classe restreinte et semi-divine, celle des Tékéfim ou personnes riches qui donnent ce dont ils n’ont pas besoin. Comment ces personnes sont-elles devenues riches, c’est ce qu’Esther ne se demandait point : pour elle cette classe constituait un élément naturel de la création, comme les nuages ou les chevaux.
Cette variété semi-céleste de l’espèce humaine est difficile à rencontrer. Quelques spécimens, à la connaissance d’Esther, vivaient loin du Ghetto. Et chacune de leurs familles, fût-elle peu nombreuse, occupait à elle seule, disait-on, une maison entière. Certains, revêtus de soies bruissantes ou d’autres costumes aussi impressionnants, qui répandent autour d’eux un indéfinissable parfum de surhumanité, pénétraient de loin en loin dans l’école, précédés de la Directrice épanouie. Alors les petites filles se levaient, puis faisaient la révérence et se rasseyaient. Les meilleures élèves, que l’on faisait bien entendu passer pour choisies au hasard dans la moyenne de la classe, émerveillaient les semi-divines visiteuses par leur connaissance approfondie de la topographie des Pyrénées ou des dissensions de Saül et de David. L’entrevue des deux espèces d’êtres humains se terminait par une effusion de sourires, et à la satisfaction générale. Mais la plus niaise des fillettes savait à quoi s’en tenir sur cette comédie, et professait un robuste mépris pour l’incompétence des personnes semi-divines, qui parlaient à la classe comme si, dès qu’elles auraient le dos tourné, on n’allait pas recommencer à bavarder en sourdine, à se tirer mutuellement les cheveux, à se chiper des épingles, à copier les devoirs du prochain, et à faire passer dans sa poche les sous de sa voisine.
Ce soir-là, les personnes semi-célestes brillaient de toute leur splendeur. Une majestueuse agglomération de philanthropes était installée à des places réservées, derrière un bureau blanc. La salle, qui formait un polygone assez irrégulier, était coupée en deux par une rangée de huit marmites, dont les grands couvercles de bois se levaient au moyen de poulies. Le fourneau était dans un coin. Des cuisiniers vêtus de blouses blanches et de bonnets de même couleur remuaient avec de longues cuillers de bois la soupe fumante. Un industriel attirait l’attention de reporters israélites sur le nouveau modèle de marmite qu’il avait inventé, et le surintendant de l’Œuvre conjurait les journalistes de ne pas oublier de publier son nom. Parmi les clergymen au costume sévère, les filles à marier d’un ministre de l’East End allaient et venaient, tels des oiseaux bariolés et chanteurs au milieu d’une bande de corbeaux.
Lorsqu’un nombre suffisant de divinités fut assemblé, le Président prononça un discours d’une étendue considérable, et destiné à bien pénétrer les clergymen et autres philanthropes présents de cette conviction que la charité est une vertu. Afin de prouver cette assertion, il en appela à la Bible, au Koran et même aux Védas. Dès le début de ce discours on avait fermé la porte à coulisse qui séparait de la cuisine le pseudo-parc à bestiaux car la foule faisait beaucoup de bruit, des enfants vagissaient inconsidérément, enfin il ne semblait pas se dégager de la cohue des patients un vif désir d’entendre les aperçus moraux du Président. Quand le speech fut terminé, ces gens aux instincts grossiers, qui ne pensaient qu’à leurs satisfactions matérielles, n’en jacassaient que plus haut. Ils avaient rompu la barrière et surgirent dans la cuisine en se bousculant. Esther dut serrer ses bras contre sa poitrine, sans quoi ils eussent été disloqués. A la porte de la rue battait une houleuse cohue de gamins et de filles, faméliques et curieux. Mais toutes les cérémonies n’étaient pas encore accomplies : le président invita le rabbin à prendre la parole à son tour, et il y eut un second discours non moins long que le premier, et non moins éloquent dans le développement de cette thèse : que la charité est une vertu.
Enfin deux pauvres furent admis. Le surintendant refoula courageusement le reste de la foule dans le pseudo-parc à bestiaux. Le cuisinier en chef, plongeant dans une marmite une énorme louche qui servait de mesure, remplit de soupe deux écuelles. Alors le rabbin leva les yeux au ciel, et dit les grâces :
— Sois béni, ô Seigneur, Roi de l’Univers, toi qui créas toutes choses !
Puis il goûta une cuillerée de la soupe ; et de même firent le président et plusieurs visiteurs. L’absorption du liquide suscita chez chacun des dégustateurs un identique sourire d’extase. Il est vrai, que pour cette soirée d’inauguration, la soupe était infiniment plus soignée qu’elle ne devait l’être dans la suite, alors que la majeure part de la viande serait comme de juste, confisquée par les cuisiniers à titre de petit et légitime bénéfice.
Tandis qu’Esther luttait pour conquérir une place aux abords du Paradis, ces airs de dégustation béate lui faisaient venir l’eau à la bouche. Elle voyait déjà par la pensée, son frère Salomon, qu’elle aimait pour son courage, la gentille Rachel, la petite Sarah, bébé aux cris éternels, et son petit frère Ikey, se rassasiant enfin du délicieux liquide. Elle pensa aussi — mais en second lieu — à son père si stoïque et à sa grand’mère. Les Ansell n’avaient mangé chacun qu’une tranche de pain sec dans la matinée. Et voici : devant elle c’était la terre de Goshen, la terre promise que Joseph fit donner à ses frères par Pharaon, pays merveilleux, arrosé de fleuves de soupe, planté de piles de pains : des pains sans nombre, coupés par quartiers, par moitié, entiers aussi et rangés sur des rayons comme pour le repas d’un géant.
Esther regardait avec avidité la tour à quatre pans construite avec ces matériaux comestibles ; elle grelottait sous le courant d’air qui lui mordait le dos, soufflant par un interstice soudain ouvert dans la foule entassée. Et ce courant d’air lui remit à l’esprit plus nettement ses petits frères et sœurs blottis à la maison près du foyer sans feu. Ah, quelle heureuse nuit allait être cette nuit ! Mais il ne faudrait pas leur laisser dévorer les deux pains en une fois : ce serait une extravagance coupable : un seul suffirait au festin, l’autre serait soigneusement mis de côté. « Et demain aussi est un jour » — comme la vieille grand’mère avait coutume de dire, dans son jargon oriental. Hélas, le banquet ne devait pas être consommé aussi vite que le supposait l’imagination d’Esther ; et il fallut que d’autres divinités et semi-divinités, en tabliers blancs, se missent à proposer et à soutenir avec éloquence et prolixité des motions de remerciements au président, au rabbin, à toutes les autres notabilités. Après quoi un visiteur français éprouva le besoin d’exprimer son admiration pour la charité anglaise. Enfin arriva le tour des estomacs angoissés. La foule grouillante et toujours bavarde avança lentement puis fit une puissante irruption par l’étroite ouverture qu’on lui avait laissée, brisant en chemin les vitres d’une fenêtre ; les semi-divinités joignirent les mains et sourirent d’un air inspiré ; d’ingénieux misérables tentèrent un mouvement tournant vers les marmites, par la porte réservée. Les filles du pasteur, ces jolis oiseaux-mouches, voletèrent au milieu des corbeaux célibataires. Les grandes louches firent « splash » en tombant dans les marmites, la soupe gargouilla en tombant dans les écuelles, le murmure des voix grandit, une vieille édentée, aux cheveux blancs et aux yeux chassieux, se plaignit en excellent anglais qu’on lui refusait la soupe, sous prétexte qu’on n’avait pas encore fait enquête sur sa situation ; et ses larmes mouillaient l’unique pain qu’elle eût reçu. Un Russe traité de la même manière se jeta sur les dalles, hurlant comme un chien.
Enfin Esther put toucher sa part. Elle s’enfuit à travers le brouillard, réchauffée par la cruche serrée contre sa poitrine, évitant les heurts, et ses deux pains cachés dans son tablier.
Elle volait presque en escaladant les marches de l’escalier sombre qui menait à sa mansarde de Royal Street. La petite Sarah pleurait avec rage. Esther, fière d’être l’ange de la délivrance, essaya de gravir à la fois les deux dernières marches de l’escalier, glissa… et tomba ignominieusement contre la porte de la mansarde. Elle vint s’abattre au milieu de la pièce, la cruche se brisa en mille morceaux ; la soupe odorante se répandit en flaque sur le parquet, coula sous les deux lits et, par les crevasses du plancher pourri s’écroula à l’étage inférieur. Esther éclata en sanglots, sa robe était toute graisseuse, ses mains saignaient, coupées par les débris. La petite Sarah devant ce désastre, s’arrêta de pleurer. Mosès Ansell n’était pas encore rentré de l’office du soir, mais la grand’mère dont la face était gelée et rougie par le froid de la mansarde, se dressant sur son grabat appela Esther « brise-tout ». Esther pleura davantage, car c’était une injustice. Elle n’avait jamais rien cassé depuis des années. Ikey, un gosse de quatre ans et demi aux yeux éveillés, se glissa près d’elle ; tous les Ansell avaient appris à voir dans l’obscurité, et pressant sa tête crépue contre son corsage murmura : « Cela ne fait rien, Esty, je te ferai coucher dans mon lit neuf. »
La consolation de dormir dans ce lit imaginaire à la possession duquel Ikey rêvait constamment était sans doute efficace, car Esther remise sur pied sortit les deux pains de son tablier, tel un joueur insouciant qui jette sur le tapis vert sa bonne monnaie après la mauvaise. On aurait tout de même une revanche ce soir, on mangerait les deux pains en une fois. Un seul — moins la part réservée au repas du père — ne suffirait point à rassasier six estomacs voraces. Salomon et Rachel enthousiasmés par la vue des pains firent un bond, brisant la croûte avec les doigts.
— Païens, cria la grand’mère : et les ablutions et la bénédiction ?…
Salomon se faisait souvent appeler païen par la vieille. Il coiffa son bonnet et, se dirigeant vers le seau d’eau placé dans un coin de la pièce, y plongea ses mains. Il est à craindre que ni la quantité d’eau puisée, ni la surface de la main qui en fut aspergée n’ait atteint, dans cette occasion, le minimum commandé par les lois rabbiniques. Salomon termina cette opération en marmottant quelques mots qui avaient la prétention d’être de l’hébreu et il commençait à débiter la pieuse petite prière qui précède la consommation du pain. Rachel à qui son sexe féminin rendait moins obligatoire la cérémonie purificative, mordit furieusement dans son morceau. Mais elle fit une grimace. Salomon à son tour engloutit une énorme tranche, poussa un cri de dégoût, et cracha.
Le pain avait été cuit sans sel. Il était immangeable.
IILE SWEATER
La catastrophe n’était pas complète. Quelques maigres effilochures du bouilli dont le suc avait servi à corser la soupe s’étalaient par terre ou adhéraient encore aux débris de la cruche. Salomon dont la tête crépue abondait en ressources, découvrit ces filaments et décida sans hésiter de combattre la fadeur du pain par le goût de la viande.
A ce moment on frappa fortement à la porte et la pièce sembla s’illuminer. C’était Becky Belcovitch.
— Qu’avez-vous fait ? dit-elle. Est-ce que c’est à faire, de laisser couler des choses à travers le plafond !
Becky Belcovitch était une belle fille joviale et grasse, dont les joues vermeilles paraissaient fort étranges en ce pays de pâles figures. Elle était coiffée d’une masse de cheveux noirs dont les boucles devaient évidemment moins à la nature qu’au petit fer et aux papillotes. Elle était, à ses moments de loisirs, la grande coquette de Royal Street et ses triomphes féminins troublaient même ses heures de travail. Car, âgée de seize ans, elle consacrait les plus belles heures de sa belle jeunesse à la confection des boutonnières. Mais dans l’Est de Londres, tout le monde sait, ce que vous ignorez, qu’il y a boutonnières et boutonnières : celles qui sont faites à la six-quatre-deux, pour les vêtements tout faits, et les autres, réservées aux vêtements des gentlemen. Becky avait la spécialité des boutonnières soignées, faites avec du fil fin. Elle les cousait dans l’atelier de son père, qui était plus confortable que celui d’un étranger, et dont la disposition permettait d’éluder les lois sur le travail.
Ce soir-là Becky était resplendissante de soie et de bijoux, son impertinent petit nez se busquait davantage, dans une félicité insolente. En la voyant, nul n’aurait pensé que cette belle demoiselle travaillait dans les boutonnières.
Avec volubilité, en patois yiddish, la vieille lui conta l’incident de la cruche cassée. Esther, encore une fois, frémit sous les injures orientales et métaphoriques de sa grand’mère.
— Si la famille meurt de privations, conclut-elle, que son sang retombe sur la tête de ma petite-fille.
— Eh bien pourquoi du moins n’essuies-tu pas, petite sotte, fit Becky. Tout est tombé en bas sur le dos de Pesach, le fiancé de ma sœur. Vas-tu lui payer un habit neuf ?
— Je suis bien fâchée, Becky, dit Esther, faisant effort pour contenir le tremblement de sa voix.
Et tirant d’un coin mystérieux un torchon sale, elle se mit à genoux et commença d’essuyer pour implorer son pardon.
Becky sifflota et redescendit chez elle pour assister aux solennités du contrat de fiançailles de sa sœur — car telle était l’explication de sa mirifique toilette, de ses boucles d’oreilles éclatantes, de sa broche massive, et de la transformation de l’atelier-chambre-à-coucher des Belcovitch, en une salle brillante de lumières. Quatre becs de gaz aux tuyaux longs et minces jouaient le rôle de torches nuptiales. Sur une longue table, étroite, recouverte d’une nappe blanche, on avait disposé des bouteilles de rhum et de gin, des biscuits et des fruits, le tout éclairé par deux bougies fichées en de hauts chandeliers de cuivre. Autour de cette table, étaient assis des Polonais au teint bruni, proprement habillés et pour la plupart en chapeau haut de forme. Quelques femmes vêtues de manteaux et de robes de soie, des chaînes d’or roulées autour de leur cou mal lavé, se tenaient à quelque distance de ce groupe. Un homme au dos voûté, à la barbe noire, aux yeux troubles, couvert d’un veston râpé et coiffé d’un bonnet noir, une longue boucle en tire-bouchon pendant de chaque côté des tempes, mangeait des amandes et du raisin sec, assis à la place d’honneur, réservé au Maggid (Rabbin). Devant lui se trouvaient des plumes, de l’encre et un rouleau de parchemin : le texte du contrat.
Les dommages-intérêts pour rupture des fiançailles y étaient stipulés d’avance et sans distinction de sexe. Chacun des deux conjoints devait en cas de rupture payer dix livres par forme de compensation. Israël est un peuple pratique et sans préjugés. Il sait que la romance, le clair de lune, sont de bien belles choses, mais que, derrière leur voile étincelant, se cache sous terre la réalité sévère et les faiblesses de l’humaine nature. Juste au moment où Becky rentrait, les deux partis étaient en train de signer le contrat. Le fiancé, qui boitait un peu d’une jambe, était un homme robuste et grand, nommé Pesach Weingott. Cordonnier de son état, il savait interpréter le Talmud et jouer du violon ; d’ailleurs, incapable de gagner sa vie. Il épousait Fanny Belcovitch, parce que ses beaux-parents s’étaient engagés à le loger et à le nourrir pendant un an, et aussi parce qu’il avait quelque penchant pour la jeune fille. Fanny, grasse et molle, blonde de teint et lymphatique d’aspect, n’était plus dans sa première jeunesse. Moins favorisée par la nature que sa sœur, elle était en revanche plus gracieuse et plus aimable. Elle savait chanter d’une voix douce en anglais et en « jargon » juif, et jadis avait figuré, pour dix shillings par semaine, dans une pantomime. Une autre fois, même, elle avait eu presque un rôle : elle brandissait un poignard contre un midshipman trop entreprenant. Mais depuis longtemps elle avait abandonné les planches pour devenir le bras droit de son père à l’atelier. Elle confectionnait des vêtements du matin au soir, assise à une grosse machine à coudre, dont la pédale était très lourde. Avant ses amours avec Pesach Weingott elle se plaignait souvent d’avoir mal dans le dos et dans la poitrine.
Lorsque le contrat fut signé il y eut un brouhaha de félicitations (Mazoltov, Mazoltov, « Bonne chance ») et beaucoup de poignées de mains ; des remarques, graves ou facétieuses, s’entrecroisaient en juif avec des phrases de russe et de polonais corrompu. Verres et coupes furent brisés, à la vieille mode, en commémoration de la fragilité des choses de ce monde. (Les Belcovitch avaient, pour cette occasion, réservé leur vaisselle fêlée.) On exprima aussi l’espoir que M. et Mme Belcovitch vécussent assez pour assister au mariage de leur autre fille et qu’ils pussent voir les filles de leurs filles à leur tour sous la Chuppah, c’est-à-dire le baldaquin nuptial. Les joues cependant endurcies de Becky rougirent.
Au no 1 de Royal Street tout le monde parlait yiddish, sauf la jeune génération et encore celle-ci employait cette langue pour parler aux aînés. Ce fut dans le patois que Mme Belcovitch s’écria :
— J’ai toujours dit qu’aucune de mes filles n’épouserait un Hollandais.
Telle avait toujours été la préoccupation dominante de la famille et elle monta aux lèvres de la mère en ce moment joyeux. Le Juif hollandais lui semblait placé aussi bas que le chrétien dans la hiérarchie des gendres possibles. Les Juifs espagnols, les premiers arrivés de Hollande après la Restauration, sont une classe à part et couvrent du même mépris les Ashkenazim, Polonais ou Danois venus après eux. Mais cela n’empêche pas le Polonais et le Hollandais de se mépriser mutuellement. Pour un Juif hollandais ou russe, un « Polak », c’est-à-dire un Juif polonais est une créature misérable ; et rien ne peut être comparé au mépris avec lequel le « Polak » considère à son tour le « Lithuanien », cet être dégradé, qui prononce Shibboleth et dit i au lieu de prononcer ou. Imiter la prononciation du juif lithuanien procure au juif polonais le même sentiment de supériorité que le juif anglais tire de son incapacité à bien prononcer l’hébreu : incapacité qui constitue son titre à la prééminence sur les émigrés récents. Et pourtant un souffle de solidarité pénètre toutes ces variétés jalouses. Les Juifs de Hollande vivent parqués dans un quartier appelé « Le Campement hollandais », mangent avec voracité, et monopolisent en quelque sorte le commerce ambulant des glaces à deux sous, des pois chauds, de la taillerie de diamants, des concombres, des harengs et des cigares. Ils ne sont pas aussi roublards que les Russes. Leurs femmes se distinguent des autres Juives par la flaccidité de leur gorge. Quelques-unes sont coiffées de petites chapes de laines et portent des sabots.
Rien n’étonna plus Esther que de lire dans ses livres de classe que le trait distinctif du caractère hollandais est la propreté. Cherchant vainement autour d’elle les figures et le linge scrupuleusement lavés et les parquets lessivés, elle ne retrouvait dans la réalité qu’un seul des traits indiqués par ses lectures : l’usage immodéré du tabac.
Les Juifs allemands gravitent autour des Juifs Polonais ou russes ; et les Juifs français restent pour la plupart en France. Le français est peut-être la seule langue qui ne se parle pas dans le ghetto de Londres, qui est pourtant un quartier essentiellement cosmopolite.
— J’avais toujours dit qu’aucune de mes filles n’épouserait un Hollandais.
M. Belcovitch parlait comme s’il n’avait pas encore une fille à marier. Mme Belcovitch insista cependant après son époux :
— Je ne donnerais pas, dit-elle, mon mouchoir de poche à un Hollandais, encore moins mon Alte ou ma Becky. Quels nez ils ont ! Ils ne sont pas restés derrière la porte au moment où le Tout-Puissant les distribuait : et leur hypocrisie est en proportion de leur nez.
L’assistance approuva, et un convive doué d’un organe puissant, le cacha dans un mouchoir de couleur, sous prétexte de se moucher.
— Que le Tout-Puissant soit béni, pour leur avoir donné des nez plus grands qu’à nous, dit le Maggid, puisque c’est avec ça qu’ils parlent.
Un éclat d’hilarité salua cette saillie. D’ailleurs l’esprit du Maggid était apprécié même hors de la prédication en chaire. Pour un chrétien ce séparatisme nasal eût semblé la guerre des borgnes contre les aveugles. Profitant du rire général et murmurant en Hébreu, « La Vie soit avec nous », le Maggid se versa un verre de rhum et l’avala d’un trait. Puis il ajouta :
— Ils devraient appeler leur parler non la langue hollandaise mais le « nez » hollandais.
— Eh oui, je m’étonne toujours comment ils peuvent se comprendre, dit Mme Belcovitch, avec leur « chatou-chayaca-liguéwise poupa ». Elle rit bruyamment, heureuse de son addition onomato-poétique au vocabulaire yiddish, serrant les narines pour augmenter l’effet. C’était une femme petite, souffreteuse, aux yeux noirs, au menton pointu, avec la perruque dont aucune femme vertueuse ne peut se passer. Car une femme mariée doit sacrifier sa chevelure sur l’autel de l’hyménée, de peur qu’elle ne s’en serve pour tendre des pièges au sexe mâle par ces appâts sensuels. Il est oublié dans les rites qu’un mari aussi est un homme. La tête de Mme Belcovitch n’était pas complètement tondue, car une mèche des cheveux bruns sortait de dessous la perruque, ne coïncidant même pas avec la raie rectiligne de la partie centrale.
Pendant ce temps Alte (ou autrement Fanny) tenait les mains de son fiancé, avec un remords de conscience, car elle était seule à savoir que des globules de sang batave couraient dans le sang du jeune homme. Pesach possédait un oncle hollandais. Il y avait un autre mystère. Ni Alte ni Fanny n’étaient le vrai nom de la jeune fille. Elle était le premier enfant qui eût survécu dans la famille. Tous les autres étaient morts peu après leur naissance. Désespérés par une infortune plus cruelle que la stérilité, les Belcovitch avaient consulté un vieux rabbin polonais qui leur avait fait cette singulière déclaration : l’excès même de leur amour pour leur progéniture avait, leur dit-il, provoqué la colère de Dieu. A l’avenir personne, sauf eux-mêmes, ne devait connaître le véritable nom de leur enfant, jusqu’à son mariage. Et le ciel alors, n’entendant point parler d’eux, oublierait peut-être de les châtier dans la personne de l’objet de leur affection. La ruse réussit et Alte attendait anxieusement de changer à la fois, sous la Chuppah, de nom et de famille ainsi que de prénom, et de satisfaire la curiosité qui la hantait à ce sujet. Jusque là sa mère l’avait appelée « Alte » ce qui veut dire « aînée » et peut sembler une appellation agréable à un enfant mais frappe péniblement les oreilles d’une jeune fille arrivée à une maturité assez avancée. Parfois Mme Belcovitch se prenait même à l’appeler « Fanny ». Pourquoi pas, puisque bien souvent elle se donnait elle-même ce nom de Belcovitch, bien qu’en réalité elle s’appelât Kosminski ?
Voilà comment cette métamorphose s’était opérée. La première fois que « Alte » alla à l’école du quartier, la directrice lui demanda son nom : la petite « Alte » ne possédait pas encore assez d’anglais pour comprendre la question, mais elle s’était bien aperçue que la maîtresse d’école en s’adressant aux précédentes élèves, avait proféré les mêmes sons, et celles qui n’avaient pas répondu avaient été grondées, tandis que la dernière était sortie triomphalement de l’épreuve rien qu’en prononçant : « Fanny Belcovitch ». Et jugeant qu’il n’y avait rien de mieux à faire que d’imiter cette triomphatrice, Alte avait répété : « Fanny Belcovitch ».
— Fanny Belcovitch ? dites-vous ? fit la directrice la plume en l’air.
Alte secoua vigoureusement sa tête blonde en signe d’affirmation.
— Fanny Belcovitch — répéta-t-elle, prononçant les syllabes plus distinctement cette fois.
Le maîtresse se tourna vers son adjointe :
— C’est étonnant comme les noms se répètent. Deux fillettes l’une après l’autre qui portent exactement le même !
On était d’ailleurs accoutumé dans l’Ecole à ces coïncidences à cause de la parenté de tribu entre élèves ; il n’y avait guère pour toutes qu’une demi-douzaine de noms.
M. Kosminsky mit plusieurs années à comprendre que « Alte » l’avait répudié. Lorsqu’il eut compris il n’en éprouva point de chagrin et accepta son sort. Comme sa femme Chayah, graduellement il se persuada qu’il était un Belcovitch ou que du moins Belcovitch était la traduction anglaise de Kosminsky.
Heureusement ignorant des attaches hollandaises de Pesach Weingott, Bear Belcovitch étalait une hospitalité prodigue. On ne signe pas un contrat de mariage tous les jours. C’est pourquoi sans récriminer il avait consacré jusqu’à dix shillings aux dépenses du festin.
Il portait un chapeau haut de forme, une redingote noire bien conservée ; et son gilet largement ouvert sur un plastron étincelant montrait une chaîne de montre massive. C’étaient là ses vêtements de Sabbat et, comme l’institution du Sabbat elle-même, ils dataient d’une haute antiquité. La chemise servait pour sept Sabbats — une semaine de Sabbats — . Ses bottines avaient aussi le cirage du Sabbat. Il avait acheté son chapeau la première fois qu’il avait rempli les fonctions de Baal Habaas, c’est-à-dire « respectable pilier » de la synagogue. Car même dans la Chevrah la plus insignifiante, le chapeau haut de forme vient immédiatement après les Tables de la Loi, dans l’ordre des choses saintes, et quiconque ne le porte pas, n’oserait aspirer aux dignités consistoriales. L’éclat de ce haut de forme avait quelque chose de miraculeux, si l’on considère qu’il avait été exposé à toutes les brises et à tous les temps. Ce n’est point que M. Belcovitch ne possédât un parapluie. Il en avait deux au contraire. Un en belle soie, tout neuf et un autre, horrible mélange de baleines brisées et de lambeaux de coton. Becky lui avait fait cadeau du premier pour éviter à la famille le déshonneur de le voir sortir avec l’ancien. Mais M. Belcovitch n’avait jamais voulu porter le nouveau parapluie pendant la semaine parce qu’il était trop beau et quant aux jours de Sabbat on sait bien que c’est péché que de porter un parapluie. Ainsi resta vain le sacrifice de Becky ; pur objet d’orgueil pour son vaniteux possesseur, il fut laissé à la maison.
Kosminsky, ou Belcovitch, qui avait eu à lutter durement pour l’existence n’avait point l’habitude de rien gaspiller. C’était un homme grand et robuste, de cinquante ans environ, aux cheveux grisonnants, pour qui la vie signifiait travail ; travail : argent, et argent : économies. Dans les livres bleus du Parlement, dans les journaux anglais et au Club socialiste de Berner Street on l’appelait un « sweater », un exploiteur de la sueur humaine, et les journaux comiques le représentaient avec une panse rebondie et un sourire onctueux : mais lui se croyait bien naïvement un citoyen industrieux et même philanthrope, vivant dans la crainte du Seigneur. Il traitait les autres comme il avait été traité lui-même. Il ne voyait pas pourquoi les immigrants pauvres ne vivraient point avec six francs par semaine, durant le temps qu’il leur enseignait la façon de se servir d’un fer à repasser ou d’une machine à coudre. Ils étaient encore, à ce prix-là, beaucoup mieux qu’en Pologne. Combien il eût été heureux d’un tel salaire aux jours terribles de son arrivée en Angleterre alors qu’il voyait mourir de faim sa femme et ses deux enfants et que la seule chose qui l’empêcha de convertir en poison ses derniers quatre sous, fut son ignorance du mot « poison » en anglais. Et de quoi vivait-il maintenant ? La poule, le boisseau de haricots et la morue que Chayah achetait pour le Sabbat, suffisaient presque pour la moitié de la semaine ; un quart de café durait huit jours, le marc étant « repassé » jusqu’à perte complète de toute saveur et de toute couleur. Le pain noir, les pommes de terre et les harengs saurs constituaient le régime ordinaire des autres jours. Non, personne ne pouvait accuser Bear-Belcovitch de s’engraisser de la sueur et des entrailles de ses employés. Le mobilier était des plus primitifs et réduit au strict indispensable. Aucun instinct esthétique ne poussait les Belcovitch à se procurer autre chose que les nécessités strictes de l’existence — sauf en ce qui concerne la vêture — . Les seules concessions faites aux beaux-arts étaient une Mizrah peinte grossièrement et accrochée au mur oriental de la pièce pour indiquer le côté où le juif doit se tourner pour faire sa prière, et la glace de la cheminée entourée de papier jaune — afin de préserver la dorure du cadre des injures des mouches — et ornée à chaque coin de roses artificielles que l’on renouvelait une fois par an, à Pâques.
Bear Belcovitch avait vécu plus somptueusement en Pologne où il possédait une cuvette de cuivre pour les ablutions, une aiguière également en cuivre, des cuillers d’argent, un calice de consécration en argent, et un buffet avec des panneaux vitrés. Et souvent il pensait avec amour à ces reliques disparues. Mais il n’avait rien emporté de tout cela, sauf la literie et encore avait-il vendu celle-ci en Allemagne durant le trajet. Il avait débarqué à Londres avec une famille de trois personnes et trois groschen.
— Le croiriez-vous, Pesach ? fit Becky aussitôt qu’elle put se frayer un chemin jusqu’à son futur beau-frère à travers la haie des convives qui le congratulaient. La tache que vous voyez là, c’est de la soupe ! Et elle indiquait le plafond sali au-dessus de leur tête. Cette bécasse de petite Esther a laissé tomber tout ce qu’elle avait rapporté de la distribution de charité.
— Achi Nebbich, pauvre petite, s’écria Mme Kosminski, qui était dans un état d’exceptionnel attendrissement, ils doivent mourir de faim là-haut ! le père est sans travail.
— Sais-tu, mère, fit Fanny, nous devrions leur donner notre soupe. La tante Léah nous en a rapporté. N’avons-nous pas pour aujourd’hui un autre souper ?
— Mais que dira leur père ? fit tout bas la vieille.
— Oh ! il ne s’en apercevra même pas. Il ignore même, je crois, que le fourneau a ouvert ce soir. Laisse-moi faire, mère !
Et Fanny, lâchant la main de Pesach, se glissa dans la chambre à coucher qui servait en même temps de cuisine et porta à l’étage supérieur le pot encore fumant. Pesach la suivait avec quelques tranches de pain, l’éclairant d’un bout de chandelle, qui s’éteignit juste au point terminus du voyage. Au moment où les fiancés disparaissaient, les convives clignèrent des yeux et tirèrent de l’Ancien Testament, ainsi que du Talmud, des citations grivoises. Mais les amoureux lorsqu’ils sortirent de la mansarde des Ansell ne songèrent même pas à s’embrasser. Seulement ils avaient les yeux humides, et lorsque doucement, la main dans la main, ils redescendirent l’escalier, il leur parut qu’ils s’aimaient plus profondément. C’est ainsi que la Providence envoya à des gens plus nécessiteux que les Belcovitch la soupe que ceux-ci, par une vieille habitude d’économie, avaient été chercher au fourneau philanthropique, ce qui prouve que, dans le double sens du mot, un bienfait n’est jamais perdu. Ce ne fut pas le seul que fit le Seigneur par l’intermédiaire de l’heureux père de la fiancée. Peu après en effet, un coreligionnaire de celui-ci apparut sur la scène enveloppé d’une longue capote et la figure défaite. C’était un nouvel immigrant, débarqué depuis quelques heures à peine et qui n’apportait avec lui pour tout bagage que beaucoup de foi en Dieu et dans la composition aurifère du pavé de Londres. Une fois débarqué, jetant à peine un coup d’œil sur la Métropole, il avait demandé où était la synagogue. Puis ses dévotions accomplies, il était allé trouver M. Kosminski-Belcovitch, dont l’adresse, inscrite sur un chiffon de papier, l’avait accompagné dans son voyage comme un talisman. Dans sa ville natale, où les Juifs gémissaient sous la persécution, la renommée de Kosminski, le pionnier, le Crésus, tenait de la légende. M. Kosminski se trouvait donc préparé à ces éventualités. Il alla dans sa chambre à coucher, tira une lourde caisse de dessous son lit, l’ouvrit et plongea la main dans un sac en toile sale plein de pièces de cuivre. L’instinct de générosité qui le dominait ce jour-là, lui fit compter quarante-huit pièces. Il les porta au « greener » entre ses paumes superposées et l’étranger ignorant qu’il devait cette largesse aux fiançailles de Fanny vit la fortune dans cette poignée de monnaie. Il s’en alla le cœur gonflé de gratitude et sa poche contenant quatre douzaines de farthings. On le recueillit à l’asile des Juifs pauvres, qui lui avait été indiqué par son coreligionnaire et où on lui donna de la soupe chaude. Kosminski rentra dans la salle de fête tressaillant de la tête aux pieds, du doux frémissement que donne une conscience satisfaite. Il caressa la tête crépue de Becky et dit :
— Eh bien, Becky, quand donc dansera-t-on à ta noce à toi ?
Becky secoua ses boucles. Les jeunes gens ne pouvaient avoir les uns des autres une opinion pire que celle que Becky avait d’eux tous. Elle acceptait leurs hommages avec plaisir et cependant ne leur en savait aucun gré. Les amoureux pullulaient autour d’elle comme les baies sur un groseillier au printemps, ou plutôt, comme sa mère disait dans son jargon réaliste, ces Chasanim ressemblaient à une meute de chiens de rues. Les adorateurs de Becky assiégeaient son escalier avant qu’elle fût levée ; l’amour les rendait de plus en plus matineux, chacun désirant être le premier à souhaiter le bonjour à cette Pénélope de la couture. On disait que les succès industriels de Kosminski, étaient dus à la beauté de Becky, cette fleur de la jeunesse travailleuse éclose dans l’atelier du Laban de l’East End.
— Je ne veux point imiter Fanny, dit-elle cependant en confidence à Pesach Weingott, dans le courant de la soirée.
Il sourit indulgemment.
— Fanny a toujours été terre à terre, continua Becky ; quant à moi j’ai toujours dit que je n’épouserai qu’un gentleman.
— Mais j’ose dire, riposta Pesach, piqué par cette déclaration, que Fanny aurait pu si elle avait voulu, épouser elle aussi un gentleman.
Pour Becky un gentleman était un employé ou un maître d’école, un être qui ne travaille pas de ses mains et ne fait que gratter du papier ou fouetter les petits enfants. Ses vues matrimoniales étaient caractéristiques. Elle méprisait la profession de ses parents et comptait se marier en dehors de leur classe. Eux, de leur côté, ne pouvaient comprendre ce désir de devenir autre chose que ce qu’ils étaient.
— Je ne dis pas que Fanny n’aurait pas pu le faire, répondit Becky, je dis seulement que personne ne peut appeler son mariage un beau mariage.
— Et toi tu fais trop de manières, gronda M. Belcovitch. Tu vises trop haut ! Becky secoua la tête.
— Je viens de recevoir mon nouveau corsage, dit-elle à un jeune homme, présent à la fête par grâce spéciale. Il faudrait que vous me voyiez avec. J’ai l’air d’une dame.
— Oui, fit Madame Belcovitch avec orgueil, ça brille au soleil.
— Est-ce qu’il ressemble à celui de Bessie Sugarman ? questionna le jeune homme.
— Bessie Sugarman, répéta Becky irritée, elle achète tous ses costumes à tempérament. Elle fait la fière, mais ses bijoux sont payés à la petite semaine.
— Si tant est qu’elle les paie, observa Fanny, en tournant vers sa sœur son visage rayonnant.
— Ne sois pas jalouse, Alte, dit la mère. Lorsque je gagnerai à la loterie je t’achèterai aussi un corsage.
Presque tous les émigrants juifs jouaient à la loterie de Hambourg et c’était une invasion chez les marchands de billets quand par hasard un habitant du Ghetto avait gagné seulement sa mise. L’espérance d’une fortune subite colorait l’horizon de ces pauvres gens comme les éclairs de chaleur traversent les nuits d’été ; elle illuminait les mornes perspectives de leur avenir. La loterie mettait hors d’eux-mêmes les possesseurs de billets, et introduisait dans leur vie un élément qui leur faisait oublier leur quotidien travail d’esclave.
Le travailleur anglais, n’ayant pas cet exutoire des loteries d’Etat, relève la monotonie de son existence en prenant un intérêt, d’ailleurs très indirect, à l’amélioration de la race chevaline.
— Allons, Pesach, encore un verre de rhum, dit M. Belcovitch à son futur gendre et pensionnaire.
— Oui, avec plaisir, après tout on ne se fiance pas tous les jours.
Le rhum était de la fabrication de M. Belcovitch. Les ingrédients qu’il employait demeuraient mystérieux, mais le parfum de ce breuvage se répandait à travers l’atmosphère jusqu’aux recoins les plus cachés de la maison. Même les habitants des mansardes se demandaient en aspirant l’air, d’où venait cette odeur de térébenthine. Pesach dégustait la décoction en murmurant : « à votre santé ». Son gosier lui sembla devenu la cheminée d’un steamer et il avait des larmes dans ses yeux lorsqu’il reposa son verre.
— Oh ! que c’est bon, murmura-t-il.
— Les Anglais n’en boivent pas de pareil, hein ? fit M. Belcovitch.
— L’Angleterre, répéta Pesach avec un indicible mépris. Quel pays ! « Daddle doo » y est une langue, et le gingerbeer une liqueur.
« Daddle doo » était la manière dont Pesach prononçait « That will do », « Cela peut aller ». C’était un des premiers mots anglais qu’il avait saisi et la puérilité de cette expression le rendait facétieux. Il leur semblait que cette locution dégageait une odeur de nursery : lorsqu’une nation traduit ainsi ses sentiments, on n’a plus lieu de s’étonner que la bière de gingembre soit considérée par elle comme un breuvage.
— Vous n’aurez pourtant rien de plus fort que le gingerbeer quand nous serons mariés, fit Fanny en riant, je ne veux pas avoir pour mari un buveur.
— Alors j’en boirai tant que je me griserai, riposta Pesach en riant.
— On ne peut pas, fit Fanny avec un large sourire.
Dans les premiers cercles anglo-juifs avec lesquels Pesach s’était trouvé en relations, le gingerbeer était la boisson favorite. Généralisant presque aussi vite que s’il avait à écrire un livre sur les mœurs du pays, il en avait conclu que c’était là le breuvage national.
Depuis longtemps déjà il avait découvert sa méprise, mais la direction que prenait la conversation, fit penser à Becky qu’elle pouvait décocher un trait à Pesach.
— Un de ces jours, lui dit-elle, j’ai envie de vous envoyer un « valentin ».
Pesach rougit et ceux qui étaient dans la confidence s’esclaffèrent. C’était une allusion à une autre des erreurs commises par Weingott. Un jour qu’en compagnie d’un autre « greener » il contemplait un étalage de libraire, les deux étrangers avaient eu grand peine à comprendre ce que pouvaient signifier ces monstrueuses caricatures. Cependant Pesach avait compris que les gentlemen microcéphales et à jambes torses et les dames avec la tête énorme et une toute petite chemise, représentaient les paysans anglais épars dans les villages du pays.
— Le jour du mariage, répliqua Pesach à Becky, ce ne sera point la saison des valentins.
— C’est dommage, dit Becky en secouant ses boucles noires, vous feriez un bien drôle de couple.
— C’est bon, Becky, fit Alte, avec bonne humeur. Ton tour arrivera et nous allons bien nous moquer de toi.
— Ah non pas, qu’ai-je donc besoin d’un homme, moi ?
Le bras du jeune homme spécialement invité à la solennité l’enserrait au moment où elle prononçait ces paroles.
— Tu te marieras comme tout le monde, Becky, dit Alte reprenant la conversation avec sa sœur. Ne fais pas de manières.
— Ce ne sont point des manières. C’est ma façon de penser. Qu’ai-je à faire des hommes qui viennent ici. Ce ne sont pas des messieurs.
— Laissez-moi le temps de gagner à la loterie, Becky, dit le jeune homme.
— Alors pourquoi ne prenez-vous pas un autre ticket, demanda Sugarman le Shadchan[2] qui sembla surgir de l’autre bout de la pièce. C’était un des plus grands talmudistes de Londres, un homme à figure hâve et famélique, aux traits âpres mais intelligents. Regardez Mrs Robinson, je viens de lui faire gagner plus de vingt livres et dire qu’elle ne m’en a pas donné plus de deux. J’appelle cela une honte.
[2] Le Marieur.
— Vous lui avez volé deux autres livres, observa Becky.
— Comment le savez-vous donc ? questionna Sugarman stupéfié.
Becky cligna des yeux et secoua sa tête d’un air entendu.
— Ça me regarde, dit-elle, vous ne le saurez pas.
La liste du tirage et des numéros gagnants était si compliquée, que Sugarman avait eu mainte occasion de rouler ses clients.
— Je ne vous vendrai plus de tickets, à vous, fit-il à Becky avec indignation.
— Oh, je m’en moque bien.
— Toi, tu te moques de tout, dit Mme Belcovitch, saisissant l’occasion pour admonester sa fille. Et dire que tu n’as même pas pensé à m’apporter ma médecine ce soir. Tu la trouveras sur la planche du placard de la chambre à coucher.
Becky fit une mine impatientée. Alors le jeune homme offrit d’aller la chercher.
— Non, il n’est pas convenable qu’un jeune homme entre dans ma chambre à coucher en mon absence, fit Mme Belcovitch, en rougissant.
Becky s’exécuta.
— Vous savez, fit Mme Belcovitch, s’adressant au jeune homme, que je souffre beaucoup des jambes. L’une est enflée et l’autre toute desséchée.
— Ah, comment cela vous est-il venu ? dit le jeune homme d’un air compatissant.
— Le sais-je seulement ? Je suis née comme ça. Ma pauvre mère avait des jambes bien conformées. Si j’avais la tête d’Aristote, je pourrais peut-être savoir pourquoi mes jambes sont si mal faites. Mais ça marche comme ça quand même.
Le respect que les Juifs professent pour Aristote est probablement dû à ce fait que le vulgaire le prend pour un philosophe juif. L’assertion que la philosophie d’Aristote est d’origine israélite a été avancée par un poète du moyen-âge, Jehuda Halevi, et soutenue par Maïmonide. La légende veut que lorsque Alexandre arriva en Palestine, il était accompagné d’Aristote. A Jérusalem le philosophe découvrit les manuscrits de Salomon et les publia sous son nom. Mais il est à remarquer que ce conte ne fut accepté que par ceux des étudiants juifs qui adoptèrent l’Aristotélisme. Ceux qui rejettent cette doctrine déclarent au contraire qu’Aristote, dans son testament a reconnu l’infériorité de ses écrits sur les livres de Moïse et demandé qu’on détruisît ses propres œuvres.
Lorsque Becky rentra avec la médecine, Mme Belcovitch observa qu’elle était bien mauvaise à prendre, et offrit au jeune homme d’en goûter. Celui-ci se réjouit intérieurement de cette faveur, considérant dès lors qu’il était bien noté par les parents de Becky. M. Belcovitch payait un penny par semaine à son médecin, qu’elle fût malade ou bien portante, et par conséquent c’était une perte sèche pour elle que d’être bien portante ! Becky avait inventé de remplir les bouteilles avec de l’eau pure pour s’éviter la peine d’aller chercher la médecine, mais comme Mme Belcovitch ne s’en doutait point, ça lui faisait autant de bien.
— Vous êtes trop sédentaire, M. Kosminski, dit Sugarman en yiddish.
— Comment voulez-vous que je sorte par un temps tout noir et humide, et « l’Ange de la mort en chasse ».
— Eh, observa M. Sugarman, abandonnant bravement l’emploi de ce jargon, nous autres Anglais nous sortons par tous les temps.
Dans le même moment Mosès Ansell rentrait de l’office du soir et s’asseyait, sans mot dire, à la lueur d’une bougie inespérée devant un repas inattendu, composé de pain et de soupe, bénissant Dieu pour ces deux dons. Le reste de la famille avait soupé. Esther avait couché les deux plus jeunes enfants ; Rachel était déjà assez grande pour se déshabiller toute seule. Elle et Salomon faisaient leurs devoirs de classe, la chandelle leur épargnant les coups de férule du lendemain à l’école. Esther tenait sa plume gauchement, car elle s’était blessée et plusieurs de ses doigts étaient ensanglantés et entortillés de toiles d’araignée. La grand’mère somnolait sur sa chaise. Tout était calme et paisible malgré l’atmosphère glaciale.
Mosès dîna en faisant joyeusement claquer sa langue. Ensuite il poussa un profond soupir, remercia Dieu par une prière qui dura au moins dix minutes, débitée avec volubilité et d’une voix chantante. Il demanda à Salomon s’il avait bien dit l’oraison du soir. Salomon regarda du coin de l’œil la grand’mère et s’apercevant qu’elle était endormie, répondit affirmativement et poussa du pied sous la table Esther en signe d’intelligence.
— Alors, fais maintenant la prière de nuit.
Il n’y avait pas moyen d’esquiver le coup. Salomon termina donc son devoir d’arithmétique écrivant les chiffres au crayon, de manière à pouvoir corriger d’après un camarade, s’il s’apercevait d’une erreur. Après quoi, tirant un livre de prière en hébreu d’une sacoche fort graisseuse, il fit entendre des murmures confus entrecoupés d’inintelligibles éclats de voix durant un nombre de minutes proportionnées au nombre des pages du livre de prière. Puis il se coucha. Esther mit la grand’mère au lit et s’étendit à côté d’elle. Longtemps elle resta éveillée écoutant le singulier marmonnement de son père qui étudiait « Le Commentaire du livre de Job », de Raschi, murmure cadencé qui se confondait assez agréablement avec les sons assourdis du violon de Pesach Weingott, perçus à travers le plancher.
IIIMALKA
La foire du Dimanche qui a depuis si longtemps lieu dans Petticoat Lane aura du mal à disparaître ; encore très courue, elle battait son plein le matin gris où Mosès Ansell traversait le ghetto. Il était onze heures environ et la foule augmentait à vue d’œil. Les vendeurs annonçaient leurs marchandises d’une voix stentorienne ; le bavardage des acheteurs semblait la rumeur confuse d’une mer démontée. Les murs nus et les palissades étaient placardés d’annonces d’où se pouvait aisément déduire le caractère, la race, le genre de vie des habitants du quartier. Beaucoup étaient en yiddish, le jargon le plus corrompu et le plus hybride qui se soit jamais parlé. Et même lorsque la langue était anglaise, les lettres étaient hébraïques. Whitechapel, Public Meeting, Board School, Sermon, Police, ces termes d’une banalité toute moderne se dissimulaient sous les caractères sacrés de la langue qui chante les miracles et les prophéties, les palmiers et les cèdres, les Séraphins et les lions, les bergers et les harpistes.
Mosès s’arrêta pour lire ces affiches hybrides — car il n’avait rien de mieux à faire, mourant de faim, lui et sa famille. Comme il rôdait sans but dans Wentworth street, il aperçut une annonce collée à la fenêtre d’une échoppe de savetier. Cette espèce d’enseigne était rédigée en jargon juif : « On demande des riveurs, des crochetiers, des couseurs et des finisseurs. — Baruch Emmanuel, savetier, confectionne et répare les chaussures au même prix exactement que Mordécai Schwartz, du 12, Goulston street. »
Mordécai Schwartz était écrit en lettres hébraïques plus grandes, plus noires, Mordécai Schwartz planait sur l’échoppe. Baruch Emmanuel était évidemment très conscient de son infériorité vis-à-vis de ce puissant concurrent, bien que Mosès n’eût jamais encore entendu parler de Mordécai Schwartz. Il entra dans la boutique et dit en hébreu :
— La Paix soit avec toi.
Baruch Emmanuel répondit, dans la même langue, en martelant une semelle :
— Avec toi la paix.
Mosès alors parla en jargon :
— Je cherche du travail. Peut-être pourras-tu m’en donner ?
— Que sais-tu faire ?
— J’ai été riveur.
— J’ai des riveurs autant qu’il m’en faut.
Mosès parut désappointé.
— J’ai aussi été coupeur, fit-il.
— J’ai tous les coupeurs dont j’ai besoin, répondit Baruch.
L’âme de Mosès s’obscurcit.
— Il y a deux ans, je travaillais comme finisseur.
Baruch secoua lentement sa tête. La persistance de l’homme commençait à l’ennuyer. Restait encore l’emploi de tailleur de formes.
— Et pendant une semaine j’ai travaillé dans les formes, fit Mosès.
— Je n’ai pas besoin de ça non plus ! cria Baruch, perdant patience.
— Mais il est écrit à ta fenêtre que tu en as besoin, protesta Mosès faiblement.
— Ça m’est absolument égal, ce qui est écrit ou non à ma fenêtre ! — Tu n’es donc pas assez intelligent pour comprendre que c’est une blague ? Malheureusement pour moi je travaille tout seul, mais l’enseigne fait bien et au fond ça n’est point un mensonge. Bien sûr, je désirerais en avoir des riveurs, des coupeurs, des finisseurs et tout ça ; si j’en avais, ça me ferait un grand établissement et j’arracherais les yeux à Mordécai Schwartz. Mais le Très-Haut me refuse des assistants et je me contente de souhaiter en avoir.