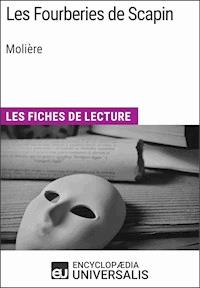
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Französisch
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalis
Comédie en trois actes créée en 1671 au théâtre du Palais-Royal à Paris,
Les Fourberies de Scapin semblent reprendre à leur compte, avec virtuosité, les tours et les figures de la comédie latine, puis italienne.
Une fiche de lecture spécialement conçue pour le numérique, pour tout savoir sur Les Fourberies de Scapin de Molière
Chaque fiche de lecture présente une œuvre clé de la littérature ou de la pensée. Cette présentation est couplée avec un article de synthèse sur l’auteur de l’œuvre.
A propos de l’Encyclopaedia Universalis :
Reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité incomparable de ses publications, Encyclopaedia Universalis met la connaissance à la portée de tous. Écrite par plus de 7 400 auteurs spécialistes et riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins…), l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable collection de référence disponible en français. Elle aborde tous les domaines du savoir.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 49
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782852294530
© Encyclopædia Universalis France, 2019. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Nito/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Encyclopædia Universalis.
Ce volume présente des notices sur des œuvres clés de la littérature ou de la pensée autour d’un thème, ici Les Fourberies de Scapin, Molière (Les Fiches de lecture d'Universalis).
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
LES FOURBERIES DE SCAPIN, Molière (Fiche de lecture)
Comédie en trois actes créée en 1671 au théâtre du Palais-Royal à Paris, Les Fourberies de Scapin semblent reprendre à leur compte, avec virtuosité, les tours et les figures de la comédie latine, puis italienne. D’antiques problèmes, que Molière (1622-1673) adapte à la société moderne, y sont traités. Le vieillard (senex) est là pour interdire aux plus jeunes (adulescentes) l’accès aux femmes et à la dépense. Son univers frugal se referme sur un monde sans plaisir où il n’est question que de conserver un patrimoine. De son côté, l’adulescens pleure, s’affole, sans parvenir à s’imposer. Enfin, entre senex et adulescens, Scapin, le fourbe, concocte les ruses et propose les stratagèmes : « À vous dire la vérité, il y a peu de choses qui me soient impossibles, quand je m’en veux mêler. J’ai sans doute reçu du Ciel un génie assez beau pour toutes les fabriques de ces gentillesses d’esprit, de ces galanteries ingénieuses, à qui le vulgaire ignorant donne le nom de fourberies ; et je puis dire, sans vanité, qu’on n’a guère vu d’homme qui fût plus habile ouvrier de ressorts et d’intrigues, qui ait acquis plus de gloire que moi dans ce noble métier... » La pièce suppose ainsi, à la manière latine, une faille dans le système de préservation du vieillard, un retour à l’harmonie après le stratagème, et le romanesque de la reconnaissance finale.
• Une histoire vieille comme le théâtre
Entre-temps, les scènes canoniques ont eu lieu : la scène du senex iratus (quand le père en colère apprend et constate la dépense) ; la scène de l’adulescens lacrimans (le jeune homme s’inquiète, devant le servus, de la colère paternelle) ; la scène du servus cogitans (le serviteur réfléchit au stratagème pendant que l’adulescens lacrimans le presse de trouver une solution) ; la scène du servus currens (le servus entre, ne voit rien, n’entend rien, et renverse tout sur son passage y compris le senex) ; le quiproquo ; enfin les scènes finales, avant le banquet harmonieux.
Comme il est commun au XVIIe siècle, Molière s’empare d’une pièce de référence, le Phormion de Térence (auteur qu’il révère), pour écrire sa pièce. Mais, au lieu de sept personnages principaux, il en introduit huit, pour la symétrie : deux vieillards (Argante et Géronte), deux couples d’amoureux (Octave et Hyacinte, Léandre et Zerbinette), deux valets enfin (l’un soumis, Silvestre, l’autre presque affranchi et capable de tout). Scapin ajoute à cette structure des jeux de scène italiens (les lazzi) et des fourberies bien françaises : le sac venu de Tabarin, les escroqueries multiples héritées de l’Antiquité et du Moyen Âge, sans compter le célèbre « Qu’allait-il faire dans cette galère ! » Classiquement, nous sommes donc passés de l’âge d’or d’avant la comédie à la crise domestique opposant les jeunes gens et les vieux, et de la crise à une nouvelle harmonie où le monde est enfin stabilisé pour qu’un nouvel âge d’or existe, une fois les jeunes filles reconnues pour ce qu’elles étaient vraiment : Zerbinette, comme la fille d’Argante, et Hyacinte, comme celle de Géronte. Le double mariage peut avoir lieu.
• Le fourbe, ou le théâtre incarné
Très vite, pourtant, on s’aperçoit que différents éléments viennent pervertir cette exemplarité canonique. Contre l’image simpliste d’un valet sans profondeur, propre à illustrer le pendant français de l’Arlequin de la commedia dell’arte, on voit s’élaborer l’image d’un héros mauvais garçon, brigand intelligent à la fois bouffon et sombre, qui se met au centre d’une intrigue qu’il détourne à son profit et qu’il rend, grâce à ses fourberies et à ses discours, intéressante pour le spectateur. Scapin ne sert donc à rien pour cette intrigue, sinon à illustrer sa propre satisfaction. De plus, il révèle ce qui ne doit être dit et lutte contre ce qui ne doit pas être fait. C’est lui qui fait le tableau de la justice (un « enfer ») menée par des juges subornés, « par des gens dévots, ou par des femmes qu’ils aimeront »... C’est lui encore qui se bat contre « l’imposture », pour la punir, lors de la scène du sac. Car cette scène, loin d’être gratuite, est la mise en scène d’une vengeance publique et légitime : Géronte a trahi Scapin en faisant croire à son fils que le valet a tout révélé de son mariage. Il faut donc qu’il paie ! Scapin, allégorie du théâtre, combat l’imposture au nom de l’honneur, à coups de bâton de théâtre. Comme si Molière corrigeait ici tout ce que cette damnée imposture lui avait faire endurer au cours de sa carrière. Cependant, la scène finit mal pour Scapin, puisqu’il est découvert par Géronte qui, littéralement, relève la tête. Le théâtre, qui est hyperbole, se montre se vengeant, en dit trop, et c’est bien là le défaut de sa cuirasse.





























