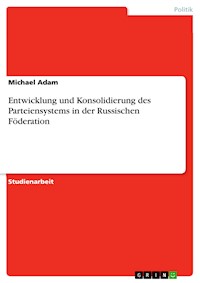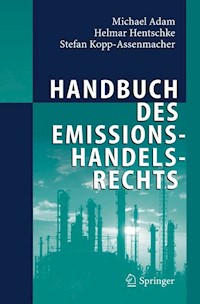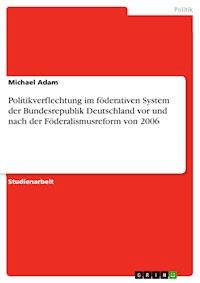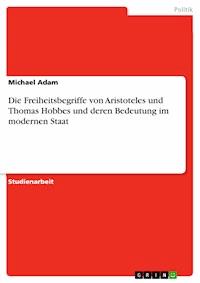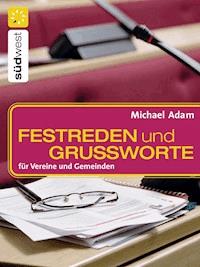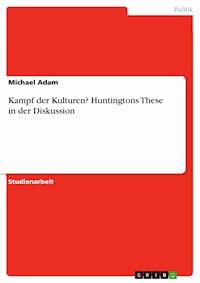Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Les gaufres de maman Cécile n'est ni un roman ni une biographie, c’est le récit d’un enfant dont les jours et les nuits sont marqués à jamais par des séparations trop précoces d’avec des êtres chers, disparus dans la plus grande des catastrophes. C’est l’histoire d’un être au passé marqué par une enfance volée, avec ses angoisses et ses amours vécues sur le fond de la nostalgie d’un passé toujours présent. Mais c’est aussi la dynamique d’un long processus de résilience qui permet à l’auteur de surmonter les épreuves de la vie en se reconstruisant dans le pays de ses ancêtres.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Dès l'âge de quatre ans,
Michaël Adam connaît la séparation d'avec ses parents, la prison, puis le corridor de la mort qu'est le camp de Drancy. Engagé dans la lutte contre l'intégrisme et la violence et à cheval sur deux cultures, il est un écrivain bilingue, poète et traducteur maintes fois lauré pour ses poèmes et ses nouvelles. Son histoire est celle de nombre de ses compatriotes, pour la plupart victimes de la démence nazie. Dans le poignant témoignage qu'est ce récit, il sait faire vibrer nos âmes avec des mots simples et un réalisme virulent. Michaël possède cette merveilleuse faculté de transmettre l'émotion, son émotion, qui devient nôtre au fil de la lecture.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 147
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michaël Adam
Les gaufres de maman Cécile
Roman
© Lys Bleu Éditions – Michaël Adam
ISBN : 979-10-377-4369-5
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Du même auteur
L'illusionniste, Poèmes engagés, éd. Stellamaris, France 2020
Poèmes Florifaunes, Poésie pour enfants, éd. Lupa, Israël 2018
Les enfants du mâchefer, éd. L’Harmattan, Paris 2002.
La Névrose et autres nouvelles, éd.L’Harmattan, Paris 2002.
À ma maman qui m’a donné la vie puis me l’a sauvée.
Préface
Le roman de Michaël Adam né en 1939 est-il vraiment un roman ? La réponse est d’abord oui parce que l’écriture lui permet d’échapper à ce qui aurait pu être un fatum, parce qu’elle lui permet d’exprimer enfin l’indicible, l’intolérable, l’insoutenable et, en même temps, de rendre un hommage mérité à ceux qui lui ont permis de survivre, puis de vivre. On a l’impression que par les mots Michaël Adam se reconstruit comme si hier doit passer du cauchemar à l’espérance la plus folle. Cet espoir, c’est le titre de l’hymne israélien qui vient inéluctablement rimer avec l’amour de la France, car comme Joséphine Baker, Michaël Adam pourrait chanter qu’il a deux amours, aussi intenses l’un que l’autre, parfois aussi éprouvants l’un que l’autre parce que l’amour est toujours un défi, une épreuve, une victoire du quotidien. Il a su aussi les exprimer par des poèmes émouvants avec, à la fois, un mélange presque terrifiant d’espoir et de désespérance même si pour lui, comme l’écrivait Malraux : « La vie ne vaut rien mais rien ne vaut la vie ».
Ce livre est au-delà d’un roman parce qu’il exprime la vérité et les souffrances réelles d’une vie. Son histoire personnelle est celle narrée dans ce roman. Les personnes, pour ne pas dire les personnages, ont rythmé son existence, l’ont accompagné, et c’est en écrivant qu’il leur exprime la plénitude de sa reconnaissance et l’authenticité de son amour, amour aussi de sa judéité loin de Dieu mais si proche du peuple juif, de son histoire, de sa transcendance au-delà des siècles.
Car il s’agit bien au fil des pages de l’expression d’un amour multiple : amour des humains qui savent parfois être des « Justes » sans s’en rendre compte, amour de la vie avec une force quasi démentielle, amour des mots pour traduire au plus près le plus profond de ce que l’on ressent, amour de deux pays et de deux traditions qui se cumulent plus qu’elles ne se heurtent. Oui, c’est bien l’amour qui se cache derrière chacune des pages, c’est bien le cœur de Michaël Adam qui est mis à nu avec une sensibilité éloquente.
On ne peut dissimuler l’impression que ce roman-biographie est à la fois une manière psychanalytique d’assumer le passé mais aussi un message d’espoir pour le jeune pionnier dont les premiers jours commencent dans un pays qui n’est pas fait de lait et de miel, mais de défis, de joies et de peines, réponse extraordinaire et émouvante à la Shoah. Les nazis ont voulu faire disparaître les Juifs de la terre, mais les survivants dont fait partie Michaël Adam ont fait mieux que survivre : ils ont construit, certes dans la douleur, une terre, leur terre : celle d’Israël !
L’enfant Michaël que sa maman, au péril de sa vie, est venue chercher dans le camp de Drancy est plus qu’un poète, plus qu’un écrivain. C’est le rescapé d’une tragédie qu’il savait avoir le devoir de transmettre avec des mots, des émotions, des larmes. Il le fait pour que les Juifs des générations futures n’oublient pas, pour que les héros involontaires aient leur place reconnue et que soient à jamais renvoyés dans les fossés de l’Histoire ceux qui ont pensé un moment faire disparaître un tout petit peuple qui a toujours su qu’il avait un seul devoir : vivre et transmettre.
Jean-Claude Kross
Magistrat Honoraire
Demain, à la cérémonie
(Lettre à Rachel)
Demain, tu sais, ils font une grande cérémonie
Pour les milliers d’enfants partis et jamais revenus
Et moi je parlerai de toi, Rachel, sans parcimonie
Je leur dirai ma peine et ma douleur continues
Je leur parlerai du hurlement des trains de minuit
Et de leurs roues qui martèlent encore les rails
Je leur parlerai de nos peurs, la nuit
De tes cheveux d’or et de tes lèvres de corail
Je leur parlerai de l’horrible silence de ton absence
Petite fleur coupée sur le quai d’une gare
Je leur dirai que sans toi la vie n’a pas de sens
Je leur dirai que sans toi souvent je m’égare
Demain, à la cérémonie, je parlerai de toi
Et tout le monde te regardera et t’écoutera
Je leur parlerai de nous deux là-bas, à Frétoy
Et personne ne sait ce qu’il m’en coûtera
Je leur parlerai de ton sourire éblouissant
De ta présence qui vit malgré le temps
Je leur dirai, petite Rachel, en frémissant
Que ta douceur me manque toujours autant.
M. A.
Avant-propos
Le souvenir transforme en rêve ce qui n’était qu’une réalité
Eugène Marbeau
Par malchance, Marcel est né quelques jours après la déclaration de la guerre la plus meurtrière, la plus sanglante, celle qui devait mettre fin à tous les conflits de la terre, l’ultime – aux dires des porte-parole des militaires et des politiciens. Pire encore, il est né de parents de confession juive et circoncis dans la clandestinité par respect des traditions.
Son père, Français de première génération, fils d’immigrés d’Europe de l’Est, a été mobilisé dès le début de la guerre, peu après la naissance de Marcel, et n’a donc pas eu l’occasion de connaître son fils. Comme nombre de ses compatriotes d’une armée en débandade, il a été rapidement fait prisonnier et a passé cinq années de sa vie dans un camp réservé aux officiers et sous-officiers, en Poméranie, l’oflag IV-B.
Sa mère, sa « maman parisienne », elle aussi Française de naissance, est restée seule dans un petit logement loué, exigu et dépourvu de confort, au quatrième étage d’un immeuble sans ascenseur dans un quartier populaire, proche des terrains vagues de l’époque, la Zone, qui démarquait Paris de Saint-Ouen. Devant assurer sa subsistance, elle s'est trouvée dans l’obligation de se séparer de son fils et de le placer, dès son plus jeune âge, en nourrice chez un couple de fermiers sans enfants, dans un charmant petit hameau de Picardie.
Employée modèle et dévouée dans une grande société qui collabore avec l’occupant, appréciée tant par ses collègues que par ses chefs, elle a subsisté tant bien que mal, faisant héroïquement face à la séparation, à la discrimination et aux privations que les autorités allemandes et françaises de l’époque lui infligent. Elle prenait son mal en patience, naïvement convaincue que cette guerre était, contrairement aux précédentes, l’affaire de militaires et de politiciens avisés, d’hommes d’État consciencieux, responsables et réfléchis, à la recherche du bien collectif, comme le proclamaient nuit et jour les médias. Ceux-ci sauraient mettre rapidement fin à un conflit qui n’aurait aucune conséquence sur des civils innocents, aux mœurs irréprochables, ne nuisant d’aucune façon à autrui.
Quant au petit Marcel, bien qu’arraché à son cadre habituel, il s’accommodait fort bien de sa vie à la campagne. Avec le temps, il avait même un peu oublié sa courte période familiale dans la capitale. Sa nouvelle vie au village fut tranquille et heureuse pendant les deux premières années, malgré la guerre qui sévissait non loin de là. Il avait de bons amis et amies de son âge avec lesquels il jouait et allait à l’école : Lina, Nicole, Jeannot, Jacques et sa chère petite Rachel pour qui il avait une particulière inclination.
Dans les champs éloignés de la ferme, les paysans du village cultivaient le blé et les pommes de terre, la luzerne aussi, qui sentait bon quand on la fauchait. Ils s’adonnaient à l’agriculture qui nourrissait les personnes et les bêtes, et à l’élevage aussi. À la ferme, deux vaches donnaient le lait, la crème et le beurre, un cochon était élevé pour la viande, les pâtés, le boudin et le saindoux. Les poules pondaient leurs œufs en toute liberté dans la remise ou dans la grange, et Marcel et les enfants se plaisaient à aller les dénicher dans chaque recoin. Ils les ramassaient tout chauds encore, et les déposaient délicatement dans un petit panier en osier qu’ils ramenaient à Maman Cécile. Il y avait également des lapins, autant compagnons de jeu que plats de prédilection.
La demeure de la famille d’accueil, située au cœur d’une vaste étendue de verdure recouverte de prairies, de bosquets, de champs et de vergers, était spacieuse, entourée d’une cour immense où vagabondaient coqs, poules et canards. Des chiens et des chats aussi passaient de la cour à la cuisine sans en être chassés par quiconque. La nourrice, maman Cécile, une paysanne chtimi de souche, corpulente, chaleureuse et avenante, au visage ridé par les années de dur labeur à la ferme et aux champs, consacrait le reste de son temps libre à la cuisine, à ses six petits pensionnaires parisiens, au clapier de la cour grouillant de vie et à la buanderie. Elle portait une affection toute particulière à ses petits Juifs qui n’avaient jamais connu autre chose que la vie bruyante et la laideur des quartiers populaires de la capitale.
Père Henri, le mari fruste de maman Cécile, un homme aux propos et aux gestes rudes comme les traits de son visage, était un vétéran de la Première Guerre mondiale que l’on dénommait familièrement la « Der des Ders », celle qui avait atteint une échelle et une intensité jusqu’alors inconnues, durant laquelle il avait été gazé à Verdun, comme des milliers de ses camarades. Depuis son retour, le cœur blasé, sans attente et sans espérance, le vieux « poilu » s’acquittait des travaux de la ferme, vêtu d’un sempiternel bleu de chauffe sale et élimé, grognant et toussant comme un damné. Il ne trouvait de réconfort que dans la boisson, debout devant le zinc du bar de madame Leroy, et dans les rencontres avec ses camarades de régiment, comme lui rescapés des tranchées.
Dans son nouveau milieu, Marcel découvrait la nature et des êtres bienveillants qui lui devinrent très rapidement familiers, un cadre pour lequel il éprouvait une affinité profonde et un rapport de connivence avec les êtres et les choses qui le faisaient s’épanouir et s’ouvrir au monde comme une fleur au printemps. Les six petits Juifs réfugiés, trois garçons et trois filles, s’étaient très vite liés d’une relation d’amitié que seuls les enfants savent cultiver grâce à l’innocence et à la naïveté caractéristiques de leur âge. Fils unique, Marcel avait trouvé dans ce petit groupe une famille chaleureuse. Maman Cécile bichonnait, couvait et protégeait les petits qu’elle considérait comme ses propres enfants, n’ayant pu en avoir elle-même.
Peu de temps après son arrivée au hameau, Marcel s’était entiché de la petite Rachel, de trois mois sa cadette, et il éprouvait à son égard un attachement et une admiration sans bornes qui allaient rester immuables dans sa mémoire d’adulte. Amis inséparables, ils jouaient ensemble ou se joignaient aux autres dans la cour, dans le jardin, dans le petit bois ou dans le grenier. Il prenait plaisir à dénouer ses nattes blondes, à respirer le parfum suave qu’exhalaient ses cheveux, cette senteur capiteuse qu’il tentera en vain de retrouver beaucoup plus tard chez d’autres amies. Souvent, les enfants s’ébattaient dans la prairie adjacente au jardin en cueillant des pissenlits pour maman Cécile qui les préparerait pour le repas de midi, ou encore s’amusaient à effeuiller des marguerites autour des ruines du vieux château, gambadant et faisant résonner dans la campagne en fête leurs cris de gamines et de gamins heureux. Pour les petits réfugiés, la maison de père Henri et de maman Cécile était un havre de paix, un petit paradis terrestre, loin de la bêtise et de la cruauté des hommes dont ils ignoraient l’existence, loin aussi de la tragédie qui était en train de se tramer autour d’eux, avec pour but de mettre fin aux rêves de Marcel, de Rachel et de leurs petits amis juifs d’ici et d’ailleurs…
Chapitre I
Maman Cécile s’essuie les mains dans son tablier, debout devant la vieille cuisinière en fonte dont la main courante en laiton est couverte de torchons blancs à carrés rouges, souillés et humides. À l’aide de son crochet dont la poignée oblongue a la forme d’un ressort, elle remet en place les rondelles sur le fourneau duquel elle vient de retirer la marmite où fume le potage. Nicole, Lina, Jeannot et Jacques qui, tout en jouant, donnaient de l’herbe aux lapins du clapier, près de la pompe, arrivent en courant et prennent place autour de la table. Sur la toile cirée, les verres se remplissent de cidre doux tiré le jour même à la cave par le père Henri qui lui préfère le gros rouge acheté à la buvette de Madame Leroy.
Tous obtempèrent d’emblée et attendent, impatients, la venue du premier plat.
Une odeur piquante et délicieuse de civet de lapin à la moutarde émane de la cocotte qui fume sur son dessous de plat et se mêle à celle de la soupe. Attiré par la voluptueuse émanation, Grisou, le vieux chat, accourt en petits bonds et miaule désespérément pour obtenir sa part. Discrètement, Marcel lui en donne un morceau sous la table, faisant en sorte de ne pas être vu par le père Henri qui le rosserait sur le champ.
Après avoir chassé d’un geste de la main les poules qui caquettent sur les marches séparant la cour de la cuisine, le père Henri lève son verre avec sa rudesse habituelle, exigeant le silence en martelant la table avec sa fourchette puis, cognant son verre avec les nôtres, il trinque tour à tour avec chacun :
Il sort de dessous la table une boîte en carton ornée d’un beau ruban rose qu’il tend à la petite Rachel qui, les yeux écarquillés, l’ouvre en gestes rapides et impatients. Une jolie poupée en celluloïd, vêtue d’une robe rose à frou-frou émerge du lit de sa cachette, se relève, ouvre les yeux et dit « maman » à la petite fille stupéfaite de ce bonheur inattendu. Contrairement à Marcel, à Lina et à Nicole, Rachel n’a pas de maman parisienne. C’est la première fois qu’on lui fête son anniversaire avec, en plus, le cadeau dont elle rêvait.
« Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères… », chantonnent maman Cécile et le père Henri, suivis en chœur par les enfants.
Rachel éclate de joie et se lève prestement pour aller embrasser le père Henri et maman Cécile.
La petite orpheline cajole et berce avec amour sa jolie Bronia. Marcel qui la considère comme une sœur partage son bonheur. Ce moment se gravera à jamais dans sa mémoire. Ce jour-là, en l’honneur de l’événement, maman Cécile a fait des gaufres, un mets dont les enfants raffolent. Ce dessert n’est confectionné qu’à l’occasion d’événements particuliers, lors de fêtes ou de visites familiales. Les bambins ne manquent jamais de se regrouper autour d’elle, observant avec avidité toutes les étapes de la préparation, depuis le mélange des ingrédients jusqu’au versement de la pâte dans les moules du gaufrier, et maman Cécile de les houspiller :
Les gaufres croustillantes et savoureuses sont bientôt saupoudrées de sucre glacé, arrosées de liqueur, puis goulûment dévorées par les petits gloutons.