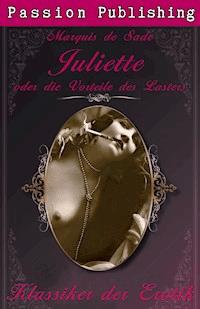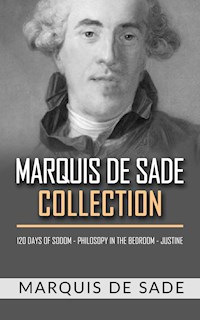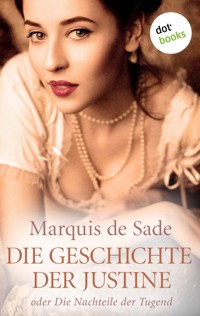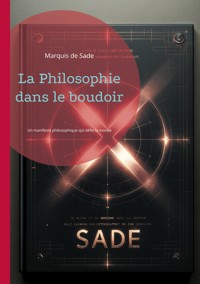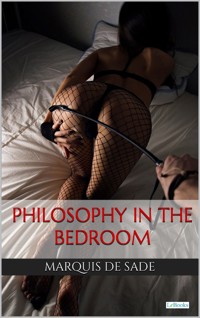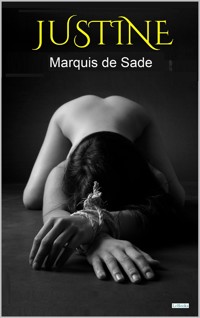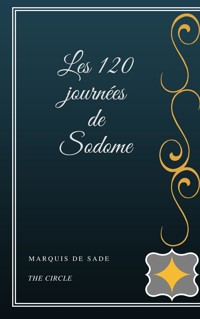Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
"Les Infortunes de la vertu est un roman sulfureux et provocateur écrit par le célèbre Marquis de Sade. Publié pour la première fois en 1787, ce livre raconte l'histoire de Justine, une jeune fille vertueuse qui se retrouve confrontée à toutes sortes de perversions et de dépravations.
Au fil des pages, le lecteur est plongé dans un univers sombre et violent, où la cruauté et la luxure règnent en maîtres. Justine, qui tente de rester fidèle à ses principes moraux, est constamment malmenée et humiliée par les personnages qui l'entourent.
Mais au-delà de son aspect choquant, Les Infortunes de la vertu est avant tout une critique acerbe de la société de l'époque. Le Marquis de Sade dénonce les hypocrisies et les injustices de son temps, et met en lumière les dérives de la morale et de la religion.
Ce livre a suscité de nombreuses controverses depuis sa publication, et a été censuré à plusieurs reprises. Mais il reste aujourd'hui un classique de la littérature érotique et une œuvre majeure de la littérature française. Les Infortunes de la vertu est un livre à la fois fascinant et dérangeant, qui ne laisse personne indifférent.
Extrait : ""Le triomphe de la philosophie serait de jeter du jour sur l'obscurité des voies dont la providence se sert pour parvenir aux fins qu'elle se propose sur l'homme, [...] la manière dont il faut qu'il interprète les décrets de cette providence sur lui, la route qu'il faut qu'il tienne pour prévenir les caprices bizarres de cette fatalité à laquelle on donne vingt noms différents, sans être encore parvenu à la définir."""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335028072
©Ligaran 2015
(1787)
Le triomphe de la philosophie serait de jeter du jour sur l’obscurité des voies dont la providence se sert pour parvenir aux fins qu’elle se propose sur l’homme, et de tracer d’après cela quelque plan de conduite qui pût faire connaître à ce malheureux individu bipède, perpétuellement ballotté par les caprices de cet être qui, dit-on, le dirige aussi despotiquement, la manière dont il faut qu’il interprète les décrets de cette providence sur lui, la route qu’il faut qu’il tienne pour prévenir les caprices bizarres de cette fatalité à laquelle on donne vingt noms différents, sans être encore parvenu à la définir.
Car si, partant de nos conventions sociales et ne s’écartant jamais du respect qu’on nous inculqua pour elles dans l’éducation, il vient malheureusement à arriver que par la perversité des autres, nous n’ayons pourtant jamais rencontré que des épines, lorsque les méchants ne cueillaient que des roses, des gens privés d’un fonds de vertu assez constaté pour se mettre au-dessus des réflexions fournies par ces tristes circonstances, ne calculeront-ils pas qu’alors il vaut mieux s’abandonner au torrent que d’y résister, ne diront-ils pas que la vertu telle belle qu’elle soit, quand malheureusement elle devient trop faible pour lutter contre le vice, devient le plus mauvais parti qu’on puisse prendre et que dans un siècle entièrement corrompu le plus sûr est de faire comme les autres ? Un peu plus instruits si l’on veut, et abusant des lumières qu’ils ont acquises, ne diront-ils pas avec l’ange Jesrad de Zadig qu’il n’y a aucun mal dont il ne naisse un bien ; n’ajouteront-ils pas à cela d’eux-mêmes que puisqu’il y a dans la constitution imparfaite de notre mauvais monde une somme de maux égale à celle du bien, il est essentiel pour le maintien de l’équilibre qu’il y ait autant de bons que de méchants, et que d’après cela il devient égal au plan général que tel ou tel soit bon ou méchant de préférence ; que si le malheur persécute la vertu, et que la prospérité accompagne presque toujours le vice, la chose étant égale aux vues de la nature, il vaut infiniment mieux prendre parti parmi les méchants qui prospèrent que parmi les vertueux qui périssent ? Il est donc important de prévenir ces sophismes dangereux de la philosophie, essentiel de faire voir que les exemples de la vertu malheureuse présentés à une âme corrompue dans laquelle il reste encore pourtant quelques bons principes, peuvent ramener cette âme au bien tout aussi sûrement que si on lui eût offert dans cette route de la vertu les palmes les plus brillantes et les plus flatteuses récompenses. Il est cruel sans doute d’avoir à peindre une foule de malheurs accablant la femme douce et sensible qui respecte le mieux la vertu, et d’une autre part la plus brillante fortune chez celle qui la méprise toute sa vie ; mais s’il naît cependant un bien de l’esquisse de ces deux tableaux, aura-t-on à se reprocher de les avoir offerts au public ? pourra-t-on former quelque remords d’avoir établi un fait, d’où il résultera pour le sage qui lit avec fruit la leçon si utile de la soumission aux ordres de la providence, une partie du développement de ses plus secrètes énigmes et l’avertissement fatal que c’est souvent pour nous ramener à nos devoirs que le ciel frappe à côté de nous les êtres qui paraissent même avoir le mieux rempli les leurs ?
Tels sont les sentiments qui nous mettent la plume à la main, et c’est en considération de leur bonne foi que nous demandons à nos lecteurs un peu d’attention mêlé d’intérêt pour les infortunes de la triste et misérable Justine.
Mme la comtesse de Lorsange était une de ces prêtresses de Vénus, dont la fortune est l’ouvrage d’une figure enchanteresse, de beaucoup d’inconduite et de fourberie, et dont les titres quelque pompeux qu’ils soient ne se trouvent que dans les archives de Cythère, forgés par l’impertinence qui les prend et soutenus par la sotte crédulité qui les donne.
Brune, fort vive, une belle taille, des yeux noirs d’une expression prodigieuse, de l’esprit et surtout cette incrédulité de mode qui, prêtant un sel de plus aux passions, fait rechercher avec bien plus de soin la femme en qui l’on la soupçonne ; elle avait reçu néanmoins la plus brillante éducation possible ; fille d’un très gros commerçant de la rue Saint-Honoré, elle avait été élevée avec une sœur plus jeune qu’elle de trois ans dans un des meilleurs couvents de Paris, où jusqu’à l’âge de quinze ans, aucun conseil, aucun maître, aucun bon livre, aucun talent ne lui avait été refusé. À cette époque fatale pour la vertu d’une jeune fille, tout lui manqua dans un seul jour. Une banqueroute affreuse précipita son père dans une situation si cruelle que tout ce qu’il put faire pour échapper au sort le plus sinistre fut de passer promptement en Angleterre, laissant ses filles à sa femme qui mourut de chagrin huit jours après le départ de son mari. Un ou deux parents qui restaient au plus délibérèrent sur ce qu’ils feraient des filles, et leur part faite se montant à environ cent écus chacune, la résolution fut de leur ouvrir la porte, de leur donner ce qui leur revenait et de les rendre maîtresses de leurs actions. Mme de Lorsange qui se nommait alors Juliette et dont le caractère et l’esprit étaient à fort peu de chose près aussi formés qu’à l’âge de trente ans, époque où elle était lors de l’anecdote que nous racontons, ne parut sensible qu’au plaisir d’être libre, sans réfléchir un instant aux cruels revers qui brisaient ses chaînes. Pour Justine, sa sœur, venant d’atteindre sa douzième année, d’un caractère sombre et mélancolique, douée d’une tendresse, d’une sensibilité surprenantes, n’ayant au lieu de l’art et de la finesse de sa sœur, qu’une ingénuité, une candeur, une bonne foi qui devaient la faire tomber dans bien des pièges, elle sentit toute l’horreur de sa position. Cette jeune fille avait une physionomie toute différente de celle de Juliette ; autant on voyait d’artifice, de manège, de coquetterie dans les traits de l’une, autant on admirait de pudeur, de délicatesse et de timidité dans l’autre. Un air de vierge, de grands yeux bleus pleins d’intérêt, une peau éblouissante, une taille fine et légère, un son de voix touchant, des dents d’ivoire et de beaux cheveux blonds, telle est l’esquisse de cette cadette charmante dont les grâces naïves et les traits délicieux sont d’une touche trop fine et trop délicate pour ne pas échapper au pinceau qui voudrait les réaliser.
On leur donna vingt-quatre heures à l’une et à l’autre pour quitter le couvent, leur laissant le soin de se pourvoir avec leurs cent écus où bon leur semblerait. Juliette, enchantée d’être sa maîtresse, voulut un moment essuyer les pleurs de Justine, mais voyant qu’elle n’y réussirait pas, elle se mit à la gronder au lieu de la consoler, elle lui dit qu’elle était une bête et qu’avec l’âge et les figures qu’elles avaient, il n’y avait point d’exemple que des filles mourussent de faim ; elle lui cita la fille d’une de leurs voisines, qui s’étant échappée de la maison paternelle, était maintenant richement entretenue par un fermier général et roulait carrosse à Paris. Justine eut horreur de ce pernicieux exemple, elle dit qu’elle aimerait mieux mourir que de le suivre et refusa décidément d’accepter un logement avec sa sœur sitôt qu’elle la vit décidée au genre de vie abominable dont Juliette lui faisait l’éloge.
Les deux sœurs se séparèrent donc sans aucune promesse de se revoir, dès que leurs intentions se trouvaient si différentes. Juliette qui allait, prétendait-elle, devenir une grande dame, consentirait-elle à revoir une petite fille défît les inclinations vertueuses et basses allaient la déshonora, et de son côté Justine voudrait-elle risquer ses mœurs dans la société d’une créature perverse qui allait devenir victime de la crapule et de la débauche publique ? Chacune chercha donc des ressources et quitta le couvent dès le lendemain ainsi que cela était convenu.
Justine caressée étant enfant par la couturière de sa mère, s’imagina que cette femme serait sensible à son sort, elle fut la trouver, elle lui raconta sa malheureuse position, lui demanda de l’ouvrage et en fut durement rejetée…
– Oh, ciel ! dit cette pauvre petite créature, faut-il que le premier pas que je fais dans le monde ne me conduise déjà qu’aux chagrins… cette femme m’aimait autrefois, pourquoi donc me repousse-t-elle aujourd’hui ?… Hélas, c’est que je suis orpheline et pauvre… c’est que je n’ai plus de ressource dans le monde et qu’on n’estime les gens qu’en raison des secours, ou des agréments que l’on s’imagine en recevoir.
Justine voyant cela fut trouver le curé de sa paroisse, elle lui demanda quelques conseils, mais le charitable ecclésiastique lui répondit équivoquement que la paroisse était surchargée, qu’il était impossible qu’elle pût avoir part aux aumônes, que cependant si elle voulait le servir, il la logerait volontiers chez lui ; mais comme en disant cela le saint homme lui avait passé la main sous le menton en lui donnant un baiser beaucoup trop mondain pour un homme d’Église, Justine qui ne l’avait que trop compris se retira fort vite, en lui disant :
– Monsieur, je ne vous demande ni l’aumône, ni une place de servante, il y a trop peu de temps que je quitte un état au-dessus de celui qui peut faire solliciter ces deux grâces, pour en être encore réduite là ; je vous demande les conseils dont ma jeunesse et mon malheur ont besoin, et vous voulez me les faire acheter par un crime…
Le curé révolté de ce terme ouvre la porte, la chasse brutalement, et Justine, deux fois repoussée dès le premier jour qu’elle est condamnée à l’isolisme, entre dans une maison où elle voit un écriteau, loue une petite chambre garnie, la paye d’avance et s’y livre tout à l’aise au chagrin que lui inspirent son état et la cruauté du peu d’individus auxquels sa malheureuse étoile l’a contrainte d’avoir affaire.
Le lecteur nous permettra de l’abandonner quelque temps dans ce réduit obscur, pour retourner à Juliette et pour lui apprendre le plus brièvement possible comment du simple état où nous la voyons sortir, elle devint en quinze ans femme titrée, possédant plus de trente mille livres de rentes, de très beaux bijoux, deux ou trois maisons tant à la campagne qu’à Paris, et pour l’instant, le cœur, la richesse et la confiance de M. de Corville, conseiller d’État, homme dans le plus grand crédit et à la veille d’entrer dans le ministère…
La route fut épineuse… on n’en doute assurément pas, c’est par l’apprentissage le plus honteux et le plus dur, que ces demoiselles-là font leur chemin, et telle est dans le lit d’un prince aujourd’hui qui porte peut-être encore sur elle les marques humiliantes de la brutalité des libertins dépravés, entre les mains desquels son début, sa jeunesse et son inexpérience la jetèrent.
En sortant du couvent, Juliette fut tout simplement trouver une femme qu’elle avait entendu nommer à cette amie de son voisinage qui s’était pervertie et dont elle avait retenu l’adresse ; elle y arrive effrontément avec son paquet sous le bras, une petite robe en désordre, la plus jolie figure du monde, et l’air bien écolière ; elle conte son histoire à cette femme, elle la supplie de la protéger comme elle a fait il y a quelques années de son ancienne amie.
– Quel âge avez-vous, mon enfant ? lui demande Mme Du Buisson.
– Quinze ans dans quelques jours, madame.
– Et jamais personne…
– Oh non, madame, je vous le jure.
– Mais c’est que quelquefois dans ces couvents un aumônier… une religieuse, une camarade… il me faut des preuves sûres.
– Il ne tient qu’à vous de vous les procurer, madame…
Et la Du Buisson, s’étant affublée d’une paire de lunettes et ayant vérifié par elle-même l’état exact des choses, dit à Juliette :
– Eh bien mon enfant, vous n’avez qu’à rester ici, beaucoup de soumission à mes conseils, un grand fonds de complaisance pour mes pratiques, de la propreté, de l’économie, de la candeur vis-à-vis de moi, de l’urbanité avec vos compagnes et de la fourberie envers les hommes, dans quelques années d’ici je vous mettrai en état de vous retirer dans une chambre avec une commode, un trumeau, une servante, et l’art que vous aurez acquis chez moi vous donnera de quoi vous procurer le reste.
La Du Buisson s’empara du petit paquet de Juliette, elle lui demanda si elle n’avait point d’argent et celle-ci ayant trop franchement avoué qu’elle avait cent écus, la chère maman s’en empara en assurant sa jeune élève qu’elle placerait ce petit fonds à son profit, mais qu’il ne fallait pas qu’une jeune fille eût d’argent… c’était un moyen de faire mal et dans un siècle aussi corrompu, une fille sage et bien née devait éviter avec soin tout ce qui pouvait la faire tomber dans quelque piège. Ce sermon fini, la nouvelle venue fut présentée à ses compagnes, on lui indiqua sa chambre dans la maison et dès le lendemain, ses prémices furent en vente ; en quatre mois de temps, la même marchandise fut successivement vendue à quatre-vingts personnes qui toutes la payèrent comme neuve, et ce fut qu’au bout de cet épineux noviciat que Juliette prit des patentes de sœur converse. De ce moment elle fut réellement reconnue comme fille de la maison et en partagea les libidineuses fatigues… autre noviciat ; si dans l’un à quelques écarts près Juliette avait servi la nature, elle en oublia les lois dans le second : des recherches criminelles, de honteux plaisirs, de sourdes et crapuleuses débauches, des goûts scandaleux et bizarres, des fantaisies humiliantes, et tout cela finit d’une part du désir de jouir sans risquer sa santé, de l’autre, d’une satiété pernicieuse qui blasant l’imagination, ne la laisse plus s’épanouir que par des excès et se rassasier que de dissolutions… Juliette corrompit entièrement ses mœurs dans cette seconde école et les triomphes qu’elle vit obtenir au vice dégradèrent totalement son âme ; elle sentit que née pour le crime, au moins devait-elle aller au grand, et renoncer à languir dans un état subalterne qui en lui faisant faire les mêmes fautes, en l’avilissant également, ne lui rapportait pas à beaucoup près le même profit. Elle plut à un vieux seigneur fort débauché qui d’abord ne l’avait fait venir que pour l’aventure d’un quart d’heure, elle eut l’art de s’en faire magnifiquement entretenir et parut enfin aux spectacles, aux promenades à côté des cordons bleus de l’ordre de Cythère ; on la regarda, on la cita, on l’envia et la friponne sut si bien s’y prendre qu’en quatre ans elle mina trois hommes, dont le plus pauvre avait cent mille écus de rentes.
Il n’en fallut pas davantage pour faire sa réputation ; l’aveuglement des gens du siècle est tel, que plus une de ces malheureuses a prouvé sa malhonnêteté, plus on est envieux d’être sur sa liste, il semble que le degré de son avilissement et de sa corruption devienne la mesure des sentiments que l’on ose afficher pour elle.
Juliette venait d’atteindre sa vingtième année lorsqu’un comte de Lorsange, gentilhomme angevin âgé d’environ quarante ans, devint si tellement épris d’elle qu’il se résolut de lui donner son nom, n’étant pas assez riche pour l’entretenir ; il lui reconnut douze mille livres de rentes, lui assura le reste de sa fortune qui allait à huit, s’il venait à mourir avant elle, lui donna une maison, des gens, une livrée, et une sorte de considération dans le monde qui parvint en deux ou trois ans à faire oublier ses débuts. Ce fut ici où la malheureuse Juliette oubliant tous les sentiments de sa naissance honnête et de sa bonne éducation, pervertie par de mauvais livres et de mauvais conseils, pressée de jouir seule, d’avoir un nom, et point de chaîne, osa se livrer à la coupable pensée d’abréger les jours de son mari… Elle la conçut et elle l’exécuta avec assez de secret malheureusement pour se mettre à l’abri des poursuites, et pour ensevelir avec cet époux qui la gênait toutes les traces de son abominable forfait.
Redevenue libre et comtesse, Mme de Lorsange reprit ses anciennes habitudes mais se croyant quelque chose dans le monde, elle y mit un peu plus de décence ; ce n’était plus une fille entretenue, c’était une riche veuve qui donnait de jolis soupers, chez laquelle la ville et la cour étaient trop heureuses d’être admises, et qui néanmoins couchait pour deux cents louis et se donnait pour cinq cents par mois. Jusqu’à vingt-six ans elle fit encore de brillantes conquêtes, mina trois ambassadeurs, quatre fermiers généraux, deux évêques et trois chevaliers des ordres du roi, et comme il est rare de s’arrêter après un premier crime surtout quand il a tourné heureusement, Juliette, la malheureuse et coupable Juliette, se noircit de deux nouveaux crimes semblables au premier, l’un pour voler un de ses amants qui lui avait confié une somme considérable que toute la famille de cet homme ignorait et que Mme de Lorsange put mettre à l’abri par ce crime odieux, l’autre pour avoir plus tôt un legs de cent mille francs qu’un de ses adorateurs avait mis sur son testament en sa faveur au nom d’un tiers qui devait rendre la somme au moyen d’une légère rétribution. À ces horreurs, Mme de Lorsange joignait deux ou trois infanticides ; la crainte de gâter sa jolie taille, le désir de cacher une double intrigue, tout lui fit prendre la résolution de se faire avorter plusieurs fois, et ces crimes ignorés comme les autres n’empêchèrent pas cette créature adroite et ambitieuse de trouver journellement de nouvelles dupes et de grossir à tout moment sa fortune tout en accumulant ses crimes. Il n’est donc malheureusement que trop vrai que la prospérité peut accompagner le crime et qu’au sein même du désordre et de la corruption la plus réfléchie, tout ce que les hommes appellent le bonheur peut dorer le fil de la vie ; mais que cette cruelle et fatale vérité n’alarme pas, que celle dont nous allons bientôt offrir l’exemple, du malheur au contraire poursuivant partout la vertu, ne tourmente pas davantage l’âme des honnêtes gens. Cette prospérité du crime n’est qu’apparente ; indépendamment de la providence qui doit nécessairement punir de tels succès, le coupable nourrit au fond de son cœur un ver qui, le rongeant sans cesse, l’empêche de jouir de cette lueur de félicité qui l’environne et ne lui laisse au lieu d’elle que le souvenir déchirant des crimes qui la lui ont acquise. À l’égard du malheur qui tourmente la vertu, l’infortuné que le sort persécute a pour consolation sa conscience, et les jouissances secrètes qu’il retire de sa pureté le dédommagent bientôt de l’injustice des hommes.
Tel était donc l’état des affaires de Mme de Lorsange lorsque M. de Corville, âgé de cinquante ans et jouissant du crédit que nous avons peint plus haut, résolut de se sacrifier entièrement pour cette femme, et de la fixer décidément à lui. Soit attention, soit procédés, soit sagesse de la part de Mme de Lorsange, il y était parvenu et il y avait quatre ans qu’il vivait avec elle absolument comme avec une épouse légitime, lorsqu’une terre superbe qu’il venait de lui acheter auprès de Montargis, les avait déterminés l’un et l’autre à y aller passer quelques mois de l’été. Un soir du mois de juin où la beauté du temps les avait engagés à venir se promener jusqu’à la ville, trop fatigués pour pouvoir retourner de la même manière, ils étaient entrés dans l’auberge où descend le coche de Lyon, à dessein d’envoyer de là un homme à cheval leur chercher une voiture au château ; ils se reposaient dans une salle basse et fraîche donnant sur la cour, lorsque le coche dont nous venons de parler entra dans la maison.
C’est un amusement naturel que de considérer des voyageurs ; il n’y a personne qui dans un moment de désœuvrement ne le remplisse par cette distraction quand elle se présente. Mme de Lorsange se leva, son amant la suivit et ils virent entrer dans l’auberge toute la société voyageuse. Il paraissait qu’il n’y avait plus personne dans la voiture lorsqu’un cavalier de maréchaussée, descendant du panier, reçut dans ses bras, d’un de ses camarades également niché dans la même place, une jeune fille d’environ vingt-six à vingt-sept ans, enveloppée dans un mauvais mantelet d’indienne et liée comme une criminelle. À un cri d’horreur et de surprise qui échappa à Mme de Lorsange la jeune fille se retourna, et laissa voir des traits si doux et si délicats, une taille si fine et si dégagée que M. de Corville et sa maîtresse ne purent s’empêcher de s’intéresser pour cette misérable créature. M. de Corville s’approche et demande à l’un des cavaliers ce qu’a fait cette infortunée.
– Ma foi, monsieur, répondit l’alguazil, on l’accuse de trois ou quatre crimes énormes, il s’agit de vol, de meurtre et d’incendie, mais je vous avoue que mon camarade et moi n’avons jamais conduit de criminel avec autant de répugnance ; c’est la créature la plus douce et qui paraît la plus honnête…
– Ah, ah, dit M. de Corville, ne pourrait-il pas y avoir là quelqu’une de ces bévues ordinaires aux tribunaux subalternes ? Et où s’est commis le délit ?
– Dans une auberge à trois lieues de Lyon, c’est Lyon qui l’a jugée, elle va à Paris pour la confirmation de la sentence, et reviendra pour être exécutée à Lyon.
Mme de Lorsange qui s’était approchée et qui entendait le récit, témoigna tout bas à M. de Corville le désir qu’elle aurait d’entendre de la bouche de cette fille l’histoire de ses malheurs et M. de Corville qui concevait aussi le même désir en fit part aux conducteurs de cette fille, en se faisant connaître à eux ; ceux-ci ne s’y opposèrent point, on décida qu’il fallait passer la nuit à Montargis, on demanda un appartement commode auprès duquel il y en eût un pour les cavaliers, M. de Corville répondit de la prisonnière, on la délia, elle passa dans l’appartement de M. de Corville et de Mme de Lorsange, les gardes soupèrent et couchèrent auprès, et quand on eut fait prendre un peu de nourriture à cette malheureuse, Mme de Lorsange qui ne pouvait s’empêcher de prendre à elle le plus vif intérêt, et qui sans doute se disait à elle-même : « Cette misérable créature peut-être innocente est traitée comme une criminelle, tandis que tout prospère autour de moi – de moi qui la suis sûrement bien plus qu’elle » – Mme de Lorsange, dis-je, dès qu’elle vit cette jeune fille un peu remise, un peu consolée des caresses qu’on lui faisait et de l’intérêt qu’on paraissait prendre à elle, l’engagea de raconter par quel évènement avec un air aussi honnête et aussi sage elle se trouvait dans une aussi funeste circonstance.
– Vous raconter l’histoire de ma vie, madame, dit cette belle infortunée en s’adressant à la comtesse, est vous offrir l’exemple le plus frappant des malheurs de l’innocence. C’est accuser la providence, c’est s’en plaindre, c’est une espèce de crime et je ne l’ose pas…
Des pleurs coulèrent alors avec abondance des yeux de cette pauvre fille, et après leur avoir donné cours un instant elle commença son récit dans ces termes.
– Vous me permettrez de cacher mon nom et ma naissance, madame, sans être illustre, elle est honnête, et je n’étais pas destinée à l’humiliation, d’où la plus grande partie de mes malheurs sont nés. Je perdis mes parents fort jeune, je crus avec le peu de secours qu’ils m’avaient laissé pouvoir attendre une place honnête et refusant constamment toutes celles qui ne l’étaient pas, je mangeai sans m’en apercevoir le peu qui m’était échu ; plus je devenais pauvre, plus j’étais méprisée ; plus j’avais besoin de secours, moins j’espérais d’en obtenir ou plus il m’en était offert d’indignes et d’ignominieux. De toutes les duretés que j’éprouvai dans cette malheureuse situation, de tous les propos horribles qui me furent tenus, je ne vous citerai que ce qui m’arriva chez M. Dubourg, l’un des plus riches traitants de la capitale. On m’avait adressée à lui comme à un des hommes dont le crédit et la richesse pouvaient le plus sûrement adoucir mon sort, mais ceux qui m’avaient donné ce conseil, ou voulaient me tromper, ou ne connaissaient pas la dureté de l’âme de cet homme et la dépravation de ses mœurs. Après avoir attendu deux heures dans son antichambre, on m’introduisit enfin ; M. Dubourg, âgé d’environ quarante-cinq ans, venait de sortir de son lit, entortillé dans une robe flottante qui cachait à peine son désordre ; on s’apprêtait à le coiffer, il fit retirer son valet de chambre et me demanda ce que je lui voulais.
– Hélas, monsieur, lui répondis-je, je suis une pauvre orpheline qui n’ai pas encore atteint l’âge de quatorze ans et qui connais déjà toutes les nuances de l’infortune. Alors je lui détaillai mes revers, la difficulté de rencontrer une place, le malheur que j’avais eu de manger le peu que je possédais pour en chercher, les refus éprouvés, la peine même que j’avais à trouver de l’ouvrage ou en boutique ou dans ma chambre, et l’espoir où j’étais qu’il me faciliterait les moyens de vivre.
Après m’avoir écoutée avec assez d’attention, M. Dubourg me demanda si j’avais toujours été sage.
– Je ne serais ni si pauvre, ni si embarrassée, monsieur, lui dis-je, si j’avais voulu cesser de l’être.
– Mon enfant, me dit-il à cela, et à quel titre prétendez-vous que l’opulence vous soulage quand vous ne lui servirez à rien ?
– Servir, monsieur, je ne demande que cela.
– Les services d’une enfant comme vous sont peu utiles dans une maison, ce n’est pas ceux-là que j’entends, vous n’êtes ni d’âge, ni de tournure à vous placer comme vous le demandez, mais vous pouvez avec un rigorisme moins ridicule prétendre à un sort honnête chez tous les libertins. Et ce n’est que là où vous devez tendre ; cette vertu dont vous faites tant étalage, ne sert à rien dans le monde, vous aurez beau en faire parade, vous ne trouverez pas un verre d’eau dessus. Des gens comme nous qui faisons tant que de faire l’aumône, c’est-à-dire une des choses où nous nous livrons le moins et qui nous répugne le plus, veulent être dédommagés de l’argent qu’ils sortent de leur poche, et qu’est-ce qu’une petite fille comme vous peut donner en acquittement de ces secours, si ce n’est l’abandon le plus entier de tout ce qu’on veut bien exiger d’elle ?
– Oh monsieur, il n’y a donc plus ni bienfaisance, ni sentiments honnêtes dans le cœur des hommes ?
– Fort peu, mon enfant, fort peu, on est revenu de cette manie d’obliger gratuitement les autres ; l’orgueil peut-être en était un instant flatté, mais comme il n’y a rien de si chimérique et de sitôt dissipé que ses jouissances, on en a voulu de plus réelles, et on a senti qu’avec une petite fille comme vous par exemple il valait infiniment mieux retirer pour finit de ses avances tous les plaisirs que le libertinage peut donner que de s’enorgueillir de lui avoir fait l’aumône.
La réputation d’un homme libéral, aumônier, généreux, ne vaut pas pour moi la plus légère sensation des plaisirs que vous pouvez me donner, moyen en quoi d’accord sur cela avec presque tous les gens de mes goûts et de mon âge, vous trouverez bon, mon enfant, que je ne vous secoure qu’en raison de votre obéissance à tout ce qu’il me plaira d’exiger de vous.
– Quelle dureté, monsieur, quelle dureté ! Croyez-vous que le ciel ne vous en punira pas ?
– Apprends, petite novice, que le ciel est la chose du monde qui nous intéresse le moins ; que ce que nous faisons sur la terre lui plaise ou non, c’est la chose du monde qui nous inquiète le moins ; trop certains de son peu de pouvoir sur les hommes, nous le bravons journellement sans frémir et nos passions n’ont vraiment de charme que quand elles transgressent le mieux ses intentions ou du moins ce que des sots nous assurent être tel, mais qui n’est dans le fond que la chaîne illusoire dont l’imposture a voulu captiver le plus fort.
– Eh monsieur, avec de tels principes, il faut donc que l’infortune périsse.
– Qu’importe ? il y a plus de sujets qu’il n’en faut en France ; le gouvernement qui voit tout en grand s’embarrasse fort peu des individus, pourvu que la machine se conserve.
– Mais croyez-vous que des enfants respectent leur père quand ils en sont maltraités ?
– Que fait à un père qui a trop d’enfants l’amour de ceux qui ne lui sont d’aucun secours ?
– Il vaudrait mieux qu’on nous eût étouffés en naissant.
– À peu près, mais laissons cette politique où tu ne dois rien comprendre. Pourquoi se plaindre du sort qu’il ne dépend que de soi de maîtriser ?
– À quel prix, juste ciel !
– À celui d’une chimère, d’une chose qui n’a de valeur que celle que votre orgueil y met… mais laissons encore là cette thèse et ne nous occupons que de ce qui nous regarde ici tous les deux. Vous faites grand cas de cette chimère, n’est-ce pas, et moi fort peu, moyen en quoi je vous l’abandonne ; les devoirs que je vous imposerai, et pour lesquels vous recevrez une rétribution honnête, sans être excessive, seront d’un tout autre genre. Je vous mettrai auprès de ma gouvernante, vous la servirez et tous les matins devant moi, tantôt cette femme et tantôt mon valet de chambre vous soumettront…
Oh madame, comment vous rendre cette exécrable proposition ? trop humiliée de me l’entendre faire, m’étourdissant pour ainsi dire, à l’instant qu’on en prononçait les mots… trop honteuse de les redire, votre bonté voudra bien y suppléer… Le cruel, il m’avait nommé les grands prêtres, et je devais servir de victime…
– Voilà tout ce que je puis pour vous, mon enfant, continua ce vilain homme en se levant avec indécence, et encore ne vous promets-je pour cette cérémonie toujours fort longue et fort épineuse, qu’un entretien de deux ans. Vous en avez quatorze ; à seize il vous sera libre de chercher fortune ailleurs, et jusque-là vous serez vêtue, nourrie et recevrez un louis par mois. C’est bien honnête, je n’en donnais pas tant à celle que vous remplacerez ; il est vrai qu’elle n’avait pas comme vous cette intacte vertu dont vous faites tant de cas, et que je prise comme vous le voyez, environ cinquante écus par an, somme excédante de celle que touchait votre devancière. Réfléchissez-y donc bien, pensez surtout à l’état de misère où je vous prends, songez que dans le malheureux pays où vous êtes, il faut que ceux qui n’ont pas de quoi vivre souffrent pour en gagner, qu’à leur exemple vous souffrirez, j’en conviens, mais que vous gagnerez beaucoup davantage que la plus grande partie d’entre eux.