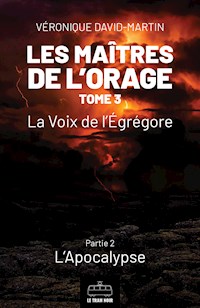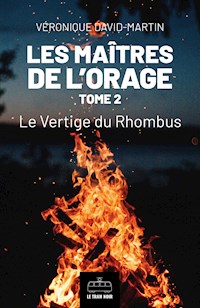
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Tram Noir
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Les Maîtres de l'orage
- Sprache: Französisch
70 ans séparent les faits décrits dans ce deuxième tome des Maîtres de l'orage. Les récentes découvertes pourraient éclairer les zones d'ombres qui entourent les aventures de Marwen sur l'Ile Verte...
Mars 1942. Anne et James de Tréharec quittent Paris sous les bombardements pour se réfugier sur l’Île Verte, siège ancestral de leur famille. Mais l’île est occupée par les Allemands, et d’étranges disparitions alimentent les pires interprétations. Pour retrouver les disparus, Anne, James et Marwen devront affronter l’abominable Rhombus.
En 2012, Arnaud de Tréharec, en vacances dans le château familial de l’Île Verte, fait la rencontre d’un jeune Allemand, Sieg, avec qui il se lie immédiatement d’amitié. Alors que de terrifiants phénomènes naturels se déchaînent sur l’île, la découverte d’un vieux cahier et de lettres jamais postées va propulser les deux garçons au centre d’événements dramatiques, fruits de ceux qu’ont vécus Anne et Marwen cinquante ans plus tôt…
Entre passé et présent, découvrez sans plus attendre le deuxième volet de la saga Les Maîtres de l'orage, dans lequel la jeune génération va devoir faire face aux événements dramatiques du passé.
EXTRAIT
— Mais c’est quoi ce truc ? s’exclama Arnaud.
Il venait d’extirper d’une gangue de boue la chose sur laquelle il avait trébuché. Il la faisait passer d’une main à l’autre en l’observant sous toutes les coutures.
On aurait dit un morceau de bois terni qui avait vaguement la forme d’une petite toupie pour enfants. Arnaud avait marché sur l’extrémité pointue et, bien que son pied ne soit pas blessé, une douleur extrême l’avait terrassé.
Il avança son doigt vers l’extrémité en pointe et à peine l’eût-il touchée qu’une décharge électrique lui fit lâcher l’objet et pousser un cri de douleur.
— C’est du délire ce truc ? Depuis quand le bois est-il devenu conducteur d’électricité ?
Les sourcils froncés, il entreprit de gratter l’objet avec une pierre. Y avait-il du métal là-dessous ? Malgré ses efforts renouvelés le bois était étonnamment résistant et la pierre ne l’entamait pas. Pourtant, malgré sa solidité, on voyait bien qu’il avait été endommagé et que sa base à l’origine était attachée à autre chose.
Arnaud fouilla la poche de son short et en sortit un mouchoir. Il le secoua pour l’ouvrir et y déposa l’objet étrange avec soin. En faisant attention à ne pas toucher son bout pointu, il l’enveloppa du mieux qu’il put puis le fourra dans sa poche, la pointe « électrique » orientée vers l’ouverture.
Il se releva, les genoux et les coudes maculés de boue. Il ne sentait ni les bleus ni les égratignures. Il ne remarquait ni le vent qui se levait, ni les grondements de l’orage tout proche. Les pieds nus dans l’herbe mouillée, les cheveux balayés par le vent, il souriait.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Entre l'Histoire, l'aventure, la science et les légendes, sans oublier le tumulte des émotions, je vous conseille vivement cette lecture pour découvrir le vertige du Rhombus… -
Du bruit dans les oreilles
À PROPOS DE L'AUTEUR
Véronique David-Martin est d’origine bretonne mais vit en Grande-Bretagne depuis une trentaine d’années. Docteure en littérature comparée, lectrice vorace depuis sa plus tendre enfance, elle se nourrit d’histoires, de mythes universels et de légendes celtiques, ainsi que de récits de famille sur la Seconde Guerre mondiale, intérêts qui l’ont évidemment inspirée dans l’écriture des Maîtres de l’orage.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 736
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Dédicace
À mon père, toujours si présent malgré son absence.
À Clara et Samuel, mes chéris : puissent-ils grandir dans la paix, loin de tous les « Rhombus » de ce monde.
À tous ceux qui, comme Rabelais, pensent que « science sans conscience n’est que ruine de l’âme ».
PREMIÈRE PARTIE L’ÎLE VERTE
Côtes-du-Nord1mars 1942
Un cahot plus violent que les autres précipita Anne de Tréharec contre le siège avant de la voiture et la réveilla en sursaut. Elle se frotta les yeux et passa ses doigts engourdis dans son épaisse chevelure brune. Combien de temps avait-elle dormi ?
Un coup d’œil par la fenêtre lui indiqua que le paysage n’avait pas changé depuis des kilomètres : des chemins étroits encastrés entre de hauts talus broussailleux qui bouchaient la vue et lui donnaient envie de vomir. Alors qu’elle tournait la tête, une toupie sombre tournoya devant ses yeux. Anne réprima à grand mal une nausée. Elle ne voyageait pas bien en voiture.
Coincée sur le siège arrière au milieu d’un amas de valises et de sacs, Anne frissonna. Il faisait froid dans la vieille Citroën qui cahotait péniblement sur la route pleine d’ornières.
– C’est un vrai parcours du combattant ! grommela le Frère Jean.
Une main sur le volant, il s’empara de ses petites lunettes à monture métallique et essaya de les astiquer contre son chandail avant de les replacer sur son nez.
– C’est ma myopie, mes lunettes, la buée dedans ou le brouillard dehors ?
– Sans doute un peu des quatre, répondit son passager, un adolescent blond dont le regard tentait lui aussi de percer le flou combiné de la condensation intérieure et de la brume extérieure.
Le Frère Jean passa une main impatiente sur la vitre devant lui.
– C’est une vraie purée de pois ! U-ne-pu-rée-de-pois, répéta-t-il plusieurs fois en appuyant sur chaque syllabe.
L’adolescent se retourna et fit un clin d’œil taquin à sa sœur. Anne se força à lui répondre par un sourire.
– Quelle heure est-il James ? demanda le Frère. Malgré ses efforts pour sembler détendu, la tension dans sa voix était presque palpable.
James se rassit face à la route et jeta un coup d’œil à sa montre.
– Presque quatre heures.
– Aïe, dit le Frère. La nuit tombe déjà.
– Vous croyez qu’ils ne vont pas nous attendre, demanda Anne en tentant, elle aussi, de masquer l’anxiété dans sa voix.
– À cette allure… commença le Frère. En plus ils ne connaissent pas la date exacte…
– Ils nous attendront, dit James.
Il se retourna à nouveau vers sa sœur et, son regard clair fixé dans le sien, il répéta tout bas : « Ils nous attendront ».
Son visage était calme et assuré.
Anne détourna les yeux. Bien qu’elle sache que son frère voulait la rassurer, le vieil énervement remontait en elle. Il ne pouvait rien lui promettre de la sorte et ferait mieux de se taire.
Elle soupira, se laissa glisser un peu sur la banquette et posa sa tête contre le dossier. Elle allait se laisser aller de nouveau au sommeil quand une ombre gigantesque et fantastique, comme un homme aux ailes déployées, apparut juste devant la voiture. Le Frère Jean freina en tournant le volant de toutes ses forces. Le véhicule fit une embardée vers la gauche puis s’arrêta net contre le rebord du chemin creux. Le rebond secoua violemment les trois passagers.
– Qu’est-ce que c’était, dit le Frère en haletant.
– On a écrasé quelqu’un, balbutia Anne les yeux dilatés d’horreur.
1 À l’époque les Côtes-d’Armor se nommaient les Côtes-du-Nord.
Île Vertejuillet 2012
Arnaud de Tréharec ne bougeait pas.
L’adolescent ne semblait remarquer ni la chaleur lourde qui avait banni toute fraîcheur du vieux grenier, ni la mouche ivre qui se heurtait en vrombissant contre la vitre brûlante. Sous la fenêtre entrouverte, qui ne rendait pas un souffle d’air mais dans la clarté de laquelle Arnaud était assis, il ne paraissait pas conscient de ce qui l’entourait.
Sa tignasse brune, retenue par une vieille épingle à cheveux de sa mère au-dessus de ses sourcils froncés, son haut front et l’espace entre son nez droit et ses lèvres remplies avaient beau être mouillés de sueur, cela le laissait indifférent. Rien, semblait-il, n’aurait pu le distraire de sa lecture passionnée.
Graduellement, la lumière intense du soleil de juillet s’atténua, tamisée par le passage d’un rideau de nuages sombres. Un grondement doux ronronna mollement dans le lointain. Ni la brise fraîche qui se glissa enfin par la lucarne du grenier, ni la porte qui claqua dans les profondeurs silencieuses de la vieille maison ne sortirent le garçon de sa transe. Seule sa main droite bougeait de temps en temps pour tourner délicatement une page jaunie du vieux cahier qui l’absorbait.
Lorsque soudain un hurlement retentit près de lui, il sursauta.
– Ce con de Bertrand ! marmonna-t-il en tendant la main vers son portable qu’il mit en haut-parleur.
– Enfin je peux t’avoir dans ton trou paumé ! dit une voix moqueuse au bout du fil. Ça fait des jours que j’essaie.
– J’avais oublié que t’avais changé ma sonnerie ! dit Arnaud. J’étais au bord de la crise cardiaque !
Un rire sardonique explosa dans le haut-parleur.
– Faut bien te réveiller de temps en temps ! Tu t’embêtes pas trop chez les culs-terreux ?
Ne serait-ce que deux jours plus tôt, Arnaud se serait lancé dans une invective contre l’Île Verte où il était forcé de passer ses vacances, loin de ses amis et loisirs favoris : à son âge, pas loin de seize ans, un véritable scandale. Mais tout avait changé si brusquement et si récemment que Bertrand semblait maintenant faire partie d’un autre monde et qu’Arnaud ne savait que lui dire.
– Ça pourrait être pire, dit-il avec un soupir.
– Waouh ! dit Bertrand. Changement massif !
– Non, commença Arnaud, c’est juste que je suis bien obligé de m’y faire… J’ai encore deux mois à tirer.
– La Gitane t’a pas encore fait tourner chèvre ?
La mention de sa mère sous son pseudo de « la Gitane » finit de le sortir de sa transe et le précipita dans la navrante réalité de sa vie. Il était convaincu que sa mère était la source de tous ses problèmes, le poison qui lui gâchait l’existence. Ce n’était pas qu’elle soit tout le temps sur son dos à lui dire que faire, mais c’était d’une façon beaucoup plus subtile qu’elle réussissait à envahir tous les aspects de sa vie sous des faux airs de complice.
– M’en parle pas ! s’exclama Arnaud. Elle me gonfle sérieusement, mais heureusement qu’elle a ses copines et leurs gosses pour l’occuper. Par contre moi, entre leurs chants tribaux du fin fond de la Papouasie et leurs mioches qu’arrêtent pas de hurler…
Bertrand éclata de rire.
– Avoue que ça te manque maintenant, mon death metal1!
Arnaud émit un gloussement sceptique.
– Et la tienne de mère, toujours aussi « pas chiante » ?
– Faut pas se plaindre, dit Bertrand d’un ton satisfait, elle est tout à fait gérable. Je l’ai bien matée. C’est mon père qui craint. Il s’est mis dans le crâne que je devais bosser cet été.
– Pour gagner de l’argent ? Veinard !
– Non, pour rattraper mon retard scolaire !
– Aïe, dit Arnaud.
– Évidemment toi, avec les notes que tu te tapes, t’as pas ce problème !
– Non, mais je suis pourtant coincé au bout du monde, sans personne, et j’ai même pas encore reçu mon VTT.
– Ben, t’es coupé de la civilisation sur ton île. Mais au moins tu peux nager ou surfer. T’es trop con si t’as pas capté ça !
– J’ai capté ! Et j’en ai bien profité depuis mon arrivée, mais au bout d’un moment…
– Ouais, je sais, j’te manque !
Le rire sardonique de Bertrand retentit à nouveau dans l’écouteur.
– C’est ça ! dit Arnaud.
– Bon, faut que je te laisse, autrement mon paternel va en faire une jaunisse quand il va voir ma note de portable.
– La Bretagne c’est pas l’Australie ! protesta Arnaud. Allez, gamin, va faire tes devoirs !
– Et toi, va bouffer ton porridge bio en écoutant tes chants de zoulous ! À plus !
Arnaud rit. La voix de Bertrand se tut et l’écran du portable s’éteignit.
Un éclair illumina l’épais couvercle de nuages noirs et un craquement grave le suivit. De grosses gouttes de pluie vinrent s’écraser sur la vitre du vasistas et une odeur de terre humide rafraîchit l’atmosphère lourde du grenier.
Arnaud frissonna.
Il serra le vieux cahier contre lui avant de le remettre dans la caisse de paperasseries où il l’avait découvert. Il laissa sa main traîner un instant sur la caisse, puis, un sourire étrange aux lèvres, il s’approcha de la lucarne entrouverte, huma l’air frais et tendit son visage vers la pluie tiède, manne généreuse descendue des profondeurs grondantes du ciel.
1 Le death metal (DM) est un sous-genre de la musique metal, caractérisé par des paroles et musiques sombres et/ou violentes, souvent chantées d’une voix gutturale et grave et parfois accompagnées de hurlements.
Côtes-du-Nordmars 1942
– Ne bougez pas d’ici, je sors ! dit le Frère Jean. Sa voix altérée en disait long sur son angoisse.
Il ouvrit la portière et un peu de l’épaisse fumée du brouillard entra dans la voiture.
– Surtout ne sortez pas, répéta-t-il en s’extirpant de son siège, ce temps est trop malsain.
Il ne mentionna pas la question qui les hantait tous les trois : avaient-ils renversé quelqu’un ? Y avait-il un blessé ou un mort sur la route ?
La portière se referma derrière lui. Un peu du froid humide et stagnant de l’extérieur transperça James et Anne de Tréharec. Anne vit son frère machinalement retenir son souffle. Inspirer du brouillard rendait malade, on le leur avait rabâché toute leur enfance. Elle eut envie d’ouvrir la fenêtre pour s’en emplir les poumons, juste par esprit de contradiction.
Sans se retourner, James allongea son bras gauche vers sa sœur. Elle ne répondit pas à son geste et au bout d’un moment il retira son bras. Le frère et la sœur restèrent ainsi, chacun enfermé dans son angoisse, sans oser parler ni regarder par la lunette arrière.
Dans la confusion qui suivait l’accident, Anne se demandait si on avait ou non ressenti un choc avant de heurter le rebord de la route. Si on avait ou non renversé l’être fantastique qui avait surgi devant la voiture. Elle aurait juré que le personnage s’était comme coupé en deux sous leurs yeux. D’un côté le corps qui s’était effondré sur la route et de l’autre les ailes qui s’étaient envolées. Impossible !
Le brouillard épaississait dehors. Le temps passait si lentement qu’il semblait à Anne que le Frère Jean était parti depuis des heures. James dut sentir la tension de sa sœur, à moins qu’il ne l’ait ressentie lui-même, car il se tourna vers elle.
– Je vais aller voir si je peux aider le Frère, dit-elle avant qu’il ne puisse prononcer un mot.
– Non ! s’exclama James. Ça pourrait être dangereux et il nous a fait promettre de rester ici.
– S’il a un problème, il aura besoin d’aide.
– C’est vrai, dit l’adolescent. J’y vais.
– Mais ta j… dit Anne.
Elle se mordit la lèvre. On ne mentionnait jamais la polio qui avait rendu son frère infirme. De remords, elle s’empara de la main de James. Elle discerna dans la pénombre qu’il lui souriait avec reconnaissance.
– Ne t’inquiète pas, dit-il, je suis tout à fait capable de me débrouiller. En plus, c’est moi l’aîné, laisse-moi y aller.
– Bien sûr ! dit Anne, essayant d’exprimer dans sa voix toute la confiance qu’elle n’avait pas en la force de son frère. Mais je pourrais moi aussi aider. Je viens avec toi !
Alors qu’ils s’apprêtaient à sortir, une forme lourde et tordue surgit du brouillard et frappa furieusement à la vitre d’Anne. Le frère et la sœur échangèrent un regard anxieux.
Un visage familier se colla presque à la glace. C’était le Frère Jean.
– Ouvrez vite et faites de la place pour un passager, dit-il.
Sans prendre le temps de réfléchir, Anne ouvrit la portière et commença à jeter les sacs qui embarrassaient l’arrière de l’auto vers les sièges avant. James les reçut comme il le pouvait. Elle eut à peine le temps de glisser le long de la banquette qu’un grand corps s’effondrait lourdement à ses côtés.
– James, passe-moi vite une couverture, dit le Frère, le visage empourpré par l’effort.
Il enveloppa le corps sans vie avec la couverture du mieux qu’il le put.
– Anne, ajouta-t-il après avoir réfléchi un instant, mieux vaudrait le pousser vers le milieu du siège et toi tu prendras la place près de la fenêtre. Il ne faut surtout pas qu’on le voie.
Au prix d’une gymnastique compliquée, Anne réussit à suivre les instructions du frère. À peine fut-elle de nouveau installée près de la vitre que la tête de l’inconnu, dodelinant sous la poussée, tomba contre l’épaule de l’adolescente. Elle essaya de distinguer ses traits mais ne put voir qu’une masse enchevêtrée de boucles d’un noir de jais.
– James, repasse-moi les sacs qu’on le cache dessous, dit le Frère Jean.
– Mais ça va l’écraser ! protesta Anne.
Elle se sentait responsable du propriétaire de la tête qui pesait sur son épaule.
– On va faire attention, dit le Frère, mais il ne faut surtout pas qu’on le trouve. Allez, vite ! On n’a pas une minute à perdre !
Anne sursauta quand elle sentit soudain quelque chose frôler sa jambe. Elle vit que la main de l’étranger avait glissé et la prit doucement pour la remettre sous la couverture. C’était une main solide, une main de pêcheur ou de paysan, dont Anne sentit la rugosité mais qui, bien qu’inanimée, était souple et tiède. L’adolescente poussa un soupir de soulagement : Dieu merci il était bien en vie !
Les bagages arrangés tant bien que mal pour dissimuler le passager sans l’étouffer, le Frère claqua la portière et reprit sa place sur le siège du conducteur.
– Une prière pour que la voiture démarre, dit-il en tirant le bouton de démarrage.
Après plusieurs essais, le moteur se mit enfin à crachoter. Le Frère dut s’épuiser au volant pour réussir à remettre la lourde voiture face à la route. Puis, le pied sur l’accélérateur, il lança l’auto à travers l’épais brouillard en direction de la côte.
Un grand oiseau blanc sortit du mur de brume qui engloutissait les talus au bord de la route et, sans un bruit, s’envola derrière la voiture.
Île Vertejuillet 2012
– Arnaud ! Arnaud ! Coucou !
– Et merde ! ronchonna Arnaud.
– Arnaud ! reprit la voix aiguë. T’es où ? On est rentrés !
Arnaud leva les yeux au ciel.
– Faudrait être sourd pour pas le savoir ! marmonna-t-il.
– Naunaud ! On est là !
« Naunaud ! » Arnaud soupira puis, l’air accablé, se leva de son lit.
On ne pouvait pas avoir une minute de tranquillité dans cette baraque ! Qu’est-ce qu’elle avait toujours à crier ? Elle ne savait pas parler comme tout le monde. Il fallait toujours qu’elle se fasse remarquer !
– Naunaud, on met la bouilloire à chauffer ! hurla la voix. Tu viens ? Mais qu’est-ce qu’il y a ma chouchoune ? Tu veux du Nutella ? Où est ta maman ? Tu ne préférerais pas le bon miel bio de Tatie Poppy ?
Typique d’elle ! Elle le dérangeait, le harcelait, l’obligeait à faire ce qu’elle voulait en l’embarrassant à mort et puis deux secondes après elle pensait déjà à autre chose et se répandait en niaiseries avec ses amies et leurs rejetons abjects. Si Arnaud avait été un chien il aurait montré ses crocs et grondé furieusement. Faute de ça, il serra les poings et, en enfilant ses tongs, laissa échapper entre ses dents un chapelet de jurons.
Il descendit les escaliers en bois sans enthousiasme. La maison était très ancienne et avait un charme lié à son âge et à la façon désuète dont elle était aménagée. Mais la mère d’Arnaud y avait déjà mis sa marque. Batiks pendus aux murs en guise de tentures, foulards indiens jetés sur les abat-jour en soie plissée du salon, bougies et porte-encens essaimés un peu partout. Arnaud détestait tout ce désordre qu’elle appelait décoration. Il aurait tellement préféré voir les meubles anciens, les peintures de marine et les objets précieux, ramenés par ses ancêtres de leurs voyages au long-court, dans la simplicité qui était la leur et qui était leur plus belle parure.
Il arriva à la porte de la cuisine et évita de justesse un enfant qui courait et lui aurait donné un coup de tête dans le ventre.
– Hé ! s’exclama-t-il. Fais gaffe où tu vas !
L’enfant ne fit pas attention à lui et continua sa course folle, tel un taureau, le front en avant.
– Naunaud darling te voilà ! dit sa mère en levant un instant la tête du monceau de tartines qu’elle était en train de beurrer. Sers-toi chouchou !
Arnaud ne supportait plus la façon qu’elle avait d’affubler ses proches (et lui, son fils unique, en particulier) de sobriquets ridicules. Et ce tic qu’elle avait de mettre de l’anglais partout. Tout en elle était faux même son nom. Elle s’appelait banalement Patricia mais se faisait appeler Poppy.
Arnaud grommela un remerciement et attrapa deux tartines avant de sortir dans le jardin.
Sur le pas de la porte, il s’arrêta pour inspirer l’air frais saturé d’humidité. Ça sentait le vert et la pureté. Il avança sur la pelouse et ses orteils se rétractèrent dans ses tongs au contact de l’herbe trempée. En colère avec lui-même pour cette réaction d’enfant des villes, il les força non seulement à se détendre mais aussi à apprécier la fraîcheur humide.
Les enfants des amies de sa mère hurlaient en se poursuivant dans le jardin (le plus vieux ne pouvait pas avoir plus de dix ans). Arnaud décida de partir se perdre dans le parc du domaine pour être tranquille et continuer à réfléchir à ce qu’il venait de découvrir dans le cahier jauni du grenier.
Il dut marcher un bon moment avant de trouver un coin suffisamment isolé pour ne plus entendre les éclats de voix venus de la maison.
Les arbres ancestraux l’entouraient de leur épaisse coupole sombre : peut-être avaient-ils connu l’auteure mystérieuse du journal qu’il avait trouvé. Quel âge aurait-elle aujourd’hui ? Treize ans en 1940… Elle serait hyper vieille ! L’âge de Mamicé, la mère de son père. Arnaud se demanda si sa grand-mère avait connu la fille du cahier. Il aurait bien du mal à le lui demander car elle était à l’hôpital à Paris, « entre la vie et la mort ».
Quand un jour son père était rentré l’air assombri et lui avait annoncé que sa grand-mère avait eu une attaque, cela ne lui avait fait ni chaud ni froid. Il la connaissait à peine. Poppy, sa mère, et elle ne s’aimaient pas. Poppy trouvait sa belle-mère trop froide et raide, et Mamicé avait donc été rayée des listes.
Quand il était petit il allait parfois la voir avec son père, mais ça faisait des années que son père y allait tout seul. Il se souvenait d’elle comme d’une dame distinguée et peut-être un peu raide. Mais elle avait un sourire très jeune et il l’avait toujours trouvée plutôt jolie. Son grand-père était mort avant sa naissance et il ne savait pas grand-chose sur lui. Il ne s’était à vrai dire jamais posé de questions à leur sujet.
Sans s’en rendre compte il avait marché jusqu’à l’étang. Des ajoncs bordaient l’eau stagnante et emplissaient l’air de leur parfum sucré. En fermant les yeux on se serait cru dans un pays exotique tant leur parfum rappelait celui de la noix de coco.
Arnaud trouva un endroit où les bords de l’étang étaient dégagés. Il s’assit sur une souche de chêne et commença à mâcher son pain en rêvassant.
Une brume perlée montait de la surface de l’eau et il crut voir une silhouette se former dans le flou. C’était la forme gracile d’une fillette de treize ans, à genoux dans une barque. Elle était habillée d’une robe chasuble démodée et ses cheveux entouraient son visage de deux tresses dorées.
Il écarquilla les yeux et la vision s’évanouit. Un grondement sourd résonna dans le lointain. Il allait repleuvoir.
Arnaud secoua la tête pour chasser l’hallucination, se leva et décida de rentrer. Ses tongs lui collaient aux pieds et il se déchaussa pour marcher pieds-nus dans l’herbe mouillée. Il ne put faire que quelques mètres avant qu’une douleur aiguë ne lui arrache un cri d’angoisse. Sur quoi avait-il marché ?
La douleur lui plomba la tête et il tomba de tout son long.
Côtes-du-Nordmars 1942
– Quelle heure est-il ? demanda le Frère Jean en frottant pour la énième fois sa manche contre le pare-brise embué.
James de Tréharec essaya d’interroger le cadran de sa montre.
– Je n’y vois rien, dit-il. Il fait trop sombre.
Le Frère fouilla d’une main dans la poche de son cardigan et lui passa un briquet.
– Je voulais arrêter de fumer à partir du Carême, expliqua-t-il, mais je n’ai pas réussi à m’y tenir après Pâques.
James alluma le briquet et l’approcha de son poignet. La flamme vacillante illumina son visage sérieux.
– Presque cinq heures et demie.
La flamme s’éteignit. Le Frère étouffa un juron.
– Ça va être juste… dit-il.
James lui redonna son briquet.
– Non, garde-le, dit le Frère. Je n’ai pas fini de te demander l’heure. Ça va derrière ?
– Très bien ! dit Anne.
Sa voix était tellement claire et positive qu’elle la fit sursauter. Elle se sentait lasse et inquiète, si différente de cette voix forte et assurée. Elle savait que le dernier bateau (celui qu’ils devaient prendre) quittait la côte à six heures et demie. Elle savait aussi que leur Ausweis ne leur garantissait la sécurité que pour cette traversée.
Manquer le bateau signifiait, au mieux, devoir attendre toute la nuit dans la voiture glacée. Puis, le lendemain, passer de longues heures à la Kommandantur la plus proche pour essayer de convaincre les boches, ou les Français qui travaillaient pour eux, de changer la date sur leurs papiers. Au pire… elle ne voulait même pas y penser.
Un froid humide pénétrait par tous les interstices de la voiture : le brouillard se glissait dans les espaces entre les portes et la carrosserie, par les côtés des fenêtres pourtant fermées. Anne grelottait, si bien que l’inconnu, toujours inconscient à ses côtés, lui apportait une chaleur dont elle lui était reconnaissante.
Qui était-il ? Enseveli sous les sacs et dissimulé sous la couverture, il était invisible à part sa tête bouclée qui bringuebalait contre l’épaule de la jeune fille. Sa chevelure épaisse exsudait une odeur forte et musquée. Anne détourna la tête. D’habitude une odeur aussi robuste, surtout en voiture, lui aurait donné la nausée. Mais pas là : sans doute à cause du stress, elle ne se sentait plus du tout malade. Par contre, elle était gênée de cette intimité forcée avec l’étranger dans l’ombre du fond de la voiture.
Elle devinait qu’il était sans papier et que c’était la raison pour laquelle le Frère voulait le cacher. Mais qu’allait-on en faire ? S’il était évanoui et blessé, que ce soit ou non à cause de l’accident, on ne pouvait pas juste l’abandonner.
On n’aurait jamais le temps de trouver quelqu’un de sûr à qui le confier. En plus, on ne pouvait plus avoir confiance en grand monde. Les boches avaient envahi la France presque deux ans plus tôt et la plupart des Français voulaient se préserver en se faisant oublier de l’occupant. Certains étaient même prêts à travailler pour et avec les Allemands, à collaborer – même si c’était contre des voisins, de la famille ou des amis.
Il fallait se méfier, ne se confier à personne, parler bas, chuchoter. Survivre était devenu quelque chose de précieux mais aussi de très compliqué.
Le Frère Jean freina brusquement. La tête du passager clandestin quitta l’appui de l’épaule d’Anne et bascula de l’autre côté.
– Pardon, j’ai cru voir quelque chose devant la voiture, dit-il. Cet accident m’a rendu nerveux. James, quelle heure est-il ?
James ralluma le briquet et consulta sa montre.
– Presque six heures.
– Je n’ai aucune idée de l’endroit où nous sommes, dit le Frère. Avec cette purée de pois et le crépuscule…
James se retourna vers sa sœur et étudia son visage à la lueur du briquet.
– Ça va, Nanou ?
Anne hocha la tête.
– Et lui ? dit James en dirigeant son briquet vers l’inconnu.
Anne se pencha vers le passager et délicatement lui prit la tête pour la ramener vers elle. À la lumière vacillante de la petite flamme, James et elle virent que malgré sa grande taille, l’étranger était un adolescent. Son visage était barbouillé de crasse et un foulard rouge sang lui entourait le cou.
Anne et son frère échangèrent un regard lourd de sens, puis James lui fit un sourire qui se voulait rassurant, éteignit le briquet et se retourna sans un mot.
Île Verte2012
– Mais c’est quoi ce truc ? s’exclama Arnaud.
Il venait d’extirper d’une gangue de boue la chose sur laquelle il avait trébuché. Il la faisait passer d’une main à l’autre en l’observant sous toutes les coutures.
On aurait dit un morceau de bois terni qui avait vaguement la forme d’une petite toupie pour enfants. Arnaud avait marché sur l’extrémité pointue et, bien que son pied ne soit pas blessé, une douleur extrême l’avait terrassé.
Il avança son doigt vers l’extrémité en pointe et à peine l’eût-il touchée qu’une décharge électrique lui fit lâcher l’objet et pousser un cri de douleur.
– C’est du délire ce truc ? Depuis quand le bois est-il devenu conducteur d’électricité ?
Les sourcils froncés, il entreprit de gratter l’objet avec une pierre. Y avait-il du métal là-dessous ? Malgré ses efforts renouvelés le bois était étonnamment résistant et la pierre ne l’entamait pas. Pourtant, malgré sa solidité, on voyait bien qu’il avait été endommagé et que sa base à l’origine était attachée à autre chose.
Arnaud fouilla la poche de son short et en sortit un mouchoir. Il le secoua pour l’ouvrir et y déposa l’objet étrange avec soin. En faisant attention à ne pas toucher son bout pointu, il l’enveloppa du mieux qu’il put puis le fourra dans sa poche, la pointe « électrique » orientée vers l’ouverture.
Il se releva, les genoux et les coudes maculés de boue. Il ne sentait ni les bleus ni les égratignures. Il ne remarquait ni le vent qui se levait, ni les grondements de l’orage tout proche. Les pieds nus dans l’herbe mouillée, les cheveux balayés par le vent, il souriait.
Son regard se posa sur l’étang étouffé de brume. La petite fille n’était pas reparue. Qui était-elle ? Une hallucination due au brouillard ? Un fantôme ? Était-ce celle qui lui envahissait la tête depuis qu’il avait eu entre les mains le cahier ancien aux pages jaunies ?
Un pan de brouillard se releva et Arnaud crut voir sur l’autre rive un grand cerf blanc qui le regardait. L’animal resplendissait et ses contours étaient flous, comme mangés de brume. Ses yeux étaient larges, sombres et graves. Ils communiquaient à Arnaud un message familier mais que pour l’instant le garçon ne comprenait pas.
Puis, comme s’il avait entendu un bruit dans les frondaisons qui l’entourait, le grand cerf détourna la tête et en un saut disparut dans les fourrés. Si la rencontre n’avait pas été aussi intense, Arnaud aurait pu croire qu’il avait rêvé.
Une cloche retentit dans le lointain. C’était sa mère qui sonnait pour le dîner. Arnaud, sans hâte, reprit la direction de la maison.
Un sentiment profond l’habitait. Sa vie allait changer. Il en était persuadé. Il lui semblait qu’il avait attendu ce moment depuis toujours, même si jusqu’alors il n’en savait rien.
Côtes-du-Nord1942
Anne sentait les boucles noires contre sa joue, leur odeur forte dans ses narines et le poids de cette tête inconsciente contre son cou. Sa gêne avait disparu. Il ne restait en elle que de l’inquiétude et de la compassion. Dieu savait ce que le malheureux à côté d’elle avait déjà dû endurer.
Elle comprenait maintenant pourquoi le Frère Jean avait voulu le cacher au fond de l’automobile. Le garçon était non seulement sans papiers mais, plus grave encore, il était gitan. Depuis 1940 un édit promulgué par l’occupant exigeait que tous les nomades soient dénoncés, arrêtés et envoyés dans des camps.
Anne se souvenait parfaitement du soir où elle avait appris ce que ça signifiait. À l’époque, elle était encore une enfant, insouciante, égoïste et espiègle. Les Allemands étaient à Paris, mais sa vie avait continué sans grands changements. École, amis, leçons de danse et d’équitation…
Le soir en question, son père était rentré chez eux l’air particulièrement sombre. Il avait convoqué ses enfants dans le salon et leur avait raconté qu’il venait d’assister à une rafle1 de tziganes par des SS2.
– On ne les reverra pas, conclut-il. Comme les Juifs, ces malheureux disparaissent dans des camps à jamais.
– Pourquoi sont-ils arrêtés, avait-elle demandé, ils ont fait quelque chose de mal ? Marie-O à l’école dit qu’ils sont sales et qu’ils volent.
James lui avait lancé un regard peu amène.
– Ils n’ont rien fait de mal, avait dit son père. Ils sont persécutés juste parce qu’ils sont différents. Et même plus, juste parce qu’ils ne correspondent pas à ce que les Allemands ont décrété être la norme. C’est comme si du jour au lendemain on décidait que les personnes qui ont un gros nez doivent disparaître.
Anne avait éclaté de rire.
– Madame Sabonaire aurait disparu depuis longtemps !
James cette fois-ci la regarda avec désapprobation.
– Ce n’est pas drôle, Anne ! dit-il.
Anne avait levé les yeux au ciel. James était toujours si raisonnable, si parfait… si ennuyeux ! Elle ne connaissait ni Juifs, ni Tziganes. En quoi tout cela la concernait-elle ?
– Ton frère a raison, avait dit M. de Tréharec. Cela nous concerne tous. Par exemple, imagine si les Allemands décidaient que les personnes handicapées doivent être supprimées.
– Ça me ferait des vacances ! dit-elle en riant.
M. de Tréharec la regardait sans sourire.
– Ou s’ils décidaient, continua-t-il, que tous les gens aux cheveux bruns doivent être supprimés…
Machinalement Anne avait mis sa main à ses cheveux. Puis elle avait regardé son père et son frère avec horreur.
– Ce n’est pas vrai ? avait-elle demandé. Dis Papa, ce n’est pas vrai ?
Elle s’attendait à ce que son père la rassure mais il ne le fit pas.
– Je n’en sais rien, avait-il dit, l’air soudain accablé. Rien n’est impossible.
Anne, atterrée, s’était tournée vers son frère. Il semblait absorbé par la contemplation de ses mains.
– Ce que je veux dire, avait conclu leur père, c’est que plus rien n’est anodin. Il faut devenir vigilant et réfléchir avant de parler. Les Gitans, les Juifs, les communistes… Tous ceux qui dérangent les nazis sont ou vont être en danger. C’est déjà comme ça en Allemagne depuis des années.
Il avait pris une cigarette dans son étui et après l’avoir tapotée sur le dos de sa main l’avait portée à ses lèvres pour l’allumer. La petite flamme de l’allumette avait fait danser une étincelle dans ses prunelles.
Pour une raison inconnue, Anne se souvenait très clairement de cette étincelle. Une odeur chaude avait envahi la pièce. M. de Tréharec avait aspiré la fumée, puis, en l’exhalant, il avait déposé sa cigarette allumée sur le rebord du cendrier.
Alors, il les avait regardés. Il s’était concentré sur eux avec une telle intensité qu’Anne avait compris que ce qu’il allait leur dire était de la plus haute importance.
– Jamais, vous m’entendez bien les enfants, avait-il dit en insistant sur chaque syllabe, ne vous laissez entraîner à faire partie d’une telle aberration. Ne vous laissez jamais aller à vous moquer, à médire et encore moins à dénoncer quelqu’un, même si votre sécurité ou votre vie en dépendent.
Un cri de détresse s’était élevé de la porte du salon. Mme de Tréharec était entrée, le visage couleur de cendre.
– Ne leur dîtes pas ça mon ami, avait-elle dit. Ils sont encore des enfants. Trop jeunes pour déjà parler d’héroïsme et de sacrifice.
M. de Tréharec s’était levé et avait entouré sa femme de ses bras.
– Il n’y a plus d’enfance, ma chère, ni de jeunesse depuis que les Allemands sont arrivés. Il n’y a plus que des gens de bonne volonté et des traîtres. Je veux que nos enfants ne fassent jamais partie de ces derniers.
Deux ans avaient passé depuis cette scène.
Bien sûr, ils avaient connu l’angoisse, l’inconfort et la faim, mais c’était la première fois qu’ils se trouvaient réellement en danger et les paroles de son père résonnaient haut et fort dans la mémoire d’Anne.
Le garçon à ses côtés, si seul et si fragile, les boches n’en feraient qu’une bouchée. Les dangers qu’il courait étaient palpables. De même, ceux que le Frère Jean, James et elle couraient à le cacher.
Partout en France on parlait à voix basse d’exécutions sommaires, de rafles et de camps de concentration. Les gens vivaient dans la peur, dans la crainte d’une dénonciation, d’un réveil forcé au milieu de la nuit, d’une arrestation par la Gestapo – la police secrète allemande.
Certains Français avaient pourtant le courage de se rebeller et avait formé ce qu’on appelait la Résistance. Leur courage était notoire mais leur folie aussi.
Certains les vénéraient comme des héros de l’ombre qui permettaient à l’esprit de la France libre d’exister sous la botte allemande. D’autres les maudissaient car leurs identités cachées signifiaient souvent que pour chaque acte de sabotage contre l’occupant, des victimes innocentes étaient sélectionnées à leur place et assassinées en représailles.
Anne avait le cœur qui battait fort dans sa poitrine. La peur lui serrait la gorge mais une excitation montait aussi en elle. Cela faisait deux ans qu’elle avait l’impression d’assister à la guerre, à l’Occupation. Comme une enfant on l’avait protégée, on lui avait tu de lourds secrets.
Mais soudain, dans le désordre de leur fuite de Paris, tout avait changé. Soudain elle rentrait dans le vif de la guerre. Elle avait peur. Elle se sentait vivre. Elle participait.
Le Frère Jean en recueillant le garçon avait réagi en homme de bonne volonté. James et elle espéraient qu’ils sauraient se montrer à sa hauteur.
Alors qu’Anne sur la banquette arrière oscillait entre l’angoisse et l’excitation, le Frère Jean freina de nouveau en jurant entre ses dents.
Devant eux, émergeant du brouillard un peu plus loin, des lumières, des barrières et des soldats allemands.
– Un barrage ! murmura James.
Le cœur d’Anne sembla s’arrêter.
***
Le Frère Jean ralentit.
– Pas de panique, siffla-t-il. James donne-moi nos papiers et surtout ne te retourne pas… Anne…
Visiblement le Frère réfléchissait à ce qu’il allait lui dire. Anne était tendue dans l’attente de ce qu’elle allait devoir faire.
– Je suis vraiment désolé de vous avoir mis tous les deux dans cette situation, commença-t-il, mais maintenant que nous y sommes, nous devons faire face ensemble. Si notre passager était découvert, surtout laissez-moi parler. Vous plaidez l’ignorance. Tout est de ma faute.
James allait dire quelque chose mais le Frère l’arrêta. Sa voix autoritaire ne souffrait aucune discussion.
– Merci mon garçon, mais ce que je dis ici fait figure de loi. Nous n’avons pas le temps de débattre. Anne, pousse-le loin de toi et couvre-le avec tout ce que tu trouves. Vite !
Anne repoussa doucement l’inconnu et couvrit son visage avec la couverture.
– Vite ! répéta le Frère. Même s’il a quelques bleus, il s’en remettra.
Anne empila sacs et valises sur leur passager. Son évanouissement était si profond qu’il n’émit pas un son.
– Bon, on respire un bon coup, dit le Frère en arrêtant l’automobile au barrage, et on reste calme.
Un soldat allemand s’approcha de la fenêtre du frère et lui fit signe d’ouvrir.
– Papiere, bitte ! dit-il, son visage noyé dans l’ombre de son casque.
Le Frère les lui donna. L’Allemand les étudia à la lueur de sa torche électrique.
Pour chaque carte d’identité il dirigeait le rayon de sa lampe sur le visage du passager correspondant. La dernière carte était celle d’Anne.
Le rayon chercha l’obscurité du fond de la voiture, s’égara un instant dans les sacs et valises, avant de s’arrêter sur le visage de l’adolescente.
– Ça fa pas la petite cheune-fille ? demanda l’Allemand avec un fort accent guttural.
Le Frère Jean se retourna vers Anne et la regarda avec inquiétude.
– Ça va, dit Anne avec difficulté, juste un peu malade en voiture.
– Tu feux prendre l’air ? dit l’Allemand.
Le regard du frère disait non. Anne se força à sourire.
– Non merci, je préfère rester dans la voiture.
– C’est tous ces falises, dit l’Allemand, ça écrase le pauvre petit Mädchen. Sors et je fais t’aider à bien mettre tout ça.
Un frisson d’angoisse parcourut Anne. S’il touchait aux valises, il trouverait leur passager clandestin.
– Non, dit-elle avec un aplomb qui l’étonna, vous êtes gentil mais je suis bien comme ça. J’ai… j’ai eu la polio et mes jambes sont paralysées. Les valises sont là pour me soutenir.
L’Allemand eu un léger mouvement de recul comme si elle avait été contagieuse. Machinalement il remonta le rayon de sa lampe et elle put voir ses traits dans la lueur jaunâtre. Il n’avait pas l’air bien méchant, mais avec les boches on ne savait jamais.
– Ach, dit-il, c’est bon.
Profitant du désarroi de l’Allemand, Anne dénoua son écharpe et la déposa sur un sac à ses côtés.
– Fous allez où ? demanda le soldat en fixant à nouveau son attention et sa torche sur le Frère Jean.
Anne ferma les yeux et étouffa un soupir de soulagement. Le boche n’avait rien vu ! Dès qu’il avait dirigé le rayon de sa torche vers le fond de la voiture, elle avait remarqué avec horreur qu’une des mains de leur passager secret avait glissé hors de la couverture. Heureusement, grâce à son écharpe, elle avait pu le cacher à temps.
– L’Île Verte, dit le Frère. Les enfants y ont de la famille et je suis leur précepteur.
– Ausweis, demanda l’Allemand.
Le Frère le lui donna. Sa main tremblait à peine. Il fallait le connaître comme James et Anne pour remarquer cet infime frémissement.
L’Allemand étudia le laisser-passer avec attention.
– Fous fenez de Paris ?
– Oui, les parents des enfants y vivent, mais ils viennent chez leur grand-mère pour leur santé.
– Tous les deux sont malades ? demanda l’Allemand en les regardant avec un mélange de pitié et de crainte.
– Oui, dit le Frère, mais l’air de la mer va leur faire du bien.
– Bon, fous pouvez y aller, dit le soldat en rendant au frère leurs papiers, mais faites vite car fous allez manquer le bateau.
Le Frère remonta sa vitre. Il remettait à peine le moteur en marche que l’Allemand refrappa à sa fenêtre. Une vague de peur glacée passa sur les trois passagers de l’auto.
– Fous afez eu un accident ? dit le soldat. Le defant de fotre foiture est tout… eingebeult.
– Embouti ? suggéra le Frère.
Le soldat hocha la tête.
– C’est le brouillard, dit le Frère, on n’y voit rien. Je suis rentré dans un talus en voulant éviter un sanglier !
– Un quoi ? demanda l’Allemand.
Le Frère cherchait visiblement une autre explication possible quand James s’exclama :
– Ein Wildschwein !
– Ja wohl ! dit l’Allemand visiblement impressionné. Wildschweine gibt es überall !
Puis il lança en direction de James quelque chose qui devait être une plaisanterie car il éclata d’un rire gras. James rit aussi, puis l’Allemand leur fit signe de partir.
– Allez ! dit-il. Schnell ! Schnell !
Le moteur toussota puis se tut. Le Frère s’y reprit à plusieurs fois. En vain. L’Allemand appela des collègues. Anne sentait une sueur froide lui couler dans le cou et le dos.
Après une discussion animée en allemand, les soldats déposèrent leurs fusils et se mirent à pousser l’automobile. Quelques soubresauts et faux départs plus tard, le moteur enfin démarra.
Le Frère rouvrit sa fenêtre pour faire un signe de remerciement. Les soldats reprirent leurs armes et leurs postes. L’Allemand qui les avait interrogés les regarda s’éloigner. Anne craignait qu’il ne les rappelle ou ne saute sur sa moto pour les rattraper et exiger une fouille de la voiture.
Les trois passagers n’osèrent respirer que lorsque les lumières du barrage eurent disparu derrière eux.
– Ce que peuvent accomplir la jeunesse, un joli minois et la peur de la maladie, dit le Frère. Bravo les enfants ! Je suis vraiment fier de vous. Quant à toi James, ton allemand m’a impressionné. Où as-tu appris à le parler si bien ?
– À Paris, hélas… Mais je préfère de loin l’anglais !
– Nous préférons tous l’anglais ! dit le Frère jovialement.
Le soulagement d’avoir traversé le barrage sans encombre leur donnait un regain d’optimisme.
James se retourna vers sa sœur.
– Entre nous, heureusement qu’il n’a pas demandé ce qu’était ma maladie.
– En effet, dit le Frère en prenant une voix germanisée : « Un seul membre d’une même famille qui perd l’usage de ses jambes, c’est infortuné ; mais deux membres de la même famille, ça fait… eingebeult ! »3
– Pauvre Oscar Wilde ! pouffa James.
Le Frère et lui s’esclaffaient.
Encore une de leurs plaisanteries que personne ne comprenait ! Anne leva les yeux au ciel.
– C’est la première chose qui m’est venue à l’idée, dit-elle. Quand on veut bien mentir, il faut parler de ce qu’on connaît. Et ça a très bien fait l’affaire !
– Elle a réponse à tout, dit James d’un ton taquin.
– Et c’est heureux ! dit le Frère. Mais attention quand on sera arrivés ! Plus de mensonges et plus d’impertinence !
James et le Frère Jean riaient à ses dépens. Anne pinça sa petite bouche avec dépit et rétorqua :
– Ne parlez pas si fort, vous allez le réveiller.
Mais le passager clandestin n’avait pas bougé, enfoui dans une inconscience profonde.
– Je m’inquiète un peu, balbutia Anne. Ça fait quand même longtemps qu’il est évanoui.
Ses compagnons qui riaient toujours ne l’entendirent pas.
– Il va falloir penser à ce qu’on va faire de lui, dit-elle plus fort.
Les rires s’interrompirent et un silence lourd se fit dans la voiture.
Le brouillard avait englouti l’automobile et ses quatre occupants, en route vers un bateau qui les attendrait ou ne les attendrait pas.
Un grand oiseau blanc sortit alors des talus et s’élança à leur poursuite.
1 Une arrestation en masse.
2 Abréviation de Schutzstaffel, l’armée allemande nazie.
3 Imitation humoristique d’une citation du grand écrivain anglais, Oscar Wilde : « Perdre un parent est malchanceux ; en perdre deux est négligent ! » (The Importance of Being Earnest, 1895)
Île Verte2012
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
Daß ich so traurig bin,
Ein Märchen aus uralten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.
Die Luft ist kühl und es dunkelt,
Und ruhig fließt der Rhein ;
Der Gipfel des Berges funkelt,
Im Abendsonnenschein.
Le chant s’éteignit dans les roulements de tonnerre qui annonçaient l’orage. La voix qui entonnait la douce mélodie était chaude et belle. Une voix jeune et forte mais comme enrobée de velours. Arnaud pensa à une dragée, dure et savoureuse à l’intérieur mais lisse et sucrée au dehors.
Sa curiosité piquée, il voulait savoir d’où venait le chant. Il eut à peine le temps d’entrevoir une tente entre les arbres du bois qu’une pluie drue se mit à tomber. Un écran d’eau entre lui et le campement ainsi que l’appel maintenant urgent de la cloche du dîner lui firent prendre ses jambes à son cou pour rejoindre la maison.
Trempé, Arnaud s’ébroua dans la cuisine comme un jeune chien. Il enleva son tee-shirt et se sécha les cheveux avec. Sa mère et ses amies s’exclamèrent.
– Va te sécher ailleurs ! s’écria la Gitane. Quelle idée de sortir sans K-way avec le temps qu’il fait !
Arnaud attrapa un quignon de pain au passage et sortit en riant. Une ou deux des amies de sa mère le suivirent du regard avec intérêt.
– Il grandit ton fils… dit l’une d’elle.
Arnaud, inconscient de l’effet qu’il avait eu, monta les escaliers quatre à quatre pour aller se changer dans son grenier. Il y avait emménagé depuis que la maison était devenue un refugium pour bobos trentenaires accompagnées de leurs tribus de marmots. C’est grâce à ce déménagement qu’il avait découvert le journal extraordinaire qui l’avait transporté dans un monde qu’il préférait nettement au sien. Un monde sombre et dangereux. Mystérieux. Où le courage d’une très jeune fille, ses doutes et ses angoisses, l’avaient complètement tourneboulé.
Ses cheveux retenu en arrière par un élastique, un tee-shirt sec sur le dos, Arnaud dégringola l’escalier de bois pour le dîner. Il était affamé.
Avec étonnement, il vit que son assiette avait été transportée de la table piaillante des enfants à celle des adultes. Il en fut touché mais aussi légèrement mal à l’aise. Allait-il devoir faire la conversation à toutes ses dames ?
– On avait besoin de Yang à cette table ! dit l’une d’elles en tirant une chaise vers lui.
– Trop de Yin n’est pas un signe d’équilibre, ajouta une autre.
Il ne connaissait pas leurs noms et avait du mal à les différencier les unes des autres. Il leur sourit poliment et s’assit à sa place.
Une assiette de pâtes fumantes fut placée devant lui et il s’y attaqua avec enthousiasme.
– Ça fait plaisir de voir un tel appétit ! dit une des femmes.
Il sentit soudain que tous leurs regards étaient sur lui. Il s’arrêta de manger en pleine ascension de sa fourchette vers sa bouche et se sentit rougir violemment.
– Quel amour ! susurra une femme. Pourquoi les hommes ne gardent-ils pas cette merveilleuse candeur ?
– C’est une des tragédies de la vie, darling ! rétorqua la Gitane. On a le choix entre l’argent ou la candeur. On ne peut pas avoir les deux.
Arnaud décida de continuer à manger en prétendant que rien de ce qui se disait ne le concernait. Il avait passé l’âge de voir des femmes s’extasier devant lui comme s’il était un petit enfant. Et pourtant, il sentait un malaise planer sur lui qui n’avait rien à voir avec l’enfance. Qu’elles s’occupent de leurs gosses, de leurs herbes et de leurs méditations et qu’elles lui fichent la paix !
Dès qu’il eut fini son assiette, il attrapa une pomme et se leva de table. L’avantage avec la Gitane, c’est qu’à cause de ses vues libérales, elle n’insistait pas pour qu’on reste attablé pendant des heures. Les femmes étaient passées à d’autres sujets de conversation et le laissèrent partir sans commentaire.
La porte de la cuisine fermée derrière lui, il poussa un soupir de soulagement.
Il grimpa l’escalier en hâte. Il avait un besoin impérieux de se replonger dans le monde de la narratrice du journal.
Côtes-du-Nord1942
Ils avaient arrêté la voiture au bord de la route, dans une voie d’entrée vers un champ qui offrait une ouverture dans les haies encastrant la chaussée étroite. James faisait le guet tandis qu’Anne et le Frère vidaient en hâte la malle en osier qu’ils avaient sortie du coffre.
– On ne garde que l’essentiel dans les valises, avait-il dit. On vide la malle, on le met dedans et on le recouvre de linges et de vêtements. Et puis après, on prie le Seigneur qu’on ne nous fouille pas…
Vider la malle de ses livres et de ses cahiers n’avait pas été difficile. Mettre le passager clandestin dedans était autre chose.
– Vous devriez mettre la malle vide dans le coffre d’abord, suggéra James.
– Et une fois la malle dans le coffre, on le met comment dedans, « M. le Professeur ès suggestions nulles » ? lui avait lancé Anne.
James s’était rapproché d’eux pour les aider.
Le Frère avait levé les yeux vers Anne, un reproche dans le regard.
– Je peux vous aider…
– Tu ne peux pas avec tes béquilles, dit Anne. Elle se mordit la lèvre, mais il était trop tard. Elle vit son frère s’arrêter et devina l’expression de frustration douloureuse sur son visage. Pourquoi ne pouvait-elle s’empêcher de mettre le doigt sur ses lacunes, là où ça lui faisait le plus mal. Elle l’aimait mais il l’énervait comme personne d’autre. Elle lui en voulait constamment et ne voulait pas trop penser à ce qu’elle lui reprochait, craignant de découvrir une facette d’elle qu’elle n’aimerait pas. Alors elle lui envoyait des piques et lui faisait payer tous les non-dits qui régnaient dans leur famille et en elle.
– James, nous avons besoin de toi pour faire le guet, dit le Frère. Anne et moi sommes assez robustes pour le porter. Je le prendrai sous les bras et toi, Anne, tu prendras ses pieds. Nous t’appellerons pour le remettre dans le coffre. On ne sera pas trop de trois pour ça !
Malgré le danger qu’ils couraient, le Frère avait laissé le moteur et les phares allumés. La faible lumière se reflétait dans le brouillard et donnait à leurs ombres des allures fantasmagoriques.
– On videra les valises et on les re-remplira après. L’essentiel c’est de le cacher le plus vite possible.
Le Frère plongea dans la voiture. Anne entendit un remue-ménage puis :
– Anne, je l’ai tourné vers la porte, attrape ses pieds, je le prends sous les bras !
La jeune fille se pencha vers la portière et attrapa les pieds chaussés de bottines éculées. Avec effort elle sortit ses longues jambes. Le Frère à genoux sur la banquette à grand renfort de soupirs et de grommellements émergea finalement de la voiture en portant les épaules du garçon contre lui. Sa tête dodelinait. Il ne semble pas gros du tout, pensa Anne, mais il pèse au moins une tonne !
Elle crut un moment qu’ils n’arriveraient jamais à le faire décoller de la banquette arrière, jusqu’à ce qu’en un sursaut héroïque et au compte de trois ahané par le Frère Jean, « un… deux… trois… », ils parvinrent enfin à le bouger.
Ce fut bien plus rudement qu’ils n’en avaient l’intention que la jeune fille et le Frère déposèrent leur fardeau dans la malle. Ils se relevèrent, rouges et essoufflés, en se massant le bas du dos.
– C’est vraiment lourd un poids mort, dit le Frère.
Anne frissonna.
– Il n’est pas mort ?
– Non, bien sûr que non, dit le Frère, mais il se pencha immédiatement vers la malle et Anne le vit placer ses doigts sous le menton du garçon.
– Son cœur bat, dit-il. On n’a hélas pas le temps de s’assurer de son bien-être avant d’avoir assuré sa sécurité et la nôtre. Allez, vite, on le recouvre et dans le coffre !
Le Frère prit des brassées de couvertures dans la voiture tandis qu’Anne ouvrait les valises et prenait des vêtements au hasard pour en recouvrir leur passager clandestin.
– Il peut respirer sous tout ça ? demanda-t-elle.
– Oui, dit le Frère Jean, l’osier est aéré et les vêtements ne l’étoufferont pas. Allez, James viens nous aider à pousser la malle dans le coffre.
Ils durent s’y prendre à plusieurs fois pour hisser le bagage dans la voiture. Finalement, le coffre fermé, ils prirent les livres essentiels et les quelques effets dont ils auraient besoin dans leurs valises et lancèrent le reste pêle-mêle dans le fond de la voiture.
– Plus une minute à perdre ! lança le Frère alors qu’ils remontaient tous les trois en voiture. Maintenant, espérons que le bateau ne sera pas parti et que les Allemands ne fouilleront pas nos bagages !
Le moteur qui était resté allumé permit à la voiture de repartir immédiatement. On n’était pas loin du port mais quand James vérifia l’heure au cadran de sa montre dans la lueur du briquet, les aiguilles indiquaient six heures et demie.
L’heure où le bateau partait ! Ils allaient le manquer !
***
Les fenêtres de la voiture étaient ouvertes et la mer emplissait la nuit brumeuse de sa respiration puissante. Les phares bleuis de la vieille Citroën créaient deux trouées vagues dans le brouillard ambiant. À l’intérieur, les passagers fouillaient l’obscurité de leurs regards angoissés. Le bateau était-il toujours amarré au quai ?
Soudain des voix fortes retentirent.
– Halt !
Deux soldats allemands se précipitèrent vers la voiture. Le Frère freina brutalement et le moteur cala. Les trois passagers firent un sursaut en avant.
– Fous faites quoi ici ? cria une voix gutturale.
La luminosité d’une torche aveugla le Frère Jean et James. Anne, à l’arrière, distingua le visage fermé d’un Allemand, son casque enfoncé jusqu’aux yeux, derrière la lumière.
– Nous venons prendre le bateau, dit le Frère en clignant des yeux. Il avait pris une voix charmante qu’il adoptait toujours dans ses rapports avec les occupants, pensant que l’amabilité les amadouerait.
L’Allemand détourna sa lampe et approcha son visage de la fenêtre ouverte.
– Fous êtes combien là-dedans ?
– Trois, dit le Frère. Moi et les deux enfants. Le bateau est-il parti ?
L’Allemand ignora la question mais, enfournant sa torche par la fenêtre, explora l’intérieur de la voiture.
– Fos papiers, bitte !
James fourragea dans la boîte à gants et en sortit les paperasseries nécessaires. L’Allemand les prit et partit avec dans la petite cabine de la société des vedettes où son collègue et lui s’étaient installés.
– Vous voyez le bateau ? demanda Anne avec impatience.
Leurs yeux tentaient de percer la nuit épaisse mais ils ne distinguaient rien.
– Le quai est de l’autre côté de la cabine, dit le Frère. On ne verra rien tant qu’on n’aura pas dépassé la barrière.
– Je n’entends pas le moteur, souffla James.
Un souffle glacé passa dans l’automobile.
– Le vent souffle du mauvais côté… suggéra le Frère.
– Mais pourquoi ne pas nous dire s’il est parti ou pas ? s’impatienta Anne. Elle donna un coup de genou dans le siège devant elle.
– Aïe, mon dos ! s’exclama James. Ce n’est pas ma faute si les boches sont des sadiques !
– C’est juste qu’on perd du temps et qu’on ne sait pas combien on a avant qu’il se réveille.
– Oui, j’y ai pensé aussi, dit le Frère. Mais on ne peut rien y faire. D’un côté j’espère qu’il ne se réveillera pas car si c’est le cas il risque fort d’être découvert. Mais, d’un autre côté, s’il ne se réveille pas…
Ni Anne ni James ne continuèrent sa phrase. Un silence lourd et angoissé était tombé dans la voiture.
– En tout cas, dit le Frère, s’ils le trouvent vous jouez l’ignorance. C’est bien entendu ? Tout est ma faute absolument.
Personne ne répondit.
– En plus, comme je suis un homme d’église, ils n’oseront rien me faire. Alors, c’est entendu ?
Les deux adolescents acquiescèrent en silence. Ils savaient tous que le statut d’homme d’église ne valait pas grand-chose auprès de l’occupant. Une peur diffuse commençait à les envahir. Cet Allemand n’avait rien à voir avec le soldat bon-enfant rencontré sur la route. Celui-ci était dur et intraitable. Ils ne connaissaient que trop son type arrogant et glacial pour l’avoir rencontré encore et encore à Paris. S’ils avaient manqué le bateau, il les retiendrait en garde à vue et se ferait un plaisir méchant de fouiller la moindre parcelle de leurs bagages. Il n’aurait pas de mal à découvrir ce qu’ils cachaient. C’était tellement plus grave que du marché noir qu’il en obtiendrait même une promotion. Et à eux, que leur arriverait-il, si… ?
– J’ai juré à vos parents que je m’occuperais de vous, dit le Frère, et que je vous conduirais sains et saufs chez votre grand-mère. Je tiendrai ma parole.
– Ils ne vous en voudraient pas… dit James. En nous envoyant en Bretagne, ils savaient bien que tout pouvait arriver. Mais ils étaient prêts quand même à prendre ce risque plutôt que de nous garder avec eux à Paris.
– Tu es gentil, James, dit le Frère.
– Je dis juste la vérité. Et puis, ne vous inquiétez pas pour moi. J’ai beau être un invalide, je ne suis plus un enfant, j’ai dix-sept ans !
– Tu veux dire que moi, je suis encore une enfant à quatorze ans ! se rebella Anne.
James n’eut pas le temps de répondre car le soldat allemand revenait.
Le cœur d’Anne battait si fort qu’elle se dit que, sans le bruit de la mer et le talonnage dur de l’Allemand sur les graviers de la route, on n’entendrait que lui.