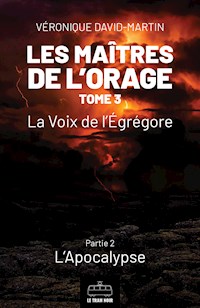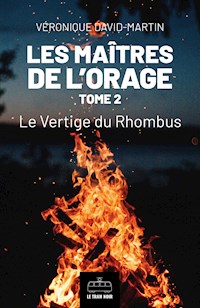Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Tram Noir
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Les Maitres de l'orage
- Sprache: Französisch
Un récit d'initiation et d'aventures, qui se déroule sur une île imaginaire au large de la Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale...
Septembre 1939. Alors que la menace nazie se précise, une vague de crimes se répand sur l’Île Verte, en Bretagne. Serait-ce à nouveau l’œuvre de la Bête mystérieuse qui a frappé il y a une quinzaine d’années ? Malgré ce climat de terreur et les interdits qui pèsent sur la forêt ancestrale de l’île, Marwen, une jeune adolescente à la santé fragile, s’y sent puissamment appelée. Là, elle va de révélation en révélation et développe peu à peu ses dons particuliers. Et si c’était elle l’Élue, seule capable de sauver l’île d’un mal venu d’un autre monde, bien plus profond que la guerre ?
Dans La Marque de l’orage, premier tome de la trilogie Les Maîtres de l’orage, l’auteure brode habilement un récit fantastique sur fond historique qui ravira tant les ados que les adultes friands de légendes et d’aventures.
Découvrez sans plus attendre les aventures de Marwen sur la mystérieuse Île Verte dans le premier tome de la saga Les Maitres de l'orage, qui mêle le fantastique au réalisme sur un fond historique !
EXTRAIT
La journée avait été chaude et la nuit s’annonçait lourde. Le climat de l’île, humide et doux, était différent de celui dont Marwen avait eu l’habitude à Rennes. Son père, le docteur Goulaouenn, lui avait expliqué que le Gulf Stream, un courant d’eau chaude venu du Mexique, baignait généreusement les côtes de l’Île Verte. De la collision entre ce courant chaud et les courants froids de la Manche et de la mer du Nord naissaient des mouvements d’air aux effets violents et complexes. Ainsi s’expliquaient, avait conclu le docteur Goulaouenn, la fréquence et la brutalité des orages sur l’Île Verte.
Un éclair déchira le ciel. Son éclat bleuté illumina un instant l’ombre de la chambre, puis la nuit engloutit de nouveau la pièce. Marwen, dans son lit, frissonna d’aise et commença à compter :
— Un – deux – trois – quatre – cinq...
Le tonnerre fit vibrer l’air nocturne.
— Foudre à cinq kilomètres ! s’exclama-t-elle.
Elle se plaisait à compter les secondes entre l’éclair et le tonnerre, qui indiquaient à combien de kilomètres la foudre avait frappé.
Comme tous les soirs depuis son arrivée récente sur l’Île Verte, Marwen avait entrebâillé les volets de bois, que sa mère fermait toujours soigneusement. Par la fenêtre ouverte, les odeurs, les bruits et les visions du dehors emplissaient sa chambre. Elle adorait l’intensité et la beauté des orages. Elle ne les craignait pas. Au contraire, du confort de son lit douillet, elle les savourait comme un poison délicieux, potentiellement mortel mais innocent à petites doses.
L’île où sa famille et elle venaient d’emménager était connue pour ses « tempêtes électriques » (comme les appelait en plaisantant son père). Cela aurait pu effrayer un esprit moins téméraire, mais Marwen, bien que de santé fragile, avait du caractère.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Nous voici en présence d'un auteur à la belle plume qui plante à merveille un contexte historique des plus réel en y incluant une dose de magie et de légendes. - Du bruit dans les oreilles
Un magnifique livre fantastique qui lie contes et vérités... merci à l'auteur qui nous emporte dans ce merveilleux monde ! - daggery, BookNode
À PROPOS DE L'AUTEURE
Véronique David-Martin est d’origine bretonne mais vit en Grande-Bretagne depuis une trentaine d’années. Docteure en littérature comparée, lectrice vorace depuis sa plus tendre enfance, elle se nourrit d’histoires, de mythes universels et de légendes celtiques, ainsi que de récits de famille sur la Seconde Guerre mondiale, intérêts qui l’ont évidemment inspirée dans l’écriture des Maîtres de l’orage.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Dédicaces
En souvenir de mon père qui nous manque tant. À Maman, pour son soutien précieux et sa compréhension. À Miles, grâce à qui je peux être qui je devais être.
À tous ceux, jeunes et moins jeunes, qui aiment qu’on leur raconte une histoire.
L’ORAGE(janvier 1940)
Un éclair illumina le ciel nocturne, suivi d’un roulement sourd. Malgré le froid de ce janvier 1940, l’orage tel un loup affamé grondait autour de l’Île Verte.
Deux adolescents, chacun à sa fenêtre, bavardaient avec animation au-dessus du passage étroit qui séparait leurs maisons. La lueur pâle qui s’échappait de la chambre du garçon éclairait faiblement leurs silhouettes sombres penchées l’une vers l’autre. La fille, Marwen, malgré sa taille élancée, ne devait pas avoir plus de douze ans, tandis que le garçon, Gaël, devait en avoir environ quatorze.
– J’enrage car l’orage … dit Marwen.
– en rage … continua Gaël.
Marwen fit une moue sceptique. Machinalement, elle passa sa main dans ses cheveux courts et bouclés.
– « En rage » comme « en colère », expliqua Gaël.
– D’accord, concéda Marwen. J’enrage car l’orage en rage … fait rage !
– et… me fait… barrage – « bar-rage » ! conclut Gaël, avec un clin d’œil triomphant.
– Sale tricheur ! cria Marwen.
Les yeux noirs du garçon riaient sous sa frange brune. Il était perché en équilibre à la fenêtre de sa chambre, en face de celle de Marwen. Elle ne put s’empêcher de sourire.
– Jeux de mots… lui lança-t-elle.
– Jeux d’idiots, acheva-t-il en s’esclaffant.
Un grondement plus fort emplit le ciel et interrompit leurs rires.
– Et si c’était une bombe au lieu du tonnerre ? dit Gaël les yeux écarquillés et l’air menaçant. Le vent aidant, une explosion sur le continent, on l’entendrait d’ici. Imagine – si c’était la fin de la drôle de guerre…
– Ne parle pas de malheur ! s’exclama Marwen, son petit visage intense crispé d’épouvante.
Elle se pencha avec précaution un peu plus en avant sur le rebord de sa fenêtre.
– Tu penses que ça va démarrer bientôt ? dit-elle, de l’angoisse dans la voix.
Il ouvrit la bouche mais au lieu de répondre, il expira doucement et observa son souffle se dérouler comme une fumée dans la nuit froide.
– Ça fait des mois que rien ne se passe… dit-il enfin. Va bien falloir que ça se déclenche un jour.
– Tu crois ? dit Marwen. Quand je pense à la guerre, je veux dire à la vraie guerre, ça me fait peur !
– Mauviette !
Marwen fit mine de lui lancer quelque chose à la tête. Gaël fit mine de l’éviter.
– Sérieusement, t’as pas peur toi qu’ils débarquent ici les Allemands ? continua-t-elle.
– C’est ça qui te fait peur ? demanda Gaël.
– Entre autres…
– Alors, ne t’inquiète pas. Que voudrais-tu que les Boches viennent faire ici ?
– Je n’sais pas, moi…
Gaël prit un air faussement sérieux.
– Réfléchissons… dit-il. Une petite île perdue au large de la Bretagne, battue par la tempête et les orages… Hum…
Il se tapota la joue du bout des doigts, les sourcils froncés et le visage songeur. Puis, brusquement, il cessa son jeu et la regarda droit dans les yeux avec un air taquin.
– Même toi, tu peux voir que les Boches ça ne les intéresserait pas ! Tu les imagines ici avec leurs chars ?
Marwen hocha la tête, mais elle n’était pas convaincue. Gaël lui fit une grimace comique. La gaieté de son ami dissipait d’habitude ses angoisses et ses peines, mais ce soir elle avait comme un pressentiment.
– Vas-y, dit-il, dis-moi ce qui pourrait les appâter dans ce trou perdu !
– Le château… avança-t-elle.
– Un vieux château miteux loué à un savant suédois, car la châtelaine n’a plus un sou. Si tu crois que les Boches vont se déplacer pour ça !
– La forêt alors ?
– Bien sûr ! s’esclaffa Gaël. Avec sa Bête sanguinaire qui éventre ses victimes et leur arrache les yeux et le cœur ?
Marwen le regarda avec horreur.
– Les yeux et le cœur ? balbutia-t-elle.
– Oh désolé, dit Gaël, je t’ai choquée ? Je croyais que tout le monde était au courant. On arrive à tout savoir au café : les gens ont la langue déliée après quelques bolées1 .
Marwen frissonna.
– Eh bien, justement, reprit-elle, ça pourrait beaucoup leur plaire aux Boches.
– Tu parles ! ricana Gaël. Ils préfèrent les chars d’assaut aux bêtes sauvages ! C’est bien plus efficace. En plus cette forêt c’est une vraie jungle. Tu verrais les Boches, comme ils y perdraient la boussole !
À cette pensée il éclata de rire. Marwen parvint à ébaucher un sourire.
– Et même s’ils s’y retrouvaient, reprit-il sur un ton rassurant, tu imagines leur réaction en tombant sur Maïa la sorcière ! Tu ne l’as jamais vue mais je peux te dire qu’elle a une sacrée réputation par ici. Elle ne leur ferait pas de cadeaux !
À la mention du nom de Maïa, Marwen avait rougi. Gaël ne sembla pas le remarquer et continua :
– Allez, quoi d’autre ?
– La forteresse, au nord de l’île… proposa Marwen.
– Une ruine ! décréta Gaël. Quoi d’autre ?
Marwen eut un moment d’hésitation.
– Alors ? taquina Gaël. C’est tout ? Tu me déçois, benête.
– La boule de feu ? proposa-t-elle comme à regret.
– Ah, dit-il une étrange expression dans le regard, la fameuse boule de feu… Même si tu ne l’as jamais vue toi-même, tu dois savoir qu’elle aime visiter un petit café que nous connaissons bien tous les deux…
Marwen l’observait avec appréhension. Il parut le remarquer car il allégea l’atmosphère en ajoutant facétieusement :
– Hélas, fantôme ou pas, elle ne s’attarde jamais assez longtemps pour prendre un verre avec les habitués !
Marwen eut un rire un peu forcé. Puis elle se ressaisit et se joignit à Gaël dans son inventaire enjoué des attraits discutables de leur île.
– Un gros monsieur le maire tout rouge et…
Elle cherchait ses mots.
– pompeux ? ridicule ? suggéra Gaël.
– Quelle vache ! dit Marwen. J’allais dire « imposant » !
– N’importe quoi ! répliqua Gaël.
Les deux adolescents éclatèrent de rire.
– Je suis si contente que… commença Marwen lorsque leur rire fut calmé.
Gaël plongea son regard soudain sérieux au plus profond des yeux clairs de Marwen.
– Tu es… murmura-t-elle… mon meilleur ami.
Leurs regard se touchèrent et restèrent longuement attachés.
– Tu veux dire ton seul ami, plaisanta alors Gaël, dissipant le trouble qui venait de se glisser entre eux. Le seul à pouvoir te supporter !
Leurs rires reprirent de plus belle, mais l’orage les interrompit en décochant un éclair vibrant dans le ciel chargé.
– Un… deux… trois… récitèrent-ils à l’unisson.
Une détonation fracassante retentit non loin de là.
– Trois kilomètres !
Les enfants applaudirent.
– Chiche que t’es pas cap de me toucher la main au-dessus du passage, lança Gaël, une lueur malicieuse dans le regard.
Marwen souffrait facilement de vertige mais aurait préféré tout plutôt que de l’avouer.
– Chiche que je suis cap ! répondit-elle, du défi plein la voix.
– D’accord ! On va voir ça !
Il tendit la main vers elle, son long corps mince en équilibre à l’extérieur de sa fenêtre. Marwen le regarda et revit dans ses yeux bruns la merveilleuse douceur qui parfois les traversait quand il la regardait. Elle sentit son cœur s’affoler et une rougeur idiote lui monta aux joues. Gênée et confuse, elle regarda un instant le vide sous elle. Elle respira à fond, puis, avec décision, le bras tendu vers son ami, elle se tortilla sur le ventre pour avancer plus avant sur le rebord de sa fenêtre.
Des grondements sourds emplissaient le ciel nocturne. Un vent glacé s’était levé. La lampe à côté de Gaël vacilla. Leurs doigts s’effleurèrent. Marwen sentit ses cheveux se dresser sur la tête. Elle regarda Gaël, dont le visage se crispa. La Dame Blanche se tenait debout à ses côtés ! Marwen voulut le prévenir, mais aucun son ne s’échappa de ses lèvres.
À cet instant, une boule lumineuse apparut au-dessus du passage entre leurs deux maisons. Marwen distingua comme des veines rouges qui palpitaient sous sa surface argentée. Une flamme gigantesque s’échappa de la boule vers le ciel.
Marwen sentit le Manac’h derrière elle, une présence non plus discrète comme à l’habitude, mais intense. Sa force obscure l’entourait. Elle se sentit protégée.
La boule qui jusqu’ici avait flotté entre les deux adolescents explosa soudain. La déflagration projeta Marwen en arrière.
Avant de perdre conscience, elle revit comme en rêve les épisodes les plus marquants de sa vie depuis son arrivée sur l’île six mois auparavant.
Gaël…
1 Des petits bols en faïence dans lesquels on sert du cidre.
PREMIÈRE PARTIE AVANT L’ORAGE (septembre – décembre 1939)
- I -
La journée avait été chaude et la nuit s’annonçait lourde. Le climat de l’île, humide et doux, était différent de celui dont Marwen avait eu l’habitude à Rennes. Son père, le docteur Goulaouenn, lui avait expliqué que le Gulf Stream, un courant d’eau chaude venu du Mexique, baignait généreusement les côtes de l’Île Verte. De la collision entre ce courant chaud et les courants froids de la Manche et de la mer du Nord naissaient des mouvements d’air aux effets violents et complexes. Ainsi s’expliquaient, avait conclu le docteur Goulaouenn, la fréquence et la brutalité des orages sur l’Île Verte.
Un éclair déchira le ciel. Son éclat bleuté illumina un instant l’ombre de la chambre, puis la nuit engloutit de nouveau la pièce. Marwen, dans son lit, frissonna d’aise et commença à compter :
– Un – deux – trois – quatre – cinq…
Le tonnerre fit vibrer l’air nocturne.
– Foudre à cinq kilomètres ! s’exclama-t-elle.
Elle se plaisait à compter les secondes entre l’éclair et le tonnerre, qui indiquaient à combien de kilomètres la foudre avait frappé.
Comme tous les soirs depuis son arrivée récente sur l’Île Verte, Marwen avait entrebâillé les volets de bois, que sa mère fermait toujours soigneusement. Par la fenêtre ouverte, les odeurs, les bruits et les visions du dehors emplissaient sa chambre. Elle adorait l’intensité et la beauté des orages. Elle ne les craignait pas. Au contraire, du confort de son lit douillet, elle les savourait comme un poison délicieux, potentiellement mortel mais innocent à petites doses.
L’île où sa famille et elle venaient d’emménager était connue pour ses « tempêtes électriques » (comme les appelait en plaisantant son père). Cela aurait pu effrayer un esprit moins téméraire, mais Marwen, bien que de santé fragile, avait du caractère.
Par la fenêtre, la nuit était opaque, sans lune. Il devait être tard. Un vent faible mais insistant faisait grincer les volets sur leurs gonds rouillés. Dans le lointain, l’orage continuait doucement de gronder. Marwen soupira. Le corps détendu dans son lit chaud et confortable, elle se sentait bien. Le Manac’h, comme un chien fidèle, veillait sur elle, silencieux et dévoué. Il flottait au pied de son lit, ses contours flous et opalescents éclairés très faiblement, à peine perceptibles. Il ondoyait là, à la fois étrange et familier, sa clarté vaporeuse comme une lanterne dans la brume. Marwen lui sourit. Tout allait bien et, pour une fois, elle qui était souvent malade n’avait mal nulle part. Elle ferma les paupières et le sommeil mollement la reprit.
Quand la sonnette d’entrée rompit le silence de la grande maison, Marwen n’ouvrit même pas les yeux. Ce genre d’incident était fréquent chez ses parents. Son père était le seul médecin de l’île, et on venait le chercher à toute heure du jour et de la nuit. Elle l’entendit se lever et aller ouvrir la porte. Toutefois, au lieu de l’activité qui suivait d’habitude ce genre de visites (le docteur s’habillant en hâte et attrapant au vol sa sacoche préparée par sa femme), Marwen n’entendit rien du tout.
Ce silence inhabituel l’alerta. Elle ouvrit les yeux.
Elle entendit sa mère se lever et aller retrouver son mari dans le vestibule. Quelques phrases furent échangées à voix basse et un cri de détresse échappa à Mme Goulaouenn. Puis la porte d’entrée claqua, et des voix étouffées se firent entendre de l’extérieur. Marwen ne distinguait pas les paroles prononcées, mais leur ton lui sembla emporté. Elle s’assit dans son lit. Une dispute ? Avec qui ? Et à quel sujet ?
Enfin les voix se turent. La porte d’entrée se rouvrit et se referma, cette fois-ci en douceur. Des chuchotements animés lui firent tendre l’oreille. Quelque chose d’insolite se passait.
Elle se leva en frissonnant, et ses pieds nus se recroquevillèrent au contact glacé du plancher. Elle se dirigea à tâtons vers la porte qui, malgré ses précautions, grinça quand elle l’ouvrit. Les voix venaient du vestibule en bas. Elle avança aussi silencieusement que possible vers la rambarde de l’escalier qui surplombait l’entrée. Une planche craqua sous ses pas. Les murmures se turent immédiatement. Elle attendit le souffle haletant.
– Tu as entendu ? dit sa mère.
– Ce n’était rien, répondit son père.
Mme Goulaouenn, sans doute rassurée par son mari, reprit :
– C’est impossible que ça recommence… Je ne peux pas croire que ça puisse recommencer… Après tant d’années…
– Calme-toi, dit le Dr Goulaouenn de sa voix apaisante. Ce n’est plus pareil. Le temps a passé. Et puis je suis là.
– Oui, dit Mme Goulaouenn, mais maintenant j’ai des enfants, des filles…
Marwen crut alors entendre un bruit de sanglot étouffé. Le silence se creusa un instant autour de cette plainte, puis la voix de son père reprit gentiment :
– Allons nous coucher.
– Tu peux aller te coucher, toi, après tout ça ?
– Je sais que c’est dur pour toi, ma chérie, mais je ne vois pas ce qu’on peut faire d’autre ce soir… Allez viens.
Marwen entendit un autre sanglot mal réprimé, suivi d’un froissement de tissu. Elle visualisa son père, le bras autour des épaules de sa mère qui pleurait, essayant en vain de la réconforter. Qu’est-ce que ça voulait dire ?
– Tu ne crois pas qu’elle a entendu là-haut ? dit alors sa mère d’un ton anxieux.
– Non, répondit son père.
– J’ai entendu du bruit.
– C’est juste la maison qui craque. Ne t’inquiète pas ! De toute façon, on ne peut pas protéger les enfants de tout. Parfois c’est mieux de les informer.
– Pas dans ce cas-là ! répliqua-t-elle d’un ton sans appel. Elle n’a pas besoin de savoir ça. En plus, tu sais comme elle est fragile ! Le bébé ne me donne pas tant de soucis !
Marwen en avait entendu assez pour savoir qu’elle n’était pas censée être là. Elle retourna dans sa chambre, un drôle de sentiment au cœur. Quelle était cette chose si terrible qui faisait pleurer sa mère ? Qui était le mystérieux visiteur dont la seule vue l’avait fait crier ?
Incapable de se rendormir, Marwen pensa allumer la lampe à pétrole et lire un peu, mais quelque chose de plus fort qu’elle l’incita à se diriger vers la fenêtre. Dehors, une lune fine et voilée éclairait à peine le jardin et le bois qui le bordait. Marwen allait retourner vers son lit, lorsqu’un mouvement à l’orée des arbres retint son regard. Elle s’approcha de la fenêtre et concentra son attention sur ce qu’elle avait cru voir.
Rien.
Probablement un renard. L’île en regorgeait. Ils rôdaient la nuit aux abords du village dans l’espoir de trouver de quoi manger.
Elle s’apprêtait à rejoindre son lit quand un flux glacé la traversa et la fit frissonner. Une peur inexplicable. Elle se concentra une dernière fois sur le jardin et vit soudain une silhouette pâle, drapée dans une longue cape, se détacher de la ligne sombre des arbres et avancer lentement hors de l’abri du bois. On eût dit un pèlerin du temps passé ou un moine.
L’inconnu s’immobilisa en face de sa fenêtre. Deux points lumineux luisaient un peu plus loin à la hauteur de ses genoux. Bien qu’elle ne puisse voir son visage noyé dans l’obscurité, elle sentit qu’il la regardait. Elle eut le réflexe de se rejeter en arrière, puis se raisonna : l’étranger ne pouvait pas la voir dans l’obscurité de sa chambre. Avec prudence, elle se rapprocha de la fenêtre. Elle jeta un coup d’œil à l’extérieur. La lune était cachée. Quand le nuage qui la dissimulait passa, l’homme encapuchonné avait disparu.
Marwen retourna à tâtons vers son lit, guidée par la lueur pâle du Manac’h qui lui en indiquait la position. Elle tremblait de froid et de frayeur. Même blottie sous son édredon douillet, elle ne parvint pas à se réchauffer.
L’aube finalement se leva et Marwen n’avait pas réussi à se rendormir. Le ciel était clair et rougeoyant.
Marwen pressentit que cette journée ensoleillée de septembre 1939 serait un jour mémorable.
***
Le télégramme était déplié sur la toile cirée quand Marwen revint de la boulangerie. Elle avait entendu des voix masculines venues de la cuisine et avait ralenti le pas devant la maison pour tenter d’entendre ce qui se disait. Par la porte-fenêtre entrouverte, elle vit son père assis à la table avec Monsieur le Maire. Ils avaient tous les deux l’air soucieux.
– On ne peut pas se passer de vous ici ! disait le maire avec conviction. On a vécu assez longtemps sans médecin après la mort du docteur Lebec. On ne peut pas se retrouver dans cette situation. Je vais leur faire savoir, moi, à la préfecture et même, s’il le faut, au ministère !
– Je ne veux pas de traitement de faveur.
– Ce n’est pas pour vous Dr Goulaouenn ! C’est pour la commune et je pourrais même dire l’île entière !
L’arrivée de Marwen interrompit la conversation.
– Bonjour Monsieur le Maire !
Sanguin, corpulent et d’apparence bougonne, le maire était un monsieur important. Le père de Marwen disait toujours que c’était un brave homme même si limité par certains aspects. Il était le plus gros agriculteur de l’île, ainsi que son maire depuis de nombreuses années. De par sa fortune et sa fonction, son attitude était facilement paternaliste, ce qui lui valait le respect de la majorité, mais en irritait certains. Avec le docteur Goulaouenn, qu’il admirait beaucoup, il était si aimable qu’il en était presque mielleux.
– Bonjour Marwen ! répondit-il en mâchouillant sa grosse moustache grise, ce qu’il faisait toujours lorsqu’il était préoccupé. Si « bon jour » est vraiment l’expression appropriée ! Je pourrais même dire qu’on ne sait plus que dire avec les événements !
Marwen déposa le pain dans la panière en fer.
– Où est Maman ?
– Dehors avec Jeanne, répondit son père.
Marwen sortit dans le jardin, de l’autre côté de la cuisine. Elle s’arrêta un instant pour respirer l’air tiède qui embaumait la menthe et le romarin. Un peu plus loin, sa mère parlait avec la blanchisseuse, « la Jeanne », devant la buanderie où les ustensiles nécessaires à la lessive étaient rangés avec soin. Il apparut vite évident que les deux femmes ne parlaient pas de linge. Jeanne avait les yeux rouges et la mère de Marwen avait l’air abattu. À la vue de sa fille, elle secoua la tête comme pour chasser des pensées tristes et pressantes.
– Tiens ! Marwen te voilà déjà revenue du pain, dit-elle avec un sourire pâle.
– Qu’est-ce qui s’est passé ? demanda Marwen.
– Elle est fine la puce, dit la Jeanne, on peut rien lui cacher !
– Si c’est de la guerre dont vous parlez, dit Marwen, j’aurais du mal à ne pas savoir ! On ne parle que de ça au village. Ça veut dire quoi « la mobilisation est déclarée » ?
À ces mots, le visage de Jeanne sembla devenir encore plus rouge que d’habitude.
– Ça veut dire, que nos hommes, vont devoir repartir, se faire tuer ! répondit-elle, sa voix entrecoupée de sanglots. La dernière fois, c’était mon homme qu’ils m’ont pris ; cette fois-ci, c’est mes gars !
De détresse, la pauvre femme tordait ses mains boursouflées par les lessives.
– Papa va partir ? demanda Marwen atterrée.
– Ce n’est pas encore fait, dit Madame Goulaouenn, sans avoir l’air très convaincue elle-même.
Ainsi c’était donc vrai. C’était la guerre. Tout le monde n’avait que ce mot à la bouche. Ce n’était pas totalement une surprise puisqu’on en parlait, sans y croire vraiment, depuis des mois et des mois. On avait voulu penser que les choses se calmeraient. Mais rien n’avait arrêté l’ambition folle de Herr Hitler, le chef d’État allemand, et de ses hordes nazies. On avait écouté la radio et le Dr Goulaouenn, visiblement accablé par les nouvelles, avait planté des drapeaux sur la carte d’Europe affichée dans son bureau pour marquer l’avancée allemande : l’Autriche, les Sudètes, la Tchécoslovaquie… Cette avancée restait abstraite pour Marwen. Irréelle.
Et puis, finalement, l’inacceptable était arrivé. Les Allemands avaient conclu un pacte de paix avec les Russes, leurs ennemis de toujours, et maintenant ils venaient d’envahir la Pologne. Le Dr Goulaouenn disait que cela scellait le destin de la France. Les Polonais étant nos alliés, la guerre était inévitable. De plus, les Boches (comme on surnommait les Allemands) se trouvaient géographiquement aux portes de la France. La ligne Maginot, sorte de frontière fortifiée entre l’Allemagne et la France, était censée protéger le territoire français. Mais en ce samedi 2 septembre 1939, tous les hommes de dix-huit à quarante ans avaient quand même été appelés à rejoindre l’armée française.
Avec consternation, les adultes et les personnes âgées répétaient à qui voulait l’entendre que l’histoire recommençait. Les horreurs de la Première Guerre mondiale étaient encore fraîches dans les esprits. Les noms des disparus de la guerre de 1914 à 1918 étaient gravés profondément dans les mémoires, ainsi que sur les stèles grises des monuments aux morts. Les grands blessés de guerre étaient hélas des visions familières dans toutes les villes et villages d’Europe.
Et voilà qu’après vingt ans, la guerre revenait. Elle était là. Vraiment là. Incontournable. Et Marwen ne ressentait qu’un sentiment d’irréalité. Son père allait-il devoir partir ? Devant ces nouvelles écrasantes et la possibilité encore plus écrasante du départ du docteur, Marwen sentait son esprit se dérober.
– Faut quand même pas trop te tracasser ma cocotte ! dit la Jeanne, dont le bon cœur parlait plus fort que le chagrin.
Elle s’essuya les yeux avec un coin de son tablier.
– Dame, reprit-elle, ton père il est bien trop utile ici ! C’est que le maire il va faire des pieds et des mains pour le garder not’ docteur. Pensez donc, un si bon docteur ! Et le maire il en connaît du beau monde sur le continent. C’est pas vrai ça, Mme Goulaouenn ?
La mère de Marwen hocha la tête distraitement. Puis son regard se fixa sur sa fille. Elle la prit par le menton et l’observa avec attention.
– Tu as bien petite mine toi ! dit-elle. Monte donc te reposer dans ta chambre avant le déjeuner. Tu sais bien que tu ne dois pas te fatiguer.
Marwen ne protesta pas ; elle ne voulait surtout pas ajouter aux soucis de sa mère. La Jeanne lui donna une tape affectueuse dans le dos.
Marwen eut un petit sourire aussi gai que possible et se dirigea en traînant un peu les pieds vers la maison. Près de la porte de la cuisine, prise d’un drôle de pressentiment, la fillette se retourna. La Jeanne avait repris sa conversation avec la mère de Marwen, mais cette dernière n’y participait pas. Marwen se fit la réflexion qu’elle avait l’air si lointain qu’on aurait dit qu’elle était déjà partie pour la guerre devant Papa.
***
Pour éviter de déranger son père et son invité, Marwen fit un court détour par l’entrée. Alors qu’elle passait de l’autre côté de la cloison entre le hall et la cuisine, elle entendit la voix tonitruante du maire et celle plus calme et grave du docteur. Elle hâta le pas et monta l’escalier le plus rapidement possible. Elle avait entendu suffisamment de mauvaises nouvelles et ne voulait rien savoir de plus. Elle aurait presque voulu se boucher les oreilles. Arrivée dans sa chambre, elle ferma la porte derrière elle et s’appuya un instant contre le battant.
La guerre.
Était-ce donc ça l’explication des événements étranges de la nuit précédente ? Cette révélation ne lui donnait toutefois ni l’identité du visiteur mystérieux, ni celle du moine encapuchonné qui l’avait tant effrayée. Cela n’expliquait en fait que la réaction horrifiée de sa mère. Elle s’assit un moment sur son lit. Quelque chose ne collait pas.
– Marwen ! Marwen ! appela sa mère du jardin. Ferme ta fenêtre. Ta chambre est assez aérée comme ça !
Marwen se leva et l’odeur âcre de la lessive lui chatouilla les narines et la gorge. De sa fenêtre, elle vit que Jeanne et sa mère avaient cessé de parler et que la blanchisseuse s’était mise au travail. Elle avait jeté dans l’eau bouillante de la lessiveuse, à l’entrée de la buanderie, la masse de linge à laver qu’elle allait ensuite remuer avec un gros bâton. C’était un rude travail que Jeanne accomplissait une fois par semaine chez diverses familles de l’île. (Les femmes des familles moins fortunées, qui ne pouvaient s’offrir ses services, allaient elles-mêmes faire la lessive au lavoir communal.)
Au bruit de la fenêtre qui se fermait, Jeanne leva la tête et, après avoir essuyé du revers de son tablier son front perlé de sueur, elle fit un petit signe amical à Marwen. La fillette lui répondit par un sourire triste, puis alla se rasseoir sur son lit. Elle ressentait un sentiment de malaise.
Désœuvrée, elle prit un livre et essaya de lire, mais mille pensées fourmillaient dans sa tête. La guerre… La guerre…
Elle repensa à M. Legoff, une « gueule cassée »2, qui tenait un bureau de tabac à Rennes à deux rues de la maison où vivaient les Goulaouenn avant leur départ pour l’Île Verte. M. Legoff était un homme tellement abîmé par la guerre qu’il ne pouvait plus que passer ses journées assis derrière le comptoir de sa boutique.
Une photo sur le mur derrière sa chaise roulante le montrait avant la tragédie qui avait entraîné ses blessures, jeune et en uniforme de soldat. Son visage depuis était devenu méconnaissable, comme mangé par une masse affreuse de cicatrices rouges et gonflées. Son corps difforme était soutenu par des oreillers que sa femme, dévouée et résignée, réarrangeait régulièrement autour de lui. On savait que le pauvre homme souffrait encore beaucoup de ses blessures, mais il était en général étonnamment joyeux et avenant avec ses clients. Les Goulaouenn le donnaient toujours en exemple.
Lorsque Marwen était malade (ce qui arrivait hélas très souvent), elle pensait à lui, et son étrange courage la rassurait. Mais, sous le coup de la déclaration de guerre, le pauvre homme devenait soudain pour Marwen une figure d’angoisse et d’horreur : elle se demandait si un tel sort pourrait être un jour celui de son père. Elle pensa au bon sourire du Dr Goulaouenn, à son calme, sa gentillesse, et son cœur se serra. Il était la joie et la stabilité de la famille. Comment pourrait-on survivre sans lui ?
De même que l’avait fait sa mère dans le jardin, elle secoua la tête pour tenter de se débarrasser de ses idées noires. Il lui fallait s’occuper l’esprit. Elle abandonna son livre, sur lequel elle ne pouvait se concentrer, se leva de son lit et se dirigea vers la seconde fenêtre de sa chambre.
Cette fenêtre ne possédait rien d’extraordinaire en soi (rien du tout en fait), mais depuis leur emménagement elle avait intrigué Marwen. C’était une ouverture toute simple, plus haute que large, avec juste un battant. On aurait pu l’ouvrir (elle avait une poignée qui fonctionnait), mais sa mère lui avait interdit d’y toucher car elle craignait trop les courants d’air. Marwen n’en avait d’ailleurs aucune envie, car ce qu’elle aimait faire c’était observer de l’abri de sa chambre, derrière le rideau et le panneau de verre, ce qu’il y avait de l’autre côté. Elle en ignorait la raison mais ça la fascinait.
La fenêtre ne donnait que sur un sombre et étroit passage qui courait entre le pignon de la demeure des Goulaouenn et celui de la maison attenante. Cette maison abritait au rez-de-chaussée le café (dont l’entrée était sur la rue) et à l’étage l’appartement du cafetier. À la petite fenêtre de la chambre de Marwen correspondait une fenêtre dans la maison voisine, les deux ouvertures se faisant presque face.
La pièce de la maison voisine était toujours sombre, si bien que Marwen l’avait imaginée inhabitée. La seule chose qu’elle pouvait y distinguer, dans le renfoncement où se blottissait la fenêtre, c’était un pan de papier peint aux couleurs passées, taché et même déchiré par endroits. Ces déchirures, qui auraient horrifié sa mère, faisaient les délices de Marwen. Elles inspiraient son imagination de fillette solitaire. Elle y voyait des choses aussi étranges et exotiques que des continents lointains, des animaux sauvages ou des sorcières bossues perchées sur leurs balais. À partir de ces éléments imaginés elle s’inventait des histoires. Cela pouvait l’occuper pendant des heures.
Il y avait aussi dans le renfoncement de la fenêtre d’en face, une étagère à la peinture écaillée qui jusqu’alors ne l’avait pas intéressée. Mais aujourd’hui, jour où le papier peint déchiré n’aurait sans doute pas suffi à la distraire, un objet était apparu sur l’étagère. Un livre. Et pas n’importe lequel, son livre préféré : une aventure palpitante qui racontait l’histoire d’un serment maudit unissant deux familles, ainsi que les conséquences terribles de ce serment sur l’amitié entre deux adolescents.
À qui pouvait bien appartenir ce livre ? Y avait-il un habitant dans la chambre abandonnée ?
- II -
Le soleil scintillait dans un ciel d’automne bleu et transparent. Marwen et sa mère avaient emmitouflé la petite sœur dans sa poussette car un vent frais soufflait de la mer. Elles allaient toutes les trois accompagner au port le Dr Goulaouenn qui partait aujourd’hui à la guerre.
– Marwen, lui dit sa mère, occupe-toi d’Anaïk pendant que j’aide ton père. Emmène-la dans le jardin. Emmaillotée comme elle l’est, elle aura trop chaud à l’intérieur.
Marwen emmena la poussette dehors. Anaïk venait d’être nourrie et sombrait déjà dans un sommeil paisible. Elle avait de la chance d’être si petite et de ne se rendre compte de rien. Marwen, elle, avait l’impression qu’en faisant ses adieux à son père son cœur se briserait.
La veille au soir le Dr Goulaouenn était monté lui dire bonsoir dans sa chambre (d’habitude c’était sa mère), et il lui avait parlé en confidence.
Il s’était assis sur son lit et, les yeux dans les yeux, il lui avait dit :
– Marwen, tu es presque une jeune fille. À douze ans tu es plus mûre que la plupart des enfants de ton âge. Toutes les années que tu as passées à être malade dans ta chambre, à lire et à réfléchir pendant que les autres enfants s’amusaient, t’ont donné de la maturité. Ce que je vais te confier, je ne peux le confier à personne d’autre.
Marwen regardait son père avec attention. Il lui parlait comme à une adulte. Son cœur s’en gonflait de fierté, mais une peur trouble s’insinuait aussi en elle. En temps normal, une telle marque de confiance l’aurait enchantée, mais plus rien n’était normal depuis l’annonce de la guerre. Terribles étaient les circonstances qui justifiaient un tel changement de rôles entre parent et enfant.
– Comme tu le sais, nous sommes en guerre. Je dois partir faire mon devoir de citoyen. Notre pays et notre liberté sont en danger. Comme les autres hommes en âge de combattre je dois partir rejoindre les rangs de l’armée. Tu comprends ce que je te dis, Marwen ?
Marwen opina de la tête.
– C’est bien. Tu sais que je pars demain, mais que je ne sais pas quand je reviendrai…
Marwen hocha de nouveau la tête. Son père lui sourit. Il semblait chercher ses mots.
– C’est la guerre… donc ça veut dire que parfois on peut être blessé…
– Comme Monsieur Legoff ? demanda Marwen, sans réfléchir.
Le docteur la considéra avec surprise. Inquiète d’avoir été maladroite, Marwen rougit et se mordit la lèvre.
– M. Legoff ? demanda-t-il.
– M. Legoff de Rennes, précisa-t-elle avec embarras.
– Oh, du bureau de tabac ! s’exclama le docteur.
Il fit une petite moue.
– Heureusement, ce n’est pas toujours aussi terrible – le pauvre homme ! Mais parfois… parfois…
Marwen regardait son père. Il s’était interrompu en milieu de phrase. Elle lisait en lui comme dans un livre ouvert. Il essayait de lui faire comprendre quelque chose tout en craignant de l’inquiéter. Elle souffrait de le voir ainsi peiner. Elle savait ce qu’il voulait dire, mais elle avait peur d’entendre des mots dont la pensée seule lui tordait le cœur. Elle aurait voulu se boucher les oreilles et partir en courant, mais le regard sérieux, presque suppliant, de son père la forçait à rester et à l’entendre prononcer l’impensable.
– Parfois… répéta-t-il. Parfois…
– On n’en revient pas, cria presque Marwen.
Son père la regarda avec étonnement puis avec une grande tendresse. Il la prit contre lui et la serra fort. Elle se blottit dans ses bras réconfortants, terrifiée à l’idée de perdre ce havre qui avait toujours été pour elle si robuste et constant.
– Tu es une vraie jeune fille maintenant, lui dit-il enfin.
Il la repoussa doucement et la tint par les épaules en la considérant avec fierté. À la vue des larmes que Marwen essayait de retenir, il plaisanta :
– Parler ainsi ne fait pas mourir, et je compte bien revenir ! De toute façon, que ferait l’île sans son médecin ? Mais en attendant, reprit-il avec sérieux, je te confie ta maman et ta petite sœur. Ta maman va avoir tant à faire. Elle est la seule infirmière du pays. Elle va devoir être ma remplaçante. Il va falloir l’aider. Pas tant au niveau pratique qu’au niveau moral. Tu tiens de moi. Tu seras forte. Les soirs où elle sera découragée et où elle se sentira seule, tu seras là pour elle. Sa petite amie. Elle ne voit pas combien tu as grandi. Il faudra que ta conduite le lui fasse comprendre.
Marwen s’essuya les yeux subrepticement et se força à faire un sourire presque joyeux à son père.
– Ne t’inquiète pas pour nous Papa. Ça ira… Mais toi…
Il se leva, se pencha sur elle et l’embrassa.
– Si je vous sais en forme, tout ira bien pour moi. Bonsoir ma grande fille chérie ! À demain !
Il éteignit la lampe. À la porte, il se retourna vers Marwen et lui lança un baiser du bout des doigts, puis il disparut derrière le battant de bois. Elle vit la lumière du couloir en rai sous la porte et entendit les pas de son père descendre l’escalier craquant.
– Mais toi… reprit-elle tout bas, toi Papa, prends bien soin de toi.
Elle pleura en pensant à son père, à ce qui l’attendait (si terrible et si confus pour elle). Puis, épuisée par le chagrin, elle s’endormit, son ours en peluche qu’elle avait délaissé depuis longtemps serré contre elle.
***
Le soleil brillait dans le ciel d’automne lisse et métallique. Anaïk, qui avait commencé à s’assoupir dans sa poussette, se réveilla en sursaut quand les cloches de l’église carillonnèrent pour inviter les appelés à se réunir sur le port. D’abord elle geignit doucement, puis ses gémissements se transformèrent en pleurnicheries, puis en cris. Marwen essaya en vain de la calmer. Ses parents étaient toujours à l’intérieur de la maison. Elle ne voulait pas les déranger dans leurs derniers instants ensemble.
Finalement, sans doute alertée par les hurlements stridents du bébé, Madame Goulaouenn sortit de la maison, le visage tendu.
– La petite s’impatiente ! dit-elle. Marwen, où est ton écharpe ? Va vite la chercher ! Tu vas attraper une angine !
Marwen partit en courant dans l’entrée où elle trouva son écharpe. Son père était au téléphone. Il parlait à voix basse.
– Il était parti, présumé mort et c’était mieux comme ça… Il n’y a rien à faire, à part être vigilant… Bon, je dois y aller, ajouta-t-il alors d’une voix forte et claire quand il vit Marwen.
Il posa le combiné sur le crochet du téléphone et sourit à sa fille.
– Que fais-tu là vilaine ?
– Je venais juste chercher mon écharpe… dit Marwen. Qui est mort ?
– Mort ? Personne ! Oh, ce que j’ai dit au téléphone ? C’était un de mes vieux pêcheurs qui veut reprendre son métier à cause de la guerre. Je le lui ai déconseillé !
Marwen se fit la réflexion que son père n’avait jamais su mentir. Il enfila son manteau, prit son chapeau sur la patère, sa valise sur le banc de l’entrée, puis il poussa gentiment sa fille vers la sortie.
– Ne nous attardons pas ma chérie. Les cloches ont déjà sonné le départ. Je ne voudrais pas manquer le bateau !
Marwen croisa les doigts très fort sous son écharpe en espérant de tout son cœur que le bateau partirait sans son père. Même une soirée de plus ensemble lui aurait paru un bonus extraordinaire.
***
Le petit port était rempli de monde. Des familles entières étaient venues accompagner les hommes qui partaient à la guerre. Ajoutant au bruit ambiant, des mouettes ricanantes voltigeaient tout autour.
Marwen vit Monsieur le Maire qui tentait de se faire un passage dans la foule. Il faisait de larges signes dans leur direction et voulait visiblement parler au docteur Goulaouenn, mais tout le monde l’arrêtait en chemin et il se sentait obligé de serrer toutes les mains.
Finalement, il les rejoignit, le visage en sueur malgré le vent frais.
– Madame, mes hommages, fit-il avec une petite courbette qui sembla finir de lui couper le souffle.
La mère de Marwen réprima un sourire et le salua en retour. Le gros homme, d’habitude affable avec tous, ignora les enfants tant il était pressé de parler au docteur.
– Docteur ! Il faut…
Une toux l’interrompit.
– Monsieur le maire ! répondit le Dr Goulaouenn en lui tendant la main. Il va falloir soigner cette toux !
– Et comment donc, quand on me vole mon médecin ?
Une seconde quinte de toux secoua violemment le gros homme. Ses joues en tremblaient.
– Prenez votre temps, dit le père de Marwen, le bateau ne part pas encore.
Le maire avala bruyamment sa salive et reprit un peu contenance. Il sortit de la poche de son pantalon un immense mouchoir de coton blanc avec lequel il s’épongea le front puis se moucha. C’est alors qu’une bourrasque de vent s’engouffra dans le mouchoir comme dans une voile et le fit s’envoler. Il atterrit à quelques mètres de là dans une flaque boueuse. Suffoqué, le maire regarda le morceau d’étoffe souillé et irrécupérable, puis il se retourna vers le docteur et s’écria rouge de confusion :
– Quelle chaleur, docteur ! Une vraie canicule !
Marwen, malgré sa tristesse, dut se concentrer sur ses chaussures pour ne pas rire. Le docteur Goulaouenn offrit son mouchoir au maire.
– Docteur, vous êtes trop aimable ! s’exclama le gros homme de plus en plus confus. Mais gardez votre linge personnel, ça va aller.
Comme pour prouver ce qu’il venait de dire, il passa la manche de sa veste sur son front ruisselant, puis, après avoir avalé quelques bouffées d’air pour reprendre ses esprits, il continua.
– Pardonnez-moi d’interrompre vos adieux avec Madame votre épouse, mais il faut impérativement que je m’entretienne avec vous.
Il fit pour s’excuser un léger signe de tête à Mme Goulaouenn, s’accrocha au bras du docteur et l’entraîna à part pour lui parler.
Marwen n’entendit pas ce que dit le maire à son père, mais, à en juger par l’expression de ce dernier, c’était quelque chose de très sérieux. Ils discutèrent un long moment. Le maire mâchouillait sa moustache avec frénésie.
La mère de Marwen regardait nerveusement sa montre. Le maire leur volait leurs dernières minutes en famille. Marwen glissa sa main sous le bras de sa mère et lui fit son sourire le plus gai. Madame Goulaouenn regarda sa fille aînée et lut dans ses yeux que la fillette comprenait beaucoup plus de choses qu’elle ne le croyait. Elle lui fit un rapide baiser sur la joue et, pour ne pas se laisser aller aux émotions, se pencha pour ajuster la capote de la poussette de la petite sœur qui dormait.
– Nolwenn ! appela alors le docteur.
La mère de Marwen leva la tête. Le docteur lui fit signe de les rejoindre.
– Marwen, dit-elle, surveille ta sœur. Et resserre ton écharpe autour de ton cou ! Le vent est frisquet.
Marwen acquiesça avec résignation. Les adultes étaient toujours ceux à qui on racontait des histoires intéressantes. Car ce que le maire avait à raconter était visiblement bouleversant. Son impact fut d’ailleurs encore plus marqué sur la mère de Marwen que sur son père. Elle porta sa main gantée à sa bouche pour étouffer un cri, puis les yeux rivés sur le maire l’écouta avec attention.
Le docteur prit ensuite la parole. Bien qu’ils aient tous parlé à voix basse, grâce au vent, Marwen saisit quelques bribes de leur conversation.
– Ma femme est ma représentante… Elle ira vérifier pour moi…
Le docteur regarda sa femme avec inquiétude.
– … je pourrais même dire, discrétion absolue ! dit ensuite le maire.
– Vous pouvez compter sur moi, répondit Madame Goulaouenn en répondant au regard anxieux de son mari par un regard confiant.
– Je vais maintenant vous laisser à vos adieux. Pardon de cette intrusion dans un moment si important et, je pourrais même dire, si privé. Madame, à plus tard, ajouta-t-il avec une drôle de courbette… et merci !
La mère de Marwen lui répondit par un petit signe de tête poli. Le maire les laissa, l’air grave bien que soulagé, comme s’il leur avait légué un peu du poids de son grand souci. Quand il fut parti, elle se tourna vers son mari.
– Ne t’inquiète pas, lui dit-elle.
– Tu te sens capable ? demanda-t-il.
– Bien sûr ! dit-elle. Je n’ai pas ta science, mais j’ai de l’expérience.
– Je voulais dire… ça va être difficile.
– Cette fois, je suis adulte… Et ce que j’ai à faire ici n’est pas pire que ce qu’une infirmière doit faire en temps de guerre. Ne t’inquiète pas pour moi !
– Je m’inquiète pour vous, dit le docteur, les petites et toi ! Maintenant je ne suis pas tranquille de vous laisser ici toutes seules.
– Je suis sûre que tout ira bien, répondit Mme Goulaouenn avec conviction. Ne t’inquiète pas pour nous et prends soin de toi.
Ils échangèrent un long regard. Le docteur murmura quelque chose dans l’oreille de sa femme, puis il l’enlaça et tous deux rejoignirent leurs enfants.
Il était temps car les bateaux étaient tous amarrés au quai et les appelés, encombrés de valises et de paquets, commençaient à embarquer. Des femmes pleuraient silencieusement en tenant leurs enfants contre elles ; d’autres prétendaient être joyeuses et faisaient à leurs hommes de grands signes d’adieux.
Marwen alors n’y tint plus. Elle serra son père dans ses bras de toutes ses forces puis, sans un regard, s’enfuit en courant. Elle ne se retourna pas une seule fois et ne s’arrêta pour reprendre son souffle que lorsque, hors de vue, elle eut presque atteint la maison.
Quand sa mère rentra plus tard, elle ne dit rien à Marwen. Elle s’affaira dans la cuisine tandis que Marwen gardait sa petite sœur. Ses yeux rouges trahissaient son chagrin, mais à la voir préparer le dîner et ranger, on n’aurait jamais dit que son mari venait de partir à la guerre. À moins, se dit Marwen, que toute cette activité ne soit qu’une façade, une façon pour elle de ne pas s’effondrer. Après tout, c’était ce que Marwen elle-même essayait de faire en s’occupant de sa petite sœur. Mais son esprit était ailleurs…
Une fois le dîner pris et le bébé couché, Marwen était dans sa chambre à lire quand sa mère ouvrit la porte et lui expliqua qu’elle devait sortir. Elle était déjà tout habillée et tenait la mallette du Dr Goulaouenn dans sa main gantée.
– Marwen, je te laisse le bébé, dit-elle. Je dois m’absenter.
– Tu vas où ? demanda Marwen. Je n’ai entendu personne t’appeler.
– C’est confidentiel, répondit Mme Goulaouenn. Si on te le demande, réponds que tu n’en sais rien. Si jamais on vient me chercher pour un quelconque problème, prends bien note de ce qu’on te dit. Et avant d’ouvrir la porte, surtout demande bien qui est là. Si tu ne reconnais pas la personne qui te parle, prends sa commission par la fenêtre, ne la laisse pas entrer. La clé est sur le guéridon de l’entrée. Je te confie ta petite sœur. Tu as bien compris ?
– Oui… Tout ça c’est parce que c’est la guerre ? demanda Marwen.
– Quoi ? Oui, c’est parce que c’est la guerre, répondit Mme Goulaouenn.
Elle tourna les talons et laissa la porte de Marwen entrouverte.
Quand la porte d’entrée claqua, Marwen entendit sa mère la fermer à clé. De quel danger croyait-elle ainsi les protéger, sa sœur et elle ? D’habitude on ne verrouillait les portes que lorsqu’on s’absentait de chez soi pendant plusieurs jours. Une telle précaution quand la maison était occupée semblait étrange et superflue. Le monde en quelques jours, en quelques heures, avait tellement changé.
Marwen se leva de son lit. Elle enfila sa robe de chambre, ses chaussons et prit son livre. À pas de loup elle descendit l’escalier. Sa mère avait laissé la lampe du vestibule allumée. Marwen prit sur la patère le vieux gilet d’intérieur de son père et, blottie dedans, elle s’installa sur le fauteuil près de la porte d’entrée. La nuit serait longue, mais elle ferait le guet. Papa était parti, il lui avait confié sa sœur et sa mère, et il n’était pas question qu’elle lui fasse faux bond.
Quand Madame Goulaouenn rentra au petit matin, elle trouva Marwen endormie dans le fauteuil, le chandail de son père serré contre elle. Le visage de la femme du médecin, crispé par les soucis et la fatigue, se détendit en un sourire de tendresse. Elle posa sa mallette par terre, prit une couverture épaisse dans le vieux coffre en bois sculpté du vestibule et la drapa autour de Marwen. Puis elle éteignit la lampe, enleva ses chaussures et, à pas feutrés, monta à l’étage pour jeter un coup d’œil au bébé avant d’aller se coucher.
Le craquement de l’escalier réveilla Marwen. Elle entrouvrit les yeux et vit devant elle la mallette et les souliers de sa mère. Maman était bien rentrée. La nuit était passée et le jour se levait. La fillette s’extirpa du vieux fauteuil, étourdie et endolorie par sa nuit de veille. Elle monta se coucher, soulagée du retour de sa mère.
- III -
Haletante et les yeux noyés de larmes, un point douloureux lui labourant le côté, Marwen s’effondra sur le sol, le dos contre la porte de sa chambre. Elle pleura longtemps, la tête entre les mains. Sa rentrée scolaire avait été un désastre.
Ce matin-là, sa mère et sa petite sœur l’avaient conduite jusqu’au portail de l’école. Après un bref adieu, elles avaient dû la laisser, car Mme Goulaouenn avait une journée chargée devant elle.
L’école était située hors du village pour permettre aux enfants des fermes éparpillées dans la partie sud de l’île de ne pas avoir trop de route à faire. C’était un bâtiment de granit, construit sur un étage et tout en longueur. Les deux classes, celle des garçons et celle des filles, étaient séparées par un préau.
Marwen s’était jointe timidement à la foule de parents et d’enfants qui arrivaient à l’école. Des groupes joyeux et babillant se formaient autour d’elle, et Marwen se sentit seule au monde. Elle ne connaissait personne.
Son cartable et ses chaussures en cuir la démarquaient des autres enfants. La plupart avaient des sacs en toile et des sabots. D’autres avaient des galoches, qui ressemblaient à des chaussures mais avec des semelles en bois. Tout ce bois claquant sur les pavés de la cour faisait un vacarme assourdissant.
Les maîtres arrivèrent, chacun agitant une cloche, et le tintamarre se calma. Le maître de la classe des garçons (qui était aussi le directeur de l’école) s’appelait M. Renoul. Il n’avait pas été mobilisé parce qu’il avait une jambe plus courte que l’autre. Son épouse, une jeune femme au sourire chaleureux, était l’institutrice de la classe des filles. Au son des cloches, les derniers parents s’éclipsèrent et les enfants commencèrent à se mettre en rang, les garçons devant leur classe à gauche du préau et les filles devant la leur à droite.
Une fille aux joues rouges poussa brutalement Marwen et se plaça devant elle dans la file. La maîtresse qui avait vu cette manœuvre chuchota un mot à la première fillette du rang qui vint la remplacer devant la porte de la classe. L’institutrice se dirigea alors d’un pas décidé vers le bout de la file.
– Elle ne t’a pas fait mal, j’espère ? demanda-t-elle à Marwen.
Marwen secoua la tête.
– Katel Le Coven, dit ensuite la maîtresse en s’adressant à la fillette aux joues écarlates, tu commences bien l’année ! Je t’ai déjà dit de ne pas maltraiter tes camarades ! Présente immédiatement tes excuses à… Quel est ton nom ? demanda-t-elle à Marwen.
– Marwen Goulaouenn.
– Mais bien sûr ! s’exclama-t-elle avec chaleur. Tu es la fille de notre bon docteur ! Bienvenue Marwen ! Je suis ton institutrice, Mme Renoul.
La maîtresse s’adressa ensuite à la fille aux joues rouges.
– Tes excuses immédiates Katel ! Comment oses-tu si mal accueillir une nouvelle ?
Katel Le Coven se tourna vers Marwen avec réticence.
– Je l’avais pas vue, maîtresse !
– Ne sois pas insolente ! rétorqua la maîtresse.
– Mais, maîtresse, elle est si maigre !
Quelques rires fusèrent dans le rang. Katel Le Coven avait aux lèvres un sourire triomphant. L’institutrice se fâcha.
– Silence dans le rang ! Quant à toi, Katel Le Coven, tu me feras cent lignes de « Je ne maltraiterai pas mes camarades » et cent autres de « Je ne serai pas insolente quand la maîtresse me réprimande ». Et s’il y a la moindre tache d’encre, tu recommenceras jusqu’à ce qu’il n’y en ait pas ! Voilà tes récréations bien occupées pour plusieurs jours !
L’institutrice la regarda durement jusqu’à ce que l’insolente baisse les yeux, puis, lentement, elle alla reprendre sa place devant la porte, dans un silence complet. Les garçons étaient déjà entrés dans leur classe depuis un moment et la cour était vide. La maîtresse laissa errer un long regard sérieux sur le rang de fillettes embarrassées, puis d’un signe de tête elle leur indiqua de rentrer dans la classe.
Katel Le Coven, dès que la maîtresse eut tourné le dos, jeta à Marwen un regard plein de haine.
– Tu perds rien pour attendre sale petite mijaurée ! souffla-t-elle.
Marwen sut dès cet instant que, pour une raison qu’elle ignorait, cette fille agressive et rougeaude n’aurait de cesse de la tourmenter. De plus, les rires dans le rang suggéraient qu’elle avait des complices dans la classe. Les choses ne se présentaient pas bien pour Marwen.
***
Mis à part les nombreuses grimaces et regards haineux que Katel Le Coven lui jetait dès qu’elle le pouvait, le reste de la journée se déroula sans incident. Mais dans la cour, à la récréation, bien que Katel soit restée en colle à l’intérieur, Marwen se retrouva seule. Toutes les fillettes se connaissaient déjà et aucune d’elles ne vint lui parler. Elle les regarda sauter à la corde, tandis que les garçons à l’autre bout de la cour jouaient aux billes. Elle n’osa même pas aller aux toilettes, car celles-ci ne fermaient pas à clé et elle n’avait personne pour lui « tenir la porte ».
En classe, elle fut placée par Mme Renoul à un pupitre double juste en face de son bureau.
– Comme ça, dit l’institutrice avec douceur, je ne serai pas loin de toi si tu as besoin de quelque chose. Je te changerai de place après les premières compositions.
Elle entendit des filles derrière elle chuchoter quelque chose à propos du « banc des simplettes ». Marwen ne comprit pas ce dont elles parlaient, mais elle vit bien qu’elles se moquaient d’elle.
Le soir, dès que la cloche sonna, elle attrapa son cartable et sortit sans demander son reste. Le portail à peine dépassé, elle prit ses jambes à son cou et courut presque tout le chemin du retour, comme si, en laissant l’école derrière elle le plus vite possible, elle pouvait se détacher de tous les chagrins de la journée.
Devant la porte de sa maison, ébouriffée, le cœur lourd et à bout de souffle, elle essaya de se composer un visage plus tranquille. Mais, la porte franchie, elle trouva la maison vide. Un mot de sa mère dans l’entrée lui expliquait que sa petite sœur était chez sa nourrice et qu’elle-même avait dû partir rendre visite à un patient. Le goûter était prêt dans le cellier.
Marwen n’avait pas faim. Elle avait juste envie de l’épaule rassurante de son père, de la présence de sa mère et des piaillements familiers de sa sœur. Besoin d’une maison accueillante après sa rude journée.
Une énorme envie de pleurer, longtemps réprimée, la submergea. Elle monta l’escalier quatre à quatre et, à peine sa porte de chambre fermée, elle s’effondra en larmes.
***
Quand Marwen se fut un peu calmée, elle se leva, essuya ses larmes et lissa sa blouse froissée. On entendait dehors des voix imprécises mais la maison était tranquille. Elle était seule chez elle et se sentait si isolée à cet instant qu’elle aurait pu tout aussi bien être seule au monde.
Elle sentit le Manac’h auprès d’elle, mais sa présence ne lui apporta nul réconfort. C’était un compagnon extraordinairement fidèle, mais si mystérieux et discret que son rapport avec Marwen était plus proche de celui qu’on entretient avec son ombre que de celui qu’on a avec son chien.
Marwen aurait aimé pouvoir invoquer son aide, mais elle n’avait aucune autorité sur lui. Il était sans substance, comme une brume ou un fantôme. Elle ne le percevait que vaguement, comme une nappe un peu floue à la lumière du soleil ou comme une lueur plus ou moins trouble dans l’ombre de la nuit. Elle ne pouvait ni compter sur lui, ni lui en vouloir de ne pas l’aider. Il n’était ni une personne, ni un animal, ni une chose. Et pourtant il existait.
Qui était-il ? Elle n’en avait pas la moindre idée. Elle savait juste qu’il était toujours auprès d’elle et que dans certains moments de peur ou de détresse extrêmes elle l’avait ressenti comme un allié. Toutes les fois qu’elle avait été malade, il l’avait veillée. Du plus loin qu’elle se souvienne, il avait toujours été à ses côtés, silencieux et loyal bien que totalement invisible aux autres. Elle l’acceptait comme on accepte une partie de soi, tout en étant parfois intensément consciente qu’il était une énigme détachée d’elle.
Très jeune, elle avait appris à ne pas parler de lui. Au tout début ses parents et ses proches l’avaient toléré, pensant que, comme beaucoup d’enfants, elle s’était inventé un camarade imaginaire. Mais en grandissant, elle avait dû se rendre à l’évidence que personne d’autre qu’elle ne le voyait. Il lui était aussi apparu très vite évident que nul autre qu’elle ne possédait un Manac’h.
Un médecin, consulté lors d’une de ses nombreuses maladies, avait émis l’hypothèse qu’elle souffrait d’une sorte de fièvre perpétuelle accompagnée d’hallucinations. Il avait suggéré de la faire hospitaliser. Marwen n’avait pas bien compris de quoi il parlait, mais le soir même son père l’avait prise à part et lui avait conseillé de garder pour elle son ami imaginaire et de ne plus jamais en parler. Il lui avait donné un carnet à secrets, avec un verrou et une clé, pour qu’elle puisse y écrire ce qu’elle ressentait, mais Marwen ne s’en était jamais servi. Elle avait bien essayé d’expliquer le Manac’h à son père, mais comment expliquer ce qu’elle ne comprenait pas elle-même ?
Par nécessité, le Manac’h était donc devenu son secret.
Elle ne pouvait imaginer qu’un jour elle rencontrerait quelqu’un à qui elle pourrait en parler ; encore moins quelqu’un qui la comprendrait…
***
Le soir de la rentrée scolaire, la mère de Marwen rentra assez tard. Elle venait de passer chez la nourrice et portait dans ses bras Anaïk, qui somnolait déjà. Sans tarder, elle mit le bébé en pyjama et le coucha. Puis elle descendit rejoindre Marwen pour le dîner.
– Ça promet d’être difficile ! dit-elle en entrant dans la cuisine. Avec ton père absent, j’ai un emploi du temps épouvantable. Et ce n’est même pas encore l’hiver !
– Je ne savais pas quoi préparer pour le dîner, dit Marwen.
– Ne t’inquiète pas, répondit sa mère. J’ai ramené des œufs et du lard de la ferme du vieux Gabier, et il nous reste une laitue dans le cellier.
Elle se lava soigneusement les mains dans l’évier en porcelaine.
– On va manger une omelette au lard avec de la salade. As-tu pensé au pain ?
Marwen rougit.
– Pardon ! dit-elle. J’ai oublié.
Sa mère eut un geste d’impatience puis se reprit et regarda sa fille avec attention.
– Dure journée ?
Marwen détourna les yeux.
– Ça ira…
– C’est toujours difficile de démarrer quelque chose de nouveau, dit sa mère. Il faut s’armer de patience et les choses s’arrangent avec le temps… Mais, en attendant, nous sommes fatiguées et il nous faut manger ! Je fais l’omelette et tu prépares la salade.
Marwen alla chercher la laitue dans le cellier, petit réduit sombre et frais attenant à la cuisine, puis elle entreprit d’éplucher la salade et de la laver.
– Au fait, une bonne nouvelle, annonça Mme Goulaouenn en battant les œufs dans un bol avant de les verser dans la poêle où doraient déjà les lardons. À partir de la semaine prochaine, la fille de Jeanne, qui a juste vingt ans, va venir tenir la maison. C’est une fille honnête et travailleuse comme sa mère.
Elle se tourna vers Marwen et lui sourit.
– Tu ne trouveras plus la maison vide en rentrant le soir, continua-t-elle, et je n’aurai plus à m’occuper du ménage et de la cuisine !