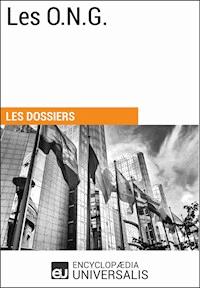
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Institutions devenues omniprésentes dans le domaine international, les O.N.G. (organisations non gouvernementales) rassemblent sous une même étiquette une multitude de structures : associations d’action humanitaire, d’aide au développement, de défense des droits de l’homme, de protection de l’environnement… Les O.N.G. sont considérées comme des intervenantes utiles, voire indispensables, par les organisations intergouvernementales, même si leur indépendance de vue peut et doit irriter tel ou tel État particulier.
Ce
Dossier Universalis, composé d’articles empruntés au fonds de l’Encyclopædia Universalis, rend compte de ces aspects multiples, du droit à la politique et à l’action humanitaire, en se fondant sur des exemples, comme ceux de la Croix-Rouge, du W.W.F., d’Amnesty International ou de Médecins sans frontières.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 69
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782341002240
© Encyclopædia Universalis France, 2019. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Symbiot/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Bienvenue dans ce dossier, consacré aux O.N.G., publié par Encyclopædia Universalis.
Vous pouvez accéder simplement aux articles de ce dossier à partir de la Table des matières.Pour une recherche plus ciblée, utilisez l’Index, qui analyse avec précision le contenu des articles et multiplie les accès aux sujets traités.
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
Les O.N.G.
Institutions devenues omniprésentes dans le domaine international, les O.N.G. (organisations non gouvernementales) rassemblent sous une même étiquette une multitude de structures, étant donné l’absence de définition juridique ou de statut commun : associations d’action humanitaire, d’aide au développement, de défense des droits de l’homme, de protection de l’environnement, à vocation culturelle…
Les O.N.G. occupent de nombreux secteurs de l’activité humaine et sont considérées comme des intervenants utiles voire indispensables par les organisations intergouvernementales, même si leur indépendance de vue peut et doit irriter tel ou tel État particulier.
E.U.
O.N.G. (organisations non gouvernementales)
Le sigle O.N.G. apparaît pour la première fois dans la Charte des Nations unies de 1945. La version française de l’article 71 précise que « le Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions utiles pour consulter les organisations non gouvernementales qui s’occupent de questions relatives à sa compétence. Ces dispositions peuvent s’appliquer à des organisations internationales et, s’il y a lieu à des organisations nationales, après consultation du membre intéressé de l’Organisation ». Ce faisant, la Charte distingue expressément deux catégories d’O.N.G. ; d’une part, les « organisations internationales non gouvernementales » (O.I.N.G.), d’autre part, les organisations non gouvernementales locales, dont l’accréditation officielle dépend de l’aval de l’État, ce qui introduit d’emblée une hypothèque sur leur statut. Même si la portée de l’article 71 instituant un statut consultatif est limité au champ de compétences du Conseil économique et social, les O.N.G. vont jouer un rôle important dans l’ensemble du système des Nations unies et au-delà dans toute la vie internationale. Les O.N.G. sont aujourd’hui des acteurs majeurs des relations internationales auprès des États et des organisations intergouvernementales, qui restent formellement les seuls sujets du droit international – « sujets primaires » dans le cas des États, « sujets secondaires » dans le cas des organisations internationales nées de la volonté des États. Face à ces deux sujets identifiés et reconnus, les O.N.G. forment une nébuleuse, dont la diversité et la complexité vont de pair avec l’absence de définition juridique ou de statut commun.
Si l’expression O.N.G. est récente, le phénomène est beaucoup plus ancien. À côté des relations entre entités politiques, notamment les États, se sont toujours développées les activités privées et les initiatives individuelles les plus diverses. Il suffit de penser aux ordres religieux, aux œuvres caritatives, aux sociétés savantes ou aux compagnies privées. Au XIXe siècle encore, à côté des grandes internationales ouvrières et des mouvements philanthropiques, c’est Henry Dunant qui fonde la Croix-Rouge internationale et Pierre de Coubertin qui restaure le mouvement olympique. Alfred Nobel institue les prix qui porteront son nom et Andrew Carnegie multiplie les fondations et construit le palais de la Paix de La Haye.
Un juriste américain, Philip Jessup, a parlé de « droit transnational » pour évoquer cette multiplicité d’échanges transfrontières qui dépassaient les relations interétatiques du droit international public classique. De son côté, le juriste français Georges Scelle a rajeuni la vieille notion de « droit des gens » pour mettre les individus au cœur du commerce international. Mais il serait réducteur d’assimiler tous les « acteurs non étatiques » des relations internationales à des O.N.G. Il faut sans doute revenir à la distinction introduite entre société politique et « société civile », alors que depuis Aristote jusqu’à Locke ces deux notions étaient confondues, societas civilis étant l’expression de la communauté politique. C’est avec les Principes de philosophie du droit d’Hegel que l’opposition entre société civile et État se trouve formalisée, avant d’être développée par toute la sociologie du XIXe siècle, de Karl Marx à Auguste Comte. Aujourd’hui c’est une vision tripartite qui prévaut, avec face à la « société politique » – le monde des États et des organisations intergouvernementales – une « société économique » dominée par les entreprises multinationales, qui doit elle-même être distinguée de la « société civile » proprement dite, même si ces trois sphères ne sont pas sans interférences, comme le montre la place prise par les grandes fondations privées, telles que la Fondation Soros ou la Fondation Bill Gates, dans la vie des O.N.G. comme dans celle des États et des organisations intergouvernementales. Cette distinction a du moins le mérite de faire apparaître la vocation non lucrative des O.N.G., en les distinguant ainsi des entreprises ayant pour objet la recherche du profit.
• Éléments de définition et régime juridique
C’est le sens des définitions juridiques qui ont été données par l’Institut de droit international – lui-même une O.N.G. savante fondée en 1873 – lors de travaux menés sur la base d’un rapport de Nicolas Politis pour élaborer un « projet de convention relative à la condition juridique des associations internationales ». Le texte adopté en 1923 soulignait « l’intérêt général de la Communauté internationale de favoriser le développement des associations internationales sans but lucratif ». En 1950, sur un rapport de Suzanne Bastid, le même Institut devait revenir sur « les conditions d’attribution d’un statut international à des associations d’initiative privée », en donnant cette définition : « Les associations internationales [...] sont des groupements de personnes ou de collectivités, librement créés par l’initiative privée, qui exercent sans esprit de lucre, une activité internationale d’intérêt général, en dehors de toute préoccupation d’ordre exclusivement national ».
La Convention européenne (no 124) sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales a été adoptée le 24 avril 1986 dans le cadre du Conseil de l’Europe. Selon son article premier, cette Convention « s’applique aux associations, fondations et autres institutions privées (ci-après dénommées O.N.G.) qui remplissent les conditions suivantes :
a) avoir un but non lucratif d’utilité internationale ;
b) avoir été créées par un acte relevant du droit interne d’un État contractant ;
c) exercer une activité effective dans au moins deux États ;
d) avoir leur siège statutaire sur le territoire d’un État contractant et leur siège réel dans cet État ou dans un autre État contractant ».
En dehors de dispositions spécifiques visant le caractère régional du Conseil de l’Europe et la vocation de la convention à ne régir que les relations entre États parties – au nombre de onze en 2008, dont la France, le Royaume-Uni, la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas et l’Autriche qui sont le siège d’importantes O.N.G. – l’idée fondamentale est la même ramassée dans la notion de « but non lucratif d’utilité internationale ». Les éléments ainsi dégagés au fil de ces trois textes de référence – les uns de nature privée, le dernier de portée régionale – restent pertinents pour définir de manière plus générale les organisations internationales non gouvernementales, en mettant l’accent sur plusieurs critères cumulatifs.
D’abord, leur caractère international, par opposition aux associations d’intérêt local. Non seulement les O.N.G. doivent avoir des membres dans plusieurs pays, mais leurs activités doivent également avoir une dimension internationale. Elles doivent « poursuivre un but d’intérêt international » ou encore « avoir une activité internationale d’intérêt général, en dehors de toute préoccupation d’ordre exclusivement national ». Reste à déterminer le nombre minimal de pays concernés. L’Union des associations internationales requiert des activités dans trois pays au moins, ce qui exclurait les jumelages. La convention européenne précitée se contente d’une « activité effective dans au moins deux États ».





























