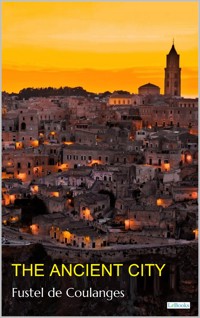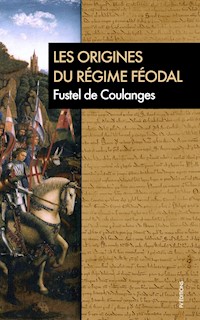
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FV Éditions
- Sprache: Französisch
La manière dont les populations de la Gaule sont passées du régime politique que Rome leur avait donné au régime féodal est un des plus graves problèmes que la science historique ait à résoudre. Il n’est jamais aisé de saisir les causes qui font qu’une société se transforme ; mais ce qui rend ici le problème particulièrement difficile, c’est la complexité des faits au milieu desquels cette transformation s’est accomplie. En effet, deux séries d’événements se sont déroulées dans le même espace de temps. D’une part, il y a eu dans la Gaule des migrations d’étrangers, des incursions de barbares, des invasions dévastatrices et un déplacement de l’autorité publique ; de l’autre, il y a eu une longue suite de changements dans les institutions, dans les mœurs, dans le droit, dans toutes les habitudes de la vie publique et privée. La coïncidence entre ces deux séries d’événements est incontestable ; mais il reste encore à chercher quelle relation il y a eu entre elles.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Les Origines du régime féodal
Fustel De Coulanges
Table des matières
LA PROPRIETE FONCIERE DANS L’EMPIRE ROMAIN ET DANS LA SOCIETE MEROVINGIENNE.
Avant-propos
1. DU DROIT DE PROPRIETE DANS L’EMPIRE ROMAIN.
2. DU DROIT DE PROPRIETE DANS LA SOCIETE GALLO-FRANQUE.
3. DE LA POSSESSION BENEFICIAIRE DANS L’EMPIRE ROMAIN.
4. DE LA POSSESSION BENEFICIAIRE DANS LA SOCIETE GALLO-FRANQUE.
LE PATRONAGE ET LA FIDÉLITÉ.
Avant-propos
1. LE PATRONAGE CHEZ LES GAULOIS, DANS L’EMPIRE ROMAIN, CHEZ LES GERMAINS.
2. LE PATRONAGE ET LA FIDÉLITÉ AU TEMPS DES MÉROVINGIENS.
3. POURQUOI LE REGIME FEODAL A PREVALU.
4. DU PATRONAGE ET DE LA FIDÉLITÉ APRÈS CHARLEMAGNE.
LA PROPRIETE FONCIERE DANS L’EMPIRE ROMAIN ET DANS LA SOCIETE MEROVINGIENNE.
i. Gromatiei veteres, édit. Lachmann, Berlin 1848. — II. Digato, édit. Mommeen, Berlin 1870. — III. Codex theodosianus, édit. O. Hœnel, 1842. — IV. Diplomata, chartœ, édit Pardessus. — V. Pardessus, La loi salique. — VI. Recueil des formules usitées dans l’empire des Francs, par M. E. de Rozière, 1859-1871. — VII. M. Guizot, Essais sur l’histoire de France ; Histoire de la civilisation en France. — VIII. M. Naudet, De la noblesse chez les Romains, 1863 ; De la noblesse citez les Francs, dans les Mém. de l’Ac. des Inscr. — IX. M. Ch. Giraud, Recherches sur le droit de propriété dans l’empire romain. — X. M. Laboulaye, Histoire du droit de propriété en Occident. — XI. Guérard, Polyptyque de l’abbé Irminon. — XIL Pétigny, Études sur l’époque mérovingienne. — XIII. G. Waitz, Die Deutsche Verfassungsgeschichte.
La manière dont les populations de la Gaule sont passées du régime politique que Rome leur avait donné au régime féodal est un des plus graves problèmes que la science historique ait à résoudre. Il n’est jamais aisé de saisir les causes qui font qu’une société se transforme ; mais ce qui rend ici le problème particulièrement difficile, c’est la complexité des faits au milieu desquels cette transformation s’est accomplie. En effet, deux séries d’événements se sont déroulées dans le même espace de temps. D’une part, il y a eu dans la Gaule des migrations d’étrangers, des incursions de barbares, des invasions dévastatrices et un déplacement de l’autorité publique ; de l’autre, il y a eu une longue suite de changements dans les institutions, dans les mœurs, dans le droit, dans toutes les habitudes de la vie publique et privée. L’entrée des Germains s’est opérée lentement depuis le IIIe siècle jusqu’au VIIIe, et c’est à peu près dans le même espace de temps que se sont produites les modifications successives qui ont abouti au régime féodal.
La coïncidence entre ces deux séries d’événements est incontestable ; mais il reste encore à chercher quelle relation il y a eu entre elles. Trois choses sont possibles. Il se peut que l’invasion germanique ait engendré le régime féodal, les nouveau-venus l’ayant apporté avec eux et imposé par la force à des populations vaincues et asservies. Il se peut aussi que les deux événements, bien qu’ils fussent simultanés, n’aient eu aucune action l’un sur l’autre, et que le régime féodal soit né de causes étrangères à l’invasion, de germes qui existaient avant elle. Il se peut enfin que la vérité soit entre ces deux extrêmes, que l’entrée des Germains dans les pays de l’empire n’ait pas été la cause génératrice de cette grande révolution sociale, mais n’y soit pas non plus demeurée étrangère, que ces Germains y aient coopéré, qu’ils aient aidé à l’accomplir, qu’ils l’aient rendue inévitable alors que sans eux les peuples y auraient peut-être échappé, et qu’ils aient imprimé au régime nouveau quelques traits qu’il n’aurait pas eus sans eux.
La première de ces trois explications est celle qui se présente tout d’abord. à l’esprit. Au XVIIe siècle, quand le régime féodal, dépouillé de ses caractères essentiels, ne se présentait plus qu’avec les dehors d’un pouvoir violent et oppressif, il parut tout naturel d’en attribuer l’origine à l’oppression et aux violences d’une conquête. Cependant, si nous nous reportons aux documents contemporains, aux chroniques, aux vies des saints, aux textes législatifs, aux actes de la vie privée, nous ne pouvons manquer d’être frappés de cette remarque, qu’aucun d’eux ne mentionne une véritable conquête du pays. Ils signalent des ravages, des désordres, des invasions, des luttes entre des cités gauloises et des bandes germaines, et plus souvent encore des luttes de Germains entre eux ; mais ils ne rapportent jamais rien qui ressemble à une guerre nationale ou à une guerre de races1, et ils ne dépeignent non plus jamais l’assujettissement d’une population indigène à une population étrangère. On n’y reconnaît aucun des traits précis qui caractérisent la conquête en tout temps et en tout pays. On n’y trouve rien de semblable à ce que firent les Anglo-Saxons en Grande-Bretagne, les Lombards en Italie, les Ottomans en Grèce. Il n’y a pas d’indice que les Gallo-Romains aient été dépouillés de leurs terres. Ils ne furent pas asservis ; il ne semble même pas qu’ils aient été politiquement subordonnés. Dans les conseils des rois, dans les armées, dans les fonctions publiques, dans les tribunaux, dans les assemblées nationales elles-mêmes, les deux populations étaient mêlées et confondues. Les chroniqueurs montrent sans cesse l’homme de race franque à côté de l’homme de race gauloise, et ils n’indiquent jamais que le premier eût des droits politiques supérieurs, ni que sa naissance franque lui valût une considération particulière. Les Gaulois étaient soumis à des rois francs ; mais nous ne voyons à aucun signe qu’ils fussent soumis à la race franque2. Il y avait des hommes libres dans les deux populations ; dans les deux populations, il y avait des esclaves. Grégoire de Tours parle fréquemment d’une aristocratie ; les hommes qu’il appelle des grands ou des nobles sont plus souvent des Gaulois que des Francs ; l’état social dont il trace le tableau n’est assurément pas celui qu’une conquête aurait produit.
Les générations modernes ont dans l’esprit deux idées préconçues sur la manière dont se fondent les gouvernements. Elles sont portées à croire tantôt qu’ils sont l’œuvre de la force seule et de la violence, tantôt qu’ils sont une création de la raison. Elles les font dériver des plus mauvaises passions de l’homme, à moins qu’elles n’imaginent de les faire descendre des régions de l’idéal. C’est une double erreur : l’origine des institutions sociales et politiques ne doit être cherchée ni si bas ni si haut. La violence ne saurait les établir ; les règles de la raison sont impuissantes à les créer. Entre la force brutale et les vaines utopies, dans la région moyenne où l’homme se meut et vit, se trouvent les intérêts. Ce sont eux qui font les institutions et qui décident de la manière dont un peuple est gouverné. Il est bien vrai que dans un premier âge de l’humanité les sociétés ont pu être dominées par des croyances ou par des sentiments puissants sur l’âme ; mais il y a vingt-cinq siècles que l’humanité a pris un autre cours. Depuis ce temps, les intérêts furent toujours la règle de la politique : aussi ne voit-on pas d’exemple d’un système d’institutions qui ait duré sans qu’il ait été en conformité avec eux. L’ordre social de chaque siècle et de chaque peuple est celui que les intérêts constituent. Ce sont eux qui élèvent ou qui renversent les régimes politiques. La violence des usurpateurs, le génie des grands hommes, la volonté même des peuples, tout cela compte pour peu de chose dans ces grands monuments qui ne se construisent que par l’effort continu des générations, et qui ne tombent aussi que d’une chute lente et souvent insensible. Si l’on veut s’expliquer comment ils se sont édifiés, il faut regarder comment les intérêts se sont groupés et assis ; si l’on veut savoir pourquoi ils sont tombés, il faut chercher comment ces mêmes intérêts se sont transformés ou déplacés. C’est une étude de cette nature que nous allons tenter de faire sur la Gaule ; afin d’entrevoir comment les populations de ce pays sont passées, par une lente transition, du régime impérial romain au régime féodal, nous observerons comment les intérêts étaient constitués au début de cette période de transition, et comment ils se sont peu à peu modifiés.
Dans l’empire romain, presque tous les intérêts étaient attachés au sol. Il ne faut pas nous faire de cette société l’idée que nous donnent les sociétés d’aujourd’hui. L’empire romain n’a ressemblé presque en aucune chose aux états de l’Europe moderne. L’un des traits qui le distinguent d’eux est que, durant les cinq siècles de son existence et les quatre siècles de sa réelle prospérité, il n’engendra pas ce que nous appelons aujourd’hui la richesse mobilière. Le sol resta toujours, dans cette société, la source principale et surtout la mesure unique de la fortune. Ce n’est pas qu’il n’y eût du commerce, de l’industrie, des professions à la fois honorables et lucratives ; mais il ne sortit jamais de tout cela une classe puissante comme celle que l’on voit dans les états modernes. Le commerçant, le banquier, l’industriel, pouvaient avoir individuellement une existence opulente ; ils ne constituaient pas comme de nos jours une force sociale ; ils ne formaient pas un groupe d’intérêts et un faisceau de valeurs avec lequel l’état dût compter et qui pût exercer quelque action sur la nature du gouvernement. C’est pour ce motif que les peuples soumis à l’empire romain eurent d’autres besoins que nous et ne réclamèrent jamais les institutions qui sont devenues nécessaires aux nations modernes.
Ce qu’on dit quelquefois de la prééminence des cités sur les campagnes dans la société romaine tient à une erreur de mots. Une cité était alors la réunion de la campagne et de la ville ; on ne distinguait pas l’une de l’autre. Les hommes ne se partageaient pas, comme de nos jours, en une population urbaine et une population rurale. Les circonscriptions administratives ne se réglaient pas sur une distinction de cette nature. Ce qu’on appelait un vicus ou un village était une partie intégrante de la civitas, et l’habitant du village était un membre de la cité. Le vrai citoyen, celui qu’on appelait curiale, était un propriétaire foncier ; il devait posséder au moins 25 arpens de terre. Il ne ressemblait pas au bourgeois du moyen âge à qui il suffisait d’avoir pignon sur rue, moins encore au bourgeois d’aujourd’hui qui peut enfermer toute sa fortune dans un portefeuille. C’était un homme qui avait des champs au soleil ; il était membre du corps municipal parce qu’il possédait une part du sol de la cité.
L’importance qu’avait le sol à cette époque se montre à nous par plusieurs symptômes. C’était sur lui que pesait la plus lourde part de l’impôt, parce qu’il était la principale richesse ; c’était de lui aussi que venait la considération. Qui n’était pas propriétaire comptait pour peu de chose. Les classes industrielles étaient reléguées dans ce qu’on appelait encore la plèbe : les commerçants aspiraient à s’en distinguer ; mais tout au plus établissait-on en leur faveur, dans la hiérarchie sociale de ce temps-là un degré intermédiaire entre la plèbe proprement dite et la classe des propriétaires. Ceux-ci portaient le poids des contributions et des charges publiques ; mais ils avaient en compensation la direction absolue des affaires municipales. A eux appartenaient de droit les magistratures, les sacerdoces, les fonctions judiciaires, tout ce qui donnait la dignité ou l’éclat à la vie. Chaque ville était administrée par sa curie, c’est-à-dire par le corps des propriétaires fonciers.
A la fin de l’empire, il existait dans toutes les provinces une classe aristocratique que l’on appelait l’ordre des sénateurs. Elle possédait des privilèges et supportait aussi des charges spéciales. Elle était héréditaire et aussi indépendante du gouvernement qu’on pouvait l’être dans un état où les mœurs étaient monarchiques autant que les lois. Ces sénateurs n’étaient autres que les plus riches parmi les propriétaires du sol. On peut voir dans les lois romaines que, pour entrer dans cet ordre, il fallait réunir plusieurs conditions, dont la principale était de posséder une grande fortune territoriale, et que l’on n’en sortait que si l’on avait perdu cette fortune. Les écrivains du Ve et du VIe siècle mentionnent fréquemment des familles sénatoriales ; ce sont toujours des familles riches en biens fonciers. Nous pouvons voir encore dans les lettres de Sidoine Apollinaire ce qu’était la classe élevée en ce temps-là Elle se composait de grands propriétaires qui possédaient de véritables châteaux entourés de vastes domaines. Ils y vivaient au milieu d’une foule nombreuse de clients, de serviteurs, de colons ; ils partageaient leur temps entre les soins de l’exploitation rurale et les plaisirs de la chasse ou de la littérature. Pendant plusieurs mois De l’année, ils quittaient leur résidence de campagne pour habiter leur maison de ville. Ils exerçaient les magistratures urbaines : quelques-uns les briguaient et se les disputaient ; d’autres les fuyaient au contraire et auraient voulu y échapper, mais les convenances, la mode, les sollicitations des amis les ramenaient incessamment vers elles, et au besoin les lois elles-mêmes les obligeaient à les remplir. Il est à remarquer aussi que c’était parmi ces grands propriétaires que l’empire allait chercher ordinairement ses fonctionnaires de l’ordre le plus élevé, au lieu de les prendre par voie d’avancement parmi les employés subalternes de ses administrations. Ces riches sénateurs de province devenaient aisément consuls, présidents, recteurs, préfets du prétoire. Ils prenaient part de cette façon à l’autorité politique et formaient la classe dirigeante. Un peu plus tard et pour les mêmes motifs, la population choisit parmi eux les évêques. Ainsi, même en face du gouvernement impérial, la terre était une puissance, et c’était elle qui donnait la plus sûre noblesse ; à l’exception des grades de l’armée, tout venait d’elle et se rattachait à elle. La propriété foncière était la grande force sociale et pour ainsi dire l’âme du corps de l’empire.