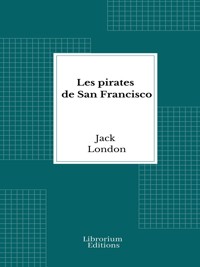
0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
La baie de San Francisco est si vaste que ses tempêtes s’avèrent souvent plus désastreuses pour les grands navires que l’Océan déchaîné. Ses eaux contiennent toutes sortes de poissons, aussi sa surface est-elle continuellement sillonnée par toutes sortes de bateaux de pêche pilotés par toutes sortes de pêcheurs. Pour protéger la faune marine contre une population flottante aussi bigarrée, des lois pleines de sagesse ont été promulguées, et une Patrouille de Pêche veille à leur exécution.
La vie des patrouilleurs ne manque certes pas d’émotions : maints d’entre eux ont trouvé la mort dans l’accomplissement de leur devoir, et un nombre encore plus considérable de pêcheurs, pris en flagrant délit, sont tombés sous les balles des défenseurs de la loi.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Jack London
LES PIRATES DE SAN FRANCISCO
Patrouille de pêche
1905
Traduction de Louis Postif
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782385741624
1“Mouchoir jaune1”
La baie de San Francisco est si vaste que ses tempêtes s’avèrent souvent plus désastreuses pour les grands navires que l’Océan déchaîné. Ses eaux contiennent toutes sortes de poissons, aussi sa surface est-elle continuellement sillonnée par toutes sortes de bateaux de pêche pilotés par toutes sortes de pêcheurs. Pour protéger la faune marine contre une population flottante aussi bigarrée, des lois pleines de sagesse ont été promulguées, et une Patrouille de Pêche veille à leur exécution.
La vie des patrouilleurs ne manque certes pas d’émotions : maints d’entre eux ont trouvé la mort dans l’accomplissement de leur devoir, et un nombre encore plus considérable de pêcheurs, pris en flagrant délit, sont tombés sous les balles des défenseurs de la loi.
Les pêcheurs de crevettes chinois comptent parmi les plus intrépides de ces délinquants. Les crevettes vivent en vastes colonies et se traînent sur les bancs de vase. Lorsqu’elles rencontrent l’eau douce à l’embouchure d’un fleuve, elles font demi-tour pour revenir vers l’eau salée. À ces endroits, quand le flot s’étale et se retire à chaque marée, les Chinois plongent de grandes nasses : les crevettes s’y font prendre pour être ensuite transférées à la marmite.
En soi, ce mode de pêche n’aurait rien de bien répréhensible, n’était la finesse des mailles des filets employés ; leur réseau est si ténu que les plus petites crevettes, celles qui viennent d’éclore et ne mesurent pas encore un centimètre de long, ne peuvent s’échapper. Les plages magnifiques des caps San Pablo et San Pedro, où se trouvent des villages entiers de pêcheurs de crevettes, sont infestées par la puanteur qui s’exhale des rebuts de la pêche. Le rôle des patrouilleurs consiste à empêcher cette destruction inutile.
À seize ans, j’étais déjà un bon marin et je naviguais dans toute la baie de San Francisco sur le Reindeer, un sloop de la Commission de Pêche, car j’appartenais alors à la fameuse patrouille.
Après un travail harassant parmi les pêcheurs grecs de la partie supérieure de la baie, où trop souvent l’éclair d’un poignard luisait au début d’une bagarre, et où les contrevenants ne se laissaient arrêter que le revolver sous le nez, ce fut avec joie que nous accueillîmes l’ordre de nous diriger un peu plus au sud pour faire la chasse aux pêcheurs de crevettes chinois.
Nous étions au nombre de six, dans deux bateaux, et, afin de ne point éveiller les soupçons, nous attendîmes le crépuscule avant de nous mettre en route. Nous jetâmes l’ancre à l’abri d’un promontoire connu sous le nom de cap Pinole. Lorsque l’Orient pâlit des premières lueurs de l’aube nous reprîmes notre voyage, et serrâmes de près le vent de terre en traversant obliquement la baie vers le cap San Pedro. La brume matinale, épaisse au-dessus de l’eau, nous empêchait de rien voir, mais nous nous réchauffâmes par l’absorption de café bouillant. Il fallut également nous livrer à la tâche ingrate d’écoper l’eau de notre bateau ; en effet, une voie d’eau s’était ouverte à bord du Reindeer. Je ne m’explique pas comment elle s’était produite, mais nous passâmes la moitié de la nuit à déplacer le ballast et à explorer les joints, sans en être plus avancés. L’eau continuant d’arriver, nous dûmes doubler le quart dans le cockpit et la rejeter par-dessus bord.
Après le café, trois de nos hommes montèrent sur l’autre embarcation, un bateau pour la pêche au saumon, et nous ne restâmes que deux sur le Reindeer. Les deux bateaux avancèrent de conserve jusqu’à ce que le soleil parût à l’horizon dispersant la brume : la flottille des pêcheurs de crevettes se déployait en forme de croissant dont les pointes se trouvaient à environ cinq kilomètres l’une de l’autre. Chaque jonque était amarrée à la bouée d’un filet à crevettes. Mais rien ne bougeait et on ne distinguait aucun signe de vie.
Nous devinâmes bientôt ce qui se préparait. En attendant que la mer fût étale pour tirer de l’eau leurs filets lourds de poissons, les Chinois dormaient au fond de leurs embarcations. Tout joyeux, nous dressâmes aussitôt un plan de bataille.
— Que chacun de vos deux hommes attaque une des jonques, me souffla Le Grant, de l’autre bateau. Vous-même sautez dans une troisième. Nous ferons de même et rien ne nous empêchera de prendre au moins six jonques à la fois.
Nous nous séparâmes. Je plaçai le Reindeer à l’autre amure et courus sous le vent d’une jonque. En approchant, je masquai la grand-voile, cassai mon erre et parvins à glisser sous la poupe de la jonque, si lentement et si près qu’un de mes hommes sauta à bord. Puis, je laissai porter, ma grand-voile se gonfla et je me dirigeai vers une seconde jonque.
Jusqu’ici tout s’était passé sans bruit, mais, de la première jonque capturée par le bateau de mes compagnons, un tintamarre s’éleva : des cris aigus en langue orientale, un coup de revolver et des hurlements redoublés.
— La mèche est éventée. Ils préviennent leurs camarades, me dit Georges, l’autre patrouilleur qui se tenait près de moi dans le cockpit.
Nous nous trouvions maintenant au beau milieu de la flottille et, avec une vitesse incroyable, la nouvelle de notre présence s’était propagée. Les ponts fourmillaient de Chinois à demi nus et à peine éveillés. Des cris d’alarme et des hurlements de colère flottaient au-dessus de l’eau calme, et bientôt éclatait le son d’une conque marine. À notre droite, le capitaine d’une jonque, armé d’une hache, coupa l’amarre, puis courut pour aider ses hommes d’équipage à hisser leur extraordinaire voile au tiers. Mais à notre gauche, dans une autre jonque, les pêcheurs commençaient seulement d’apparaître sur le pont. Je dirigeai le Reindeer vers cette embarcation, assez lentement pour permettre à Georges de sauter à son bord.
À présent, toute la flottille était en mouvement. Outre leurs voiles, les Chinois avaient tiré de longs avirons et la baie était sillonnée en tous sens de jonques en fuite. Désormais je me trouvais seul à bord du Reindeer, essayant fiévreusement de capturer une troisième jonque. La première que j’essayai d’attraper m’échappa sans peine, car elle borda ses voiles à fond et avança de façon surprenante dans le vent. Elle rentrait au vent d’un bon demi-quart de plus que le Reindeer, et je commençais à concevoir un certain respect pour cet esquif dénué de grâce. Comprenant l’inutilité de la poursuite, je laissai porter, choquai l’écoute de grand-voile et me dirigeai grand largue vers les jonques sous le vent, où l’avantage était de mon côté.
Celle que j’avais choisie flottait de façon indécise devant moi, et comme j’évitais largement pour faire un abordage soigné, elle laissa porter brusquement, le vent emplit ses voiles et elle partit de l’avant, pendant que les Mongols, penchés sur leurs avirons, psalmodiaient en cadence un rythme sauvage. Mais ils ne me prirent pas au dépourvu. Je lofai rapidement. Poussant toute la barre sous le vent et la maintenant dans cette position avec mon corps, je halai progressivement l’écoute de grand-voile de manière à conserver le plus de force possible. Les deux avirons de tribord de la jonque furent dressés le long du bord et les deux bateaux se rencontrèrent avec fracas. Semblable à une main géante, le beaupré du Reindeer atteignit par-dessus le pont et balaya le mât trapu et la voile disproportionnée de la jonque.
Aussitôt s’éleva un cri à vous glacer le sang. Un gros Chinois à l’air terrible, la tête enveloppée d’un mouchoir de soie jaune et la face marquée de la petite vérole, planta une longue gaffe dans la proue du Reindeer et se mit en devoir de séparer les deux embarcations. Faisant une pause suffisamment longue pour laisser tomber le foc, au moment où le Reindeer se dégageait et commençait à dériver vers l’arrière, je sautai sur la jonque avec un bout de corde et l’amarrai solidement. L’homme au visage grêlé et au mouchoir de soie jaune s’avança vers moi, l’air menaçant ; je fourrai la main dans ma poche de hanche, et il hésita. Je n’étais point armé, mais les Chinois ont appris à se méfier des poches de hanche américaines, et je comptai là-dessus pour le maintenir à distance, ainsi que son farouche équipage.
Je lui ordonnai de jeter l’ancre à la poupe de la jonque, ce à quoi il répondit :
— Pas compris.
Les autres hommes d’équipage répondirent dans les mêmes termes, et bien que je leur expliquasse clairement ce que je désirais par des signes, ils s’obstinèrent à ne pas comprendre.
Devinant l’inutilité de toute discussion, je me rendis moi-même à l’avant du bateau, et jetai l’ancre.
— Que quatre d’entre vous montent à mon bord ! commandai-je d’une voix forte, indiquant avec mes doigts que quatre d’entre eux devaient me suivre, et le cinquième rester sur la jonque.
L’homme au mouchoir jaune hésita, mais je répétai le commandement d’une voix menaçante (exagérant ma colère) et au même moment je portai la main à ma hanche. De nouveau, l’homme au mouchoir de soie parut intimidé, et, l’air sombre, il conduisit trois de ses hommes à mon bord. Je larguai aussitôt et laissant le foc abattu, dirigeai ma course vers la jonque de Georges. Ainsi la tâche devenait plus aisée ; outre que nous étions deux, Georges possédait un revolver qui pouvait nous servir si les choses se gâtaient. Comme je venais de le faire pour l’équipage de la jonque prise par moi, quatre des Chinois furent transférés dans mon sloop et un seul demeura sur la jonque.
De la troisième jonque, quatre autres Chinois furent ajoutés à notre liste de passagers. De son côté le bateau de nos collègues avait ramassé ses douze prisonniers, et il vint se ranger à notre bord lourdement chargé. Leur situation était pire que la nôtre, du fait que le bateau étant très petit, les patrouilleurs se trouvaient pêle-mêle avec leurs prisonniers et, en cas de révolte, il leur eût été bien difficile de ramener l’ordre.
— Il faut absolument que tu nous aides, me dit Le Grant.
Je regardai mes prisonniers qui s’étaient réfugiés dans la cabine et sur le toit de celle-ci.
— Je puis en prendre trois, répondis-je.
— Voyons, prends-en quatre, et Bill montera ici, suggéra l’autre (Bill était le troisième homme de la patrouille). Ici nous sommes serrés comme des sardines, et si jamais une bagarre se produit, ce n’est pas trop d’un Blanc contre deux Jaunes.
L’échange ayant eu lieu, Le Grant hissa sa voile de livarde et dirigea son bateau au sud de la baie vers les marais de San Rafael. J’établis le foc et mis le Reindeer dans la même direction.
San Rafael, où nous devions remettre nos prisonniers entre les mains des autorités, communiquait avec la baie par un long chenal boueux, tortueux et marécageux, navigable seulement à marée haute. La mer était déjà étale et comme le reflux commençait, il fallait se hâter si nous ne voulions pas attendre une demi-journée la marée suivante.
Avec le soleil levant, la brise de terre s’était affaiblie et ne nous arrivait plus qu’avec parcimonie. Le saumonier sortit ses avirons et nous laissa bientôt en arrière. Quelques-uns de mes Chinois se tenaient dans la partie antérieure du cockpit, près des portes de la cabine. À un moment donné, comme je me penchais sur la lisse du cockpit pour border le foc bien à plat, je sentis qu’on se frottait à ma poche de hanche. Je ne laissai rien voir, mais du coin de l’œil je constatai que l’homme au mouchoir de soie jaune venait de découvrir le vide de cette poche qui jusque-là l’avait tenu en respect.
Pendant tout le temps qu’avait duré l’abordage des jonques, nous avions omis de vider l’eau du Reindeer, et à présent elle envahissait le plancher du cockpit. Les pêcheurs de crevettes me montraient cette eau et me regardaient d’un air interrogateur.
— Oui, tout à l’heure nous allons tous couler, si vous ne vous pressez pas d’écoper cette eau. Compris ?
Non, ils ne « comprenaient » pas, ou du moins me le firent savoir par des hochements de tête, tout en discutant mon ordre entre eux dans leur propre langue. Je soulevai trois ou quatre planches, pris une paire de petits seaux d’un placard, et par le langage infaillible des signes, je leur enjoignis de se mettre à l’ouvrage. Mais ils éclatèrent de rire ; quelques-uns entrèrent dans la cabine, d’autres grimpèrent sur le toit.
Leur ricanement n’augurait rien de bon ; il contenait une nuance de menace, une méchanceté qui se reflétait dans leurs regards sombres. Depuis que l’homme au mouchoir de soie s’était aperçu que ma poche de hanche était vide, il montrait plus d’arrogance, se faufilait parmi les autres prisonniers et leur chuchotait d’un air très sérieux.
Refoulant mon dépit, je descendis dans le cockpit et me mis à écoper. Mais à peine avais-je commencé que le gui se balança sur ma tête, la grand-voile se gonfla en donnant une secousse et le Reindeer s’inclina.
Le vent du matin s’annonçait. Georges était un vrai marin d’eau douce, et je dus abandonner mon seau pour prendre la barre. Le vent soufflait droit du cap de San Pedro et des hautes montagnes qui se dressaient derrière lui, aussi était-ce un temps à grains, la brise gonflant par moments la voile et à d’autres la secouant paresseusement.
J’ai rarement rencontré de type si incapable que ce Georges. Il convient de dire qu’il était bien handicapé, étant donné qu’il était poitrinaire, et je savais qu’en essayant d’écoper il risquait une hémorragie. Cependant l’eau montait et à tout prix il fallait prendre une décision. De nouveau, je commandai aux pêcheurs de crevettes d’aider à vider l’eau. Ils riaient d’un air de défi, et ceux qui se trouvaient dans la cabine avec de l’eau jusqu’aux chevilles mêlaient leurs ricanements à ceux de leurs compagnons juchés sur le toit.
— Tu ferais mieux de sortir ton revolver pour les obliger à écoper, remontrai-je à Georges.
Mais il hochait la tête et ne montrait que trop sa frayeur. Les Chinois voyaient aussi bien que moi son manque d’autorité et leur insolence devint insupportable. Ceux de la cabine ouvrirent les placards à provisions, ceux qui étaient montés sur le toit descendirent pour se joindre à eux et se livrer à une débauche dont nos biscuits et nos boîtes de conserves firent les frais.
— Qu’est-ce que cela peut bien nous faire ? me dit Georges d’une voix dolente.
Je trépignais de colère.
— S’ils échappent à notre contrôle, il sera trop tard pour essayer de les tenir. Le mieux serait de les faire obéir tout de suite.
L’eau continuait à monter et les coups de vent, présages d’une forte brise, augmentaient de violence. Les prisonniers, ayant absorbé nos provisions d’une semaine, s’amusèrent à courir d’un bord à l’autre si bien qu’au bout d’un instant le Reindeer se balança comme une coque de noix.
L’homme au mouchoir jaune s’approcha de moi, et, me désignant du doigt son village sur la grève de San Pedro, il me fit comprendre que si je mettais le cap dans cette direction et les conduisais à terre, en retour ils enlèveraient l’eau du bateau. En ce moment, elle atteignait les couchettes de la cabine et les couvertures étaient trempées. Néanmoins, je refusai. Georges ne parvenait pas à cacher son dépit.
— Si tu ne te montres pas plus énergique, ils vont se jeter sur nous et nous lancer par-dessus bord, lui fis-je remarquer. Si tu tiens à ta peau, passe-moi ton revolver.
— Le mieux serait de les mettre à terre, murmura-t-il timidement. Je ne veux point me faire noyer pour une poignée de sales Chinois.
— Et moi, je ne céderai pas à une « poignée de sales Chinois » pour échapper à la noyade, ripostai-je vigoureusement.
— En ce cas, gémit-il, tu vas couler le Reindeer et nous avec. À quoi cela t’avancera-t-il ?
— Chacun son goût.
Il ne répliqua point, mais je le vis trembler de façon pitoyable. Entre les Chinois menaçants et l’eau envahissante, la peur le paralysait. Plus que les Chinois et que l’eau, je redoutais Georges et les décisions qu’il pouvait prendre sous l’influence de la frayeur. Il jetait des regards désespérés vers le canot minuscule amarré à l’arrière, aussi, durant la prochaine accalmie, je hissai la petite embarcation le long du bord. Je vis alors ses yeux briller d’espoir ; mais avant qu’il eût deviné mon intention, je défonçai la coque fragile d’un coup de hache et l’eau remplit le canot jusqu’au plat-bord.
— Nous allons couler ou nous sauver ensemble ! lui dis-je. Donne-moi ce revolver et je me charge de faire vider le Reindeer en un clin d’œil.
— Ils sont trop, se lamenta-t-il. Que pouvons-nous contre une telle bande ?
Écœuré, je lui tournai le dos. Depuis longtemps le saumonier se trouvait hors de vue, dissimulé par un petit archipel appelé les îles Marines ; nous ne pouvions donc attendre aucun secours de ce côté-là. « Mouchoir Jaune » vint vers moi sans vergogne, l’eau du cockpit clapotant contre ses jambes. Sa mine ne me disait rien de bon. Derrière le sourire aimable qu’il arborait se cachaient de noirs desseins. Je lui ordonnai de reculer, d’un ton si péremptoire qu’il obéit sur-le-champ.
— Tiens-toi à cette distance et n’approche pas.
— Pourquoi ? demanda-t-il, indigné. Moi pouvoir parler-parler beaucoup bon.
— Parler-parler, répétai-je d’un ton amer. (À présent, je savais qu’il avait compris ce qui s’était passé entre Georges et moi.) Pourquoi parler-parler ? Tu ne connais pas l’anglais.
Il grimaça un faible sourire.
— Si, moi beaucoup savoir parler. Moi honnête Chinois.
— Bon, répondis-je. Toi savoir parler-parler. Eh bien, enlève l’eau beaucoup-beaucoup. Ensuite, nous parlerons.
Il hocha la tête, tout en désignant du doigt ses compagnons par-dessus son épaule.
— Pas pouvoir. Tlès mauvais Chinois, tlès mauvais. Je crois… Hum…
— Arrière ! m’écriai-je.
Je venais en effet de remarquer que la main de mon homme avait disparu sous sa blouse et que son corps se tendait pour bondir.
Déconcerté, il retourna à la cabine parlementer avec ses camarades, à en juger par le papotage qui s’ensuivit.
Le Reindeer continuait de s’enfoncer et ses mouvements devenaient de plus en plus désordonnés. Dans une forte houle, il eût infailliblement coulé, mais le vent, lorsqu’il soufflait, venait de la terre et ridait à peine la surface de la baie.
— Il me semble que tu ferais bien de gagner le rivage, me dit soudain Georges.
Le ton de sa voix m’indiquait que sa peur le décidait à agir.
— Ce n’est pas mon avis, répondis-je brièvement.
— Je te l’ordonne ! s’écria-t-il, autoritaire.
— J’ai pour mission de conduire ces prisonniers à San Rafael, répliquai-je.
Au bruit de notre altercation, les Chinois sortirent de la cabine.
— À présent, vas-tu retourner à terre ?
Georges osait me parler ainsi, et braquait sur moi le canon de son revolver… de ce revolver dont, par lâcheté, il ne s’était pas servi pour faire obéir les Chinois.





























