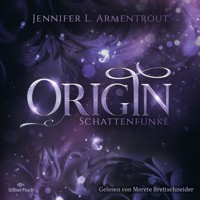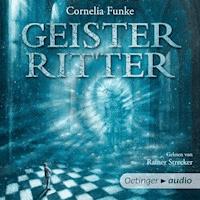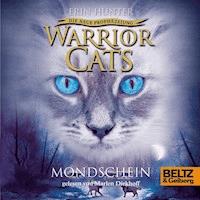Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
Cet ouvrage est destiné aux candidats, étudiants et professionnels souhaitant se présenter aux concours de l’enseignement secondaire et supérieur. Il permet aux personnes ayant des bases en économie d’approfondir leurs connaissances ou leur culture économique notamment sur des sujets comme la place du Big Data dans le capitalisme mondialisé, la place de la nouvelle économie, les « Start-up » et la croissance de demain, la croissance de l’Inde et la Chine, les puissances économiques mondiales de demain, les effets de la robotisation sur l’emploi, l’ubérisation de l’économie, l’économie circulaire et la transition écologique. En somme, ce livre est une réflexion exigeante avec un contenu diversifié de qualité rendant possible l’acquisition des savoirs nécessaires pour une formation.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Benjamin Hocque, docteur en sciences économiques, est enseignant de sciences économiques à l’université d’Angers et à l’université catholique de l’Ouest à Angers. Auteur de plusieurs ouvrages d’économie à l’instar de
Réussir le DSCG 6, épreuve orale d’économie, co-écrit avec Lydia Kernevez, ESSCA Angers, il est également professeur hors classe de sciences économiques et sociales en Lycée.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 579
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les sciences économiques :
de l’université aux concours
Benjamin Hocque
Les sciences économiques :
de l’université aux concours
© Lys Bleu Éditions – Benjamin Hocque
ISBN : 979-10-377-6069-2
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Avant-propos
Les sciences économiques : de l’université aux concours est le fruit d’une réflexion sur les thématiques des concours et examens. Ce livre répond à un besoin crucial de préparation optimale des étudiantes et étudiants, à des questionnements qui sont souvent rencontrés dans les examens et concours.
Cet ouvrage est l’un des rares sur le marché à analyser précisément les différentes problématiques abordées dans les concours et examens. L’écriture de cet ouvrage s’est faite à partir des questions centrales des programmes de concours et d’examens, tant au niveau des concours de l’Éducation nationale qu’aux concours des grandes écoles de commerce.
Cet ouvrage est destiné aux candidats, étudiants ou professionnels qui souhaitent se présenter aux concours de l’enseignement secondaire et supérieur. Il prépare plus précisément les candidats aux concours de l’éducation nationale (CAPES, CAER, agrégation de sciences économiques et sociales et CAPET et agrégation en économie-gestion…).
Cet ouvrage s’adresse également aux étudiants préparant notamment les concours et examens d’entrée dans les grandes écoles de commerce (HEC, ESSEC, ESCP, EDHEC, EM LYON, SKMA…), les IEP (sciences politiques…) et les concours d’administrations publiques.
Il est susceptible d’intéresser aussi étudiants de sciences économiques et de gestion, d’AES et des IUT d’économie-gestion.
Ce livre peut aussi intéresser les étudiants surtout de Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE) en ECG (Économique et Commerciale, voire Générale) pour leur apporter des connaissances solides et des techniques de construction de la réflexion pour réussir les épreuves des concours.
De même, il peut être un outil indispensable pour les étudiants du Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG – Licence 3) et du Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG – Master 2) qui peuvent trouver des connaissances et des analyses utiles pour leurs examens/concours.
Cet ouvrage peut enfin être utile aux candidats aux concours de catégorie A comportant des épreuves d’économie (ex. : inspecteur général des finances publiques, attaché territorial), aux candidats au concours de l’École nationale d’administration, aux candidats aux concours de l’Institut Technique de Banque (ITB).
Benjamin Hocque
Docteur ès sciences économiques
Introduction
Les sciences économiques : de l’université aux concours est un outil d’analyse permettant de comprendre les problématiques économiques et sociétales et les enjeux financiers et environnementaux de nos sociétés contemporaines mondialisées.
Cet ouvrage est destiné aux candidats, étudiants ou professionnels, qui souhaitent se présenter aux concours de l’enseignement secondaire et supérieur. Ainsi cet ouvrage peut permettre aux personnes ayant des bases en économie et qui souhaitent approfondir leurs connaissances ou leur culture économique notamment sur les questions comme les effets de la robotisation sur l’emploi ; le dollar, une puissance en déclin (?) ; la place de la nouvelle économie ; les « Start-up » et la croissance de demain ; l’économie numérique ; la place du Big Data dans le capitalisme mondialisé ;l’ubérisation de l’économie ; l’économie circulaire ; la transition écologique…
En somme, ce livre est une réflexion exigeante avec un contenu diversifié de qualité. Chaque notion est clairement définie et expliquée avec précision. Il permet au candidat ou à l’étudiant d’acquérir les connaissances nécessaires pour leur formation, de connaître les faits historiques, courants et données qui leur permettront d’approfondir leur réflexion.
Cet ouvrage est divisé en six parties et chaque partie est subdivisée en chapitres.
La première partie traite des analyses économiques de la croissance, la croissance des pays émergents, des institutions dans le développement économique.
La seconde partie aborde la régulation des marchés, du marché du travail et politique de lutte contre le chômage, des politiques économiques et de l’intégration économique et monétaire européenne.
La troisième partie engage une réflexion sur les problématiques de la politique de soutien aux innovations et à la compétitivité, de l’innovation technologique, économie de la connaissance et compétitivité.
La quatrième partie porte sur l’économie internationale, monétaire et financière, sur les banques centrales et politiques monétaires, la globalisation financière, le financement et la croissance économique mondiale.
La cinquième partie, pour sa part, aborde l’économie sociale et solidaire, la protection sociale, la solidarité et la protection de l’environnement.
Enfin, la sixième partie présente les principaux courants de la pensée économique : les courants économiques pré- capitalistes, les théories économiques classique et néoclassique, les théories économiques marxiste et keynésienne, le nouveau libéralisme (le néolibéralisme), la théorie de la régulation et la pensée hétérodoxe et la théorie de la croissance endogène.
La rédaction de cet ouvrage a été guidée par le souci de permettre au candidat d’optimiser son processus d’apprentissage et de préparation au concours ou à l’examen, selon les étapes suivantes :
Ces axes sont présentés sous forme de thématiques de réflexion qui peuvent figurer dans les différentes épreuves (écrites et orales) des examens et concours.
Partie 1
Croissance, institutions
et développementéconomique
Cette première partie sera divisée en 4 chapitres :
Chapitre 1 : Les analyses économiques de la croissance
Chapitre 2 : Développement économique et libéralisme économique
Chapitre 3 : La croissance des pays émergents, les puissances économiques mondiales de demain
Chapitre 4 : Économie institutionnelle et développement économique
Chapitre 1
Les analyses économiques de la croissance
1. Le PIB est-il un indicateur dépassé ?
Est-il aujourd’hui encore pertinent d’utiliser cet indicateur pour mesurer la performance d’une nation ou faut-il à présent oublier cet agrégat et s’en débarrasser ?
1.1. Le PIB, un indicateur peu pertinent pour mesurer la performance économique d’un pays ?
L’intérêt et les limites du PIB comme agrégat initialement conçu pour mesurer quantitativement la croissance économique d’une nation.
C’est à partir de la conférence de Bretton Woods en 1944 que le PIB devient le mètre étalon des économies nationales1 et le calcul du PIB par habitant doit alors permettre de mesurer l’évolution du bien-être économique ou plutôt du niveau de vie des habitants.
Le PIB est un indicateur de la richesse créée au cours d’une période donnée par les unités productives résidentes ou territoriales, le PIB peut être calculé de trois façons (approches de la production, des dépenses et des revenus). Il mesure l’accumulation de produits et correspond à la logique capitaliste.
Le PIB remplit la mission qui est la sienne depuis sa création en dépit de quelques limites :
Les productions non marchandes sont sous-estimées (puisqu’elles sont comptabilisées à leur coût de production) alors qu’elles occupent une place essentielle dans certains pays (cf. Le rôle des associations et des administrations publiques) tandis que les activités domestiques et les activités informelles ne sont par exemple pas prises en compte (car hors marché
)
2
.
Les inégalités économiques existant dans un pays ne sont pas mesurées par le PIB. Le PIB par habitant n’est qu’un PIB moyen par habitant, c’est-à-dire un indicateur imparfait du niveau de vie des habitants d’un pays puisqu’il ne tient pas compte des disparités en matière de répartition des richesses.
Malgré ces premières limites, le PIB présente de l’intérêt pour mesurer la performance économique d’un pays et se priver d’un tel indicateur conduirait à se priver d’informations importantes indispensables pour l’analyse économique et les décideurs.
Le PIB est un indicateur dont le calcul est harmonisé dans le temps et l’espace. Il permet donc d’effectuer des comparaisons entre pays et entre diverses périodes afin de comparer les performances économiques.
Les décideurs politiques suivent de près l’évolution du PIB car le chômage
et les revenus des ménages notamment en dépendent. Objectif de politique économique
, le PIB permet aussi d’évaluer l’impact des politiques économiques mises en œuvre. De plus, du fait des modalités de calcul du PIB, l’analyse des différentes composantes de cet agrégat et de leur évolution est plutôt aisée et nécessaire pour la conduite de la politique économique puisqu’elle permet de mesurer les contributions à la croissance du PIB.
1.2. Le PIB doit être dépassé
Le PIB ne tient compte que de la dimension économique de la production. Les dimensions environnementales et sociales du développement durable (cf. la définition donnée dans le rapport Brundtland, 1987) sont passées sous silence.
Les externalités négatives sont valorisées positivement dans le PIB du fait des dépenses qu’elles entraînent pour leur réparation, elles contribuent à la création de richesses (exemple : pollution et dégradation de l’environnement, accidents de la route) alors que les conséquences sociales et environnementales sont désastreuses. Le PIB est en effet indifférent à la nature de l’activité génératrice de richesses ; il ne tient d’ailleurs pas non plus compte du fait que certaines activités entraînent des externalités positives (exemple de l’éducation ou encore de l’innovation cité dans le texte)3.
Le PIB et sa croissance sont indifférents au fait que l’on puise dans des stocks de ressources (en particulier naturelles qui s’épuisent) pour continuer à croître. Comme le soulignent D. Méda et J. Gadrey (2011)4, « notre comptabilité nationale n’est pas une comptabilité patrimoniale ». La question de la soutenabilité de la croissance économique, telle que définie par l’évolution du PIB, est donc posée. Elle a, d’ailleurs, conduit certains économistes à prôner une « croissance zéro » et même la décroissance (cf. rapports du Club de Rome et travaux de N. Georgescu-Rogen dans les années 1970).
Le fait que le PIB ne mesure que la performance économique a rendu nécessaire la recherche d’autres indicateurs permettant d’évaluer l’impact social et environnemental de l’activité économique. Le plus connu est celui développé par A. Sen dans le cadre du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) : il s’agit de l’indice de développement humain (IDH), indice composite qui est la moyenne géométrique de trois indices (de santé, d’éducation et de niveau de vie)5. Il comprend donc plus de dimensions que le PIB mais ne propose pas de mesure de la performance environnementale.
On peut aussi citer d’autres indicateurs comme l’empreinte écologique, des indicateurs spécifiques comme les comptabilités carbone, l’indice de santé sociale, l’indice de richesse globale élaboré par l’ONU, l’indicateur d’épargne nette ajustée' de la Banque mondiale, l’indicateur du mieux vivre de l’OCDE. Au-delà ou à côté du PIB, il existe divers indicateurs permettant de compléter et d’aider à mesurer l’évolution des conséquences de l’activité économique sur le bien-être et l’état des ressources. Il s’avère donc que l’indicateur idéal et unique permettant d’appréhender la performance globale d’un pays n’existe pas.
Encadré 1
C’est en septembre 2009 que la Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi – ou Commission sur la mesure de la performance économique et du progrès social – a rendu ses conclusions. Mise en place au début de l’année 2008 sur l’initiative du gouvernement français, cette commission avait pour mission de réfléchir aux problèmes de mesure de la performance économique, notamment celles fondées sur les chiffres du PIB. La validité de ces chiffres comme mesure du bien-être social ainsi que du développement durable étant contestée depuis plusieurs décennies par nombre d’économistes, il s’agissait alors de s’interroger sur la pertinence de cet agrégat en tant qu’indicateur de la performance d’une nation et de réfléchir à de nouveaux indicateurs. Par ses travaux, cette commission a rendu légitime les interrogations sur lapertinence du PIB comme indicateur de la performance globale d’une nation (même si ses travaux ont eu peu de suites).
En somme, il est intéressant de rappeler que S. Kuznets lui-même indiquait que le PIB n’était qu’une mesure quantitative et n’avait pas vocation à décrire les éléments qualitatifs de la croissance. Il faut aussi souligner que le débat actuel sur le PIB prend, ces dernières décennies, une dimension particulière du fait de la montée des inégalités et de la crise écologique.
2. Comment les économistes expliquent-ils la croissance ?
Les économistes ont été beaucoup critiqués à la suite de la crise de 2007/2008. Le fait est qu’ils ne savent pas analyser le mécanisme de croissance.
On distingue trois écoles de pensée. La première, avec Solow et Swan, explique la croissance par l’accumulation de capital. D’autres économistes tels Lucas et Romer, y ajoutent la notion de dissémination de la connaissance. Cependant, ces modèles sont trop vagues.
Un deuxième groupe d’économistes a choisi la recherche empirique, se penchant sur les données économiques pour essayer d’expliquer les différences de croissance. Mais il y a tellement de variables qu’il est impossible de quantifier clairement les critères de croissance.
Un troisième groupe se penche sur l’histoire, la révolution industrielle par exemple, pour appréhender le rôle de la culture et de la politique comme facteurs de croissance.
2.1. L’analyse néo (classique) reposant sur des facteurs exogènes (Robert Solow)
Selon les économistes classiques (A. Smith, D. Ricardo), la croissance est « l’accumulation du capital » qui se transforme en épargne.
R. Solow (Prix Nobel d’économie, 1987), explique la croissance par l’accumulation de capital. Pour Solow, le progrès technique est considéré comme une variable exogène car il est extérieur au modèle et à la croissance obtenue. Il s’agit d’un résidu6 non expliqué par le modèle de croissance. Le progrès technique apparaît comme un « miracle » (c’est-à-dire les découvertes sont aléatoires).
R. Solow a affirmé dans les années 1970 : « We produce more and more with computers but at the same time the statistics do not show it. » « On produit de plus en plus avec les ordinateurs mais en même temps les statistiques ne le montrent pas. » C’est le « Paradoxe de Solow » : « L’informatique se voit partout sauf dans les statistiques. » Les NTIC ont tendance à relativiser ce paradoxe : un ordinateur seul n’améliore pas la productivité. Il faut aussi des connaissances obtenues grâce une formation, des logiciels (adaptés aux besoins), l’organisation de l’entreprise, du travail.
2.2. La théorie de la croissance déséquilibrée de Harrod et Domar
Le modèle de Harrod-Domar est le premier modèle économique formalisé de la croissance. Pour ces deux économistes, les principales sources de la croissance sont l’accumulation du capital et le progrès technique. Le modèle Harrod-Domar, inspiré des travaux de Keynes, montre qu’une croissance équilibrée n’est réalisable que de façon exceptionnelle, d’où la notion d’une « croissance cheminant sur le fil du rasoir ».
Le modèle de Harrod-Domar vise à faire ressortir le caractère instable de la croissance économique, et la nécessité de l’intervention étatique.
2.3. L’analyse schumpétérienne invoquant l’innovation et le rôle des entrepreneurs
Pour J. A. Schumpeter, la croissance vient de « l’innovation » qui est un « processus de destruction créatrice ». Selon J. A. Schumpeter, « le progrès technique est un processus permanent d’innovation, de création, de destruction et de restructuration des activités économiques, source de croissance ».
Le système doit son dynamisme à l’entrepreneur qui ose prendre des risques (ex. : Bill Gates). Pour Schumpeter, l’entrepreneur est un innovateur et non un simple gestionnaire ou un dirigeant routinier. En effet, Schumpeter a montré le rôle majeur joué par l’entrepreneur. L’entrepreneur réunit certaines caractéristiques : capacité à surmonter les résistances, aventurier, prise de risques. L’entrepreneur joue un rôle important dans le système capitaliste car son innovation permet l’accumulation du capital, et a des effets d’entraînement sur les autres secteurs.
Pour Schumpeter, l’entrepreneur (avec un esprit pionnier) est un innovateur. Il joue un rôle important dans le système capitaliste car son innovation permet l’accumulation du capital et a des effets d’entraînement sur les autres secteurs.
Schéma illustratif :
Entrepreneur innovateur risques monopole rente de monopole profit et croissance.
Les innovations sont à l’origine des cycles économiques (expansion/récession/dépression). Pour Schumpeter, la croissance vient de « l’innovation » (qui est un processus de destruction créatrice). La « destruction créatrice » désigne le processus de déclassement des activités, des machines et des emplois au profit de nouvelles branches, de nouveaux équipements et de nouveaux emplois.
2.4. La théorie de la croissance endogène de Barro, Lucas et Romer, fin 1970
Selon l’analyse de P. Romer, R. Barro et R. Lucas, le progrès technique est endogène.
Selon ces partisans de la croissance endogène, la croissance apparaît comme un processus autoentretenu sous l’effet de l’accumulation du capital. Ainsi, la croissance s’autoentretient.
Pour la théorie de la croissance endogène, le progrès technique est produit. Il est généré par la croissance elle-même. Autrement dit, le progrès technique serait à la fois une cause et une conséquence de la croissance.
Les modèles de croissance endogène se basent donc sur l’idée que c’est le capital humain(connaissances, formation, expériences) et la R&D (innovation) qui sont à l’origine du progrès technique.
L’État joue aussi un rôle essentiel en soutenant la recherche privée et en réalisant des investissements dans le capital public pour compenser le sous-investissement privé dans le capital humain (G. Becker, Prix Nobel d’économie en 1992) et le capital technologique.
Schéma : « L’endogénéité » de la croissance
La croissance entraîne le progrès technique et le progrès technique entraîne la croissance.
Le cercle vertueux de la croissance
L’État
peut agir positivement sur la croissance à travers les politiques publiques et dans le système éducatif et la formation
(externalités positives).
2.5. Le rôle particulier des institutions et des droits de propriété
2.5.1. La croissance s’explique par l’existence des environnements institutionnels favorables
Des auteurs comme D. North ou D. Rodrik7 mettent en avant le rôle des institutions, « les bonnes institutions », comme facteur de croissance et de développement économique.
Certaines institutions contribuent à la croissance économique : un cadre réglementaire, un code d’investissement libéral et un système judiciaire qui protègent les droits de propriété jouent un rôle incitatif obtenir les bénéfices de son investissement incitation à investir/innover hausse de la production croissance…
2.5.2. À l’opposé, certains environnements institutionnels sont défavorables à la croissance économique
Dans les pays en guerre, instables politiquement ou encore fortement gangrénés par la corruption, le cadre institutionnel devient un frein à la croissance et au développement
économique.
C’est le cas aussi de pays où l’activité économique est monopolisée par une minorité au pouvoir
8
(les élites/dirigeants politiques ou l’oligarchie) qui détourne les richesses à son profit et qui empêche l’existence d’un marché concurrentiel. C’est le cas des PVD et des PMA avec des comportements fondés sur les anti-valeurs qui constituent des handicaps pour le développement
économique.
Encadré 2
L’apport de P. Artus :
Plus récemment, pour P. Artus, l’affaiblissement de la croissance de long terme dans la plupart des pays développés depuis plusieurs décennies vient principalement du ralentissement des gains de productivité.
Cette évolution est paradoxale dans la mesure où nos économies sont de plus en plus capitalistiques et numérisées et, par conséquent, où le progrès technique ne semble pas avoir fléchi.
3. La croissance économique est-elle un objectif à remettre en cause ?
3.1. Les arguments contre la croissance
Depuis plusieurs années, de nombreuses critiques se sont élevées qui conduisent à douter de la pérennité du mode de croissance. Pour les partisans de ces critiques, la croissance illimitée est incompatible avec la survie de la planète aux ressources limitées. Fondée sur l’accumulation des richesses, la croissance est destructrice de la nature et de plus, génératrice d’inégalités sociales ce qui la condamne sans appel, à court ou moyen terme.
C’est pourquoi certains prônent l’abandon du système actuel au profit d’un autre modèle de société qualifié de décroissance ou d’a-croissance ou une société sans croissance.
3.1.1. Les arguments économiques et sociaux
Les principaux arguments économiques et sociaux s’articulent autour de :
L’épuisement des ressources naturelles dû au modèle productiviste ; la notion de croissance durable
est hypothétique
Le culte du quantitatif à travers le PIB est réducteur (norme capitaliste) ; l’idéologie du court terme est nocive.
La consommation conduit à une aliénation aux objets ; l’individualisme efface la générosité et l’altruisme ; le productivisme crée du chômage
et la pauvreté ; la compétition permanente accentue les inégalités au lieu de les réduire.
3.1.2. Les arguments environnementaux (nous y reviendrons dans la partie 5)
Les différents arguments environnementaux sont notamment :
Le réchauffement climatique menace notre écosystème ; l’empreinte écologique (estimation de la surface terrestre nécessaire pour subvenir aux besoins) est insoutenable pour notre planète.
Les pollutions remettent en cause la survie des espèces.
La croissance basée sur l’exploitation des ressources fossiles non renouvelables est insoutenable à terme.
3.2. Les arguments en faveur de la croissance
3.2.1. Les arguments économiques
Les principaux arguments économiques sont :
La croissance est créatrice de richesses et pas exclusivement matérielles ; les services publics dépendent en grande partie de la croissance.
Le ralentissement de la croissance entraîne l’augmentation du chômage
.
La croissance, c’est travailler moins pour gagner plus ; comment résoudre la pauvreté des PMA sans croissance ; le PIB n’est pas le seul instrument de mesure du développement
, cf. IDH.
3.2.2. Les arguments sociaux
Les différents arguments sociaux sont :
Aucun système n’a pu élever le niveau de vie d’autant de personnes sans croissance ; la croissance est anti-malthusienne.
Sans croissance, il n’y a pas d’amélioration des services publics, pas de progrès en matière d’éducation, de santé, de communication, de culture.
La croissance alimente la redistribution
et concourt à la réduction des inégalités ; la croissance reste le meilleur moyen pour résorber le chômage
.
En somme, une croissance, ou un mode de production, visant à corriger les déséquilibres sociaux est respectueuse de l’environnement.
4. Les moteurs de la croissance économique de demain
4.1. La faiblesse de la croissance, problème de stagnation conjoncturelle ou stagnation séculaire décrite par L. Summers ?
La croissance représente l’accroissement des richesses produites. Il faut distinguer une croissance effective qui dépend surtout de la conjoncture, et la croissance potentielle qui dépend plus de facteurs structurels.
La faiblesse de la croissance : est-ce un problème de stagnation conjoncturelle suite à la « crise des Subprimes de 2008 », ou sommes-nous devant une stagnation séculaire décrite par L. Summers ?
Dans le cas d’une stagnation conjoncturelle, on retrouve les moteurs traditionnels que sont la consommation et l’investissement. Les libéraux chercheront plutôt à agir sur l’investissement par une politique de l’offre (Say) à travers une diminution des normes et des règlements, des baisses de la fiscalité pour les entreprises…
Les keynésiens chercheront eux à agir sur la consommation, par des politiques de dépenses de l’État et la recherche de l’effet multiplicateur.
En revanche, si la crise est séculaire, il faut rechercher d’autres causes à la baisse de la croissance : des facteurs démographiques (âge de la population, baisse de la fertilité ou de l’immigration selon le texte), ou une baisse de l’innovation.
On retrouve les travaux théoriques sur la croissance. Plus de croissance repose sur plus de travail (démographie) et plus de capital. Depuis Solow, on connaît l’importance de l’innovation.
4.2. Les autres facteurs de croissance
Pour les facteurs démographiques : on pourra s’interroger alors sur des politiques de natalité, migratoires… Par exemple, le cas de l’Allemagne à long terme est plus inquiétant à long terme que le cas français.
Pour l’innovation : Les modèles de croissance endogène
font reposer notre croissance sur notre capacité à innover, par des investissements en infrastructure, formation
ou recherche et développement
. Ces modèles partent de l’hypothèse de rendements croissants de l’innovation. Mais que se passerait-il si nous avions franchi la frontière technologique selon Tyler Cowen
9
et que les rendements devenaient décroissants ? Les modèles de croissance endogène restent-ils pertinents ? Ou doit-on s’adapter à l’idée d’une grande stagnation ?
Les notions essentielles
Croissance économique
C’est l’augmentation quantitative soutenue pendant une longue période de la production de biens et services dans un pays pendant une période déterminée. Pour François Perroux : « C’est l’augmentation soutenue, pendant une ou plusieurs périodes longues, d’un indicateur de dimension significative : pour une nation, le produit global brut ou net en termes réels » (L’économie du XXesiècle, chap5, PUF, 1961).
PIB
Indicateur de la richesse créée au cours d’une période donnée par les unités productives résidentes ou territoriales, le PIB peut être calculé de trois façons (approches de la production, des dépenses et des revenus). Le PIB est une « norme capitaliste ». Il mesure l’accumulation de produits et correspond à la logique capitaliste.
Destruction créatrice
Pour J. A. Schumpeter, la « destruction créatrice » désigne le processus de déclassement des activités, des machines et des emplois au profit de nouvelles branches, de nouveaux équipements et de nouveaux emplois ; élimination du « vieux » remplacé par du « neuf ». La destruction créatrice correspond au processus au cours duquel les éléments périmés sont détruits sous l’effet du progrès technique. Le progrès technique est à la fois destructeur et créateur. La destruction créatrice est source de croissance parce que la réallocation des ressources vers les firmes les plus productives fait augmenter la productivité moyenne mais aussi parce que la menace de disparition incite les entreprises à ne jamais cesser d’innover. Ce processus est coûteux pour les agents économiques déclassés. Ces derniers peuvent chercher à empêcher l’innovation pour que leurs positions ne soient pas remises en cause.
Progrès technique
Le progrès technique regroupe, au sens strict, les innovations de nature technique apportant des perfectionnements aux produits ou aux procédés de production et, au sens large, tout ce qui permet d’augmenter la productivité des facteurs de production. La notion « progrès technique » est plutôt utilisée au niveau macroéconomie, celle d’innovation plutôt au niveau microéconomique.
Au sens strict, le progrès technique correspond aux innovations de produit et aux innovations de procédé, que l’on trouve au niveau microéconomique. Au sens large, le progrès technique correspond à l’augmentation de la productivité globale des facteurs. Cependant, étant donné que cette dernière définition correspond plus à une question de mesure de ce qui reste inexpliqué (le « résidu »), nous privilégierons la définition au sens strict. De plus, beaucoup de phénomènes augmentent la productivité globale des facteurs sans pour autant apparaître comme liés à des connaissances scientifiques : rôle des institutions notamment.
Croissance endogène
La croissance endogène est un modèle théorique de croissance économique autoentretenue.
Pour les théoriciens de la croissance endogène, la productivité globale n’est pas un « résidu », mais doit être expliquée par les comportements des agents économiques qui accumulent différentes sortes de capitaux qui, de plus, profitent à tous (externalités positives) favorisant l’émergence de rendements croissants ; dès lors la croissance peut s’entretenir indéfiniment.
Ces différentes sortes de capitaux sont tout d’abord le capital technique (les machines bien sûr) mais aussi le capital public (notamment les infrastructures), ensuite le capital technologique (recherche, innovations) et enfin le capital humain (santé, formation) ; elles permettent toutes des externalités positives :
Pour le capital technique, il peut s’agir de l’amélioration des équipements utilisés par les uns qui profitent à tous par des travaux d’ingénierie ou par la diffusion des qualifications ou méthodes de travail efficaces par rapport aux machines. Tout un apprentissage est réalisé qui peut se diffuser.
Pour le capital public, il est évident que lorsque l’État
développe des infrastructures (routes, communications), elles bénéficient à tous.
Pour le capital technologique, des découvertes peuvent bénéficier à tous par l’accumulation des connaissances dont chacun peut tirer parti. L’accès de tous aux inventions et innovations est source d’externalité
et de croissance supplémentaire.
Pour le capital humain
, une population qui se soigne bien, par exemple dans un pays en développement
, accroît les capacités de production. De même, un individu qui investit du temps dans une formation
en sera bénéficiaire par des revenus probablement plus élevés mais l’économie
aussi dans son ensemble par les plus grandes capacités productives du travailleur. Face à ce supplément de croissance, donc de revenus, chaque agent pourra avoir les moyens financiers d’investir pour lui… et donc pour les autres.
Chapitre 2
Développement économique
et libéralisme économique
1. Le développement économique, un phénomène qualitatif
Le développement économique est un processus par lequel un pays parvient à maintenir un sentier de croissance économique de façon durable et équilibrée. Le développement économique relevant à la fois de la richesse matérielle mais aussi du bien-être et prend en compte de nombreuses dimensions telles que l’état de santé, le niveau d’éducation, l’accès à l’emploi, aux loisirs, la qualité du lien social, de l’environnement naturel, la sécurité et la gouvernance.
1.1. Les indicateurs qui permettent d’évaluer la notion multidimensionnelle du développement
1.1.1. Les limites du PIB comme indicateur quantitatif conçu pour l’évaluation d’une richesse matérielle
Le PIB ignore plusieurs types d’activités :
Le travail bénévole, le travail domestique, une partie des activités illégales et non déclarées regroupées dans l’économie
souterraine. L’économie souterraine est l’ensemble des activités qui ne donnent pas droit aux paiements de salaires, de charges sociales. Elle est constituée du secteur informel (activités licites et tolérées : travail domestique, activités bénévoles, le bricolage, le jardinage, le troc) et du marché
noir (activités illicites et interdites : travail au noir, prostitution, fraude fiscale, racket, terrorisme…).
Les effets positifs d’activités hors du champ de l’économie
marchande : les externalités positives.
Les externalités négatives de la croissance : stress et insécurité économique, dégradation des ressources naturelles.
1.1.2. Les enjeux
Nous distinguons plusieurs catégories d’enjeux :
Les enjeux liés à la mesure : « Ce que l’on mesure a une incidence sur ce que l’on fait », J. Stiglitz, Richesse des nations et bien-être des individus, 2009.
Les objectifs de l’évaluation statistique (outil d’aide à la décision) doivent refléter le plus fidèlement la réalité observée en vue de comprendre cette réalité, réaliser un diagnostic adéquat et orienter les politiques publiques et les comportements privés.
Les enjeux liés à la mesure de la performance économique sont multiples :
Décalage entre la richesse mesurée par le PIB et la qualité de vie : problème de crédibilité des évaluations et des décisions publiques.
Le PIB : un indicateur donnant des incitations contre-productives, entraînant des comportements non soutenables.
Du point de vue écologique : gaspillage des ressources naturelles, réchauffement climatique, dégradation du cadre de vie naturel (pollutions)…
Du point de vue social : dégradation du lien social, montée de l’individualisme au travers du consumérisme…
1.2. Les indicateurs alternatifs
1.2.1. Un aperçu des alternatives
De nombreux indicateurs alternatifs fondés sur différentes méthodologies depuis la création de l’Indice de développement humain (IDH) par A. Sen (Prix Nobel d’économie en 1998), sous l’égide du PNUD en 1990 :
Les indicateurs construits à partir d’améliorations du PIB et de la comptabilité nationale : Indice de progrès véritable, PIB verts…
Les indicateurs mesurant une dimension particulière du bien-être : empreinte écologique, mesure de satisfaction subjective du bien-être (Subjective well-being), Gross National Happiness (GNH).
Les indicateurs composites : IDH et IDHI (IDH corrigé des inégalités), IPH (indice de pauvreté humaine), Indice de santé sociale (ISS), BIP 40…
1.2.2. Les difficultés méthodologiques
Comme le PIB, ces alternatives posent des problèmes méthodologiques tels que :
L’attribution d’une valeur monétaire à des éléments qui n’ont pas de prix voire dont les effets ne sont guère mesurables et évaluables, dans le cadre des améliorations du PIB.
L’agrégation et la pondération des composantes hétérogènes, difficilement comparables et non substituables, dans le cas des indicateurs composites.
Le manque de visibilité, de synthèse et de hiérarchisation dans le cas des tableaux de bord.
Encadré 3
Le développement économique relevant à la fois de la richesse matérielle mais aussi du bien-être et prend en compte de nombreuses dimensions telles que l’état de santé, le niveau d’éducation, l’accès à l’emploi, aux loisirs, la qualité du lien social, de l’environnement naturel, la sécurité et la gouvernance.
Le PIB (au sens du PNUD), travaux menés notamment par Amartya SEN capabilités (capacités + possibilités) est un indicateur limité d’où des indicateurs alternatifs :
L’IDH, créé par les Nations Unies en 1990. Indicateur composite (PIB/hbt, espérance de vie, niveau d’éducation)IPH : indicateur de pauvreté humaine (IDH + conditions sociales)IBEE : indicateur de bien-être économique (flux de consommation, stocks de richesses, distribution de revenus, sécurité économique).BNB : Bonheur national brut : indice préconisé par le roi du Bhoutan : « les 4 piliers du BNB sont le développement socio-économique équitable et durable, la préservation et la promotion des valeurs culturelles, la défense de la nature et la bonne gouvernance »Cependant, des indicateurs qui sont limités et critiqués
Plusieurs critiques sont adressées contre ces indicateurs :
Critique liée aux choix des éléments entrant dans le calculCritique politique (problème de gouvernance), car élaborer un indice de bien-être revient à construire la norme qui déterminera l’action publique.Comme le PIB, ces alternatives posent des problèmes méthodologiques tels que l’attribution d’une valeur monétaire à des éléments qui n’ont pas de prix.
L’agrégation et la pondération des composantes hétérogènes, difficilement comparables et non substituables, dans le cas des indicateurs composites…
2. Le libéralisme favorise-t-il le développement économique ?
2.1. Le développement doit prendre place dans un cadre libéral
W. W. Rostow explique dans son ouvrage Les étapes de la croissance, 1960 que le développement passe nécessairement par 5 étapes (la société traditionnelle, les préalables au développement, le décollage, la marche vers la maturité, la consommation de masse).
Pour Rostow, les PED n’ont pas encore atteint le décollage et, pour stimuler leur développement, il faut mettre en place les principes du libéralisme.
Le succès des stratégies de développement des économies émergentes des pays d’Asie, la Chine en tête, semble montrer la supériorité du libre-échange sur le protectionnisme. Il est vrai que les stratégies autocentrées (substitution des importations et industries industrialisantes) se sont toutes soldées par des échecs.
2.2. Le développement nécessite des interventions de l’État
Les pays en développement (PED) cumulent de nombreuses difficultés :
L’absence d’entreprise privée suffisamment importante pour industrialiser le pays ; la dépendance technologique ; l’absence et surtout l’insuffisance d’épargne privée.
Les services publics (éducation, santé) et des infrastructures publiques, notamment de transport, insuffisamment développés.
A.O. Hirshman et F. Perroux soulignent la nécessité des investissements publics dans les secteurs à forte intensité capitalistique, sous peine de créer des goulots d’étranglement. Cela permet de générer des effets d’entraînement sur les secteurs situés en amont et en aval.
Les stratégies extraverties de développement
(à la chinoise) se sont appuyées sur un appareil d’État
puissant et un protectionnisme « éducateur » important (F. List). Ces stratégies érigées en modèle par la Banque mondiale impliquent : une accumulation primitive de capital ; une bonne affection de celui-ci afin de stimuler la productivité
(problème de corruption des classes au pouvoir) ; une redistribution
des richesses afin de faire émerger une classe moyenne et un marché
intérieur conséquent. La dépendance vis-à-vis de l’extérieur n’est plus alors une contrainte.
En somme, le développement ne peut se faire sans intervention de l’État.
3. Le modèle de développement de demain
3.1. Quel modèle de développement de demain ?
Le modèle de développement de demain doit chercher à concilier la préservation des ressources naturelles (durabilité) et le développement humain (équité et bien-être) face aux excès induits par le capitalisme financier contemporain.
3.1.1 Le modèle de développementdans les pays du Sud
Les caractéristiques du modèle de développementdans les pays du Sud sont :
Une persistance d’une situation de très grande pauvreté, en dépit des progrès réalisés dans l’atteinte des objectifs du millénaire pour le développement
. Le ralentissement économique mondial a provoqué des reculs importants dans les progrès réalisés vers les Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD).
Les OMD témoignent de la volonté de l’ONU de réduire les inégalités de développement
humain, en reconnaissant que la communauté internationale est « collectivement tenue de défendre à l’échelon mondial, les principes de dignité humaine, de l’égalité et de l’équité
» (ONU, 2000).
3.1.2. Le modèle de développement dans les pays du Nord
Les inégalités de revenus primaires se sont accrues dans tous les pays développés à compter de la fin des années 1980, à la suite notamment des politiques de modération salariale et de la progression des revenus issus du patrimoine.
À titre d’exemple, les pays où la qualité de vie est la plus élevée sont également ceux qui ont une forte empreinte écologique d’où la recherche d’un modèle de développement qui concilie durabilité et bien-être.
3.2. Concilier développement humain et développement durable
Nous y reviendrons avec plus de profondeur dans la partie 5, chapitre 3 intitulé : « Croissance et protection de l’environnement. »
3.2.1. Le développement humain
A. Sen souligne l’importance des politiques publiques (liées notamment à l’accès au système de santé et à l’éducation) afin d’accroître les « capabilités » des individus ; M. Yunus souligne, quant à lui, le rôle joué par le microcrédit (banque des pauvres). De grands groupes développent des « entreprises sociales » (« pas de perte, pas de dividendes » mais un résultat positif pour la société).
3.2.2. Vers une croissance verte.
Pour lutter contre les externalités négatives, les solutions passent par l’écotaxe, les marchés des droits à polluer (C. PIGOU : « Pollueurs, payeurs »), les normes, les labels et les interdictions dans le cadre des politiques de l’environnement…
La décroissance est un concept très critiqué. En France, l’économiste Serge Latouche indique que la décroissance n’est pas un but en soi, mais une nécessité dont il est possible de tirer des enseignements et représente une opportunité pour favoriser des rapports humains plus solidaires et conviviaux.
L’application des principes de la décroissance nécessiterait un renversement total de la pensée et de nos habitudes de vie. La question des effets sociaux d’une réduction des activités productives se pose fortement dans le contexte économique actuel.
Les tenants de la décroissance (André Gorz, Van Illich, Jacques Ellul) considèrent que la croissance n’est pas une condition nécessaire au développement, mais, au contraire, l’expression d’une domination du monde par l’occident et d’une destruction de ressources naturelles.
Les notions essentielles
Développement économique
Le développement désigne la transformation des structures économiques, sociales, culturelles, politiques, institutionnelles qui accompagnent la croissance économique. C’est un phénomène qualitatif irréversible et observable sur une longue période. Pour F. Perroux, le développement est « la combinaison des changements mentaux et sociaux d’une population qui la rendent apte à faire croître cumulativement et durablement son produit réel global ». Le développement s’accompagne nécessairement d’un changement des techniques de production et d’une transformation des structures politiques, sociales et institutionnelles. C’est un processus qualitatif qui crée plus d’interdépendance entre les secteurs économiques et les catégories sociales. Le développement économique est un donc processus de transformations à long terme, d’ordre techniques, démographiques et sociales, qui permettent, sur le long terme, l’apparition et la prolongation de la croissance économique et l’élévation du niveau de vie.
Libéralisme économique
Le libéralisme économique est une doctrine selon laquelle la liberté économique, le libre jeu de l’entreprise ne doivent pas être entravés.
Le libéralisme économique est l’application des principes du libéralisme à la sphère économique. Cette école de pensée (associée au siècle des Lumières) estime que les libertés économiques (libre-échange, liberté d’entreprendre, libre choix de consommation, de travail, etc.) sont nécessaires au bon fonctionnement de l’économie et que l’intervention de l’État doit y être limitée.
Développement humain
Le développement humain (au sens du PNUD, travaux menés notamment par A. SEN) : Paradigme du développement qui repose sur la création d’un environnement au sein duquel les individus peuvent développer pleinement leur potentiel et mener des vies productives et créatives en accord avec leurs besoins et leurs intérêts. Le développement vise donc à élargir les choix qui s’offrent aux personnes pour leur permettre de mener des vies qui leur sont précieuses.
Développement durable
D’après la définition de la Banque mondiale (1992), un développement sera considéré comme durable « s’il permet de répondre aux besoins des générations actuelles sans compromettre la satisfaction des générations futures ». Concernant sa dimension écologique, nos modèles de croissance actuels sont considérés comme non durables car ils se traduisent par une raréfaction des ressources naturelles non reproductibles, génèrent de hauts niveaux de pollution et conduisent à des quantités de déchets toujours plus grandes.
Indicateurs pertinents : Empreinte écologique, IDH, IDH (IDH ajusté aux inégalités), IPH (indice de pauvreté humaine), en France BIP 40, etc.
Chapitre 3
La croissance des pays émergents, les puissances économiques mondiales de demain
1. La croissance et le développement des pays émergents asiatiques
1.1. La crainte de la concurrence des pays émergents
Un pays émergent se caractérise par un revenu intermédiaire (supérieur aux pays les moins avancés, inférieur aux revenus des économies de l’OCDE), une ouverture économique au reste du monde, des transformations structurelles et institutionnelles de grande ampleur et un fort potentiel de croissance.
L’émergence peut se relier aux notions de décollage ou « Take off » (Rostow, The Stages of Economic Growth, 1960) ; de convergence : c’est l’idée qu’un pays ou groupe de pays serait en situation de rattraper le groupe des économies avancées, notamment grâce à un fort taux de croissance. Jim O’Neill10 met en évidence 5 critères cumulatifs permettant de définir l’émergence économique : une population nombreuse et en croissance démographique significative, idéalement jeune et éduquée ; un sentier de croissance de long terme autour de 5 % ; une urbanisation importante (facilite l’accès aux transports, à la l’eau potable et à l’électricité) ; une qualité des infrastructures (nécessaire au développement économique et humain) et une stabilité politique permettant de mettre en œuvre des projets à long terme.
1.1.1. La concurrence des pays émergents : une menace pour les économies avancées
Les entreprises des économies avancées subissent une pression concurrentielle accrue (aspects microéconomiques). Les pays émergents déstabilisent la hiérarchie des puissances économiques (aspects macroéconomiques).
Pour les économies avancées, en considérant le fait que ces nouvelles puissances économiques bouleversent l’ordre économique établi :
Pour les entreprises, concurrence vive sur les marchés, notamment dans un premier temps sur les marchés des produits manufacturés à faible contenu technologique où le prix de vente est une variable essentielle dans la décision du consommateur, et de plus en plus, sur des produits à fort contenu technologique menace sur l’emploi
: les émergents offrent des conditions de production attractives pour les entreprises (certes liées au coût de production et au différentiel de salaires, mais pas uniquement : fiscalité
attractive, faibles contraintes sociales et environnementales, qualification
de la main-d’œuvre locale sont autant d’attraits) ; on peut faire le lien avec les notions de délocalisation (déplacement d’unités productives) et de désindustrialisation
(déclin du tissu industriel et donc de la part de l’emploi industriel dans l’emploi total), avec les notions de dumping social et environnemental.
Certaines politiques économiques conduites par les pays émergents sont spécifiquement destinées à accroître la part de marché mondial (exemple de la politique de change chinoise visant la sous-évaluation du yuan afin de soutenir les exportations par une action sur la compétitivité
-prix, on parle de protectionnisme monétaire) certaines firmes multinationales
mettent en œuvre des stratégies de prédation à l’égard des actifs technologiques (ex. : recherche de transferts de technologie) et également des entreprises des pays occidentaux qui sont la cible de nombreux IDE ; on peut citer également l’accaparement de certaines ressources rares nécessaires aux activités de production (exemple des terres rares).
1.1.2. La crainte suscitée par les pays émergents doit toutefois être relativisée
Les pays émergents représentent une source considérable d’opportunités pour les économies avancées, et notamment en termes de débouchés commerciaux (montée des classes moyennes avec pouvoir d’achat en croissance VS ralentissement économique ; saturation de certains marchés ; stagnation du pouvoir d’achat et vieillissement de la population dans les économies avancées). Par ailleurs, les firmes occidentales peuvent renforcer leur compétitivité en s’implantant à l’étranger (certains économistes tel E. M. Mouhoud11 expliquent qu’à court terme, les délocalisations détruisent des emplois [non qualifiés] mais qu’à plus long terme les gains de compétitivité peuvent théoriquement permettre de compenser ces destructions par la création d’emplois qualifiés).
Les pays émergents connaissent eux-mêmes des difficultés ou évolutions qui limitent au moins temporairement leur compétitivité, voire leur puissance économique. Il s’agit notamment des effets du rattrapage salarial (en Chine notamment) ; une instabilité politique (ex de la Turquie), tensions sociales ; des changements démographiques (vieillissement démographique provoquant une pénurie de main-d’œuvre en Chine) ; des retards de développement persistants qui pénalisent l’essor économique (exemple du retard indien en matière d’infrastructures) et une instabilité financière (les pays émergents accueillant d’abondants capitaux étrangers sont particulièrement vulnérables). Dans ces pays, certaines industries cherchent à relocaliser leurs activités (hausse des coûts de transport, besoin de proximité avec les clients et de réactivité…).
Encadré 4
Géographiquement, les pays émergents sont variés et ne doivent pas être réduits au cas de la Chine et l’Inde, on peut citer les groupes de pays émergents : les traditionnels BRIC(S), mais aussi les Next Eleven, ou les CIVETS.
BRIC (Jim O’Neill, 2001, Goldman Sachs), Brésil, Russie, Inde, Chine (adjonction plus tard de l’Afrique du Sud).
Next Eleven (Jim O’Neill, 2005) : Bangladesh, Égypte, Indonésie, Iran, Corée, Mexique, Nigeria, Pakistan, Philippines, Turquie, Vietnam.
CIVETS (Robert Ward, 2009) : Colombie, Indonésie, Vietnam, Égypte, Turquie, Afrique du Sud.
1.2. La Chine et l’Inde : des modèles de développement convergents et divergents, des puissances économiques mondiales de demain
Il est naturel de comparer la Chine et l’Inde du fait de leurs similitudes (deux grandes puissances qui n’ont pas fait la révolution industrielle au XVIIIe siècle, une émergence à la fin du XXe siècle, une croissance très forte avec un volant de réformes important depuis quelques années) mais aussi des différences.
Si l’Inde connaît actuellement la plus forte croissance (7,9 % de croissance du PIB en 2015 vs 6,9 % pour la Chine), la Chine affiche par ailleurs de meilleures performances économiques que l’Inde, et seule la Chine peut parfois prétendre dépasser les pays développés. Depuis 2015, la Chine est ainsi la 1re puissance économique en termes de PIB PPA devançant ainsi les États-Unis (2e) tandis que l’Inde est en 3e position ; la 1re puissance commerciale (à l’origine de 14,4 % des exportations de marchandises en valeur vs 1,7 % pour l’Inde), le 3e investisseur mondial. Enfin, la Chine et l’Inde sont les deux premières puissances démographiques (respectivement 1,37 milliard d’habitants et 1,31 milliard d’habitants vs 321 millions d’habitants aux États-Unis).
1.2.1. Les caractéristiques communes des modèles de développementdes pays émergents asiatiques : la Chine et l’Inde
Une puissance économique est un pays dominant la scène économique mondiale grâce à ses performances économiques et sa capacité à influencer les décisions et les performances économiques des autres pays.
La Chine et l’Inde connaissant un développement particulièrement remarquable avec un certain nombre de traits communs (anciennes grandes puissances, forte population, bas coût de la main-d’œuvre et docile).
Les pays émergents sont des pays en développement connaissant une forte croissance économique, généralement permise par les exportations et leur attractivité pour les capitaux étrangers. Leur croissance s’accompagne de mutations sociales, économiques et institutionnelles importantes. On considère qu’ils pourraient devenir des pays développés dans les trente années à venir.
On repère généralement quelques grandes caractéristiques communes :
L’acquisition des techniques et le copiage des produits, technologies des pays développés
Une protection sélective du marché intérieur
Un développement
massif des exportations industrielles en s’appuyant sur un prix faible de la main-d’œuvre
L’intervention active de l’État
(en matière de formation
, et de créations d’infrastructures…).
1.2.2. Les limites des spécialisations des deux géants asiatiques
Ces performances économiques des 2 pays sont cependant à relativiser :
En termes de développement
, la Chine reste très loin derrière les pays développés, l’Inde étant encore plus en retard. La Chine a ainsi été classée par la Banque mondiale parmi les pays à revenu intermédiaire inférieur en 1997 et fait partie depuis 2010 des pays à revenu intermédiaire supérieur tandis que l’Inde est devenue un pays à revenu intermédiaire inférieur seulement en 2007. La Chine ne se positionne qu’en 90e position en termes d’IDH et l’Inde en 131
e
position.
L’Inde et la Chine sont des économies « dualistes » caractérisées par l’existence d’un secteur moderne (connaissant une forte expansion tournée vers l’exportation et avec une forte intensité capitalistique) en parallèle d’un secteur traditionnel (rural, faible productivité
, sous-emploi
). Ce dualisme, constitue pour certains économistes, une entrave aux transformations nécessaires du secteur traditionnel (Nurske) et empêche une propagation des effets de l’un vers l’autre (inarticulation des économies, Perroux).
Leur développement
peut nécessiter des politiques de développement (infrastructures notamment), visant une croissance de tous les secteurs (stratégie de croissance équilibrée, Nurske ou Rosenstein Rodan) ou d’une branche devant ensuite entraîner les autres (stratégie de croissance déséquilibrée, Hirschmann, Perroux). Les théories de la croissance endogène
permettent également de justifier l’intervention étatique du fait des externalités positives et des effets d’entraînement des infrastructures, de l’éducation ou des efforts de R&D (Barro, Lucas, Romer). La planification étatique du développement peut parfois être une réponse et s’accompagner d’une certaine forme de protectionnisme, à l’instar du modèle de développement chinois s’appuyant sur des plans quinquennaux. Pour d’autres (néolibéraux), c’est la croissance du secteur moderne qui permettra de résorber le sous-emploi
du secteur traditionnel.
Risque pour la Chine (dès aujourd’hui) ou l’Inde dans quelques années de rester coincées dans le « Piège des pays au revenu intermédiaire » les empêchant de rejoindre le club des pays à hauts revenus (selon la dénomination de la Banque Mondiale) : la croissance s’accompagne d’une augmentation des coûts salariaux leur faisant perdre leur compétitivité
prix (par rapport à des pays comme le Bangladesh ou le Vietnam pour les textiles par exemple), sans qu’elles ne soient capables de générer de la croissance du fait de manque de compétitivité hors prix.
Le développement
humain de l’Inde et de la Chine semble indispensable à une consommation intérieure importante et garante d’une certaine indépendance des puissances économiques actuelles. Selon Sen (idées reprises par le PNUD), ce sont alors les « capabilités » de chaque individu qu’il faut développer (libertés, éducation, santé
, réduction de la pauvreté
).
En somme, les principales limites et les fragilités du développement de ces pays sont bien connues : un développement inégalement distribué ; d’importantes inégalités ; des conséquences écologiques quelquefois dramatiques et une pollution importante ; également une grande dépendance économique et commerciale par rapport à l’extérieur mais aussi des différences certaines avec notamment des spécialisations économiques différentes entre les deux pays. La Chine est devenue « l’usine » ou « l’atelier » du monde (spécialisation industrielle), quand l’Inde est « le bureau » du monde grâce à sa position de pays leader dans le domaine des services aux entreprises.
2. Le modèle de développement de l’économie chinoise
2.1. Le nouveau modèle de développement de l’économie chinoise
2.1.1. L’économie chinoise, une « économie socialiste de marché »
Il y a encore peu, les entreprises chinoises bénéficiaient des transferts de technologies et assuraient leur développement grâce aux innovations, produits, services, savoir-faire technologiques provenant d’autres pays ou par le biais de leurs partenaires commerciaux.
Désormais, le dynamisme et l’esprit d’initiative des entreprises chinoises leur permettent de surpasser les entreprises concurrentes et d’occuper une position dominante sur les marchés internationaux, au point que la Chine ne peut plus être uniquement considérée comme un pays en développement.
Une évolution des formes du capitalisme et particulièrement du concept de « d’économie socialiste de marché » a été développée par la Chine dès 1979. Avec cette ouverture au marché, la Chine se développe sur un modèle d’investissement massif dans l’industrialisation en profitant d’une main-d’œuvre bon marché et docile.
2.1.2. Un modèle qui s’appuie sur les théories économiques
1° Lien avec le modèle des avantages relatifs de Ricardo et le modèle HOS
Une nouvelle DIT (DIPP) se met en place. La Chine semble être « l’atelier du monde », mais c’est en fait un pays qui n’intervient qu’à la fin d’une chaîne de valeur éclatée dans le monde, et qui produit en fait peu de valeur.
2° Analyse de D. Cohen sur la décomposition de la chaîne de valeur dans le monde, analyse de l’OMC sur la création de la valeur de l’iPhone
Au lendemain de la crise des « subprimes », la Chine découvre son exposition à l’économie américaine. Elle fait évoluer le modèle chinois vers le développement d’une consommation intérieure. Très forte augmentation des salaires et mise en place d’une sécurité sociale, et donc augmentation des coûts de production qui rend la Chine moins attractive pour les firmes étrangères.
3° Lien avec la théorie de Keynes sur une croissance qui dépend de la consommation
Évolutions à envisager de la DIT et de la DIPP ainsi que de la place de firmes internationales chinoises et étrangères dans ce nouveau contexte économique.
La volonté de la montée en gamme de la Chine, qui s’oriente de plus en plus vers des produits à forte valeur ajoutée. Investissement
massif dans l’éducation et la recherche.
2.1.3. Une volonté politique de conquête
Un pays qui investit le plus dans l’intelligence artificielle par exemple ; succès des entreprises chinoises dans le mobile ; volonté affirmée de la Chine de dominer le monde dans 10 ans.
Belt and Road Initiative (BRI) : politique à l’initiative de la Chine pour développer la connectivité (réseau ferroviaire, routier, numérique, facilités commerciales…) du pays avec le reste du monde, particulièrement l’Asie et l’Europe. C’est une nouvelle « route de la soie ».
Congrès du parti communiste chinois (2017) : Xi Jinping a assuré que l’économie
chinoise devait ouvrir ses portes au monde et protéger « les droits et intérêts légitimes des investisseurs étrangers ».
2.2. Les faiblesses du modèle de développement de l’économie chinoise
La Chine doit encore surmonter de nombreux obstacles : intervention étatique importante à l’origine de bulles (immobilières), forte corruption, endettement très important (260 % du PIB), forte dépendance aux exportations et IDE du fait d’une consommation intérieure encore trop faible.
De nouvelles difficultés apparaissent également : signes de surproduction et faible inflation
, début de vieillissement de la population, tensions sociales importantes. Accent mis depuis l’arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012 sur des aspects davantage qualitatifs de la croissance (verte, nouvelles technologies).
3. L’Inde, une puissance économique émergente
3.1. L’Inde, une puissance économique émergente
L’émergence de l’Inde peut être datée de la crise financière de 1991, qui a nécessité l’intervention du FMI et la mise en place d’un ensemble de réformes, ouvrant l’économie indienne, réformant (en la libéralisant) l’industrie et accompagnant le développement du secteur des services. On notera la spécificité de l’émergence de l’Inde, qui passera directement d’une économie agricole traditionnelle à une économie tertiaire, sans passer par l’étape d’industrialisation (contrairement à la Chine).
Elle se développe sur ses points forts : une démocratie avec une élite mobile et bien formée, une croissance démographique très forte, avec une main-d’œuvre qualifiée. Elle est fermée aux capitaux étrangers par rapport au reste de l’Asie et a connu un développement dans les services et des niches de haute technologie avec son pôle de compétitivité (Bangalore).
3.2. Les faiblesses de spécialisations du modèle de développement de l’économie indienne
3.2.1. Les difficultés de l’économie indienne
L’économie indienne connaît aussi des difficultés :
Les infrastructures restent médiocres, une bureaucratie qui reste très forte et paralysante.
Une majorité de la population continue de survivre sur une agriculture peu productive (malgré la révolution verte), et le système des castes maintient de fortes inégalités. Or celles-ci sont vues comme des freins à la croissance (T. Piketty).
D’un point de vue théorique, les théories de la croissance endogène
permettent d’expliquer les besoins d’infrastructure et d’éducation nécessaires pour l’Inde.
Les théories keynésiennes, selon François Bourguignon et T. Piketty, permettent de montrer l’importance des réductions des inégalités et l’émergence d’une classe moyenne (en faisant éventuellement référence au cas du Brésil). L’émergence s’accompagne non seulement des problèmes d’inégalités, mais aussi de problèmes environnementaux.
Le cas de Bangalore peut être rattaché aux théories de l’économie spatiale avec les travaux sur les districts de Marshall ou les économies d’agglomération de Krugman.
3.2.3. Une volonté politique de relever les défis
L’Inde a connu un décollage plus lent et tardif que la Chine mais avec un modèle de développement la rendant moins dépendante des exportations (poids des services, de l’informatique et de l’industrie pharmaceutique ; importance de la consommation domestique).
Ses institutions se rapprochent de celles des économies développées (démocratie, rôle du marché), mais rendent toutefois plus difficile d’imposer des réformes structurelles profondes pourtant indispensables à son développement (structure sociale très traditionnelle et inégalitaire, système de castes, forte corruption, secteur agricole très important et peu productif, infrastructures encore insuffisantes notamment dans les transports ou l’électricité). Ce sont les défis que souhaite relever le Premier ministre Narendra Modi, élu en 2014, avec notamment la mise en place d’un plan d’industrialisation « Made in India ».
Les notions essentielles
Émergence/économie émergente
Une économie émergente se caractérise par un revenu intermédiaire (supérieur aux pays les moins avancés, inférieur aux revenus des économies de l’OCDE), une ouverture économique au reste du monde, des transformations structurelles et institutionnelles de grande ampleur et un fort potentiel de croissance.
L’émergence peut se relier aux notions de décollage ou « Take off » (Rostow, The Stages of Economic Growth, 1960) ; de convergence : c’est l’idée qu’un pays ou groupe de pays serait en situation de rattraper le groupe des économies avancées, notamment grâce à un fort taux de croissance. Jim O’Neill12 met en évidence 5 critères cumulatifs permettant de définir l’émergence économique : une population nombreuse et en croissance démographique significative, idéalement jeune et éduquée ; un sentier de croissance de long terme autour de 5 % ; une urbanisation importante (facilite l’accès aux transports, à la l’eau potable et à l’électricité) ; une qualité des infrastructures (nécessaire au développement économique et humain) et une stabilité politique permettant de mettre en œuvre des projets à long terme.
Puissance économique
Une puissance économique est un pays dominant la scène économique mondiale grâce à ses performances économiques et sa capacité à influencer les décisions et les performances économiques des autres pays.
Développement économique
Cette notion désigne les évolutions structurelles d’une zone géographique ou d’une population donnée : maîtrise démographique, expansion reposant sur les secteurs industriels et tertiaires, progrès techniques, amélioration des conditions sanitaires et sociales. Ces évolutions entraînent l’enrichissement de la population et l’amélioration des conditions de vie.
Transferts de technologie
Les transferts de technologie désignent l’ensemble des contenus matériels et immatériels, faisant l’objet d’une transaction encadrée juridiquement, qui permettent au bénéficiaire d’acquérir rapidement des technologies ayant nécessité des investissements au long terme.
Économie de marché
L’économie de marché désigne un système économique organisé principalement, voir uniquement autour du marché







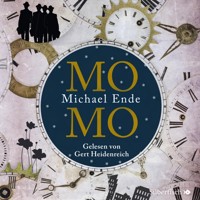



![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)