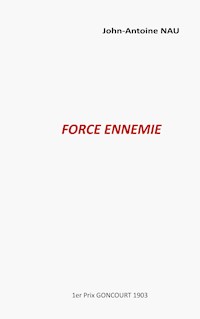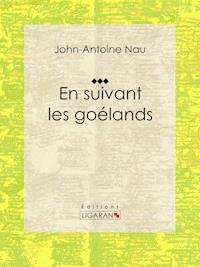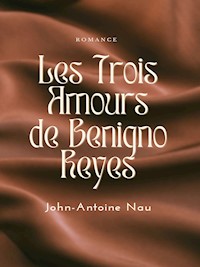
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Il faut mettre à part Les Trois Amours de Benigno Reyes qui nous montre John Antoine Nau dans toute la richesse de son génie de romancier et qui me paraît un véritable chef-d'oeuvre. Cette histoire sentimentale (mais écrite sans aucun sentimentalisme) d'un Canarien qui vit dans un petit port de la côte du Chili, ne peut se raconter : elle est trop subtile, elle atteint trop profondément les mystères du coeur. Elle est d'un pessimisme presque hallucinatoire, et cependant on y remarque l'idéal de Nau, son aspiration, son hymne à la femme.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 62
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les trois Amours de Benigno Reyes
Les trois Amours de Benigno ReyesIIIIIIIVVVIVIIPage de copyrightLes trois Amours de Benigno Reyes
John-Antoine Nau
…
Pour Georges Poirel.
I
Ce matin-là il parut à Benigno Reyes qu’il s’éveillait, non seulement de son long sommeil sans rêves, mais encore d’une torpeur de quinze années qui l’avait rendu indifférent à l’étrangeté des êtres et des choses.
De sa fenêtre il apercevait l’immense rade foraine aux flots verdâtres un peu jaunis, comme huileux, sous le ciel d’outremer intense dont toute la splendeur ne parvenait pas à modifier la teinte morne du grand désert marin à peine mouvant, sans écumes et sans courants perceptibles.
L’Océan Pacifique, partout ailleurs si radieusement céruléen, semble, sur plus d’une centaine de lieues, le long de la côte sud-ouest du Pérou et de la portion tropicale du Chili, refléter la tristesse de la terre effroyablement aride et farouche.
Tout près de Benigno, un petit quai aux pierres fendillées s’effritait entre deux maisons basses d’un délabrement sinistre : toits grisâtres crevés par places, vérandas effondrées sur des piliers en arcs, volets à moitié arrachés. Et le plus lugubre, c’était que ces ruines avaient des habitants, – d’affligeantes familles aux teints de sépia, maladives et déguenillées, dont les enfants ulcéreux et rachitiques somnolaient devant les cases, accroupis dans la poussière et les ordures, ou jetaient des pierres à des chiens inclassables.
Des rails luisants – c’était tout ce qui brillait dans le paysage – filaient à perte de vue sur le sol fauve et sec entre deux rangées de poteaux télégraphiques, seule végétation de la contrée – avec un maigre cocotier empanaché de pennes plutôt jaunes, un acacia épineux vestige d’un square dont les grilles subsistaient, cinq ou six cactus-raquettes d’un ton de cendre à peine verdie et trois aloès monumentaux mais valétudinaires : des aloès mal portants !…
Un semis de plâtras, de constructions roussâtres ou crayeuses, dessinait tant bien que mal des rues difficilement discernables, – vue prise de la fenêtre ; et c’était là – dominé par une énorme, une titanesque muraille de montagnes nues, sauvages et effrayantes – le panorama intégral de Toboadongo, « ville maritime du Chili, province de Tarapaca, par 19° 30’ latitude sud et 72° 39’ longitude ouest, conquise sur le Pérou en 1878 ; salines, dépôts de nitre ; 5900 habitants », – pour parler comme les dictionnaires de géographie commerciale.
Benigno Reyes regarda un moment l’appareillage d’un voilier dépeint, rouillé, gondolé, aussi galeux et lépreux que le décor terrestre ; il envia les quatorze ou quinze privilégiés, capitaine et équipage, qui se confiaient à sa charpente dangereuse pour fuir l’abominable région désolée, et leur souhaita dans son cœur, bon voyage et bonne arrivée : c’eût été vraiment trop terrible de se noyer sans avoir revu des terres un peu plus amènes que les plages de la maudite province de Tarapaca. Mais c’était égal, – leur sort, quel qu’il fût, demeurerait préférable au sien : ils avaient de grandes chances, à présent, de ne pas mourir à Toboabongo ! Tandis que lui !…
Ah ! le charmant séjour que ce Toboadongo ! Certes, sans compter les assommoirs, on y possédait comme lieu de distractions un bureau télégraphique des mieux montés : on pouvait même téléphoner des messages aussi facétieux qu’inutiles à de joyeux employés logés dans des postes-cahutes au beau milieu de pays vagues où les habitants étaient aussi rares que les arbres. Par contre il fallait généralement visiter quatre ou cinq magasins avant de découvrir des denrées médiocrement comestibles : l’unique boulanger n’avait pas toujours assez de farine pour faire du pain pour tout le monde et les approvisionnements de riz et de maïs étaient limités.
Le boucher ne tuait que les jours où les vapeurs de la « Great Inca and Patagonian Company » débarquaient pour son compte deux ou trois veaux monstrueux, tout en pattes et en côtes, fallacieusement qualifiés de bœufs, – ou d’attendrissants petits moutons à mines d’enfants poitrinaires. Et si l’on découvrait assez facilement, de temps à autre, chez l’épicier teinturier ou chez le restaurateur-pharmacien, d’épais carrés de morue bien jaune, rigide comme la femme de Loth et pour la même raison, – on ne voyait pas une barque de pêcheur sur la mer pourtant follement poissonneuse. Des légumes ?… il n’y en avait que sur les planches coloriées de quelques bons ouvrages de botanique enfouis dans la bibliothèque du Senor Cura ; mais, en revanche, abondaient sur le marché de jolis morceaux de cuir de basane connus sous le nom flatteur de tasajo ; – certains colosses munis d’estomacs de tôle ou de platine se vantaient, en exagérant un peu, d’avoir digéré de ces tiges de bottes au moins trois fois dans leur vie, après quelques heures de combat.
Les jours de spleen on avait la ressource de faire pas mal de lieues dans la… campagne, sur la plate-forme du tramway électrique de système ultra-perfectionné qui circulait depuis un point sans nom dont la population consistait en un factionnaire gratifié d’une guérite à claire-voie jusqu’à la station « del Gran’Libertador », – moins triste, – puisqu’à défaut de tout abri humain on y voyait encore les fondations d’un ancien magasin à salpêtre – et que de hardis spéculateurs avaient eu jadis l’intention d’y construire un casino ! – Ils avaient eu bien soin de ne rien bâtir du tout après y avoir mieux réfléchi, mais une personne d’imagination moyenne pouvait toujours passer quelques minutes agréables à se figurer la somme d’animation et de gaieté qu’eût fournie un kursaal édifié en un pareil endroit.
Cependant la Compagnie du Tramway (Limited) faisait mal ses affaires bien qu’une excursion en l’un de ses cars offrît tout autant d’intérêt, grâce à la variété des sites, qu’une promenade sur une table de cuisine passée à l’ocre et indéfiniment prolongée.
Il y avait aussi un chemin de fer qui pouvait, un jour ou l’autre, d’après les projets de ses entrepreneurs, réunir Toboadongo à divers « grands centres » de la Bolivie. Mais la gare seule était terminée, les travaux ayant dû prendre fin le jour où la Société du « Ferro-Carril internacional Sur-Americano » avait reçu la désastreuse nouvelle du naufrage de sa locomotive coulée à pic dans le détroit de Magellan avec le steamer qui l’apportait.
Il y avait de plus les parlotes chez le pharmacien ; le club installé dans la fameuse gare, un club où les cartes tachaient les doigts et où l’on ne trouvait à boire que de l’eau-de-vie de Pisco, un club où sur douze membres dix étaient, la plupart du temps, malades ou en voyage ; l’hôtel belge où l’on mangeait du homard conservé…
Il y avait encore…
Mais Benigno trouvait tout cela parfaitement insuffisant, surtout ce matin-là où la tristesse le reprenait à la gorge aussi furieusement que le jour de son arrivée, – après quinze ans d’un engourdissement qu’il ne s’expliquait plus.
Il importe de dire que Reyes était un calme canarien du Puerto de La Orotava, dans l’île de Ténériffe, généralement un peu plus imaginatif et réfléchi qu’une mule de son pays natal. Du moment qu’il gagnait sa vie, le milieu ne lui importait guère et avant de se fixer à Toboadongo il avait déjà pérégriné quelque peu à la recherche, – non point d’une « position » lucrative, – mais tout simplement de maigres gages permettant des festins de soupe et de gofio, plus le luxe d’une très petite tirelire.
Ses passages sur les bateaux, il les avait toujours payés en travail.
Fils de bourgeois ruinés, pourvu d’une instruction décente, il s’était vu obligé de se faire ouvrier pour vivre et d’émigrer en conséquence, – la furibonde vanité de ses parents ne l’ayant jamais autorisé à exercer une « profession vile » sur le sol qu’ils daignaient fouler. Successivement scieur de long, puis trieur de tabacs aux environs de La Havane, plâtrier à Caracas, chauffeur sur la voie ferrée de Colon à Panama et charpentier à bord d’une goélette équatorienne, il avait été débarqué sans une perra chica à Toboadongo par le capitaine Yrrigoyenechea du port de Guayaquil, le vilain soir où ce navigateur, plus ivre qu’à l’ordinaire, s’était aperçu que la présence d’un marin étranger déshonorait la vieille carcasse de son navire.
Et dans l’atroce bourgade chilienne la chance souriait enfin à Benigno Reyes : de garçon d’auberge il devenait commis de négociant, plus tard négociant lui-même et spéculait aujourd’hui sur les nitres sans trop de maladresse.