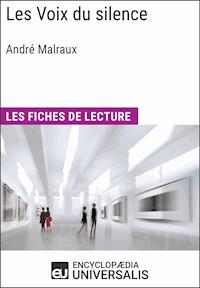
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Französisch
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalis
D’abord publiés chez Skira en trois volumes, parus de 1947 à 1949, intitulés Psychologie de l’art –
Le Musée imaginaire, La Création artistique, La Monnaie de l’absolu –, les grands textes sur l’art d’André Malraux (1901-1976), recomposés et retouchés, deviennent, en 1951, chez Gallimard, un imposant livre illustré divisé en quatre parties,
Les Voix du silence.
Une fiche de lecture spécialement conçue pour le numérique, pour tout savoir sur Les Voix du silence d'André Malraux
Chaque fiche de lecture présente une œuvre clé de la littérature ou de la pensée. Cette présentation est couplée avec un article de synthèse sur l’auteur de l’œuvre.
A propos de l’Encyclopaedia Universalis :
Reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité incomparable de ses publications, Encyclopaedia Universalis met la connaissance à la portée de tous. Écrite par plus de 7 400 auteurs spécialistes et riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins…), l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable collection de référence disponible en français. Elle aborde tous les domaines du savoir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 51
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782852296237
© Encyclopædia Universalis France, 2019. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Bluraz/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Encyclopædia Universalis.
Ce volume présente des notices sur des œuvres clés de la littérature ou de la pensée autour d’un thème, ici Les Voix du silence, André Malraux (Les Fiches de lecture d'Universalis).
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
LES VOIX DU SILENCE, André Malraux (Fiche de lecture)
D’abord publiés chez Skira en trois volumes, parus de 1947 à 1949, intitulés Psychologie de l’art – Le Musée imaginaire, La Création artistique, La Monnaie de l’absolu –, les grands textes sur l’art d’André Malraux (1901-1976), recomposés et retouchés, deviennent, en 1951, chez Gallimard, un imposant livre illustré divisé en quatre parties, Les Voix du silence. Malraux écrivain, habité par la création artistique, publie par ailleurs en 1950 un essai sur Goya, Saturne, qui devient en 1978 Saturne. Le destin, l’art et Goya, ainsi que les trois volumes, qui comprennent plus d’images que de textes issus du Musée imaginaire de la sculpture mondiale – La Statuaire. Des bas-reliefs aux grottes sacrées, Le Monde chrétien – et, enfin, les trois volumes de La Métamorphose des dieux – Le Surnaturel, L’Irréel et L’Intemporel – dont la publication s’achève en 1976. De ses rencontres avec Picasso, il a tiré un livre qui n’est ni un essai ni une biographie, La Tête d’obsidienne, qui connaît sa forme définitive en 1974. Les écrits sur l’art occupent donc dans l’œuvre de Malraux, et à toutes les époques de sa vie, une place considérable, à tort minimisée par ses biographes, par rapport au Malraux romancier, au ministre et à l’homme politique, qui demeurent aujourd’hui les plus populaires et les mieux étudiés.
• Une anti-histoire de l’art : réponse aux « Antimémoires »
Malraux, dès ses années de jeunesse, ses premiers voyages en Italie ou au Cambodge, et ensuite pendant la période de la guerre, a été hanté par les œuvres des musées, composant son musée personnel grâce à sa prodigieuse mémoire. Les œuvres qu’il cite reparaissent dans différents ouvrages comme les personnages des romans de Balzac ou de Proust, elles vivent de leur vie propre dans cette épopée sans équivalent dans la littérature – qu’il ne faut donc pas lire et juger comme une « histoire ». Malraux crée ses « livres d’art » comme des œuvres, comme les collages de Rauschenberg, en assemblant des images, en établissant des ponts entre les cultures et les civilisations. Son dédain pour une histoire de l’art traditionnelle, qui place au premier plan la chronologie et la distinction géographique des « écoles », lui a valu l’animosité des historiens de l’art, qui, à la suite de Georges Duthuit, byzantiniste réputé et gendre de Matisse, ont mis en cause non seulement ses connaissances réelles mais, plus fortement, sa conception de l’art comme « anti-destin ». Pourtant, l’immense succès des livres de Malraux, leur place dans les ateliers d’artistes et dans les bibliothèques des amateurs cultivés à partir des années 1950 en a fait des classiques. Leur l’influence, parfois cachée – dans le monde des musées et des expositions notamment –, fut immense et mériterait d’être redécouverte aujourd’hui, sans polémique.
Henri Zerner a souligné le fait que le copyright de la première édition du Musée imaginaire de la sculpture mondiale porte explicitement « Texte et illustrations », mention rare qui prouve à quel point Malraux est l’auteur absolu de ses ouvrages sur l’art, depuis les fulgurances du texte jusqu’aux subtils équilibres de la maquette, au détourage de certaines sculptures, aux angles choisis par les photographes : on peut parler, chez un auteur qui a été aussi cinéaste, d’une écriture avec des images. La confrontation est la clé de sa vision : « L’œuvre d’art surgit dans son temps et de son temps, mais elle devient œuvre d’art par ce qui lui échappe. » Ne citant aucun des historiens de l’art qu’il connaît pourtant – ni Émile Mâle, ni Henri Focillon, ni Roberto Longhi, à peine Bernard Berenson – Malraux dialogue avec Nietzsche, Hegel, Valéry, Baudelaire ou, à la rigueur, avec Fromentin, écrivains passionnés autant que lui par l’art. Il tire les conclusions du texte de Walter Benjamin de 1936, L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée, pour faire comparaître les œuvres devant le lecteur : l’illustration est une des raisons du succès et de la force des Voix du silence.
• Malraux et les historiens de l’art
« Le Grand Louvre existerait-il sans Les Voix du silence » ?, demande, avec un peu de provocation, Henri Zerner.
La notion, centrale dans le livre, de métamorphose, a pris chez Malraux une telle puissance qu’elle semble habiter les musées réels d’aujourd’hui, « confrontations de métamorphoses ». La vie des formes se poursuit pour Malraux de siècle en siècle, en une émulation qui a commencé avec « les dessinateurs des cavernes » et dont le musée moderne et le livre illustré sont désormais les arènes – succédant aux temples où « Rome accueillait dans son panthéon les dieux des vaincus ».





























