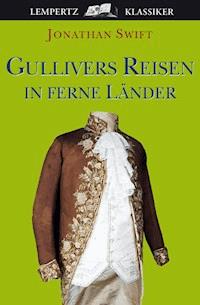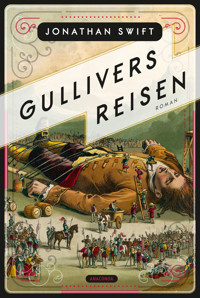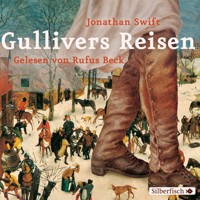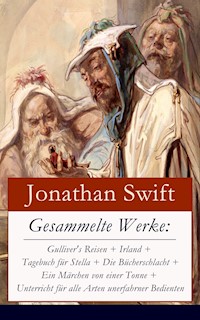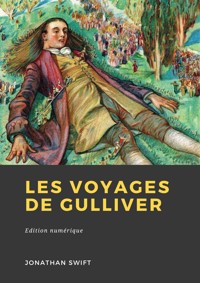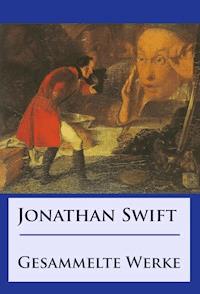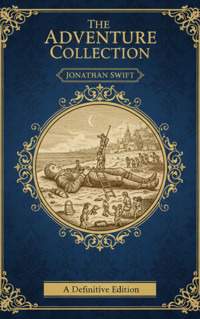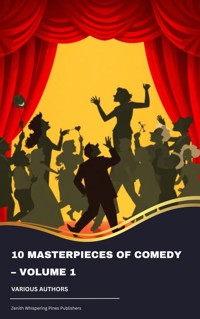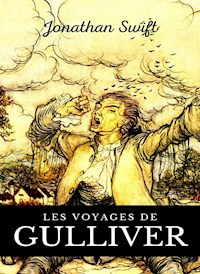
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: anna ruggieri
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Cette édition est unique;
- La traduction est entièrement originale et a été réalisée pour l'Ale. Mar. SAS;
- Tous droits réservés.
Les Voyages de Gulliver de Jonathan Swift ont été publiés pour la première fois en 1726. Le titre complet du livre est "Travels in several remote nations of the world". En quatre parties. "Par Lemuel Gulliver, d'abord chirurgien puis capitaine de plusieurs navires". Il s'agit d'un roman fantastique satirique qui suit Lemuel Gulliver dans ses voyages vers différents mondes. Le premier est Lilliput, où Gulliver rencontre une race de personnes minuscules. Le second est Brobdingnag, où les gens sont des géants. Le troisième voyage se déroule à Laputa (un royaume où les habitants se consacrent aux arts de la musique, des mathématiques et de l'astronomie mais sont incapables de les utiliser à des fins pratiques), à Balnibarbi (un royaume en ruine déterminé par la poursuite aveugle de la science sans résultats pratiques), à Luggnagg (avec des personnes immortelles) et à Glubbdubdrib (où notre héros rencontre les fantômes de personnages historiques tels que Jules César et René Descartes). Le quatrième voyage se déroule au pays de Houyhnhnm, où des chevaux parlants règnent sur des créatures difformes ressemblant à des humains, appelées Yahoos.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Table des matières
L'éditeur au lecteur
Une lettre du capitaine Gulliver à son cousin Sympson.
PARTIE 1. UN VOYAGE À LILLIPUT
PARTIE 2. Un voyage à Brobdingnag
PARTIE 3. UN VOYAGE À LAPUTA, BALNIBARBI, LUGGNAGG, GLUBBDUBDRIB, ET AU JAPON
PARTIE 4. UN VOYAGE AU PAYS DES HOUYHNHNMS
Les voyages de Gulliver
Jonathan Swift
L'éditeur au lecteur
[Comme indiqué dans l'édition originale.]
L'auteur de ces Voyages, M. Lemuel Gulliver, est mon vieil et intime ami ; il existe également entre nous une certaine parenté du côté maternel. Il y a environ trois ans, M. Gulliver, lassé de la foule de curieux qui venaient le voir dans sa maison de Redriff, a fait un petit achat de terrain, avec une maison commode, près de Newark, dans le Nottinghamshire, son pays natal, où il vit maintenant retiré, mais en bonne estime parmi ses voisins.
Bien que M. Gulliver soit né dans le Nottinghamshire, où habitait son père, je l'ai entendu dire que sa famille était originaire de l'Oxfordshire ; pour le confirmer, j'ai observé dans le cimetière de Banbury, dans ce comté, plusieurs tombes et monuments des Gulliver.
Avant de quitter Redriff, il m'a confié la garde des documents suivants, avec la liberté d'en disposer comme bon me semble. Je les ai lus attentivement trois fois. Le style est très clair et simple ; et le seul défaut que je trouve est que l'auteur, à la manière des voyageurs, est un peu trop circonstanciel. Il y a un air de vérité qui se dégage de l'ensemble ; et en effet, l'auteur était si distingué pour sa véracité, que c'était devenu une sorte de proverbe parmi ses voisins de Redriff, quand quelqu'un affirmait une chose, de dire qu'elle était aussi vraie que si M. Gulliver l'avait dite.
Sur le conseil de plusieurs personnes de valeur, à qui, avec la permission de l'auteur, j'ai communiqué ces papiers, je me hasarde maintenant à les envoyer dans le monde, espérant qu'ils seront, au moins pour quelque temps, un meilleur divertissement pour nos jeunes nobles, que les vulgaires gribouillages de la politique et du parti.
Ce volume aurait été au moins deux fois plus grand, si je n'avais pas osé rayer d'innombrables passages relatifs aux vents et aux marées, ainsi qu'aux variations et aux relèvements dans les différents voyages, ainsi que les descriptions minutieuses de la conduite du navire dans les tempêtes, dans le style des marins ; de même le compte des longitudes et des latitudes, où j'ai des raisons de craindre que M. Gulliver ne soit un peu mécontent.
Mais j'étais résolu à adapter l'ouvrage autant que possible à la capacité générale des lecteurs. Toutefois, si ma propre ignorance des affaires maritimes m'a amené à commettre quelques erreurs, je suis seul à en répondre. Et si un voyageur a la curiosité de voir l'ouvrage en entier, tel qu'il est sorti des mains de l'auteur, je serai prêt à le satisfaire.
Quant aux autres détails relatifs à l'auteur, le lecteur sera satisfait dès les premières pages du livre.
RICHARD SYMPSON.
***
Une lettre du capitaine Gulliver à son cousin Sympson.
Écrit en l'an 1727.
J'espère que vous serez prêt à avouer publiquement, chaque fois que vous y serez appelé, que par votre grande et fréquente insistance, vous m'avez persuadé de publier un compte rendu très vague et non correct de mes voyages, en me demandant d'engager un jeune homme de l'une ou l'autre université pour y mettre de l'ordre et corriger le style, comme mon cousin Dampier l'a fait, sur mon conseil, dans son livre intitulé "Un voyage autour du monde". Mais je ne me souviens pas de vous avoir donné le pouvoir de consentir à ce que quelque chose soit omis, et encore moins à ce que quelque chose soit inséré ; par conséquent, en ce qui concerne ce dernier point, je renonce ici à toute chose de ce genre, en particulier à un paragraphe sur sa majesté la reine Anne, de très pieuse et glorieuse mémoire, bien que je la révère et l'estime plus que toute autre espèce humaine. Mais vous, ou votre interpolateur, auriez dû considérer que ce n'était pas mon inclination, et qu'il n'était pas décent de louer un animal de notre composition devant mon maître Houyhnhnm : Et d'ailleurs, le fait était tout à fait faux ; car, à ma connaissance, étant en Angleterre pendant une partie du règne de Sa Majesté, elle gouvernait par un ministre principal, et même par deux successivement, dont le premier était le lord de Godolphin, et le second le lord d'Oxford ; de sorte que vous m'avez fait dire une chose qui n'était pas. De même, dans le récit de l'académie des projecteurs, et dans plusieurs passages de mon discours à mon maître Houyhnhnm, vous avez soit omis des circonstances importantes, soit haché ou changé de telle manière que je ne sais plus ce que j'ai fait. Lorsque je vous en ai fait part dans une lettre, vous avez eu le plaisir de répondre que vous aviez peur d'offenser, que les gens au pouvoir surveillaient de près la presse et qu'ils étaient capables non seulement d'interpréter, mais aussi de punir tout ce qui ressemblait à une insinuation (comme vous l'appelez, je crois). Mais, je vous en prie, comment ce que j'ai dit il y a tant d'années, et à environ cinq mille lieues de distance, sous un autre règne, pourrait-il s'appliquer à l'un des Yahoos qui, dit-on, gouvernent maintenant le troupeau, surtout à une époque où je ne pensais pas, ou ne craignais pas, le malheur de vivre sous leurs ordres ? N'ai-je pas le plus de raisons de me plaindre, quand je vois ces mêmes Yahoos portés par des Houyhnhnms dans un véhicule, comme s'ils étaient des brutes, et ceux-ci des créatures rationnelles ? Et en effet, éviter un spectacle aussi monstrueux et détestable était l'un des principaux motifs de ma retraite ici.
Voilà ce que j'ai cru bon de vous dire à propos de vous-même et de la confiance que j'avais en vous.
Je me plains ensuite d'avoir manqué de jugement en me laissant convaincre par les supplications et les faux raisonnements de vous et de quelques autres personnes, tout à fait contre mon avis, de permettre la publication de mes voyages. Rappelez-vous, s'il vous plaît, combien de fois je vous ai demandé de considérer, lorsque vous avez insisté sur le motif du bien public, que les Yahoos étaient une espèce d'animaux tout à fait incapables d'être amendés par le précepte ou l'exemple : et c'est ce qui s'est produit ; car, au lieu de voir un arrêt complet à tous les abus et à toutes les corruptions, au moins dans cette petite île, comme j'avais raison de l'espérer ; voici, après plus de six mois d'avertissement, je ne peux pas apprendre que mon livre ait produit un seul effet selon mes intentions. Je désirais que vous me fassiez savoir, par une lettre, quand les partis et les factions seraient éteints ; les juges instruits et droits ; les plaideurs honnêtes et modestes, avec quelque teinture de bon sens, et Smithfield flamboyant de pyramides de livres de droit ; l'éducation de la jeune noblesse entièrement changée ; les médecins bannis ; les Yahoos féminins abondant en vertu, en honneur, en vérité et en bon sens ; les cours et les levées des grands ministres soigneusement nettoyées et balayées ; l'esprit, le mérite et l'apprentissage récompensés ; tous les détracteurs de la presse en prose et en vers condamnés à ne manger que leur propre coton et à étancher leur soif avec leur propre encre. Ces réformes, et mille autres, je comptais fermement sur vos encouragements, car elles étaient clairement déductibles des préceptes énoncés dans mon livre. Et il faut reconnaître que sept mois étaient un temps suffisant pour corriger tous les vices et toutes les folies auxquels les Yahoos sont sujets, si leur nature avait été capable de la moindre disposition à la vertu ou à la sagesse. Cependant, vous avez été si loin de répondre à mon attente dans aucune de vos lettres, qu'au contraire, vous chargez chaque semaine notre transporteur de libelles, de clés, de réflexions, de mémoires et de secondes parties, où je me vois accusé de réfléchir sur les grands personnages de l'État, de dégrader la nature humaine (car ils ont encore la confiance de l'appeler ainsi) et d'abuser du sexe féminin. Je trouve aussi que les auteurs de ces liasses ne sont pas d'accord entre eux, car certains d'entre eux ne me permettent pas d'être l'auteur de mes propres voyages, et d'autres me font auteur de livres auxquels je suis totalement étranger.
Je trouve également que votre imprimeur a été si négligent qu'il a confondu les temps et les dates de mes différents voyages et retours, n'attribuant ni la véritable année, ni le véritable mois, ni le jour du mois ; et j'ai entendu dire que le manuscrit original a été entièrement détruit depuis la publication de mon livre ; il ne m'en reste pas non plus de copie : cependant, je vous ai envoyé quelques corrections, que vous pourrez insérer, si jamais il devait y avoir une seconde édition : et pourtant je ne peux pas m'y tenir ; mais je laisserai cette question à mes judicieux et candides lecteurs pour qu'ils la règlent à leur gré.
J'ai entendu certains de nos Yahoos de la mer trouver à redire sur mon langage marin, comme n'étant pas approprié dans de nombreuses régions, ni en usage actuellement. Je n'y peux rien. Lors de mes premiers voyages, alors que j'étais jeune, j'ai été instruit par les marins les plus âgés et j'ai appris à parler comme eux. Mais j'ai découvert depuis que les Yahoos de la mer sont aptes, comme ceux de la terre, à se renouveler dans leurs mots, que ces derniers changent chaque année ; à tel point que je me souviens qu'à chaque retour dans mon pays, leur ancien dialecte était tellement modifié que je pouvais à peine comprendre le nouveau. Et j'observe que, lorsqu'un Yahoo vient de Londres par curiosité pour me rendre visite chez moi, nous ne sommes ni l'un ni l'autre capables de livrer nos conceptions d'une manière intelligible pour l'autre.
Si la censure des Yahoos pouvait m'affecter, j'aurais de grandes raisons de me plaindre, car certains d'entre eux ont l'audace de penser que mon livre de voyages n'est qu'une fiction sortie de mon propre cerveau, et sont allés jusqu'à laisser entendre que les Houyhnhnms et les Yahoos n'ont pas plus d'existence que les habitants d'Utopie.
En effet, je dois avouer qu'en ce qui concerne les peuples de Lilliput, de Brobdingrag (car c'est ainsi que le mot aurait dû être orthographié, et non par erreur Brobdingnag) et de Laputa, je n'ai encore jamais entendu parler d'un Yahoo assez présomptueux pour contester leur existence ou les faits que j'ai relatés à leur sujet, car la vérité frappe immédiatement chaque lecteur avec conviction. Et y a-t-il moins de probabilité dans mon récit des Houyhnhnms ou Yahoos, alors qu'il est évident que pour ces derniers, il y en a tant de milliers même dans ce pays, qui ne diffèrent de leurs frères brutes du Houyhnhnmland, que parce qu'ils utilisent une sorte de jabber, et ne vont pas nus ? J'ai écrit pour leur amendement, et non pour leur approbation. L'éloge unanime de toute la race aurait moins d'importance pour moi que le hennissement de ces deux Houyhnhnms dégénérés que je garde dans mon écurie ; car de ceux-ci, tout dégénérés qu'ils sont, j'améliore encore quelques vertus sans aucun mélange de vice.
Ces misérables animaux ont-ils la prétention de penser que je suis dégénéré au point de défendre ma véracité ? Yahoo comme je le suis, il est bien connu dans tout le Houyhnhnmland, que, par les instructions et l'exemple de mon illustre maître, j'ai pu en l'espace de deux ans (bien qu'avec la plus grande difficulté, je l'avoue) enlever cette habitude infernale de mentir, de traîner, de tromper et d'équivoquer, si profondément enracinée dans l'âme même de toute mon espèce ; surtout des Européens.
J'ai d'autres plaintes à formuler en cette vexante occasion, mais je m'abstiens de me troubler ou de vous troubler davantage. Je dois avouer librement que depuis mon dernier retour, certaines corruptions de ma nature de Yahoo se sont ravivées en moi en conversant avec quelques-uns de vos congénères, et particulièrement ceux de ma propre famille, par une nécessité inévitable ; sinon je n'aurais jamais tenté un projet aussi absurde que celui de réformer la race Yahoo dans ce royaume : Mais j'en ai maintenant fini avec tous ces projets visionnaires pour toujours.
2 avril 1727
PARTIE 1. UN VOYAGE À LILLIPUT
Chapitre 1
L'auteur donne quelques informations sur lui-même et sa famille. Ses premières incitations à voyager. Il fait naufrage et nage pour sauver sa vie. Il arrive sain et sauf sur le rivage dans le pays de Lilliput ; il est fait prisonnier et transporté dans le pays.
Mon père avait un petit domaine dans le Nottinghamshire : J'étais le troisième de cinq fils. À quatorze ans, il m'a envoyé au collège Emanuel de Cambridge, où j'ai résidé trois ans, et où je me suis appliqué à mes études ; mais la charge de m'entretenir, bien que j'eusse une très maigre allocation, étant trop grande pour une petite fortune, j'ai été lié comme apprenti à M. James Bates, un éminent chirurgien de Londres, avec qui j'ai continué quatre ans. Mon père m'envoyait de temps à autre de petites sommes d'argent, que je dépensais pour apprendre la navigation et d'autres parties des mathématiques, utiles à ceux qui ont l'intention de voyager, comme j'ai toujours cru qu'il serait, un jour ou l'autre, de mon ressort de le faire. Lorsque je quittai M. Bates, je descendis chez mon père, où, grâce à son aide, à celle de mon oncle John et de quelques autres parents, j'obtins quarante livres et une promesse de trente livres par an pour m'entretenir à Leyden : j'y étudiai la physique pendant deux ans et sept mois, sachant qu'elle serait utile dans les longs voyages.
Peu après mon retour de Leyde, mon bon maître, M. Bates, m'a recommandé comme chirurgien sur le Swallow, commandé par le capitaine Abraham Pannel, avec lequel j'ai travaillé pendant trois ans et demi, effectuant un ou deux voyages au Levant et dans d'autres régions. À mon retour, j'ai décidé de m'établir à Londres, ce à quoi M. Bates, mon maître, m'a encouragé, et il m'a recommandé à plusieurs patients. J'ai pris une partie d'une petite maison dans le Old Jewry ; et comme on m'a conseillé de modifier ma condition, j'ai épousé Mme Mary Burton, deuxième fille de M. Edmund Burton, bonnetier, dans Newgate-street, avec qui j'ai reçu quatre cents livres pour une partie.
Mais mon bon maître Bates mourut deux ans plus tard, et comme j'avais peu d'amis, mes affaires commencèrent à péricliter, car ma conscience ne me permettait pas d'imiter les mauvaises pratiques de trop de mes frères. Après avoir consulté ma femme et certaines de mes connaissances, j'ai décidé de reprendre la mer. J'ai été chirurgien successivement sur deux navires, et j'ai fait plusieurs voyages, pendant six ans, dans les Indes orientales et occidentales, grâce auxquels j'ai pu ajouter quelque chose à ma fortune. J'employais mes heures de loisir à lire les meilleurs auteurs, anciens et modernes, étant toujours pourvu d'un bon nombre de livres ; et lorsque j'étais à terre, à observer les manières et les dispositions des gens, ainsi qu'à apprendre leur langue, ce qui m'était très facile grâce à la force de ma mémoire.
Le dernier de ces voyages ne s'étant pas avéré très heureux, je me suis lassé de la mer et j'avais l'intention de rester à la maison avec ma femme et ma famille. J'ai déménagé de l'Old Jewry à Fetter Lane, et de là à Wapping, dans l'espoir de faire des affaires avec les marins, mais cela n'a rien donné. Après trois ans d'attente que les choses s'améliorent, j'ai accepté une offre avantageuse du capitaine William Prichard, maître de l'Antilope, qui faisait un voyage dans les mers du Sud. Nous sommes partis de Bristol, le 4 mai 1699, et notre voyage a d'abord été très prospère.
Il ne serait pas approprié, pour certaines raisons, d'ennuyer le lecteur avec les détails de nos aventures dans ces mers ; qu'il suffise de l'informer, que dans notre passage de là aux Indes orientales, nous avons été poussés par une violente tempête au nord-ouest de la Terre de Van Diemen. Par une observation, nous nous sommes trouvés dans la latitude de 30 degrés 2 minutes sud. Douze membres de notre équipage étaient morts par suite d'un travail immodéré et d'une mauvaise nourriture ; les autres étaient dans un état de grande faiblesse. Le 5 novembre, qui était le début de l'été dans ces régions, le temps étant très brumeux, les marins aperçurent un rocher à moins d'une demi-longueur de câble du navire ; mais le vent était si fort, que nous fûmes poussés directement dessus, et nous fendîmes immédiatement. Six des membres de l'équipage, dont je faisais partie, ayant laissé tomber le bateau dans la mer, ont fait un mouvement pour s'éloigner du navire et du rocher. Nous ramions, d'après mes calculs, environ trois lieues, jusqu'à ce que nous ne puissions plus travailler, étant déjà épuisés par le travail pendant que nous étions dans le navire. Nous nous en remîmes donc à la merci des vagues, et au bout d'une demi-heure environ, le bateau fut renversé par une soudaine rafale venant du nord. Ce qu'il advint de mes compagnons dans le bateau, ainsi que de ceux qui s'échappèrent sur le rocher, ou qui furent laissés dans le navire, je ne peux le dire ; mais je conclus qu'ils étaient tous perdus. Pour ma part, j'ai nagé comme la fortune me l'ordonnait, et j'ai été poussé en avant par le vent et la marée. J'ai souvent laissé tomber mes jambes, et je ne sentais pas le fond ; mais lorsque j'étais presque épuisé, et que je ne pouvais plus lutter, je me suis retrouvé dans ma profondeur ; et à ce moment-là, la tempête s'était beaucoup calmée. La déclivité était si faible que j'ai marché près d'un mille avant d'atteindre le rivage, ce que j'ai supposé être vers huit heures du soir. J'ai ensuite avancé de près d'un demi-mille, mais je n'ai pu découvrir aucun signe de maisons ou d'habitants ; du moins, j'étais dans un état de faiblesse tel que je ne les ai pas observés. J'étais extrêmement fatigué, et avec cela, et la chaleur du temps, et environ une demi-pinte de brandy que j'ai bu en quittant le navire, je me suis trouvé très enclin à dormir. Je m'allongeai sur l'herbe, qui était très courte et très douce, où je dormis plus profondément que je ne me rappelle l'avoir fait dans ma vie, et, selon mes calculs, environ neuf heures ; car lorsque je me réveillai, il faisait à peine jour. J'ai essayé de me lever, mais je n'ai pas pu bouger, car, lorsque je me suis couché sur le dos, j'ai découvert que mes bras et mes jambes étaient solidement attachés au sol de chaque côté, et que mes cheveux, qui étaient longs et épais, étaient attachés de la même manière. Je sentais également plusieurs fines ligatures sur mon corps, des aisselles aux cuisses. Je ne pouvais que regarder en l'air ; le soleil commençait à devenir brûlant, et la lumière offensait mes yeux. J'entendais un bruit confus autour de moi, mais dans la position où je me trouvais, je ne pouvais rien voir d'autre que le ciel. Au bout de peu de temps, je sentis quelque chose de vivant bouger sur ma jambe gauche, qui avançait doucement sur ma poitrine et arrivait presque jusqu'à mon menton ; alors, en baissant les yeux autant que je le pouvais, je perçus que c'était une créature humaine de moins de six pouces de haut, avec un arc et des flèches dans les mains, et un carquois dans le dos. Entre-temps, j'en ai senti au moins quarante autres du même genre (comme je le supposais) à la suite du premier. J'étais très étonné et j'ai rugi si fort qu'ils ont tous reculé, effrayés, et certains d'entre eux, comme on me l'a dit plus tard, ont été blessés par les chutes qu'ils ont faites en sautant de mes côtés sur le sol. Cependant, ils revinrent bientôt, et l'un d'eux, qui se risqua à voir mon visage, levant les mains et les yeux en signe d'admiration, s'écria d'une voix stridente mais distincte, Hekinah degul : les autres répétèrent les mêmes mots plusieurs fois, mais je ne savais pas ce qu'ils signifiaient. Je restai tout ce temps, comme le lecteur peut le croire, dans une grande inquiétude. Finalement, en m'efforçant de me détacher, j'eus la chance de briser les cordes et d'arracher les chevilles qui attachaient mon bras gauche au sol ; en effet, en le soulevant jusqu'à mon visage, je découvris les moyens qu'ils avaient pris pour me lier, et en même temps, par une traction violente, qui me causa une douleur excessive, je détachai un peu les cordes qui retenaient mes cheveux du côté gauche, de sorte que je pus tout juste tourner la tête de deux pouces environ. Mais les créatures s'enfuirent une seconde fois, avant que je puisse les saisir ; alors il y eut un grand cri d'un accent très aigu, et après qu'il eut cessé, j'entendis l'un d'eux crier à haute voix Tolgo phonac ; quand en un instant je sentis plus de cent flèches déchargées sur ma main gauche, qui, me piquèrent comme autant d'aiguilles ; De plus, ils lancèrent une autre volée en l'air, comme on fait des bombes en Europe, dont beaucoup, je suppose, tombèrent sur mon corps (bien que je ne les aie pas senties), et quelques-unes sur mon visage, que je couvris immédiatement de ma main gauche. Lorsque cette pluie de flèches fut terminée, je tombai en gémissant de chagrin et de douleur ; puis, s'efforçant à nouveau de se dégager, ils tirèrent une autre volée plus importante que la première, et certains d'entre eux tentèrent avec des lances de me planter dans les côtés ; mais, par chance, je portais une peau de chamois qu'ils ne purent percer. J'ai pensé que la méthode la plus prudente était de rester couché, et mon intention était de continuer ainsi jusqu'à la nuit, quand, ma main gauche étant déjà détachée, je pourrais facilement me libérer : quant aux habitants, j'avais des raisons de croire que je pourrais faire le poids face à la plus grande armée qu'ils pourraient amener contre moi, s'ils étaient tous de la même taille que celui que j'ai vu. Mais la fortune en a décidé autrement pour moi. Quand les gens virent que j'étais tranquille, ils ne lancèrent plus de flèches ; mais, par le bruit que j'entendis, je sus que leur nombre augmentait ; et à environ quatre verges de moi, contre mon oreille droite, j'entendis pendant plus d'une heure un cliquetis, comme celui de gens au travail ; quand je tournai la tête de ce côté, aussi bien que les chevilles et les cordes me le permettaient, je vis une estrade érigée à environ un pied et demi du sol, capable de contenir quatre des habitants, avec deux ou trois échelles pour la monter : D'où l'un d'eux, qui semblait être une personne de qualité, me fit un long discours dont je ne compris pas une syllabe. Mais j'aurais dû mentionner qu'avant que le principal personnage ne commence son oraison, il a crié trois fois, Langro dehul san (ces mots et les précédents m'ont été répétés et expliqués par la suite) ; sur quoi, immédiatement, une cinquantaine d'habitants sont venus et ont coupé les cordes qui fixaient le côté gauche de ma tête, ce qui m'a donné la liberté de la tourner vers la droite, et d'observer la personne et le geste de celui qui devait parler. Il semblait être d'un âge moyen, et plus grand que les trois autres qui l'accompagnaient, dont l'un était un page qui soutenait sa traîne, et semblait être un peu plus long que mon majeur ; les deux autres se tenaient de chaque côté pour le soutenir. Il jouait tous les rôles d'un orateur, et j'ai pu observer plusieurs périodes de menaces, et d'autres de promesses, de pitié et de bonté. Je répondis en quelques mots, mais de la manière la plus soumise, en levant ma main gauche et mes deux yeux vers le soleil, comme pour l'appeler en témoin ; et comme j'étais presque affamé, n'ayant pas mangé un morceau depuis quelques heures avant de quitter le navire, je trouvais les exigences de la nature si fortes sur moi, que je ne pouvais pas m'empêcher de montrer mon impatience (peut-être contre les règles strictes de la décence) en mettant fréquemment mon doigt sur ma bouche, pour signifier que je voulais manger. Le hurgo (car c'est ainsi qu'on appelle un grand seigneur, comme je l'appris par la suite) me comprit très bien. Il descendit de l'estrade et ordonna qu'on m'applique plusieurs échelles sur les côtés, sur lesquelles plus d'une centaine d'habitants montèrent et marchèrent vers ma bouche, chargés de paniers pleins de viande, qui avaient été fournis et envoyés là par les ordres du roi, dès qu'il avait eu connaissance de mon existence. J'ai observé qu'il y avait la chair de plusieurs animaux, mais je n'ai pas pu les distinguer au goût. Il y avait des épaules, des jambes et des longes, formées comme celles du mouton, et très bien habillées, mais plus petites que les ailes d'une alouette. Je les mangeais par deux ou trois à la fois, et prenais trois pains à la fois, de la taille de balles de mousquet. Ils me ravitaillaient aussi vite qu'ils le pouvaient, montrant mille marques de surprise et d'étonnement devant ma corpulence et mon appétit. Je fis alors un autre signe, indiquant que je voulais boire. Ils se rendirent compte, en me voyant manger, qu'une petite quantité ne me suffirait pas ; et étant des gens très ingénieux, ils mirent à l'eau, avec une grande dextérité, l'un de leurs plus grands tonneaux, puis le roulèrent vers ma main, et en battirent le sommet ; je le bus à la pression, ce que je pouvais bien faire, car il ne contenait pas une demi-pinte, et avait le goût d'un petit vin de Bourgogne, mais beaucoup plus délicieux. Ils m'apportèrent un second tonneau, que je bus de la même manière, et je fis des signes pour en avoir d'autres, mais ils n'en avaient pas à me donner. Quand j'eus accompli ces prodiges, ils poussèrent des cris de joie, et dansèrent sur ma poitrine, en répétant plusieurs fois, comme ils l'avaient fait d'abord, Hekinah degul. Ils me firent signe de jeter les deux tonneaux, mais en avertissant d'abord les gens en bas de se tenir à l'écart, en criant à haute voix : Borach mevolah ; et quand ils virent les vaisseaux en l'air, il y eut un cri universel de Hekinah degul. J'avoue que j'ai souvent été tenté, pendant qu'ils passaient en avant et en arrière sur mon corps, de saisir quarante ou cinquante des premiers qui se trouvaient à ma portée, et de les écraser contre le sol. Mais le souvenir de ce que j'avais ressenti, qui n'était probablement pas le pire qu'ils pouvaient faire, et la promesse d'honneur que je leur avais faite - car c'est ainsi que j'interprétais mon comportement soumis - ont rapidement chassé ces imaginations. De plus, je me considérais maintenant comme lié par les lois de l'hospitalité, à un peuple qui m'avait traité avec tant de dépense et de magnificence. Cependant, dans mes pensées, je ne pouvais m'étonner suffisamment de l'intrépidité de ces petits mortels, qui osaient se risquer à monter et à marcher sur mon corps, alors qu'une de mes mains était libre, sans trembler à la vue d'une créature aussi prodigieuse que je devais leur paraître. Après quelque temps, lorsqu'ils constatèrent que je ne demandais plus de viande, apparut devant moi une personne de haut rang de sa majesté impériale. Son Excellence, étant montée sur le petit de ma jambe droite, s'avança jusqu'à mon visage, avec une douzaine de membres de sa suite, et, présentant ses lettres de créance sous le sceau royal, qu'il appliqua près de mes yeux, parla pendant une dizaine de minutes sans aucun signe de colère, mais avec une sorte de résolution déterminée, en montrant souvent du doigt l'avant, ce qui, comme je le découvris par la suite, était vers la capitale, à environ un demi-mille de distance, où il avait été convenu par sa majesté en conseil que je devais être transporté. Je répondis en peu de mots, mais sans résultat, et fis un signe avec ma main libre, la mettant sur l'autre (mais par-dessus la tête de Son Excellence, de peur de le blesser ou de blesser son train), puis sur ma propre tête et mon corps, pour signifier que je désirais ma liberté. Il sembla qu'il me comprenait assez bien, car il secoua la tête en signe de désapprobation et tint la main de manière à montrer que je devais être transporté comme un prisonnier. Cependant, il fit d'autres signes pour me faire comprendre que j'aurais assez de viande et de boisson, et que je serais très bien traité. Sur quoi je pensai une fois de plus à essayer de briser mes liens ; mais, une fois de plus, lorsque je sentis l'éclat de leurs flèches sur mon visage et mes mains, qui étaient tous couverts de cloques, et que beaucoup de fléchettes y étaient encore plantées, et observant également que le nombre de mes ennemis augmentait, je donnai des signes pour leur faire savoir qu'ils pouvaient faire de moi ce qu'ils voulaient. Sur ce, l'hurgo et sa suite se retirèrent, avec beaucoup de civilité et de gaieté de visage. Peu après, j'entendis un cri général, avec de fréquentes répétitions des mots Peplom selan ; et je sentis un grand nombre de personnes sur mon côté gauche détendre les cordes à tel point que je pus me tourner sur ma droite, et me soulager en faisant de l'eau ; ce que je fis très abondamment, au grand étonnement du peuple ; qui, devinant par mon mouvement ce que j'allais faire, ouvrit immédiatement à droite et à gauche de ce côté, pour éviter le torrent, qui tombait de moi avec tant de bruit et de violence. Mais avant cela, ils m'avaient enduit le visage et les deux mains d'une sorte de pommade, très agréable à l'odorat, qui, en quelques minutes, fit disparaître toute l'intelligence de leurs flèches. Ces circonstances, ajoutées au rafraîchissement que j'avais reçu par leurs victuailles et leurs boissons, qui étaient très nourrissantes, me disposèrent à dormir. Je dormis environ huit heures, comme on me l'assura par la suite ; et ce n'était pas étonnant, car les médecins, sur l'ordre de l'empereur, avaient mêlé une potion somnifère aux tonneaux de vin.
Il semble que dès que l'on m'a découvert endormi sur le sol, après mon atterrissage, l'empereur en a été informé par un exprès et a décidé en conseil que je serais attaché de la manière que j'ai racontée (ce qui a été fait dans la nuit pendant que je dormais), qu'on m'enverrait de la viande et des boissons en abondance et qu'on préparerait une machine pour me transporter à la capitale.
Cette résolution peut peut-être paraître très audacieuse et dangereuse, et je suis sûr qu'aucun prince en Europe ne l'imiterait en pareille occasion. Cependant, à mon avis, elle était extrêmement prudente et généreuse : en effet, si ces gens avaient essayé de me tuer avec leurs lances et leurs flèches pendant que je dormais, je me serais certainement réveillé avec le premier sentiment d'alerte, ce qui aurait pu éveiller ma rage et ma force au point de me permettre de rompre les cordes avec lesquelles j'étais attaché ; après quoi, comme ils n'étaient pas capables de résister, ils ne pouvaient attendre aucune pitié.
Ces gens sont d'excellents mathématiciens, et sont arrivés à une grande perfection en mécanique, par la faveur et l'encouragement de l'empereur, qui est un protecteur renommé du savoir. Ce prince a plusieurs machines fixées sur des roues, pour le transport des arbres et autres grands poids. Il construit souvent ses plus grands hommes de guerre, dont quelques-uns ont neuf pieds de long, dans les bois où le bois pousse, et les fait porter sur ces machines à trois ou quatre cents mètres de la mer. Cinq cents charpentiers et ingénieurs furent immédiatement mis au travail pour préparer la plus grande machine qu'ils avaient. Il s'agissait d'un cadre de bois élevé à trois pouces du sol, d'environ sept pieds de long et quatre de large, se déplaçant sur vingt-deux roues. Le cri que j'entendis fut celui de l'arrivée de cette machine, qui, semble-t-il, partit quatre heures après mon atterrissage. On l'apporta parallèlement à moi, alors que j'étais couché. Mais la principale difficulté fut de me soulever et de me placer dans ce véhicule. Quatre-vingts poteaux, chacun d'un pied de haut, furent érigés à cet effet, et des cordes très fortes, de la grosseur d'un fil de paquet, furent attachées par des crochets à de nombreux bandages, que les ouvriers avaient entourés autour de mon cou, de mes mains, de mon corps et de mes jambes. Neuf cents des hommes les plus forts furent employés à tirer ces cordes, par de nombreuses poulies fixées aux poteaux ; et ainsi, en moins de trois heures, je fus soulevé et suspendu dans la machine, et là attaché. On m'a raconté tout cela, car, pendant que l'opération se déroulait, j'étais plongé dans un profond sommeil, sous l'effet du médicament soporifique infusé dans ma liqueur. Quinze cents des plus grands chevaux de l'empereur, hauts d'environ quatre pouces et demi chacun, furent employés à me tirer vers la métropole, qui, comme je l'ai dit, était distante d'un demi-mille.
Environ quatre heures après le début de notre voyage, je me réveillai par un accident très ridicule ; car la voiture étant arrêtée un moment, pour ajuster quelque chose qui était hors d'usage, deux ou trois des jeunes indigènes eurent la curiosité de voir à quoi je ressemblais quand je dormais ; Ils grimpèrent dans la locomotive et, s'approchant doucement de mon visage, l'un d'eux, un officier de la garde, introduisit le bout pointu de sa demi-pique dans ma narine gauche, ce qui me chatouilla le nez comme une paille et me fit éternuer violemment ; puis ils s'enfuirent sans être aperçus, et il fallut trois semaines avant que je sache la cause de mon réveil si soudain. Nous fîmes une longue marche pendant le reste de la journée, et nous nous reposâmes la nuit avec cinq cents gardes de chaque côté de moi, la moitié avec des torches, l'autre avec des arcs et des flèches, prêts à me tirer dessus si je faisais un geste. Le lendemain matin, au lever du soleil, nous avons poursuivi notre marche et sommes arrivés à deux cents mètres des portes de la ville vers midi. L'empereur et toute sa cour sortirent à notre rencontre, mais ses grands officiers ne voulurent en aucun cas que Sa Majesté mette sa personne en danger en montant sur mon corps.
A l'endroit où la voiture s'arrêta, il y avait un ancien temple, considéré comme le plus grand de tout le royaume ; qui, ayant été pollué quelques années auparavant par un meurtre contre nature, était, selon le zèle de ces gens, regardé comme profane, et par conséquent avait été appliqué à l'usage commun, et tous les ornements et les meubles emportés. Il fut décidé que je logerais dans cet édifice. La grande porte qui donnait sur le nord était haute d'environ quatre pieds et large de près de deux pieds, ce qui me permettait de me faufiler facilement. De chaque côté de la porte, il y avait une petite fenêtre, à six pouces du sol : dans celle de gauche, le forgeron du roi transporta quatre-vingt onze chaînes, semblables à celles qui sont suspendues à la montre d'une dame en Europe, et presque aussi grandes, qui furent verrouillées à ma jambe gauche par six cadenas et trente. En face de ce temple, de l'autre côté de la grande route, à vingt pieds de distance, il y avait une tourelle d'au moins cinq pieds de haut. C'est là que l'empereur est monté, accompagné des principaux seigneurs de sa cour, pour avoir l'occasion de me voir, comme on me l'a dit, car je ne pouvais pas les voir. On a estimé que plus de cent mille habitants étaient sortis de la ville pour la même raison et, malgré mes gardes, je crois qu'il ne pouvait y en avoir moins de dix mille à plusieurs moments, qui montaient sur mon corps à l'aide d'échelles. Mais une proclamation fut bientôt publiée, pour l'interdire sous peine de mort. Les ouvriers, voyant qu'il m'était impossible de me détacher, coupèrent toutes les cordes qui me liaient ; après quoi je me levai, avec une disposition aussi mélancolique que je ne l'avais jamais eue de ma vie. Mais le bruit et l'étonnement du peuple, en me voyant me lever et marcher, ne sont pas à exprimer. Les chaînes qui retenaient ma jambe gauche avaient environ deux mètres de long, et me donnaient non seulement la liberté de marcher en avant et en arrière en demi-cercle, mais, étant fixées à quatre pouces de la porte, elles me permettaient de me glisser à l'intérieur et de me coucher de tout mon long dans le temple.
***
Chapitre 2
L'empereur de Lilliput, accompagné de plusieurs membres de la noblesse, vient voir l'auteur dans sa réclusion. Description de la personne et de l'habit de l'empereur. Des hommes érudits sont désignés pour enseigner leur langue à l'auteur. Il s'attire les faveurs de l'opinion par son caractère doux. Ses poches sont fouillées, son épée et ses pistolets lui sont retirés.
Une fois sur pied, j'ai regardé autour de moi, et je dois avouer que je n'ai jamais vu une perspective plus amusante. Le pays environnant ressemblait à un jardin continu, et les champs clos, qui étaient généralement de quarante pieds carrés, ressemblaient à autant de parterres de fleurs. Ces champs étaient entremêlés de bois d'un demi-étang,1 et les plus grands arbres, d'après ce que j'ai pu juger, semblaient avoir sept pieds de haut. Je regardai la ville à ma gauche, qui ressemblait à la scène peinte d'une ville dans un théâtre.
Depuis quelques heures, j'étais extrêmement pressé par les nécessités de la nature, ce qui n'était pas étonnant, car il y avait presque deux jours que je ne m'étais pas déchargé. J'avais de grandes difficultés entre l'urgence et la honte. Le meilleur expédient auquel j'ai pensé a été de me glisser dans ma maison, ce que j'ai fait en conséquence ; et en fermant la porte après moi, je suis allé aussi loin que la longueur de ma chaîne le permettait, et j'ai déchargé mon corps de cette charge pénible. Mais c'est la seule fois que je me suis rendu coupable d'une action aussi impure, et je ne peux qu'espérer que le lecteur sincère me pardonnera, après avoir considéré avec maturité et impartialité mon cas et la détresse dans laquelle je me trouvais. Depuis lors, j'ai toujours eu l'habitude, dès que je me levais, d'accomplir cette tâche en plein air, dans toute la mesure de ma chaîne ; et chaque matin, avant l'arrivée de la compagnie, j'avais soin de faire transporter les matières offensives dans des brouettes, par deux domestiques désignés à cet effet. Je ne me serais pas attardé si longtemps sur une circonstance qui, peut-être, à première vue, peut sembler peu importante, si je n'avais pas pensé qu'il était nécessaire de justifier mon caractère, en matière de propreté, aux yeux du monde ; ce que, me dit-on, certains de mes malfaiteurs se sont plu, en cette occasion et en d'autres, à mettre en doute.
Quand cette aventure fut terminée, je sortis de ma maison, ayant l'occasion de prendre l'air. L'empereur était déjà descendu de la tour, et s'avançait à cheval vers moi, ce qui aurait dû lui coûter cher ; car la bête, quoique très bien dressée, mais tout à fait inhabituée à un tel spectacle, qui lui donnait l'impression qu'une montagne se déplaçait devant elle, se cabra sur ses pattes de derrière ; mais ce prince, qui est un excellent cavalier, resta assis jusqu'à ce que ses serviteurs arrivent en courant et tiennent la bride, pendant que Sa Majesté avait le temps de descendre de cheval. Lorsqu'il descendit, il m'examina de tous côtés avec une grande admiration, mais sans dépasser la longueur de ma chaîne. Il ordonna à ses cuisiniers et à ses maîtres d'hôtel, qui étaient déjà prêts, de me donner des victuailles et des boissons, qu'ils firent avancer dans une sorte de véhicules sur roues, jusqu'à ce que je puisse les atteindre. Je pris ces véhicules et les vidai bientôt tous ; vingt d'entre eux étaient remplis de viande, et dix de liqueur ; chacun des premiers me donna deux ou trois bonnes bouchées ; je vidai la liqueur de dix vaisseaux, qui était contenue dans des flacons de terre, dans un seul véhicule, et la bus au compte-gouttes ; et je fis de même avec le reste. L'impératrice et les jeunes princes de sang des deux sexes, accompagnés de nombreuses dames, étaient assis à quelque distance dans leurs fauteuils ; mais à la suite de l'accident qui arriva au cheval de l'empereur, ils descendirent et s'approchèrent de sa personne, que je vais maintenant décrire. Il est plus grand, de la largeur de mon ongle, que n'importe quel membre de sa cour, ce qui suffit à susciter l'effroi chez les spectateurs. Ses traits sont forts et masculins, avec une lèvre autrichienne et un nez arqué, son teint olive, son visage droit, son corps et ses membres bien proportionnés, tous ses mouvements gracieux et son comportement majestueux. Il avait alors passé la fleur de l'âge, étant âgé de vingt-huit ans et trois quarts, dont il avait régné environ sept dans la grande félicité, et généralement victorieux. Pour mieux l'observer, je me suis couché sur le côté, de sorte que mon visage était parallèle au sien, et il se tenait à trois mètres de moi : cependant, je l'ai eu depuis plusieurs fois dans ma main, et je ne peux donc pas me tromper dans la description. Sa robe était très simple, à la mode asiatique ou européenne, mais il avait sur la tête un léger casque d'or, orné de bijoux, avec une plume sur la crête. Il tenait son épée dégainée à la main pour se défendre, s'il m'arrivait de me détacher ; elle avait près de trois pouces de long ; la garde et le fourreau étaient d'or enrichi de diamants. Sa voix était aiguë, mais très claire et articulée, et je l'entendais distinctement quand je me levais. Les dames et les courtisans étaient tous magnifiquement vêtus, de sorte que l'endroit où ils se tenaient semblait ressembler à un jupon étendu sur le sol, brodé de figures d'or et d'argent. Sa Majesté impériale me parlait souvent, et je lui répondais, mais aucun de nous ne pouvait comprendre une syllabe. Plusieurs de ses prêtres et avocats étaient présents (comme je l'ai supposé d'après leurs habitudes), et on leur a ordonné de s'adresser à moi ; je leur ai parlé dans autant de langues que j'en avais la moindre idée, à savoir le haut et le bas néerlandais, le latin, le français, l'espagnol, l'italien et la lingua franca, mais tout cela en vain. Après environ deux heures, la cour se retira, et je restai avec une forte garde, pour prévenir l'impertinence, et probablement la malice de la populace, qui était très impatiente de s'entasser autour de moi aussi près qu'elle le pouvait ; et certains d'entre eux eurent l'impudence de tirer leurs flèches sur moi, alors que j'étais assis sur le sol près de la porte de ma maison, et l'une d'entre elles manqua de peu mon œil gauche. Mais le colonel a ordonné de saisir six des meneurs, et n'a pas jugé bon de les livrer ligotés entre mes mains, ce que certains de ses soldats ont fait en conséquence, les poussant avec le bout de leurs piques jusqu'à ma portée. Je les ai tous pris dans ma main droite, j'en ai mis cinq dans la poche de mon manteau, et quant au sixième, j'ai fait mine de vouloir le manger vivant. Le pauvre homme poussa un cri terrible, et le colonel et ses officiers eurent beaucoup de peine, surtout lorsqu'ils me virent sortir mon canif ; mais je ne tardai pas à leur ôter toute crainte ; car, prenant un air doux, et coupant immédiatement les cordes avec lesquelles il était attaché, je le posai doucement sur le sol, et il s'enfuit. Je traitai les autres de la même manière, en les sortant un par un de ma poche, et j'observai que les soldats et le peuple étaient très heureux de cette marque de ma clémence, qui fut représentée à mon avantage à la cour.
Vers la nuit, je parvins avec quelque difficulté à entrer dans ma maison, où je me couchai sur le sol, et je continuai à le faire pendant une quinzaine de jours ; pendant ce temps, l'empereur donna l'ordre de me faire préparer un lit. Six cents lits de la mesure commune furent amenés dans des chariots, et travaillés dans ma maison ; cent cinquante de leurs lits, cousus ensemble, faisaient la largeur et la longueur ; et ceux-ci étaient quatre doubles : ce qui, cependant, ne me gardait que très indifféremment de la dureté du plancher, qui était de pierre lisse. Par le même calcul, ils me fournirent des draps, des couvertures et des couvre-lits, assez tolérables pour quelqu'un qui avait été si longtemps accoutumé aux privations.
La nouvelle de mon arrivée s'étant répandue dans le royaume, elle amena un nombre prodigieux de riches, d'oisifs et de curieux à venir me voir, de sorte que les villages étaient presque vides, et qu'il s'ensuivit une grande négligence des travaux des champs et des affaires domestiques, si Sa Majesté impériale n'avait pas prévu, par plusieurs proclamations et ordres d'État, de remédier à cet inconvénient. Il ordonna à ceux qui m'avaient déjà vu de rentrer chez eux et de ne pas s'approcher à moins de cinquante mètres de ma maison sans une autorisation de la cour, ce qui permit aux secrétaires d'État de toucher des honoraires considérables.
Pendant ce temps, l'empereur tenait de fréquents conseils pour débattre de la conduite à tenir à mon égard, et un ami particulier, une personne de grande qualité, qui était autant dans le secret qu'un autre, m'a assuré que la cour avait de nombreuses difficultés à mon sujet. Ils craignaient que je ne m'échappe, que mon régime ne soit très coûteux et qu'il ne provoque une famine. Parfois, ils décidaient de m'affamer, ou du moins de me tirer au visage et aux mains des flèches empoisonnées, ce qui me ferait bientôt disparaître ; mais ils considéraient encore que la puanteur d'une si grande carcasse pourrait produire une peste dans la métropole, et probablement se répandre dans tout le royaume. Au milieu de ces consultations, plusieurs officiers de l'armée se présentèrent à la porte de la grande salle du conseil, et deux d'entre eux, étant admis, rendirent compte de ma conduite aux six criminels susmentionnés ; Ce qui fit une impression si favorable dans le sein de Sa Majesté et de tout le conseil, en ma faveur, qu'une commission impériale fut émise, obligeant tous les villages, à neuf cents mètres autour de la ville, de livrer chaque matin six bêtes, quarante moutons, et d'autres victuailles pour ma subsistance ; ainsi qu'une quantité proportionnelle de pain, de vin, et d'autres liqueurs ; pour le paiement de ce qui est dû, Sa Majesté donna des assignations sur son trésor :-car ce prince vit principalement de ses propres dèmes ; rarement, sauf dans les grandes occasions, il lève des subsides sur ses sujets, qui sont tenus de l'assister à leurs frais dans ses guerres. Il a également été établi que six cents personnes seraient mes domestiques, et que des pensions leur seraient accordées pour leur entretien, et que des tentes seraient construites pour eux de façon très commode de chaque côté de ma porte. Il fut également ordonné que trois cents tailleurs me fassent un costume à la mode du pays ; que six des plus grands savants de Sa Majesté soient employés à m'instruire dans leur langue ; et enfin, que les chevaux de l'empereur, ceux de la noblesse et des troupes de gardes, soient fréquemment exercés sous mes yeux, pour s'habituer à moi. Tous ces ordres furent dûment exécutés et, en trois semaines environ, je fis de grands progrès dans l'apprentissage de leur langue ; pendant ce temps, l'empereur m'honora fréquemment de ses visites et se fit un plaisir d'aider mes maîtres à m'enseigner. Nous commençâmes déjà à converser ensemble en quelque sorte, et les premiers mots que j'appris furent pour exprimer mon désir "qu'il veuille bien me donner ma liberté", ce que je répétais chaque jour à genoux. Sa réponse, telle que je la comprenais, était "qu'il s'agissait d'un travail de longue haleine, auquel il ne fallait pas penser sans l'avis de son conseil, et que je devais d'abord lumos kelmin pesso desmar lon emposo", c'est-à-dire jurer la paix avec lui et son royaume. Cependant, que je sois utilisé avec toute la bonté possible. Et il me conseilla "d'acquérir, par ma patience et ma conduite discrète, la bonne opinion de lui-même et de ses sujets." Il souhaitait que "je ne prenne pas mal le fait qu'il donne l'ordre à certains officiers compétents de me fouiller, car il est probable que je porte sur moi plusieurs armes, qui doivent nécessairement être des choses dangereuses, si elles correspondent au volume d'une personne aussi prodigieuse". Je répondis : " Sa Majesté devrait être satisfaite, car j'étais prêt à me déshabiller et à retourner mes poches devant elle. " Je fis cette déclaration en partie en paroles et en partie en signes. Il me répondit "que, par les lois du royaume, je devais être fouillé par deux de ses officiers ; qu'il savait que cela ne pouvait se faire sans mon consentement et mon assistance ; et qu'il avait une si bonne opinion de ma générosité et de ma justice, qu'il confiait leurs personnes entre mes mains ; que tout ce qu'ils me prendraient devrait être rendu quand je quitterais le pays, ou payé au taux que je leur imposerais." J'ai pris les deux officiers dans mes mains, les ai mis d'abord dans les poches de mon manteau, puis dans toutes les autres poches de mon corps, à l'exception de mes deux fobs et d'une autre poche secrète, que je n'avais pas l'intention de fouiller, et dans laquelle j'avais quelques petits objets de première nécessité qui n'avaient d'importance que pour moi. Dans l'un de mes fobs, il y avait une montre en argent, et dans l'autre une petite quantité d'or dans une bourse. Ces messieurs, ayant sur eux une plume, de l'encre et du papier, firent un inventaire exact de tout ce qu'ils voyaient, et quand ils l'eurent fait, ils voulurent que je les inscrive, afin de les remettre à l'empereur. Cet inventaire, que j'ai ensuite traduit en anglais, est, mot pour mot, le suivant :
"Imprimis : Dans la poche droite du grand homme-montagne (car c'est ainsi que j'interprète les mots quinbus flestrin), après les recherches les plus minutieuses, nous n'avons trouvé qu'un grand morceau d'étoffe grossière, assez grand pour servir de couvre-pieds au chef de la chambre d'État de Votre Majesté. Dans la poche de gauche, nous avons vu un énorme coffre d'argent, avec un couvercle du même métal, que nous, les fouilleurs, n'avons pu soulever. Nous avons souhaité qu'il soit ouvert, et l'un d'entre nous y a pénétré et s'est retrouvé dans une sorte de poussière jusqu'à mi-jambe, dont une partie a volé jusqu'à nos visages et nous a fait éternuer plusieurs fois de suite. Dans la poche droite de son gilet, nous avons trouvé un prodigieux paquet de substances blanches et minces, pliées l'une sur l'autre, de la taille de trois hommes, attachées avec un câble solide, et marquées de chiffres noirs ; nous pensons humblement que ce sont des écritures, chaque lettre étant presque aussi grande que la paume de nos mains. Dans la gauche il y avait une espèce de moteur, du dos duquel s'étendaient vingt longues perches, ressemblant aux pallisados devant la cour de votre majesté : avec lesquelles nous conjecturons que l'homme-montagne se peigne la tête ; car nous ne le troublions pas toujours de questions, parce que nous trouvions une grande difficulté de lui faire comprendre. Dans la grande poche, à droite de sa couverture médiane" (c'est ainsi que je traduis le mot ranfulo, par lequel ils désignaient ma culotte), "nous vîmes un pilier de fer creux, de la longueur d'un homme, attaché à une forte pièce de bois plus grande que le pilier ; et sur un côté du pilier, dépassaient d'énormes morceaux de fer, taillés en figures étranges, dont nous ne savons que faire. Dans la poche de gauche, un autre moteur du même genre. Dans la poche plus petite du côté droit, se trouvaient plusieurs pièces rondes et plates de métal blanc et rouge, de différentes grosseurs ; certaines des blanches, qui semblaient être de l'argent, étaient si grosses et si lourdes que mon camarade et moi pouvions à peine les soulever. Dans la poche gauche se trouvaient deux piliers noirs de forme irrégulière : nous ne pouvions, sans peine, en atteindre le sommet, car nous nous tenions au fond de sa poche. L'un d'eux était couvert et semblait tout d'une pièce, mais à l'extrémité supérieure de l'autre apparaissait une substance ronde et blanche, environ deux fois la taille de notre tête. Dans chacune d'elles était enfermée une prodigieuse plaque d'acier que, par ordre, nous l'avons obligé à nous montrer, car nous craignions qu'il ne s'agisse de moteurs dangereux. Il les sortit de leur étui, et nous dit que, dans son pays, il avait l'habitude de se raser la barbe avec l'une d'elles, et de couper sa viande avec l'autre. Il y avait deux poches dans lesquelles nous ne pouvions pas entrer : il les appelait ses fobs ; c'étaient deux grandes fentes pratiquées dans le haut de sa couverture médiane, mais serrées par la pression de son ventre. De la poche de droite pendait une grande chaîne d'argent, avec une sorte de moteur merveilleux à la base. Nous lui ordonnâmes d'extraire ce qui se trouvait à l'extrémité de cette chaîne ; ce qui semblait être un globe, moitié argent, moitié métal transparent ; car, sur le côté transparent, nous voyions certaines figures étranges dessinées circulairement, et nous pensions pouvoir les toucher, jusqu'à ce que nous trouvions nos doigts arrêtés par la substance lucide. Il nous mit ce moteur dans les oreilles, qui faisait un bruit incessant, comme celui d'un moulin à eau : et nous conjecturons que c'est soit quelque animal inconnu, soit le dieu qu'il adore ; mais nous sommes plus enclins à cette dernière opinion, car il nous assura, (si nous l'avons bien compris, car il s'exprimait très imparfaitement) qu'il faisait rarement quelque chose sans le consulter. Il l'appelait son oracle et disait qu'elle lui indiquait le moment de chaque action de sa vie. De la poignée gauche, il sortit un filet presque assez grand pour un pêcheur, mais qui s'ouvrait et se fermait comme une bourse, et qui lui servait pour le même usage : nous y trouvâmes plusieurs pièces massives de métal jaune, qui, si elles étaient de l'or véritable, devaient être d'une immense valeur.
"Ayant ainsi, en obéissance aux ordres de Votre Majesté, fouillé toutes ses poches, nous avons observé une ceinture autour de sa taille faite de la peau de quelque animal prodigieux, à laquelle, du côté gauche, pendait une épée de la longueur de cinq hommes ; et à droite, un sac ou une poche divisée en deux cellules, chaque cellule pouvant contenir trois sujets de Votre Majesté. Dans l'une de ces cellules se trouvaient plusieurs globes ou boules d'un métal très lourd, de la taille de nos têtes, et nécessitant une main forte pour les soulever : l'autre cellule contenait un tas de certains grains noirs, mais sans grand volume ni poids, car nous pouvions en tenir plus de cinquante dans la paume de nos mains.
"Ceci est un inventaire exact de ce que nous avons trouvé sur le corps de l'homme-montagne, qui nous a utilisé avec une grande civilité, et le respect dû à la commission de votre majesté. Signé et scellé le quatrième jour de la quatre-vingt-neuvième lune du règne propice de votre majesté.
Clefrin Frelock, Marsi Frelock."
Lorsque cet inventaire fut lu à l'empereur, il m'ordonna, bien qu'en termes très doux, de livrer les différents éléments. Il a d'abord demandé mon cimeterre, que j'ai sorti, fourreau et tout. Pendant ce temps, il ordonna à trois mille de ses meilleurs soldats (qui l'accompagnaient alors) de m'entourer à distance, avec leurs arcs et leurs flèches prêts à être tirés ; mais je ne l'ai pas observé, car mes yeux étaient entièrement fixés sur sa majesté. Il me demanda alors de dégainer mon cimeterre, qui, bien qu'il ait été rouillé par l'eau de mer, était, dans la plupart des cas, extrêmement brillant. Je le fis, et immédiatement toutes les troupes poussèrent un cri de terreur et de surprise, car le soleil brillait clairement, et le reflet éblouissait leurs yeux, tandis que j'agitais le cimeterre dans ma main. Sa Majesté, qui est un prince très magnanime, fut moins découragée que je ne pouvais l'espérer : il m'ordonna de le remettre dans le fourreau, et de le jeter à terre aussi doucement que possible, à six pieds environ de l'extrémité de ma chaîne. Il me demanda ensuite l'un des piliers de fer creux, c'est-à-dire mes pistolets de poche. Je le tirai, et à son désir, je lui expliquai de mon mieux l'usage que j'en faisais ; et le chargeant seulement de poudre, qui, par l'étroitesse de ma poche, avait échappé à l'eau de mer (inconvénient contre lequel tous les marins prudents prennent soin de se prémunir), j'avertis d'abord l'empereur de ne pas avoir peur, puis je le lâchai en l'air. L'étonnement fut ici bien plus grand qu'à la vue de mon cimeterre. Des centaines de personnes tombèrent comme si elles avaient été frappées de mort, et même l'empereur, bien qu'il ait tenu bon, ne put se relever avant un certain temps. Je lui ai remis mes deux pistolets de la même manière que mon cimeterre, puis ma poche de poudre et de balles, en le priant de ne pas mettre le premier au feu, car il s'enflammerait à la moindre étincelle et ferait exploser son palais impérial dans les airs. J'ai également remis ma montre, que l'empereur était très curieux de voir, et j'ai ordonné à deux de ses plus grands hommes de garde de la porter sur une perche, sur leurs épaules, comme les cochers d'Angleterre le font avec un tonneau de bière. Il fut étonné du bruit continuel qu'elle faisait, et du mouvement de l'aiguille des minutes, qu'il pouvait facilement discerner, car leur vue est beaucoup plus fine que la nôtre. Il demanda l'avis de ses savants à ce sujet, qui étaient divers et éloignés, comme le lecteur peut l'imaginer sans que je doive le répéter, bien que je ne puisse pas les comprendre parfaitement. Je renonçai alors à mon argent et à mon cuivre, à ma bourse, qui contenait neuf grosses pièces d'or et quelques autres plus petites, à mon couteau et à mon rasoir, à mon peigne et à ma tabatière d'argent, à mon mouchoir et à mon journal. Mon cimeterre, mes pistolets et ma pochette ont été transportés dans des voitures jusqu'aux magasins de Sa Majesté, mais le reste de mes biens m'a été rendu.
J'avais, comme je l'ai déjà dit, une poche privée qui a échappé à leurs recherches, dans laquelle se trouvaient une paire de lunettes (que j'utilise parfois à cause de la faiblesse de mes yeux), une perspective de poche et quelques autres petites commodités ; comme elles n'avaient aucune importance pour l'empereur, je ne me sentais pas tenu par l'honneur de les découvrir, et je craignais qu'elles ne soient perdues ou gâchées si je m'aventurais à les sortir de ma possession.
***
Chapitre 3
L'auteur divertit l'empereur, et sa noblesse des deux sexes, d'une manière très peu commune. Description des divertissements de la cour de Lilliput. L'auteur se voit accorder sa liberté sous certaines conditions.