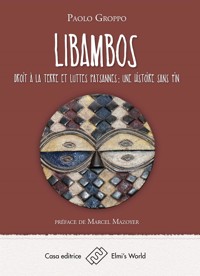
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Elmi's World
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Französisch
Le mot clé de Libambos est l’accaparement (“grabbing" en anglais), une pratique qui a toujours fait partie intégrante des politiques coloniales et post-coloniales. Non seulement l'accaparement des terres, mais aussi de l'eau, des forêts, des ressources génétiques et minières et maintenant aussi du sable et de l'air. Grâce aux nouveaux moyens de communication des organisations paysannes, l’accaparement a gagné en visibilité et touche davantage la communauté internationale et les populations.
Pourquoi ce titre : dans la langue Kimbundu (Angola), le mot "libambos" désignait les chaînes que les esclaves portaient aux pieds et, par conséquent, les longues colonnes d'esclaves transportés par bateaux en Amérique. Ce titre, qui fait référence à ce sentiment d'esclavage, vient d'un raisonnement que l'inspecteur de police James “Grosses Fesses” a avec des membres de la communauté où le viol et le meurtre de la jeune Pureza Mwito ont eu lieu. Une invitation à ne pas lâcher prise, à ne pas devenir esclave et à prendre en main son propre destin et ses responsabilités.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Collana
Français
Paolo Groppo
Libambos
droit à la terre et luttes paysannes : une histoire sans fin
Libambos
droit à la terre et luttes paysannes : une histoire sans fin
di Paolo Groppo
Collana "Français"
ISBN: 978-88-85490-38-3
© Casa Editrice Elmi's World
Tutti i diritti di copyright sono riservati
Casa Editrice Elmi's World
Via Compagno, 7 - 35124 Padova
Tel. 389.13.48.854
mail: [email protected]
sito: www.elmisworld.it
Grafica di Archistico
Couverture arrière
Le mot clé de Libambos est l’accaparement (“grabbing" en anglais), une pratique qui a toujours fait partie intégrante des politiques coloniales et post-coloniales. Non seulement l'accaparement des terres, mais aussi de l'eau, des forêts, des ressources génétiques et minières et maintenant aussi du sable et de l'air. Grâce aux nouveaux moyens de communication des organisations paysannes, l’accaparement a gagné en visibilité et touche davantage la communauté internationale et les populations.
Pourquoi ce titre : dans la langue Kimbundu (Angola), le mot "libambos" désignait les chaînes que les esclaves portaient aux pieds et, par conséquent, les longues colonnes d'esclaves transportés par bateaux en Amérique. Ce titre, qui fait référence à ce sentiment d'esclavage, vient d'un raisonnement que l'inspecteur de police James “Grosses Fesses” a avec des membres de la communauté où le viol et le meurtre de la jeune Pureza Mwito ont eu lieu. Une invitation à ne pas lâcher prise, à ne pas devenir esclave et à prendre en main son propre destin et ses responsabilités.
Biographie
Paolo Groppo a collaboré une trentaine d’années avec l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), durant lesquelles il s’est avant tout occupé de questions relatives à la réforme agraire, à l’agriculture familiale, aux droits fonciers des communautés locales et des populations indigènes, au droit à la terre pour les femmes, au développement territorial ainsi qu’aux problèmes des conflits liés à la terre.
Il a été Editeur de la Revue “Réforme agraire, colonisation et coopératives” de la FAO pendant 17 ans et co-organisateur de la Conférence Internationale pour la Réforme Agraire et le Développement Rural (ICARRD) qui s’est tenue en 2006 à Porto Alegre, Brésil.
Il est membre des associations Land Portal (landportal.org) et AGTER (agter.asso.fr).
En 2012, il publie son premier roman (“Esperanza”, avec Pierre Groppo) dans lequel il met en parallèle la question des desaparecidos argentins et celle du nazisme allemand.
En 2014, il publie “Marne Rosse”, une histoire d’accaparement de terres en Valpolicella, célèbre zone de production du vin Amarone.
“Libambos”, publié en italien en 2016, analyse le thème de l’accaparement foncier dans sa complexité mondiale, en partant d’une petite communauté africaine, pour remonter aux grands projets de développement agricole, peu respectueux des droits fonciers coutumiers.
En 2019, il publie - toujours avec Elmi’s World - “A Manà” sa biographie professionnelle, une réflexion concernant plus de 30 années de travail liées aux questions du Tiers-monde.
Je dédie ce livre à Mia Couto, narrateur d'histoires qui font rêver et sont à l’origine de la nôtre.
« Em toudo o mundo è assim : morrem as pessoas, fica a Historia. Aqui è o inverso : morre apenas a Historia, os mortos não se vão. »;
(O Barbeiro de Vila Longe)
Je le dédie également à Pepetela, pour la légèreté de ses trames policières qui ont inspiré le personnage de l'inspecteur de police de notre récit.
Avertissements
Les droits d'auteur de ce livre ont été dévolus à AGTER, une association internationale à but non lucratif de droit français créée en 2005, qui travaille à l’amélioration de la Gouvernance de la Terre, de l’Eau et des autres Ressources naturelles (www.agter.org). Face aux accaparements et à la concentration, mais aussi vu l’épuisement et la dégradation des ressources, AGTER appuie l’émergence non-violente de nouvelles formes politiques et sociales de gestion de celles-ci, qui préservent les équilibres écologiques. Elle accompagne un processus permanent de réflexion et d’apprentissage collectif, destiné à aider les membres des organisations de la société civile et les gouvernements à s’informer, à formuler des propositions et à les mettre en pratique.
De la part de l'auteur, il s'agit d'une manière concrète de soutenir la recherche, la formation et les activités promues par l’association.
Préface
Depuis la Vénétie rurale de sa jeunesse jusqu’au poste de conseiller technique de la FAO qu’il a occupé de 1989 à 2017, Paolo Groppo a toujours fait preuve d’un engagement résolu en faveur d’un développement agricole durable, justement et largement partagé entre les différentes régions du monde et entre les groupes sociaux les plus directement concernés. Depuis une trentaine d’années, il n’a cessé de contribuer par ses publications et communications à de très nombreux débats scientifiques et publics sur les questions foncières.
Il est l’auteur (avec Pierre Groppo) de “Esperanza” (2012), en mettant en parallèle la question des desaparecidos argentins et du nazisme allemand. En 2014, il publie “Marne Rosse”, une histoire d’accaparement de terre en Valpolicella, célèbre zone de production du vin Amarone, suivi par la version italienne de “Libambos” (2016). En cette même année 2019 il publie, toujours avec Elmi’s World, “A Manà” sa biographie professionnelle après 30 de travail dans les questions du tiers-monde.
Dans ce nouveau roman, Libambos - droit à la terre et luttes paysannes : une histoire sans fin, Paolo Groppo témoigne une fois de plus de cet engagement, de l’actualité de la question de l’accès à la terre et de l’intensité des luttes et des débats qu’elle suscite, tant localement que globalement, dans les milieux sociaux touchés au premier chef ainsi que dans les milieux scientifiques, professionnels et politiques intéressés.
Ce roman à la fois picaresque et personnel, véridique et fictif, est riche de l’expérience exceptionnelle de son auteur, non seulement au siège de la FAO mais aussi sur les terrains où cette organisation est amenée à intervenir, notamment en Afrique (Angola, Mozambique), en Amérique latine (Brésil, Colombie) et en Asie (Philippines). Il rend bien compte de l’étendue et de la complexité des problèmes rencontrés, ainsi que de la diversité des acteurs engagés. C’est pourquoi ce roman passionnera aussi bien les lecteurs familiers de ces questions que les non-initiés.
Les événements mis en scène dans ce nouveau livre se déroulent principalement dans un contexte africain (Mozambique), sud-américain (Brésil), asiatique (Birmanie) et accessoirement européen (Italie, Angleterre). Les acteurs principaux de ces aventures sont principalement les paysans et paysannes de ces régions, en particulier les plus vulnérables, certains politiciens promoteurs de projets, ainsi que des mouvements paysans luttant pour le droit à la terre.
Dans cette histoire, tout part de l’expropriation d’une communauté paysanne de ses meilleures terres, dans la savane boisée du Nord Mozambique, suivie du viol et de l’assassinat de la jeune paysanne Pureza. Il s’ensuit tout un enchaînement d’actions et de réactions parmi les acteurs proches ou lointains de ce drame, allant jusqu’à la préparation d’un attentat - heureusement non abouti - contre un personnage politique sud-américain mondialement connu. Telle est la fiction racontée dans ce livre, qui prend appui sur certains événements bien réels de ces dernières années et sur des idées fortement débattues par ceux qui se préoccupent des questions foncières.
Au-delà de la complexité du thème, ce témoignage romancé nous montre la grande difficulté de la lutte nécessaire pour faire respecter les droits des plus faibles, y compris le droit à la vie, quand les inégalités et les dissymétries de pouvoir sont aussi grandes qu’aujourd’hui.
Mais la détermination et le courage des paysannes de la communauté concernée par les événements nous transmettent un message d’encouragement et d’espoir pour continuer à lutter. Partant de là, l’inspecteur Jaime, qui nous conte cette histoire, décide de changer de vie pour se consacrer à cette cause. Puisse le lecteur en faire autant !
Marcel Mazoyer
Fils de paysans et artisans des hauteurs du Morvan.
Ingénieur agronome, Ingénieur des Eaux et Forêts.
Marcel Mazoyer a été 40 ans Professeur d’Agriculture comparée et Développement agricole à l’Institut National Agronomique Paris-Grignon (aujourd’hui Agro Paris-Tech). Président du Comité de programme de la FAO (1985-1991).
Il est notamment l’auteur de :
- Histoire des agricultures du monde Du Néolithique à la crise contemporaine avec Laurence Roudart, Seuil, Paris, 1997.
- « Protéger la paysannerie pauvre dans un contexte de mondialisation », Marcel Mazoyer, FAO, 2001.
- La Fracture agricole et alimentaire mondiale. Nourrir l’humanité aujourd’hui et demain, dir. avec Laurence Roudart, Universalis, Paris, 2005.
Il a largement contribué au Rapport d’Evaluation des buts et activités de la FAO, à la demande de la Conférence Générale de la FAO, 1990.
L’attentat contre l'ex-Président
Cet attentat, survenu à la fin de l’année dernière, fit couler l’encre des journaux du monde entier et ne constitua pas une bonne publicité pour le pays où celui-ci se produisit. Dans ce cas, c'était le mien : l’Italie. Comme souvent, tous les lecteurs de journaux, qu’ils soient écrits, télévisés ou électroniques (et bientôt tous les citoyens) s’étaient transformés en autant de Sherlock Holmes. Tous mettaient en cause les mesures de sécurité inadaptées, nos agents secrets guère professionnels et formulèrent toute une série de critiques.
Au bar, en ligne, au lit, au bureau : ce fut une occasion en or pour reparler des succès politiques de l’ex-Président Reyes, de son pays et de la passion qui réunissait nos deux contrées - le football. Des discussions pittoresques et répétitives, pour remplir les espaces télévisuels et les pages des journaux. Personne ne semblait se poser la question de savoir ce qui avait pu provoquer un tel acte. Personnellement, je me suis fait une idée et donc, je vous la livre. À vous ensuite de juger de sa crédibilité.
Partons des faits relayés par la presse. L'ex-Président Reyes avait été invité à se rendre en Italie pour participer à une conférence mondiale sur la pauvreté. Étant donné son bilan modèle en matière de lutte contre la faim et la pauvreté rurale, il était perçu comme l’hôte le plus qualifié pour cette Lectio Magistralis1 que l’on célébrait chaque année en automne à Rome, au siège de la FAO, l’agence onusienne spécialisée dans les questions d’agriculture et d’alimentation.
Profitant du voyage, l’ancien Président avait demandé à visiter une exposition d’artistes contemporains qui avait lieu à la même période au musée Maxxi à Rome. Je me rappelle bien cette exposition, car elle était consacrée en particulier à un ami, Mauro Martoriati, qui fut enfin reconnu pour sa capacité à revisiter des sujets populaires, transformés avec des techniques simples, à partir de matériaux de récupération. Ma femme et moi avions également reçu une invitation pour l’inauguration officielle, qui se tenait le jour suivant la visite du célèbre hôte. Le carton, représentant au verso une œuvre de Martoriati, avait fini collé au frigo sous un aimant en forme de Tour Eiffel, pour ne pas être oublié.
La compagne de l’ex-Président avait connu le travail de Martoriati grâce à une collectionneuse française rencontrée à l’université. Une demande pour une visite privée avait été envoyée et le service diplomatique du pays d’accueil s’en était chargé. Il est d’usage qu’en plus d’une visite officielle, une autre visite plus informelle soit organisée, parfois même centrée sur un thème choisi par la personne accompagnant l’hôte principal. Dans ce genre d’occasion, aussi bien le gouvernement que les services de police sont chargés d’assurer le confort nécessaire ainsi que les conditions élémentaires de sécurité.
La routine prévoyait une première inspection des lieux à visiter : horaires, trafic, déplacements externes et internes, sorties de secours et tout ce qui peut être nécessaire. L'ex-Président, dans sa bonhomie et son goût pour les bains de foule, avait l’habitude de ne jamais respecter scrupuleusement les mesures de sécurité. Ainsi, chaque occasion était bonne pour s’arrêter et serrer quelques mains, échanger trois mots, faire un selfie et jouer un peu plus avec les nerfs des personnes chargées de sa protection.
Après seulement que furent connus les faits, plutôt les méfaits, les antécédents ainsi que chacun des détails qui filtrèrent (et qui auraient probablement mérité une attention majeure) que les Italiens se transformèrent en autant d’enquêteurs et de juges du comportement laxiste des forces de sécurité. Pour la défense de celles-ci, il faut reconnaître que la responsabilité des événements aurait dû également être partagée avec l’escorte personnelle de l'ancien Président, qui le suivait depuis son départ. Au fait de ses habitudes, elle aurait dû pouvoir anticiper les événements mieux que personne.
L'ex-Président Reyes s’était mis depuis quelques mois au régime. A cause de son hypertension et de problèmes d’acide urique, un des remèdes conseillés avait été de boire beaucoup d’eau. Au moins deux litres par jour, niveau auquel il s’adaptait comme il pouvait. Reyes, mêlant impératif médical et sens de la communication politique, avait donc pris l’habitude, lors de ses visites privées, d'acheter une bouteille d’eau au premier bar venu. Une bonne occasion de prendre des clichés et de tester sa popularité qui, il faut le dire, était restée à un niveau record, même plusieurs années après sa sortie de la scène politique. Les responsables de la sécurité étaient bien évidemment au courant de ces haltes faussement inopinées et se rendaient à l’avance dans le bar qui serait choisi “par hasard”, suggérant au personnel ce qu’il devait répondre aux éventuelles (et bien connues, c’était toujours les mêmes) questions de l'ancien Président. Il en résultait ainsi une majorité écrasante en faveur de tout ce qu'il avait fait, qui le poussait à renouveler ces arrêts encore et encore, surtout à l’étranger. Il était dès lors évident qu'un arrêt au bar aurait été inclus lors de cette matinée au musée.
Cette histoire d’eau peut sembler banale, mais elle ne le fut pour personne. Cette habitude de l'ex-Président, en devenant publique, aurait dû attirer davantage l’attention chez les personnes en charge de sa sécurité, car elle pouvait représenter un point faible dans le mécanisme bien huilé de sa protection. Ce ne fut pas le cas.
Les gens qui voulaient attenter à la vie de l’ex-Président suivaient attentivement ses déplacements et accumulaient tous les détails qui pouvaient leur être utiles au vu de l'objectif. L’histoire de l’arrêt pour acheter de l’eau ayant été relayée maintes fois, il était sûr que Reyes, accompagné de son escorte, allait faire une pause à l’unique point de restauration : la cafétéria-librairie située juste après l’entrée, rue Guido Reni, demandant (et payant de sa poche) sa bouteille d’eau. Le point critique où agir, c’était donc le bar.
La première partie du plan consistait à ce que l’on donne à l’ex-Président une bouteille bien précise, dans laquelle auraient été injectées quelques gouttes d’un diurétique qui, quelques minutes plus tard, l’obligerait à aller aux toilettes. Pour mener à bien ce plan, il fallait une aiguille suffisamment fine pour que le trou ne se décèle pas et que le serveur présente la bouteille en question et pas une autre. Cela nécessitait donc une infiltration afin de placer le bon serveur au bon endroit. Et c’est ce qu’ils firent. Le subterfuge ne fut découvert que trop tard, une fois les faits survenus et le barman disparu.
Après coup, il ne fut pas difficile de découvrir la ruse des malfaiteurs.
Michele, le véritable serveur, employé à mi-temps - il était aussi comédien - s’était fait renverser le mois précédent par un scooter devant le Théâtre Eliseo, alors qu’il sortait d’une répétition. Ses jours n’étaient pas en danger, mais l’accident l’avait quand même envoyé à l’hôpital Sandro Pertini, avec deux côtes cassées, une épaule démise et la figure passablement abîmée. Le conducteur portait un casque intégral et, selon la police, le véhicule était équipé d’une fausse plaque. La profession de la victime n’attira pas l’attention des autorités et aucune signalisation ne fut transmise à qui de droit. Le lendemain, un candidat se présenta au Musée pour le remplacer. Il s’appelait Luigi. Un peu artiste lui aussi, il approchait de la trentaine et avait non seulement de l’expérience, mais aussi l’allure parfaite, ce genre mi intello, mi créatif, prisé par les concessions commerciales des institutions culturelles. Il était de plus chaudement recommandé : un appel téléphonique avait été passé par une connaissance du gérant du bar, un célèbre Commendatore dont la voix, modifiée, assurait qu’il avait lui-même envoyé ce brave garçon. Étant donné que pratiquement toute embauche passe par les raccomandazioni, cela n’intrigua pas le gestionnaire qui, voyant la dextérité du jeune homme et son habileté à faire grimper le chiffre d’affaire l’avait déjà promu responsable du bar. Ainsi, ce serait lui qui donnerait la bouteille à Oreste Frittarozzi, le Propriétaire du bar en question, qui la confierait ensuite aux mains présidentielles. Le passage final du témoin, euh pardon, de la bouteille, serait ainsi sous sa responsabilité. J’écris « Propriétaire » avec un P majuscule car l’exubérance du personnage (à Rome, on dirait certainement « qu’il se la racontait ») me fait énormément penser à mon grand-père Alfredo.
Le propriétaire du bar, notre ami Oreste, avait compris tout de suite que c'était là une occasion en or pour serrer la main de l’ex-Président, apparaître sur les photos et par-dessus tout, à la télévision. Ainsi, le fameux quart d’heure de célébrité auquel tout le monde a droit, selon Andy Warhol, arrivait. Sur ça, il allait pouvoir vivre cent ans.
Le jour J à dix heures du matin, Luigi, le faux et habile serveur, inséra 3 millilitres d’Aldactazine à travers la capsule en plastique de la bouteille d’Acqua di Panna - version plate, les médecins redoutant les gaz présidentiels - à l'aide d'une seringue hypodermique à aiguille ultra fine achetée en pharmacie. Le cas échéant, Luigi se tenait prêt à laisser entendre que sa petite amie était diabétique et qu’il s’y connaissait en injections d’insuline, mais il n’eut pas besoin de justifier quoi que ce soit. Le carton de bouteilles avait été livré la veille par une équipe des services de sécurité, mais le placard où il avait été remisé était dans un angle mort des caméras de surveillance. Luigi avait rangé ensuite la bouteille en deuxième ligne, une étude attentive des précédentes visites ayant démontré que c’était, dans plus de 90% des cas, l’une de celles-ci qui était tendue au Président. Avec Oreste, ils avaient répété encore et encore le passage de la bouteille du barman au propriétaire au moins autant de fois que des coureurs olympiques de relais.
L’étape suivante consistait à s’infiltrer dans les toilettes, qui seraient évidemment contrôlées par l’escorte, sachant que l’ex-Président s’y rendait toujours seul. Chance pour le serveur et malchance pour Reyes, il y avait, à gauche de la rangée d’urinoirs, minutieusement passés à la javel parfum eucalyptus, une porte avec mention « privé » donnant sur un placard où étaient rangés les produits d’entretien. A l’intérieur du placard, une trappe - dont Oreste pensait être le seul à détenir la clé électronique - conduisait à un sous-sol communiquant avec le reste du bâtiment, notamment avec la zone de livraison.
Lors de l’inspection, tout fut vérifié avec soin. La clef du placard fut donnée par Oreste au personnel de sécurité. De plus, il fut décidé de limiter les entrées au musée le jour de la visite de l’ex-Président. En dehors du personnel, d’un groupe de faux visiteurs âgés et d’une classe de collégiens d’une banlieue populaire - tous munis d’un pass spécial et dont les noms et photographies avaient été transmis à qui de droit - personne ne serait présent. En plus du cortège officiel, six voitures banalisées furent positionnées dans les rues attenantes, dont une centrale de vidéo surveillance, équivalent du SDLP2, banalisée en fourgonnette de pizza. Sur les bords du Tibre, un hydrofoil patientait dans l’hypothèse d’une éventuelle évacuation par voie fluviale.
Luigi, maître dans l’art de se faire apprécier, avait bien entendu examiné tous les accès. Il découvrit ainsi qu’il existait une deuxième clé, dans les mains d’Anna Maria, une des femmes de ménage, affligée d’un léger boitement de la jambe droite. A cause de son handicap, elle avait eu droit à un double afin de pouvoir entrer et sortir par le placard sans passer par la porte principale des toilettes. Le serveur réussit à se lier d’amitié avec elle. Sa mère aussi boitait, lui avait-il raconté. La polio... Un jour, il lui offrit au débotté trois places pour la comédie musicale Mamma Mia ! Les enfants de la femme de ménage furent ravis. Le lendemain, il crocheta le casier d’Anna Maria, emprunta la carte d’accès dont il prit copie en quelques instants sur un sabot militaire, en s’assurant que les traces électroniques seraient bien celles de la femme de ménage. Puis il rangea l’original dans le portefeuille bon marché, près d’une image pieuse de Padre Pio, referma le casier et s’en alla.
Le jour J, tous les voyants étaient au vert, le ciel au grand bleu et la température dépassait les 20 degrés à dix heures du matin. Comme prévu dans l’agenda, l’ex-Président et sa compagne entrèrent au musée à l’heure indiquée, entourés d’un cortège de spécialistes, administrateurs de l’institution, commissaires d’expositions, directeurs de collections, dans l’habituel crépitement des flashes. Le couple s’arrêta un instant dans le grand hall de l’entrée, faisant mine d’écouter les explications qu’on leur donnait sur le travail de la célèbre architecte d’origine irakienne Zaha Hadid. En traversant le couloir, l'ex-Président fit mine d’apercevoir l’enseigne du bar et bifurqua immédiatement pour aller prendre sa fameuse bouteille. Sous le regard des responsables de la sécurité, Luigi se saisit d’une bouteille d’Acqua di Panna plate, la passa rapidement à Oreste, qui la présenta à Reyes avec un sourire radieux destiné aux caméras qui filmaient la scène. L’ex-Président l’ouvrit, en but une grande gorgée et se dirigea vers la caisse pour payer. Oreste lui emboîta le pas, en position stratégique pour les caméras de télévision et factura en personne le paiement d'un euro. La comédie continua comme prévu. L’ex-Président lui demanda s’il avait déjà entendu parler des programmes qu’il avait mis en œuvre dans son pays, de ses actions pour réduire la pauvreté et comment l’art devait aussi être partagé avec les plus modestes. Oreste n’aurait sûrement pas été capable de situer le pays de son invité sur une carte, mais le service communication avait apposé une feuille plastifiée comportant les « éléments de langages » essentiels en dessous de la caisse enregistreuse. Oreste fut parfait, flatteur, mais pas trop. Oui, l’art n’est pas que pour les riches, bien sûr les pauvres aussi sont les bienvenus et quel beau pays que celui du Président... Luigi, derrière, avait la contenance réservée du parfait employé. Plus tard, la bande vidéo montrerait un léger battement incontrôlé de la paupière gauche, mais c’était invisible à l’œil nu et le serveur n’était pas dans le champs des caméras.
Au bout de sept minutes, Reyes s’en alla avec la compagne vers la salle présentant les « Expansions » de Martoriati, sa bouteille à la main et buvant de temps à autre une gorgée d’eau. Le diurétique était censé faire effet dans les vingt minutes. Pendant ce laps de temps, Luigi devait avant tout participer aux festivités du bar, c’est à dire féliciter Oreste pour son aisance, son élégance et tutti quanti. Puis, comme tous les membres du personnel de l’entrée du Musée, il sortit son téléphone, faisant mine d’appeler ses proches, de raconter la visite et d’envoyer des photos de l'ancien Président. L’appareil bas de gamme avait été acheté dans un bazar chinois de la Piazza della Repubblica et muni d’une puce activée le matin même. Adossé à la porte des toilettes, à l’écart de tous, Luigi envoya un unique sms. Puis, souriant, les mains croisées dans le dos comme un chasseur de grand hôtel, il attendit l’envie d’uriner présidentielle.
Celle-ci ne se fit pas attendre. Quelques minutes plus tard, trois hommes en costume noir et oreillettes arrivèrent au trot, râlant entre eux en portugais sur cette envie soudaine, encore une, il faudrait vraiment que Reyes consulte, se fasse opérer, quand même, à son âge... Luigi entendit qu’on vérifiait les toilettes puis le placard et qu’on s'assurait que la petite porte était fermée. Ils sortirent au moment où l’ex-Président arrivait, l’air visiblement pressé de se soulager. Il était presque midi. De son côté, le serveur s'était faufilé vers le sous-sol et, grâce à la clé électronique subtilisée à la pauvre Anna Maria, se trouvait dans le placard communiquant avec les toilettes, juste au moment où l’ex-Président y faisait son entrée. Reyes déboutonna son pantalon et on entendit rapidement ce ruissellement caractéristique rendu célèbre par une marque d'eau oligominérale : « pling-pling », accompagné par un profond soupir de satisfaction. Putain, que ça soulage de pisser, semblait vouloir dire l’ex-Président, en sentant un picotement au cou. Reyes se retourna, mais il n’y avait personne. Puis le plafond fut au sol et les murs devinrent cotonneux. L'ex-Président paniqua. Il étouffait. A son oreille on susurra des mots : « Celui qui fait du mal à la nature, périt par la nature ». C’était Luigi qui les avait prononcés après avoir soufflé, à l’aide d’une sarbacane, une microscopique flèche enduite de curare, un poison utilisé par des tribus amazoniennes. Plus un filet d’air ne passait et ses poumons devenaient de plus en plus chauds - plus encore que la pisse qui détrempait le pantalon de son costume sur mesure. Reyes s’était fait pipi dans son froc.
Il fallut quelques minutes pour qu’on se rende compte de ce qui s’était passé. Car après tout, si l’ex-Président n’avait pas fait que la petite commission ? Les hommes à oreillettes regardaient les trotteuses de leurs montres et échangeaient des regards vides entre eux. Finalement, l’un hocha imperceptiblement le menton et un autre entrouvrit la porte des toilettes. Puis il s’exclama : « le Président se sent mal, appelez une ambulance. »
Si ce genre de situation est parfaitement prévu par tout service de sécurité, la confusion finit toujours par s’inviter à la fête. Ça ne rata pas. Quand des hommes armés surgirent d’on ne sait où, trois collégiennes attendant sagement que l’ex-Président leur serre la main firent une crise de panique. Leurs camarades se mirent à crier de concert, ce qui tétanisa le groupe des retraités. « De l’eau, de l’eau », se mit à haleter une vieille dame qui menaçait de perdre connaissance. Une serveuse courut vers elle, un plateau à la main, mais elle glissa dans sa précipitation et la bouteille explosa au sol, le transformant en patinoire sur laquelle un garde du corps perdit à son tour l’équilibre. Un coup de pistolet partit. Les alarmes se mirent à hurler. Une œuvre en métal de Martoriati tomba à son tour, on ne sait comment et faillit atterrir sur le crâne d’un des étudiants. Bientôt, la confusion fut totale, alors même qu’à l’extérieur, les voitures banalisées bloquaient toutes les voies d’accès au Musée. Des hommes en tenue de combat sortirent de la camionnette à pizza. Sur le Tibre, l’hydrofoil fit rugir ses moteurs. Dix minutes plus tard, deux hélicoptères surgirent dans le bleu du ciel, tandis qu’une horde grossissante de journalistes en voiture, en scooter, en vélo remplissait les rues du quartier.
Après avoir occupé les chaînes d’informations en continu tout l’après-midi, l’attentat contre l’ex-Président fit l’ouverture de tous les journaux télévisés de 20 heures.
Au même moment, dans un petit bureau glauque du commissariat de quartier, la femme de ménage Anna Maria Serafini, en pleurs, essayait de convaincre les policiers que non, elle n’avait pas travaillé ce jours-là au Musée, jurant ses grands dieux qu’elle n’avait pas utilisé son badge, qui était là, d’ailleurs, dans son petit portefeuille bon marché, près de l’image pieuse de Padre Pio. Les policiers faisaient des moues dubitatives, attendant de savoir si la quinquagénaire était administrativement en garde à vue ou pas encore. Le système de vidéo surveillance avait disjoncté pendant exactement huit secondes au niveau de l’accès livraisons et les écrans de contrôle étaient d’un noir d’encre. C’était le bordel partout, leurs supérieurs étaient plus nerveux que jamais et cette pleureuse commençait à ennuyer sérieusement son petit monde.
Personne, en revanche, ne remarqua ce jour-là la silhouette mince, vêtue d’une combinaison de plongée noire, qui se faufila quelques minutes après l’attentat parmi les roseaux qui poussent ici et là sur les berges du Tibre. Elle s’enfonça avec une agilité de poisson dans les eaux boueuses du fleuve, qui se refermèrent sur elle, la faisant ainsi disparaître de cette drôle de journée romaine.
Le sel de la terre
En réalité l’histoire était assez complexe et il n’est pas interdit de penser que tout avait commencé quand la guerre civile qui ensanglanta ces pays africains pendant tant d’années s’était achevée. Finalement, il faut reconnaître que sans l’aide de l’inspecteur James Grosses Fesses Simba (autre personnage peu connu du grand public) qui décida de raconter en détail sa version de l’histoire, nous n’aurions sûrement jamais résolu l’énigme. Procédons donc par étapes.
Julia Mwito et sa fille aînée travaillaient leurs champs dans un village du sud de l’Afrique, à une période qui fut synonyme d’un changement majeur dans leur vie.
À cette époque, je faisais partie de cette multitude de personnes qui avaient décidé de s’occuper des pays dits en voie de développement. J’étais donc un « expert », au sens italien ou français du terme, un de ceux qui étaient appelés à donner leur opinion, en espérant qu’elle soit juste, sur l’avenir du monde, les droits humains et toutes sortes de problématiques à la croisée de la métaphysique et de l’agronomie. J’avais acquis ce titre car j’avais pu accéder à une de ces grandes écoles qui délivrent des diplômes certifiant que vous êtes devenu expert en quelque chose. Il existe pourtant une autre signification pour le mot « expert », comme c’est le cas en portugais et ce mot prend alors un tout autre sens. Ce mot-là veut dire « fourbe ». Combien de fois, dans ma vie professionnelle, ai-je rencontré des « experts » qui correspondaient mieux à la version portugaise qu’à la version italienne du mot. Ceux-là étaient surtout experts dans l’art d’exploiter la pauvreté des pays du Sud pour s’attirer les louanges et s’enrichir à leurs dépens.
A cette époque, la motivation originelle qui m’avait fait aimer ce travail était encore intacte. Elle s’était manifestée avant ma première manifestation politique après la bombe qui avait provoqué douze morts lors de la manifestation antifasciste de la place de la Loggia à Brescia en 1974, en passant ensuite par le Nicaragua sandiniste du début des années 80. Quand je débarquai dans la cité éternelle, cet élan mélangeait trois énergies qui allaient bientôt devenir le slogan d’un groupe de jeunes avec qui je commençais à travailler : la rage, la liberté et l’imagination. La rage, contre ce à quoi le monde était réduit, avec des inégalités croissantes ; la liberté, contre l’oppression idéologique, quelle qu’en soit l’origine ; et l’imagination, afin de se réunir pour organiser une reconstruction cohérente des mécanismes qui maintenaient et maintiennent toujours le sous-développement ; pour comprendre ensuite à quelles portes d’entrée frapper pour essayer d’améliorer le monde dans lequel nous vivions.
Retournons au village de Julia Mwito, où la vie commençait à reprendre ; l’aube pointait et le soleil, derrière la colline, semblait hésiter à se manifester. Les ombres transparentes des arbres en arrière-plan commençaient à disparaître, instables dans les premières lueurs du matin. On pouvait deviner les premiers bruits de la savane ; faibles et éloignés au début, puis de plus en plus forts à mesure que le jour se levait. L’humidité de la nuit était encore palpable. Les vieilles couvertures faisaient ce qu’elles pouvaient pour remédier à ce problème, tout comme le petit matelas gonflable acheté l’année précédente. La hutte cependant restait une simple cabane faite de torchis, de bois et de plaques de zinc pour couvrir le toit.
Julia Mwito sortit la première pour se soulager dans les fosses d’aisance qui avaient été creusées au village récemment. Le travail réalisé par une petite ONG avait été très apprécié : à présent, plus personne ne cherchait un buisson derrière lequel se réfugier. On utilisait désormais cet aménagement. Cela avait constitué une avancée majeure en termes d’hygiène ; chose qui, dans cette contrée noyée dans la savane au centre nord du pays, valait tellement, étant donné que le poste de soins le plus proche se trouvait en périphérie de la capitale provinciale, à une journée de marche. Un peu moins en autocar, mais pas beaucoup, les routes étant des pistes et les autocars victimes de toutes sortes d’avaries techniques, quand autocars il y avait.
Julia Mwito avait moins de quarante ans, même s’il eût été difficile de le deviner. Une vie de privations, depuis toujours. Travailler la terre sous un soleil de plomb qui brûle toute matière organique, la mince couche d’humus fertile comme les corps des paysans, demandait autant de volonté et de résignation qu’il supposait l’impossibilité d’une alternative. Elle rentra lorsque sa fille aînée Pureza sortait pour les mêmes nécessités. Un peu d’eau de la petite bassine qui restait de la veille au soir permettait la toilette matinale. A tour de rôle, elles se lavèrent le visage, en silence, la bouche encore pâteuse. Les deux petites filles dormaient encore. Pureza pris les seaux et s’en alla. Il fallait presque une heure pour arriver au fleuve afin de faire des provisions d’eau. Mais elle pouvait s’estimer heureuse, car au moins ici, l’eau était bonne et abondante.
Les quinze ans de Pureza auraient, sous une autre latitude, été synonyme d’adolescence. Mais chez elle, ce statut n’existait pas. On passait rapidement du statut d’enfant à celui d’adulte, sans étapes intermédiaires. Aller prendre l’eau était son premier devoir matinal, se substituant à Julia, sa mère, qui commençait à préparer un repas à emporter au champ et à préparer les deux petites sœurs pour aller à l’école. En marchant avec les seaux dans les mains, il lui arrivait de sourire en repensant à ces jeunes Italiens travaillant pour cette ONG, qui était venue les aider il y a quelques années. Un jour, ils avaient choisi de l’accompagner au fleuve et, à cause de la chaleur estivale, ils avaient eux aussi voulu essayer de boire de son eau qui. Pureza leur avait expliqué que cela ne se faisait pas comme ça, qu’ils devaient d’abord faire bouillir l’eau pour la boire car leurs intestins n’étaient pas habitués. Mais eux, pour montrer qu’ils n’avaient pas peur, ou peut-être pour confirmer leur ignorance, en avaient bu une gorgée directement du seau. C’était des gamins. Ils avaient une idée très romanesque de l’Afrique, mais aucune expérience. Sur le chemin du retour, la dysenterie était très vite arrivée et les pauvres garçons s’étaient vidés de tout ce qu’ils avaient en eux, encore et encore... Au début, elle s’était mise à rire, mais elle s’était ensuite rendu compte qu’ils allaient vraiment mal et elle avait dû courir chercher leur chef pour les faire emmener en vitesse au poste de soins. Pour ces Italiens-là, on avait réquisitionné un des attelages de misère qui servent aux paysans, tiré par deux boeufs faméliques mais extraordinairement résistants à la chaleur. Les Italiens avaient été sauvés mais la terre, ce jour-là, n’avait pas été travaillée.
Pendant ce temps, Julia Mwito avait réveillé ses deux dernières filles. Un peu d’eau sur le visage, s’habiller, prendre leur sac à dos et partir, tout ça, le ventre vide, comme toujours. Avec les enfants des campagnes alentour, elles s’étaient mises en route pour l’école, à moitié endormies mais contentes d’être tous ensemble. Grâce à des Sœurs missionnaires belges, une école élémentaire avait été construite dans le village voisin. On y apprenait aux enfants à lire et à écrire. Au moins, ils restaient occupés toute la journée et recevaient même une collation offerte par les Sœurs. Cela permettait à Julia Mwito de se rendre, l’esprit libre, sur le terrain où elle cultivait du manioc et même, depuis quelques années, des arachides qui se vendaient bien et lui permettaient de dégager un petit revenu pour vivre. Elle avait planté également quelques bananiers et des papayers, pour avoir des fruits frais et même des tomates.
Si vous n’avez jamais connu ce que signifie travailler sous le soleil d’Afrique, faites l’expérience en allant dans le sud de mon pays. Calabre, Sicile, Pouilles : prenez une houe à manche court, comme celles qui vous font plier en deux tout le temps, puis commencez votre labeur par 40 degrés ; vous comprendrez. Par chance, les arbres (surtout les bananiers) poussaient rapidement. Ainsi Julia et les autres paysannes pouvaient au moins avoir un peu d’ombre quand elles s’arrêtaient pour se reposer. La terre était sèche. C’était de la latérite rouge, très peu fertile. Les sols étaient compacts, typiques de ces latitudes. Son quotidien était rythmé par les coups secs et réguliers de la machette avec laquelle elle enlevait les mauvaises herbes, car c’était la saison du désherbage. Seuls ces bruits rompaient le silence et semblaient agiter imperceptiblement la masse d’air lourd et brûlant. Aucun chant, comme on pouvait en entendre souvent dans les documentaires sur les paysans africains, ne retentissait. Ces chants sont un mensonge : pour ces femmes, il s’agit d’avant tout d’économiser la salive et l’énergie.
Julia Mwito était originaire d’une commune assez proche du village qu’elle habitait aujourd’hui. Les deux communautés étaient presque de la même famille. Pour simplifier, on pourrait dire qu’elles faisaient partie du même groupe tribal, elle et quelques autres communautés, toutes sous le commandement d’un même roi. Ce dernier résidait très loin, bien au-delà de la frontière qui séparait les deux états actuels, fruit de décisions prises par les puissances colonisatrices il y a longtemps. Rares étaient ceux qui avaient vu ce roi, mais son autorité n’était pas mise en doute dans les affaires importantes, surtout quand il s’agissait de lutter contre les autres tribus pour les éternels problèmes territoriaux. Il existait à un niveau plus bas d’autres figures d’autorité traditionnelle, qui s’occupaient de toutes les questions ayant trait aux familles de la communauté. Elles étaient en général respectées car elles avaient une légitimité historique : elles avaient en effet été choisies selon les critères traditionnels. Les choses avaient un peu changé- en pire - depuis que la politique s’était immiscée dans les affaires locales au cours des années cinquante et soixante. La guerre froide entre les deux blocs s’était également répandue en Afrique et les pays avaient dû choisir dans quel camp se ranger : d’une part, le monde libre occidental ; de l’autre, le monde libre socialiste. C’était dans tous les cas une liberté illusoire, car pour eux, misérables paysans, rien n’avait changé, si ce n’est que les dirigeants voulaient s’assurer de la fidélité des différentes communautés et des différents royaumes qui existaient dans leur pays. Il fallait donc que les autorités respectées par la population soient aussi - et surtout - fidèles aux intentions du gouvernement, quel qu’il fût. C’est ainsi que, peu à peu, les autorités traditionnelles commencèrent à perdre leur légitimité historique pour en acquérir une autre, cette fois, politique. Cela faisait d’eux des personnes respectées par le gouvernement, utilisées comme caisses de résonance pour faire passer les ordres et les slogans à scander quand il fallait se regrouper sur une place pour acclamer le président aussi inamovible que son parti. Au fond, les communautés paysannes continuaient à respecter leurs autorités traditionnelles, qui restaient pour la plupart secrètes, afin que le gouvernement ne réussisse pas à leur mettre la main au collet. Les conflits n’avaient fait qu’augmenter, car quand l’autorité politique en place cherchait à forcer les paysans à faire des choses contraires à la tradition, cette dernière se retournait comme un animal blessé, mettant de mauvaise humeur le gouvernement, le parti et toute la chaîne de commandement. Il ne s’agissait pourtant pas là d’une désobéissance politique organisée, mais simplement de rites et coutumes que ces gens modestes respectaient depuis la nuit des temps. L’entrée dans la « modernité », en fait, avait fini par créer davantage de problèmes. Les solutions étaient illusoires, les solidarités menacées et si ces humbles parmi les humbles essayaient d’obtempérer à ces ordres étranges, au final, ils finissaient par respecter les usages et les représentants traditionnels qui avaient été les leurs depuis, semble-t-il, la nuit des temps.
Mon ami Mario vient de Bologne. Expert en systèmes coutumiers africains, il me raconta un jour comment l’affrontement entre autorités modernes et traditionnelles avait progressivement augmenté depuis les années de la colonisation et devenait un problème commun à cause de l’intérêt croissant pour la terre de la part de nombreuses personnes influentes. Même Julia Mwito commençait à pressentir des choses qu’elle n’avait pas le temps de définir ni d’analyser. Un jour, elle était restée particulièrement surprise lorsque, lors d’une réunion communautaire, la question de la vente de la terre avait été évoquée. Vendre la terre ? Quel drôle d’idée, s’était-elle simplement dit. Les anciens de la communauté étaient restés ancrés à une chaîne de rapports familiaux et à une vision centrée sur les personnes dont ils tiraient leur légitimité. Avec la valeur marchande croissante de la terre, la fracture avec les autorités imposées, dont la légitimité venait de la nomination par le parti, devenait chaque jour plus évidente et difficile à gérer.





























