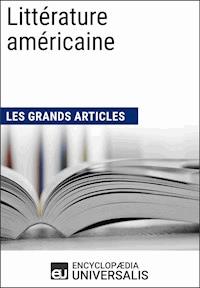
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Französisch
Peut-on les comprendre sans évoquer leurs ancêtres, Melville et Hawthorne, Whitman et Mark Twain ? La littérature américaine est rarement présentée de façon chronologique comme une succession d'écrivains ayant eu une influence les uns sur les autres …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782852297395
© Encyclopædia Universalis France, 2019. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Monticello/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Bienvenue dans ce Grand Article publié par Encyclopædia Universalis.
La collection des Grands Articles rassemble, dans tous les domaines du savoir, des articles : · écrits par des spécialistes reconnus ; · édités selon les critères professionnels les plus exigeants.
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
Littérature des États-Unis
Le goût qu’ont les lecteurs européens pour la littérature des États-Unis n’est pas une mode passagère. On a pu croire que les troupes de la Libération avaient apporté Hemingway dans leurs bagages et que l’âge du roman américain ne durerait pas. Mais, des décennies plus tard, les œuvres « traduites de l’américain » occupent plus que jamais la devanture des librairies. Même ceux qui y cherchent l’image d’un monde qu’ils récusent en subissent la fascination. Certains ont cru que Faulkner « passerait » et en sont pour leurs frais. On ne peut ignorer aujourd’hui les noms de Bellow, de Pynchon ou de Baldwin. Peut-on les comprendre sans évoquer leurs ancêtres, Melville et Hawthorne, Whitman et Mark Twain ?
La littérature américaine est rarement présentée de façon chronologique comme une succession d’écrivains ayant eu une influence les uns sur les autres. Il n’y a pas de querelles des anciens et des modernes entre les générations autour desquelles reconstruire une histoire par étapes.
Pour les critiques, la littérature américaine se présente volontiers comme le reflet d’un trait dominant qui caractérise la situation originale des hommes de ce continent. Les uns la voient profondément marquée par le puritanisme des fondateurs, d’autres au contraire par l’optimisme d’une phase d’expansion auquel succède la nostalgie d’un rêve perdu. Pour certains, l’Américain est pur, innocent, un nouvel Adam ; pour d’autres, son âme est en proie à de noirs tourments de conscience. On dit aussi que les États-Unis cherchent depuis longtemps à atteindre l’âge adulte dans leur expression artistique, comme si ce continent était voué à la poursuite toujours vaine d’un idéal européen ; d’autres pensent au contraire qu’un art « organique » et spontané exprime l’âme américaine, et que c’est dans le dépouillement, le rejet des formes et des conventions, qu’une littérature nationale a vu ou verra le jour. C’est pourquoi la littérature américaine s’interprète plutôt qu’elle ne s’explique ou ne se raconte.
1. Le problème des origines
• Les ancêtres
La littérature américaine est née, à une date incertaine, de mère anglaise et de père inconnu. Malgré les efforts des critiques pour lui confectionner un acte de naissance en bonne et due forme, l’écrivain d’outre-Atlantique se sent toujours le descendant d’un enfant perdu ou d’un continent trouvé. Le grand ancêtre est peut-être un de ces obscurs prêcheurs puritains qui, au XVIIe siècle, annonçaient aux colons la mission glorieuse de régénération que leur confiait le ciel, en même temps que le châtiment implacable promis aux pécheurs : la Cité de Dieu en ce monde et l’Enfer dans l’autre. On peut penser aussi aux chroniqueurs qui prirent la plume pour vanter les exploits des premiers fondateurs, Cotton Mather le clerc (1663-1728) ou William Bradford (1590-1657) le gouverneur. Lequel mérite le titre de premier homme de lettres américain ?
Si, aux lointains ancêtres coloniaux, on préfère un illustre citoyen de la République, Benjamin Franklin (1706-1790), auteur de maximes morales et d’une célèbre autobiographie (bricoleur, homme de science et ambassadeur par surcroît), pourra prendre rang. Le « bonhomme Richard » fait assez bonne figure pour illustrer le provincialisme yankee, mais il manque de grandeur pour symboliser les aspirations du Nouveau Continent. On ne saurait faire naître la littérature américaine dans une arrière-boutique. Ne nous attardons pas, non plus, sur les retentissants écrits révolutionnaires de Tom Paine (1737-1809), Américain d’adoption, ou sur une pièce comme Le Contraste (The Contrast, 1787), de Royall Tyler (1757-1826), dans laquelle Jonathan, l’Américain, dit leur fait aux aristocrates du Vieux Monde, ou encore sur les Lettres d’un fermier américain (Letters from an Americain Farmer, 1782) de Crèvecœur (1735-1813), qui pose la question : « Qu’est-ce qu’un Américain ? » Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle l’imagination américaine est plus politique que poétique.
Certains attendaient un poème épique, et on en écrivit de fort pesants, mais c’est en prose qu’ont été traduits pour la première fois les grands mystères du Nouveau Continent, du moins aux yeux des lecteurs modernes.
• James Fenimore Cooper ou Mark Twain ?
Mystère de l’homme de couleur d’abord. James Fenimore Cooper (1789-1851), dont les personnages évoluent aux confins de l’État de New York, exprime l’affrontement de l’homme « civilisé » et du « sauvage ». Termes ambigus, car le conquérant blanc est souvent plus sauvage que le Peau-Rouge. Son héros, le célèbre Bas-de-Cuir, un Blanc qui met en pratique les vertus des Indiens en vivant avec eux, est l’image de l’Américain tel qu’il s’est rêvé.
Face à l’homme noir réduit en esclavage depuis près de deux siècles et demi, c’est aussi une Américaine telle qu’elle s’est rêvée que suggère Harriet Beecher Stowe (1811-1896) dans la célèbre Case de l’oncle Tom (Uncle Tom’s Cabin, 1851-1852). On retient de ce livre l’image d’un méchant Yankee, d’un Noir qui a toutes les vertus et d’une petite fille, baptisée Ève bien entendu, mais une Ève sans descendance, qui monte au ciel en disant sa prière.
Avec ces deux écrivains, la littérature américaine fait son entrée sur la scène mondiale. Premières œuvres d’imagination vraiment nationales par les sujets qu’elles traitent et internationales par le succès qu’elles remportent ; œuvres foncièrement américaines aussi par les réponses ambiguës qu’elles donnent aux problèmes du Nouveau Monde. L’homme blanc reste en effet porteur des valeurs les plus nobles de la chrétienté et de la « civilisation », mais il les dégrade en se faisant envahisseur et esclavagiste. Quant au « primitif », il est, selon les cas, un modèle à imiter, un ennemi à massacrer, un inférieur à exploiter ou à éduquer.
Le nom de Cooper et, après lui, ceux de Poe (1809-1849), Emerson (1803-1882), Hawthorne (1804-1864), Melville (1819-1891), Whitman (1819-1892) suffisent amplement à prouver qu’une littérature nouvelle était bel et bien née au milieu du XIXe siècle, mais, pour certains, les œuvres de ces hommes ne portent pas assez l’empreinte de ce qu’est l’Américain, citoyen du Nouveau Monde. Hester Prynne, le capitaine Achab, Walt Whitman lui-même ne parlent pas la langue familière et irrévérencieuse qui choque tant les gentlemen anglais. Ces écrivains de la Renaissance n’ont pas coupé les ponts avec l’Europe ; certains vénèrent encore la terre des ancêtres, la patrie culturelle britannique. Aussi, pour saluer la naissance de la littérature américaine, faut-il attendre Mark Twain (1835-1910), qui regarde de haut les Européens et s’adresse résolument au grand public de son pays. Hemingway (1899-1961), Faulkner (1897-1962), T. S. Eliot (1888-1965) et bien d’autres après eux ont affirmé cette tendance.
Au moment des premiers écrits de Mark Twain, après la guerre de Sécession, cette littérature essayait de définir sa vocation plutôt que de prouver son existence. Sa naissance, en effet, était passée inaperçue, sans publication de manifeste d’école, sans préfaces retentissantes, sans reniement du passé. Quand, vers la fin du XIXe siècle, les États-Unis atteignent leur majorité politique et, selon l’expression volontiers employée par les historiens, deviennent une nation adulte, ils ont déjà leur pléiade de grands ancêtres : Cooper, Poe, Emerson, Hawthorne, Melville, Thoreau (1817-1862), Whitman.
• La quête du « père »
On pourrait croire que cette recherche d’un fondateur n’est qu’un vain jeu d’historiens de la littérature. Elle s’apparente pourtant sur le plan culturel à la quête des ancêtres qui caractérise toute l’histoire des États-Unis, à cette angoisse devant le problème de leur origine qu’éprouvent les Américains. Faute de pouvoir prouver la légitimité de leur naissance par un passé mythique et immémorial, les habitants blancs de ce continent se sont en effet donné des « pères pèlerins » et des « pères fondateurs » dont ils s’efforcent de transformer l’histoire en légende. Ils voudraient aussi dater leur Déclaration d’indépendance littéraire ou la perdre dans un lointain Moyen Âge.
Ce fait non seulement jette une certaine lumière sur un problème culturel national, mais encore explique la permanence d’un thème central dans la production littéraire américaine, celui de la quête du « père », de l’ancêtre ou du fondateur de la lignée. Nombre de héros, en effet, sont des orphelins, élevés par un oncle, une tante ou une famille adoptive, de Tom Sawyer à Augie March, ou des adolescents qui ont pratiquement coupé tout lien avec leur famille, qu’il s’agisse du grand départ de Sister Carrie ou de la fugue passagère de Holden Caulfield, ou encore des déracinés venus chercher fortune aux États-Unis, des exilés, vivant fastueusement en Europe, des aventuriers ou de simples vagabonds : Huckleberry Finn, Isabel Archer, ou Nick Adams.
Plus récemment, ils sont les enfants de la beat generation (ou de celle des hippies). Après Henry Miller, le grand ancêtre qui s’exile sous les tropiques de l’amour, Jack Kerouac cherche la route de la béatitude, Burroughs s’enfonce dans l’enfer de la drogue et A. Ginsberg jette un cri de désespoir dans son célèbre poème, Howl. La jeune génération, enfin, découvre la drogue et la clandestinité ou distribue des fleurs en chantant la gloire de Krishna.
L’Américain est-il alors un nouvel Adam capable de réinventer l’homme ? H. James (1843-1916) intitule un de ses romans L’Américain (The American, 1887) et baptise son héros Christopher Newman (Christophe, comme Christophe Colomb, et Newman, l’homme nouveau) ; ou bien ce héros n’est-il qu’un usurpateur, un Jay Gatsby, par exemple, qui renie ses parents, invente sa nouvelle identité et se fait bootlegger ? Hawthorne avait depuis longtemps proclamé que la lignée des propriétaires de la maison aux sept pignons (The House of the Seven Gables, 1851) ne fondait ses droits que sur le crime et sur l’hypocrisie. L’origine des dynasties, dans l’œuvre de Faulkner, celle de Sutpen comme celle des Snopes, est également impure. Pour O’Neill (1888-1953), une plongée dans ses origines familiales est un « long voyage au bout de la nuit » (A Long Day’s Journey into Night, 1940).
Face à l’Américain sûr de soi, fier d’être un self-made man, consacré par la tradition nationale et une réputation internationale, la littérature américaine révèle donc l’inquiétude, la hantise d’un homme qui, tel Œdipe, s’obstine à poser la question fatale, cause de son angoisse et peut-être un jour de sa perte.
2. Les thèmes spécifiquement américains
• L’homme de couleur
Pour les Européens, l’événement qui consacrait la naissance d’une littérature américaine était l’apparition de thèmes indigènes, d’une couleur locale comparable à celle que Chateaubriand était allé découvrir aux États-Unis. Le Peau-Rouge et l’esclave noir apportaient le dépaysement que cherchait le lecteur d’une littérature étrangère. Pour les Américains, il s’agissait moins d’une source de pittoresque que d’un problème de conscience. Bonne conscience pour les uns, qui acceptent, comme une évidence, la supériorité du Blanc ; mauvaise conscience pour les autres, qui perçoivent l’injustice fondamentale d’un racisme triomphant. Après Cooper, l’Indien n’est plus pour l’écrivain américain qu’un mauvais souvenir. Il apparaît épisodiquement comme un noble sachem ou un bandit de grand chemin, finalement relégué dans les westerns, ce musée de L’Homme américain. Le Noir, au contraire, vit avec les Blancs, et non en marge de la société qu’il a créée. Dans un pays si dépourvu des signes extérieurs de la hiérarchie sociale, il fournit à l’écrivain sa première image identifiable de l’inégalité et de l’injustice. De La Case de l’oncle Tom et de Huckleberry Finn à Lumière d’août (Light in August, 1932), à L’Homme invisible (Invisible Man, 1952) ou aux Confessions de Nat Turner (1967), de la résignation à la révolte et à la vengeance, le Noir a acquis dans la littérature américaine une place exceptionnelle. Parallèlement aux hommes d’action que sont Martin Luther King ou Malcolm X s’affirment des écrivains comme Ralph Ellison, James Baldwin, Alice Walker et Toni Morrison. Les Blancs eux-mêmes, après avoir créé un monde de la culpabilité qu’illustre bien « L’Ours » de Faulkner, en viennent parfois à identifier leur propre révolte contre la société à celle de l’homme de couleur contre l’oppression raciale ; c’est le Nègre blanc (The White Negro, 1958) de Norman Mailer.
Ainsi se trouve paradoxalement vérifiée la vision puritaine simpliste de l’univers qu’apportaient les premiers pèlerins. Ces pieux Américains firent volontiers du Noir et de l’Indien des symboles du diable qu’il fallait réduire à merci ou détruire. Leurs descendants se voient maintenant encerclés dans l’Enfer ainsi créé : James Baldwin devient le prophète de leur destruction en leur promettant « la prochaine fois, le feu ». Vision biblique de la malédiction céleste que n’est pas loin de partager l’écrivain blanc William Styron, qui leur conseille aussi de « réduire en cendres cette maison ».
Pourtant, si ce thème de la mauvaise conscience est celui auquel nous sommes le plus sensibles, il n’est qu’un contrepoint à celui de la grande espérance qui anime les Américains. Que de sermons ont illustré l’attente de la Terre promise, que de discours ou d’écrits politiques, de Jefferson et Lincoln à Franklin Roosevelt et John Kennedy, ont exalté la victoire de l’homme sur la barbarie politique, morale ou économique ! La réponse que donnait John Crèvecœur à sa question : « Qu’est-ce qu’un Américain ? » est une description de l’homme idéal de son siècle, bon, sain et heureux.
Seules quelques créations folkloriques, équivalents des fabliaux par les témoignages qu’elles contiennent sur la société de l’époque, font vivre cet homme moyen américain, travailleur, optimiste, démocrate, attendant le résultat de ses efforts en ce monde plutôt qu’en l’autre, passionné de justice et d’égalité, le common man, différent de ce que le Français entend par l’homme du peuple. Or, d’Ismaël, le narrateur morose de Moby Dick (1851), ou de Davy Crockett, lequel est le plus américain ? Question insoluble, mais qui met en lumière les deux faces de l’âme d’une nation.
• L’homme de la nature
L’Amérique, c’est d’abord la nature au moment où l’homme la découvre. Des mots comme « Maine », « Mississippi », « Oregon », « Grandes Plaines » ont encore un charme magique qui évoque celui du lac Glimmerglass de Cooper, et qu’essayent de sauvegarder ou de recréer artificiellement les parcs nationaux. Il existe un coin sauvage dans la conscience de bien des Américains où l’on part à la pêche et à la chasse avec Ernest Hemingway ou Thoreau.
Cette recherche de la nature comporte une identification avec des forces vives : l’expérience d’une promenade dans les bois pour Emerson ou Thoreau, d’un corps qui se roule dans l’herbe pour Whitman, d’un radeau qui flotte au fil de l’eau pour Mark Twain. Or, au XXe siècle, ce contact, cette rencontre miraculeuse de l’homme et de la nature sont perdus. Ils n’en sont alors que plus passionnément recherchés, sur les grand-routes, dans l’exotisme, la guerre, le crime, la drogue ou les aventures sexuelles. La « frontière » qui, sur le plan mythique, rapprochait l’homme de sa pureté originelle, en se rétrécissant sans cesse a finalement laissé l’Américain face à un vide et à une nostalgie. Celui-ci a définitivement perdu au XIXe siècle les bois, la ferme ou le jardin de son enfance. Le Mississippi, comme la Tamise d’Eliot, ne roule plus aujourd’hui que les déchets de la civilisation industrielle.
La nature, c’est aussi pour l’Américain celle que découvre l’agriculteur dans sa ferme : les travaux des champs, la vie patriarcale, les vertus simples, parfois un peu bornées, du colon romain. Le vrai défricheur, le vrai pionnier de la mythologie américaine, est l’homme qui abat des arbres, puis laboure et vit en paix avec ses voisins. Un tel idéal se prête mal aux évocations littéraires, car il ne suggère que le dur labeur et l’ennui et provoque chez l’artiste un sentiment de révolte plutôt que d’admiration. Des œuvres mineures, comme celles de Hamlin Garland, à la fin du XIXe siècle, révèlent la misère des fermiers et l’envers du rêve américain. Seul peut-être, Robert Frost a su allier un attachement têtu de Yankee à son coin de terre, le sens de la plénitude qu’on y découvre, à l’âpreté et l’amertume d’une vie d’intellectuel paysan. Mais c’est à la force de l’évocation nostalgique, au début du XXe siècle, que l’on peut mesurer combien l’Amérique s’est longtemps voulue une terre de paysans libres. Dès que la machine, la banque et l’homme politique se liguent pour exploiter le fermier, les hommes de lettres se révèlent passionnément agrariens. Frank Norris commence une épopée du blé et John Steinbeck vendange sur les vignes américaines les « raisins de la colère » (The Grapes of Wrath, 1939). Même le fermier embourgeoisé et presque urbanisé que dépeint Truman Capote dans De sang froid (In Cold Blood, 1965) est, avec toute sa famille, un modèle de la vertu austère et prospère de l’Amérique.
Du contact avec une nature rebelle, sauvage, présentant aux hommes des obstacles parfois démesurés, les Américains ont enfin gardé l’image d’un affrontement cruel, souvent d’une lutte à mort. Moby Dick reste, au niveau d’interprétation le plus simple, l’histoire de la défaite d’un homme face à un monstre marin, et ce récit fait écho à celui de terrifiantes chasses à l’ours dans les légendes de l’Ouest. La nature est, au premier abord, redoutable et même hostile, comme en firent l’expérience les premiers pèlerins débarquant en Nouvelle-Angleterre. Dans ses déserts ou ses forêts règne la loi du plus fort. Norris situe, tout naturellement, dans la Vallée de la mort le duel entre deux brutes qui sert de dénouement à McTeague (1899). La violence de la nature justifie celle de l’homme, celle des hors-la-loi des westerns ou d’Ishmael Bush dans La Prairie (The Prairie, 1828) de Cooper, et elle lui laisse le goût du sang, comme le montre Norman Mailer dans Pourquoi sommes-nous au Vietnam ? (Why Are We in Vietnam ?, 1967). Dans la littérature contemporaine, si préoccupée des rites de passage et des actes qui assurent la transition symbolique de l’enfance à l’âge d’homme, on retrouve sans cesse ce rôle prédominant accordé à la blessure, aux armes de chasse ou de guerre, qui permettent à l’homme de découvrir simultanément l’existence du mal et sa propre virilité. Il y a dans les œuvres de Stephen Crane, Hemingway, Dos Passos, Faulkner un sens de la victoire et de la défaite ambiguës de l’homme dans la guerre et la violence.
Promeneur dans les bois, fermier, chasseur ou vacancier, l’Américain dans la nature reste seul, en tout cas rarement accompagné d’une femme. Devant un horizon qu’il perçoit illimité, il est tenté de se laisser griser par les délices d’une communion romantique, comme au jardin d’Éden, ou de combler cet espace, ce vide, et de construire une civilisation au milieu du désert. Pour cet Américain solitaire, l’« autre » peut être un compagnon ou un ennemi qui empiète sur son domaine. Fraternité et assassinat sont les deux pôles de la vie comme de la littérature américaines.
Si, à la question, « Qu’est-ce qu’un Américain ? » la littérature des États-Unis répond : « C’est un homme de la nature », avec toutes les ambiguïtés de cette formulation, on comprend pourquoi cet Américain « authentique » n’existe plus au XXe siècle. Le héros américain est maintenant un adolescent qui a perdu son rêve.
• L’homme du progrès
Même si les bois de Concord ou du Michigan, l’étang de Walden ou les rives du Mississippi et, de nos jours, la nature domestiquée des jardins de faubourgs résidentiels et des ports du cap Cod semblent être immédiatement accessibles, ils ne sont perçus et décrits que dans un univers dominé ou cerné par la machine, le chemin de fer, le bateau à vapeur, l’automobile, l’avion. Les valeurs de la nature sont, presque dès l’origine, vécues par contraste avec celles de la ville, de la civilisation et de la société mécanisée. L’Américain, comme Rousseau au moment d’écrire le Discours sur les sciences et les arts, sait que l’homme a irrémédiablement choisi le progrès, mais il s’abandonne à la nostalgie d’une pureté originelle.
Sans doute, en 1900, Sister Carrie prend-elle le train pour Chicago et quitte-t-elle sans regret son village natal, et vingt ans plus tard Carol Kennicott, prisonnière de Main Street, se révoltera-t-elle contre le provincialisme étroit d’une ville minuscule du Middle West ; mais, en contrepoint à cette fuite vers la capitale, vers les capitales, Chicago, Washington, New York, Greenwich Village ou Montparnasse, à cette haine de la vie rurale et de l’esprit de clocher, s’installe une nostalgie encore plus forte de l’Amérique perdue, celle de l’innocence, d’une enfance dans le Michigan, en Virginie, en Caroline. Winesburg, Ohio finit là où commence Sister Carrie : sur le quai d’une gare de campagne. Là se situe la charnière entre deux Amériques irréconciliables.
Si Carl Sandburg a voulu écrire une poésie de la vie moderne, de la ville et de la machine, de la démocratie américaine au XXe siècle, beaucoup ont au contraire choisi l’Amérique du passé, comme Faulkner dans son comté de Yoknapatawpha, où il voit d’un œil soupçonneux la montée des Snopes, ou Steinbeck lorsqu’il s’attendrit sur une Californie d’opérette où l’on côtoie de bons clochards et des prostituées généreuses. Mais ce choix devient de plus en plus illusoire, car le monde rural ou provincial de Carson McCullers, Flannery O’Connor, John Cheever n’est pas un refuge, mais un enfer, guère différent de celui des citadins dans lequel se promène, terrifié, Holden Caulfield, le jeune héros de Salinger.
Pour les écrivains juifs ou





























