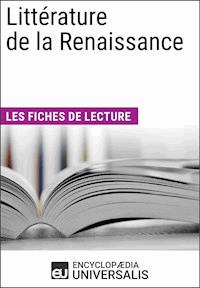
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Französisch
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalis
Le Chant de l’Épouse : c’est ainsi que Jean de la Croix (1542-1591), frère carme, désignait le poème dont il composa un commentaire en prose.
Une fiche de lecture spécialement conçue pour le numérique, pour tout savoir sur Littérature de la Renaissance
Chaque fiche de lecture présente une œuvre clé de la littérature ou de la pensée. Cette présentation est couplée avec un article de synthèse sur l’auteur de l’œuvre.
A propos de l’Encyclopaedia Universalis :
Reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité incomparable de ses publications, Encyclopaedia Universalis met la connaissance à la portée de tous. Écrite par plus de 7 400 auteurs spécialistes et riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins…), l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable collection de référence disponible en français. Elle aborde tous les domaines du savoir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 108
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage a été réalisé par les services éditoriaux et techniques d’Encyclopædia Universalis
ISBN : 9782341002486
© Encyclopædia Universalis France, 2016
Retrouvez-nous sur http://www.universalis.fr
Couverture : © Monticello/Shutterstock
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Bienvenue dans ce dossier, consacré à La Littérature de la Renaissance, publié par Encyclopædia Universalis.
Vous pouvez accéder simplement aux articles de ce dossier à partir de la Table des matières.Pour une recherche plus ciblée, utilisez l’Index, qui analyse avec précision le contenu des articles et multiplie les accès aux sujets traités.
Uniquement sur Amazon : Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence (par exemple Caecilia pour Kindle). À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).CANTIQUE SPIRITUEL, de saint Jean de la Croix
Le Chant de l’Épouse : c’est ainsi que Jean de la Croix (1542-1591), frère carme, désignait le poème dont il composa un commentaire en prose. Cet ensemble, rassemblé dans les manuscrits sous le titre de Explication des Chants qui traitent de l’exercice d’amour entre l’âme et son Époux le Christ, fut appelé Cántico espiritual par référence au Cantique des cantiques de la Bible. Le poème fut composé en partie (trente et une strophes) dans la prison du couvent de Tolède (1577-1578) où Jean de la Croix était emprisonné parce qu’il souhaitait réformer l’ordre des Carmes ; trois autres strophes furent écrites à Baeza (1579-1581), et les cinq dernières strophes, à Grenade, vers 1583. Le commentaire fut aussi rédigé à diverses époques. La première rédaction de l’ouvrage, terminée en 1584 (dite Cantique A) fut suivie d’une seconde rédaction, achevée vers 1586 (Cantique B). L’œuvre est dédiée à la mère Anne de Jésus (1545-1621).
• Un lyrisme mystique
Le poème, reflet d’une expérience mystique singulière, est l’élément essentiel du Cantique spirituel. Selon le modèle du Cantique des cantiques, celle-ci s’exprime en une sorte d’églogue pastorale, dans une métrique harmonieuse. La poursuite amoureuse des deux personnages mis en scène s’achève par l’union d’amour et sa célébration lyrique. Le poème se présente comme un dialogue d’amour entre l’Épouse et l’Époux, figures de l’âme et de Dieu. L’étrangeté ou la beauté des images, la variété des rythmes et des tonalités, le souffle de l’inspiration qui traverse toute la composition en font un chef-d’œuvre de l’art lyrique, où la voix de l’âme se fond dans la plénitude du désir érotique : « Jouissons de nous, Ami,/ en ta beauté allons nous contempler,/ sur le mont ou sur la colline,/ là où jaillit l’eau pure,/ et dans l’épaisseur entrons plus avant. » De ces strophes « composées en amour d’abondance mystique », Jean de la Croix déclare vouloir « donner quelque lumière en général [...], ce qui me semble être le mieux, car il est plus à propos de laisser ces discours d’amour en leur étendue, afin que chacun en profite selon sa façon et selon la portée de son esprit, que de les restreindre à un sens qui ne sera ajusté à toute sorte de palais ». Malgré ces réserves, Jean de la Croix explique minutieusement chaque strophe. Le commentaire est toujours composé de la même manière : une brève introduction précède chaque strophe, citée en entier ; le sens général, aussitôt résumé, est suivi d’une explication détaillée.
• Une autobiographie spirituelle
Ce traité de théologie expose ainsi, de façon précise et vivante, les aspirations et les souffrances, les tentations et les épreuves, les plaintes et les impatiences, toutes les passions d’une aventure spirituelle qui, à l’instar d’une relation humaine, peut aller du désespoir au bonheur fulgurant. Les étapes classiques sont ici reprises, depuis les fiançailles spirituelles jusqu’à la consommation et l’achèvement du mariage spirituel, « car l’âme ne se repose jamais tant qu’elle n’y est pas arrivée ; elle vit alors d’une vie aussi heureuse et comblée qu’est la vie de Dieu ». Devenir Dieu « par participation », tel est en effet l’état le plus élevé de « l’union transformante », où l’âme est « comblée de dons et de délices très riches et extraordinaires ». Toutes les puissances ou facultés, « désormais réduites au silence », l’Épouse « se consacre à jouir de son Bien-Aimé dans le recueillement intérieur de son âme, où il est uni à elle dans l’amour, où il la réjouit grandement et en secret ». Une seconde rédaction (1586) ajoute une strophe au poème, dont l’ordonnance est recomposée. Le commentaire correspondant, ainsi renouvelé, présente d’une façon plus systématique le déroulement de « l’exercice d’amour » entre l’âme et Dieu. Ces deux versions ont donné lieu à controverses entre spécialistes, certains niant l’authenticité du Cantique B, auquel l’ordre du Carmel donne la préférence.
« Le poème – écrit Federico Ruiz – est l’oraison d’un poète mystique, qui vit de l’amour de Dieu. Il doit être considéré comme le poème le plus complet et le plus proche de son expérience. Pris dans son ensemble il est très largement une autobiographie spirituelle. » Le Cantique spirituel semble avoir été l’œuvre préférée de Jean de la Croix. Avec le Château intérieur, de Thérèse d’Ávila, qui, la première, avait entrepris la réforme du Carmel, il offre un exposé intégral de théologie mystique.
Bernard SESÉ
Études
J. BARUZI, Saint Jean de la Croix et le problème de l’expérience mystique, Introd. É. Poulat, Salvator, Paris, 1999 (réédition de l’édition de 1931)R. DUVIVIER, La Genèse du « Cantique spirituel » de saint Jean de la Croix, Les Belles Lettres, Paris, 1971F. RUIZ, Saint Jean de la Croix mystique et maître spirituel, Cerf, Paris, 1992.DÉLIE, de Maurice Scève
Délie objet de plus haute vertu parut en 1544 à Lyon. C’était le premier canzoniere, c’est-à-dire le premier recueil de poèmes amoureux à la manière de Pétrarque publié en France.
• Un canzoniere
Le recueil de Maurice Scève se compose de 449 dizains décasyllabiques répartis en groupes de neuf, que séparent cinquante emblèmes. Fort à la mode au XVIe siècle, les emblèmes sont des images à valeur symbolique accompagnées d’une devise et commentées par une légende, en l’occurrence un dizain ou une série de dizains. Mais le rôle, l’origine, l’intérêt, et jusqu’à la signification des emblèmes de la Délie font l’objet d’interprétations contradictoires. De même, l’organisation des dizains a suscité de multiples réflexions. Des critiques y ont cherché – et trouvé – des explications numérologiques, hermétiques ou ésotériques devant lesquelles d’autres, non moins informés, ne cachent pas leur scepticisme. Le titre lui-mêmea été compris de manières diverses : on y a vu l’anagramme de L’Idée, concept platonicien, ce qui n’a rien d’impossible. Mais Délie est aussi l’un des noms de la déesse Diane, la Lune sœur du Soleil, d’où une série d’antithèses telles que Lune/Soleil, ombre/lumière, absence/présence : « En toy je vis, où que tu sois absente :/ En moy je meurs, où que soye présent » (dizain 144).
Délie reprend les thèmes pétrarquistes et s’organise selon le schéma habituel des canzonieri : la fascination pour la beauté et les yeux d’une dame décrite de façon à la fois stéréotypée et idéalisée (dont on a dit qu’elle serait une poétesse lyonnaise, Pernette du Guillet), les émois qu’inspire cet amour malheureux (espoir, malentendus, jalousie, etc.), une succession de menus événements (rencontres, regards, sourires, voyages, etc.), des représentations allégoriques, des allusions mythologiques, autant d’incidents qui marquent la vie de l’amant depuis le coup de foudre initial jusqu’à la séparation et au renoncement : « Mais moy : je n’ay d’escrire aultre soucy,/ Fors que de toy, et si ne sçay que dire,/ Sinon crier mercy, mercy, mercy » (dizain 18).
• Une poésie de l’insatisfaction amoureuse
La mise en œuvre poétique du recueil relève de plusieurs traditions, héritées de Pétrarque et de ses imitateurs, mais aussi des élégiaques latins, des poètes courtois du Moyen Âge, des rhétoriqueurs du XVe siècle et du courant néo-platonicien récemment importé de Florence. À l’instar des poètes de son temps, Scève pratique l’imitation. Mais, comme tous les grands écrivains, il choisit ce qu’il imite et en fait sa chose, de même que l’abeille qui butine le pollen en fait son miel, selon une comparaison courante à l’époque. Si l’auteur de la Délie se souvient de Pétrarque et colore ses emprunts de touches platoniciennes, cela ne révèle pas en lui un adepte de Platon, non plus qu’un suiveur de Pétrarque. À bien le lire, on s’aperçoit même que rien n’est moins platonicien ni désincarné que ce poème de l’insatisfaction amoureuse, et on se tromperait en imaginant qu’il chante le mépris des corps. La jalousie physique n’épargne pas l’amant, et on peut même comprendre qu’il a reçu ce que les troubadours appelaient le don de merci : « Ta coulpe fut, et ma bonne aventure » (dizain 287).
La poésie de Scève est difficile. L’auteur de la Délie reprend sans doute les images et parfois même les mots de Pétrarque, mais il leur imprime sa marque, « soit par le raccourci, la netteté, le réalisme du détail, soit par une fusion plus intime du concret et de l’abstrait » (Henri Weber). Il resserre la syntaxe, fait éclater les sonorités, contrôle et brusque le rythme du vers, et crée des effets de concision saisissants : « Seule raison, de la Nature loy,/ T’a de chascun l’affection acquise » (dizain 23). D’où l’impression de difficulté qui naît de sa lecture, et qui a longtemps nui à sa réputation. En réalité, Scève n’est pas un auteur hermétique. Obscur, il ne le devient que parce qu’il élimine les scories du discours. « Je travaille à être bref, je deviens obscur », écrivait déjà Horace dans son Art poétique (Ier siècle av. J.-C.).
Cette poésie qui vise à l’essentiel, qui a la densité et l’éclat du diamant et qui renouvelle la parole poétique, a été accueillie lors de sa parution avec plus de perplexité que d’enthousiasme, et son purgatoire s’est prolongé plusieurs siècles durant. Il a fallu attendre la fin du XIXe siècle et l’expérience symboliste (Mallarmé, Valéry) pour qu’elle commence à trouver des lecteurs capables de l’apprécier à sa juste valeur. Aujourd’hui, Scève est placé au nombre des plus grands.
Yvonne BELLENGER
Études
F. CHARPENTIER éd., Lire Maurice Scève, n0 3 des Cahiers Textuel, 1987F. RIGOLOT, Poétique et onomastique, Droz, Genève, 1977H. WEBER, Le Langage poétique de Maurice Scève dans la « Délie », Publications de l’Institut français de Florence, 1948.DISCOURS DE LA SERVITUDE VOLONTAIRE, d’Étienne de La Boétie
Écrit par un auteur à peine sorti de l’adolescence, le Discours de la servitude volontaire a confirmé jusqu’à nos jours sa réputation d’être, de tous les ouvrages jamais parus, le plus radical, au sens où l’entend Marx : « Être radical, c’est prendre les choses par la racine, et la racine, pour l’homme, c’est l’homme lui-même. »
Aucun livre n’a sans doute suscité, par sa singularité, autant de réticences, avouées ou tacites. Interdit par toutes les dictatures, tenu à l’écart des grandes traditions culturelles, ravalé à un simple et brillant exercice de style, réédité le plus souvent dans la langue abrupte du XVIe siècle, qui en rend la lecture malaisée, et, par-dessus tout, approuvé par des lecteurs que leur adhésion intellectuelle n’induit pas pour autant à s’affranchir de toute tyrannie, le texte d’Étienne de La Boétie, pertinent depuis plus de quatre siècles, ne cesse de gagner en importance en raison du désarroi de notre époque, où le sort des individus relève d’une détermination personnelle plus que d’un pouvoir souverain ou d’instances providentielles, désormais tombés en désuétude.
• La rédaction
Selon Montaigne, La Boétie (1530-1563) aurait écrit son livre à seize ou dix-huit ans, soit en 1546 ou, plus probablement, en 1548, le corrigeant quelques années plus tard, alors qu’il était étudiant à l’université d’Orléans.
Le chapitre XXVIII du livre premier des Essais précise : « C’est un discours auquel il donna le nom de La Servitude volontaire, mais ceux qui l’ont ignoré l’ont bien proprement depuis rebaptisé Le Contre’un. Il l’écrivit par manière d’essai en sa première jeunesse, à l’honneur de la liberté contre les tyrans. » Le libelle, communiqué à Montaigne, favorisa entre les deux hommes une amitié jamais démentie.
La politique des bûchers, qui régnait alors, dissuada l’auteur des Essais de livrer le texte à la publication. Néanmoins, des versions manuscrites circulaient, qu’attestent des pamphlets tels que Le Réveille-matin des Français et de leurs voisins





























