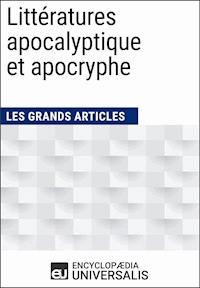
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Französisch
On appelle « littérature apocalyptique » une masse d'écrits organiques que les juifs anciens, du IVe siècle avant J.-C. à la fin du IIe siècle de l'ère chrétienne, ne cessèrent de produire et de promouvoir (.). Les textes chrétiens du Nouveau Testament sont eux-mêmes, pour nombre d'entre eux, en tout ou en partie, largement apocalyptiques.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 47
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782341002615
© Encyclopædia Universalis France, 2019. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Tarapong Siri/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Bienvenue dans ce Grand Article publié par Encyclopædia Universalis.
La collection des Grands Articles rassemble, dans tous les domaines du savoir, des articles : · écrits par des spécialistes reconnus ; · édités selon les critères professionnels les plus exigeants.
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
Littératures apocalyptique et apocryphe
On appelle « littérature apocalyptique » une masse d’écrits organiques que les juifs anciens, du IVe siècle avant J.-C. à la fin du IIe siècle de l’ère chrétienne, ne cessèrent de produire et de promouvoir. Des éléments précurseurs s’en retrouvent plus ou moins nettement dans plusieurs livres, antérieurs et contemporains, de l’Ancien Testament hébraïque. Les textes chrétiens du Nouveau Testament sont eux-mêmes, pour nombre d’entre eux, en tout ou en partie, largement apocalyptiques. Tous ces écrits ont pour langue originale l’hébreu, voire l’araméen, et le grec. Traduits en d’autres idiomes comme le syriaque, le latin, l’éthiopien, le copte, l’arabe, l’arménien et le slavon, c’est par ce canal que, adoptés volontiers comme livres sacrés par les communautés chrétiennes locales, ils sont parvenus jusqu’à nous. Ils émanent d’à peu près toutes les tendances ou mouvements du judaïsme ancien, à savoir, principalement, pharisien, essénien, zélote, samaritain et chrétien. On ne saurait donc parler à leur sujet ni de marginalité ni d’hétérodoxie. Bien au contraire, ils sont l’effet direct et significatif, sur la terre nationale des juifs comme dans la Diaspora, d’un habitus littéraire généralisé dont il existe différents et solides témoins. C’est donc à la constitution du tableau d’ensemble de la société juive des derniers siècles du second Temple que la littérature apocalyptique nous renvoie : c’est là qu’elle peut et doit trouver son explication.
Le mot « apocalypse » est l’exacte translitération du terme grec apokalypsis, le premier de l’Apocalypse chrétienne dite de Jean, œuvre qui porte précisément son nom : elle le céda, comme générique, à bien d’autres antérieures de la même veine. Ce terme, qui signifie « révélation », dérive du verbe apokalyptein, « découvrir », « révéler », que la Bible grecque des Septante utilise pour traduire les verbes hébraïques galâh et hâsaph, dont la signification précise est « découvrir » (Exode, XX, 26) ou « révéler » (I Samuel, II, 27). Le livre de Daniel, le premier des livres bibliques à répondre à la perfection à la définition du modèle ou de la forme apocalyptique, l’a introduit dans le sens spécifique de « révéler les secrets » (II, 29). Il est utilisé d’une façon identique dans les épîtres de Paul de Tarse (ainsi : Galates, II, 2). Il n’est donc pas étonnant que, dès l’Antiquité, on ait intitulé volontiers « apocalypses » les écrits annonçant, et souvent décrivant, « révélant » donc l’état et le statut définitifs des choses, terrestres et célestes, à la phase ultime de l’histoire. L’apocalypticien, c’est donc le prophète de la fin des temps qui utilise les procédés d’écriture conventionnels de l’expression dite apocalyptique. La « fin » des temps comme moment, acte et réalités, se disant en grec eschaton ou, au pluriel, eschata, « choses dernières », on dit et on peut dire de l’apocalyptique que la dimension « eschatologique » lui est essentielle. Or l’œuvre et la forme apocalyptiques sont relatives à la transformation radicale du système de représentations des relations entre ce qui est divin et ce qui ne l’est pas et, en deçà, aux conditions historiques globales dudit système.
La fixation et la définition par l’Église, voire par les Églises, du canon des Écritures ont eu pour effet que l’on désignât comme « apocryphes », respectivement « de l’Ancien Testament » et « du Nouveau Testament », nombre de livres très proches, par leur écriture et par leur contenu, des écrits bibliques, juifs et chrétiens. Imputée à une littérature qui couvre des siècles, avant et après Jésus-Christ, cette appellation ne manque pas d’ambiguïté, s’agissant du moins de l’Ancien Testament : les catholiques ne lui donnent pas le même sens que les protestants.
• La littérature apocalyptique
Comme repère originel de l’écriture apocalyptique, il faut placer la destruction du Temple de Jérusalem en 587 avant J.-C. et l’Exil à Babylone. Occasion d’un croisement religieux et culturel aux effets imprescriptibles, l’Exil entraîna une renaissance véritable, caractérisée par le maintien de l’essentiel éthique, voire culturel, d’une religion nationale, celle de Moïse, conservée aussi pure que possible sur une terre étrangère et par la réinterprétation de cet héritage fondamental par le retour archaïsant de ce qui était très ancien, tant des traditions nationales que des cultures voisines. Plus précisément, il fut le lieu et le moment de réhabilitation des cultures et le creuset de refonte des mythes anciens. Ce vaste engouement pour l’Antiquité, remarquable jusque dans le vocabulaire utilisé, ne se limita pas à Israël : il reflétait même, largement, une tendance générale. La longue période qui précéda tout au long du VIIe siècle avant J.-C. et jusqu’en 587, comme celle antérieure à l’édit de Cyrus en 538 avant J.-C., fut celle des restaurations et des renaissances, des retours aux sources lointaines et des croisements culturels. Dans la littérature biblique de cette époque, on est frappé par le lien presque systématique entre, d’une part, un réinvestissement mythique très soutenu jusque dans la forme et, de l’autre, l’usage fréquent d’archaïsmes bibliques. L’exemple de Shadday, mot solidement enraciné chez les Sémites du Nord-Ouest et épithète de El





























