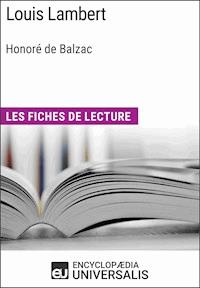
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Französisch
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalis
La
Notice biographique sur Louis Lambert parut en 1832, achevant l’édition des
Nouveaux Contes philosophiques.
Une fiche de lecture spécialement conçue pour le numérique, pour tout savoir sur Louis Lambert d'Honoré de Balzac
Chaque fiche de lecture présente une œuvre clé de la littérature ou de la pensée. Cette présentation est couplée avec un article de synthèse sur l’auteur de l’œuvre.
A propos de l’Encyclopaedia Universalis :
Reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité incomparable de ses publications, Encyclopaedia Universalis met la connaissance à la portée de tous. Écrite par plus de 7 400 auteurs spécialistes et riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins…), l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable collection de référence disponible en français. Elle aborde tous les domaines du savoir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 82
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782852294509
© Encyclopædia Universalis France, 2019. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Monticello/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Encyclopædia Universalis.
Ce volume présente des notices sur des œuvres clés de la littérature ou de la pensée autour d’un thème, ici Louis Lambert, Honoré de Balzac (Les Fiches de lecture d'Universalis).
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
LOUIS LAMBERT, Honoré de Balzac (Fiche de lecture)
La Notice biographique sur Louis Lambert parut en 1832, achevant l’édition des Nouveaux Contes philosophiques. Mais Balzac (1799-1850) remania son texte à plusieurs reprises et en offrit des versions successives, avant que celui-ci ne trouve une fortune et un titre définitifs au tome XVI de la Comédie humaine, en 1846. Un principe demeurait : celui d’un récit historique, c’est-à-dire strictement chronologique et s’appuyant sur des témoignages et des documents. Une nouveauté apparut : le recours à un narrateur ami intime du héros et s’exprimant à la première personne. Ce procédé narratif, très rarement utilisé dans La Comédie humaine, permit à l’auteur de recourir abondamment à des éléments autobiographiques. Le collège des Oratoriens de Vendôme où entre Louis Lambert, Balzac y a été élève de 1807 à 1813, soit au même moment que son personnage, ce qui donne à l’évocation de ces années d’études et de claustration une densité émotive particulière.
On conçoit donc que les contemporains aient été moins sensibles à la dimension philosophique de l’œuvre qu’à son appartenance au genre littéraire des souvenirs d’enfance et de jeunesse. Delacroix y revivait son adolescence. Quant à Flaubert, il confiait à Louise Colet, dans une lettre du 2 décembre 1852, l’impression terrifiante que lui avait causée la lecture de l’ouvrage : non seulement toute une page de Madame Bovary s’y trouvait presque mot pour mot (l’entrée de Charles dans la salle de classe), mais il lui semblait voir narrée sa propre histoire : « Quel sacré livre ! Il me fait mal ; comme je le sens ! » D’autres admirations suivront. Gide et Valéry, notamment.
• La pensée transmuée en volonté
Fils unique d’un humble tanneur, Louis Lambert naît à Montoire en 1797. Pour lui épargner plus tard le service militaire, ses parents le destinent à l’état ecclésiastique et le confient à son oncle, curé de Mer. Là, l’enfant peut assouvir l’immense appétit de lecture qu’il a très tôt manifesté : « L’Ancien et le Nouveau Testament étaient tombés dans les mains de Louis à l’âge de cinq ans. » Louis n’est pas seulement un enfant prodige. Il possède un don presque surnaturel qui lui permet de se représenter des choses qu’il n’a jamais vues, uniquement à travers la lecture. C’est ainsi qu’il peut éprouver d’« incroyables délires » en lisant de simples dictionnaires. De plus, un penchant le porte vers les ouvrages mystiques. C’est alors qu’il est plongé dans Le Ciel et la Terre du philosophe suédois Swedenborg que Madame de Staël, de passage dans la région, le rencontre. Impressionnée par ses dons – « C’est un vrai voyant », dit-elle – elle décide de le faire entrer à ses frais au collège des Oratoriens de Vendôme.
Habitué jusqu’alors à la liberté et au plein air, Louis s’étiole vite dans l’atmosphère du collège où sa personnalité hors du commun fait de lui un paria. Mis à l’écart par ses camarades, incompris de ses maîtres qui voient en lui un élève paresseux et rebelle, il doit supporter les brimades, les coups de férule, les engelures et la puanteur. Par chance, il trouve l’amitié auprès d’un élève rêveur et marginal comme lui, qui voue à Louis une admiration si vive qu’il entreprendra de raconter sa vie. « Pythagore » et « Le Poète », comme on les surnomme, se réfugient ensemble dans les livres, l’imagination et la spiritualité ; oubliant ainsi un monde où ils vivent « comme deux rats ». « Cet aigle, dit de Louis son ami, qui voulait le monde pour pâture, se trouvait entre quatre murailles étroites et sales. Aussi sa vie devint-elle, dans la plus large acception du terme, une vie idéale. »
Au travers de ses lectures, Louis acquiert un savoir quasi encyclopédique, si bien qu’il entreprend d’expliquer rationnellement les dons qui sont les siens et rédige un ambitieux Traité de la volonté : « Pour lui, la Volonté, la Pensée étaient des forces vives. » Mais le manuscrit est confisqué par les Pères du collège qui le jugent rempli d’inepties. Son ami le quitte bientôt. Resté seul, Louis Lambert sort à son tour du collège en 1815 et décide d’aller approfondir ses connaissances scientifiques à Paris, où il connaît une profonde misère. Le tourbillon de la capitale lui devient vite insupportable. Aspirant à vivre dans un désert, à être hors du monde, il retourne chez son oncle.
Là, il s’éprend d’une jeune femme, Pauline de Villenoix, que ses origines juives mettent à l’écart de la société et à laquelle il écrit des lettres enflammées. Quand celle-ci accepte de l’épouser, Louis perd soudain la raison et connaît des crises de catalepsie où il reste des jours entiers sans bouger ni parler. Il est d’abord soigné dans un asile, puis Pauline le recueille chez elle et se consacre à lui. Lorsque son ami de collège le revoit, il est stupéfait de sa dégradation : « Hélas, déjà ridé, déjà blanchi, enfin déjà plus de lumière dans ses yeux... C’est un débris arraché à la tombe, une espèce de conquête faite par la vie sur la mort, ou par la mort sur la vie ». Louis meurt en 1824, à l’âge de vingt-huit ans.
• La tentation de l’infini
Cette métamorphose tragique d’un homme encore jeune en vieillard précoce est une des illustrations du principe fondamental qui régit l’ensemble des contes philosophiques de Balzac : la durée d’une existence dépend de la puissance des désirs ou de la dissipation des idées ; dans ce dernier cas, la pensée tue le penseur. À cet égard, Louis Lambert appartient bien à la famille de ceux que la recherche de l’absolu ou de l’infini a brutalement consumés, comme Raphaël de Valentin dans La Peau de chagrin ou Frenhofer dans Le Chef-d’œuvre inconnu. Mais il les surpasse sans doute par la dimension mythologique que Balzac a voulu donner au personnage.
En effet, l’ambition du romancier est ici de lutter avec Goethe et Byron et d’imaginer à leur instar un héros animé d’un rêve prométhéen : non pas comme Faust la quête de l’éternelle jeunesse, mais celle d’une transcendance, d’un état supérieur de l’humain. Tout comme Balzac lui-même, Louis a fait sienne la théorie du philosophe Swedenborg selon laquelle « il y aurait en nous deux natures distinctes ». Ainsi qu’il l’explique à son ami, « l’ange serait l’individu chez lequel l’être intérieur réussit à triompher de l’être extérieur. Un homme veut-il obéir à sa vocation d’ange, dès que la pensée lui démontre sa double existence, il doit tendre à nourrir l’exquise nature de l’ange qui est en lui... S’il substante son intérieur des essences qui lui sont propres, l’âme l’emporte sur la matière et tâche de s’en séparer ».
L’histoire intellectuelle de Louis, sa vie idéale se résument donc à l’étude et à la maîtrise des forces qui conduisent à l’état d’ange. Y parvient-il ? C’est là toute l’ambiguïté du récit. Pour le narrateur, Louis est devenu fou à force de penser aux choses intangibles. Pour Pauline, en qui Louis a reconnu un « ange-femme », « il a réussi à se dégager de son corps et nous aperçoit sous une autre forme ».
Avec Louis Lambert, Balzac n’a certainement pas forgé le grand mythe littéraire qu’il ambitionnait ; il considérait même finalement son œuvre comme « le plus triste des avortons ». Elle n’en reste pas moins une des clés essentielles de son imaginaire, en ce sens qu’elle illustre au plus point la « passion que sentent tous les hommes vraiment grands pour l’infini », et qui est un des moteurs de La Comédie humaine.
Philippe DULAC
Études
A. BEGUIN, Balzac lu et relu, Seuil, Paris, 1965G. PICON, Honoré de Balzac, coll. Les Écrivains de toujours », Seuil, 1956G. POULET, La Distance intérieure, Plon, Paris, 1961J. STAROBINSKI, « Raphaël, Louis, Balthazar », in Action et réaction, Seuil, 1999.BALZAC HONORÉ DE (1799-1850)
Prométhée, Protée, homme à la robe de bure, créateur halluciné immortalisé par Rodin, Balzac a suscité toutes les imageries et toutes les gloses. L’œuvre immense vit, de réédition en réédition : elle est traduite et lue dans le monde entier et la télévision lui a redonné, plus que le cinéma, peut-être, une nouvelle fortune.





























