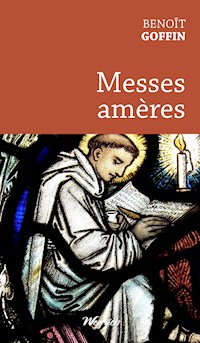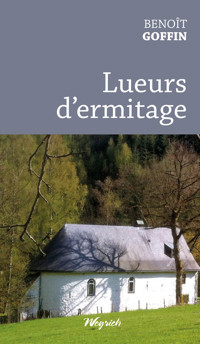
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Weyrich
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Bernister, un petit ermitage oublié dans la forêt ardennaise, en bordure des Hautes Fagnes… Jusqu’à ce que le père Elysée, un moine en exil de sa communauté vienne y réveiller des drames enfouis. Un tourbillon d’intrigues ébranle alors les murs de l’antique bâtisse. Des visages disparus resurgissent. Des forces obscures harcellent le nouvel ermite et seul Crapule, son vieux chat neurasthénique semble le comprendre.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Né en 1961 et historien de formation,
Benoît Goffin s’est intéressé particulièrement aux ordres monastiques en Belgique. Il a enseigné plus de vingt ans dans un collège bruxellois, avant d’en devenir le directeur. "Messes amères" est son premier roman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pour mon père Henri, bientôt centenaire.
Pour mon petit-fils Lucas, à l’aube de sa vie.
Deux pôles dans les liens de tendresse, à un siècle de distance.
Ouverture
Le père Élisée de la Nativité est mort il y a un quart de siècle. La maladie de Kahler dont il souffrait depuis des années finit par avoir raison de lui.
De son vrai nom Jacques Montplainchamps, il vivait depuis quelques années en solitaire à l’ermitage de Bernister proche de Malmedy, dans ces cantons de l’Est dont la Belgique hérita de l’Allemagne au sortir de la Première Guerre mondiale. Il s’y était retiré au terme d’une sombre affaire qui fit scandale à l’époque. Je fus témoin de la violence perpétrée dans la communauté religieuse bruxelloise dont il était le prieur1 et c’est à cette époque que je fis sa connaissance, en qualité d’enquêteur mandaté par le juge d’instruction.
La différence radicale de tempérament entre lui et moi ne nous empêcha pas de garder contact par la suite, puis de lier amitié, au fil des ans. Je revins le voir occasionnellement à Bernister, enfoui dans ces forêts de pins qu’il affectionnait particulièrement. Dans l’intervalle de nos rencontres trop rares, nous échangions un courrier pour maintenir la chaleur du lien. L’écriture nous permettait d’approfondir nos questionnements, mais aussi nos différends, bien au-delà des courts moments passés ensemble dans une certaine retenue et une impossibilité de se dire plus. Nous nous sentions souvent frustrés par ce manque, probablement dû à sa discrétion naturelle et au parler quelquefois rugueux, je l’avoue, de ma part.
C’est la propriétaire d’un hôtel-restaurant des environs, amie proche de l’ermite, qui découvrit son corps effondré dans le fauteuil de l’ermitage, son vieux chat « Crapule » lové entre les bras et tout aussi mort que lui. Malgré le nom peu amène de cet animal, il y avait entre eux une symbiose extraordinaire dont cette fin simultanée fut peut-être l’ultime manifestation.
Des funérailles furent organisées à l’ermitage avec ses plus proches, dont je fus, et célébrées par le curé-doyen de Malmedy, l’abbé Forthomme, qui en avait bien de la peine. Au premier rang de l’étroite chapelle, son amie hôtelière, très affectée. Des notables, tels la comtesse de Malifaye von Stein et son fils Lancelot, ainsi qu’une vieille abbesse bénédictine exceptionnellement sortie de son cloître, y côtoyaient plusieurs fermiers des environs, aux lourdes semelles raclant le dallage, endimanchés et naphtalinés, dont il était le pasteur occasionnel.
Une bien étrange assemblée, puzzle bigarré évoquant l’étendue de ses liens. D’autres têtes chenues, venues de plus loin et dont la peine visible disait l’affection. Ainsi d’un vieux majordome auquel j’avais eu affaire autrefois, dans le cadre d’une enquête internationale longtemps tenue secrète, et ce vieux Slave, fils de Russes blancs émigrés chez nous après avoir fui le régime soviétique.
La commune avait autorisé de l’inhumer selon ses vœux, dans un essart de forêt proche de l’ermitage, au pied d’une stèle formant cromlech avec six autres, à la mémoire du poète Guillaume Apollinaire. L’écrivain avait résidé dans la région à la fin du dix-neuvième siècle et chaque stèle portait une partie de l’inscription : « Soyez indulgents quand vous nous comparez à ceux qui furent la perfection de l’ordre, nous qui quêtons partout l’aventure. » La sépulture, où deux autres compagnons de Résistance avaient déjà été ensevelis, se trouvait sous la dernière pierre marquée du « partout l’aventure » et ce n’était que juste.
Le père Élisée avait peu de biens et pas de famille. L’ermitage retourna à l’évêché pour l’attribuer à un autre solitaire, ses chers livres furent versés à la bibliothèque du séminaire diocésain et je vis arriver chez moi l’épais cahier de son journal personnel, par les soins du doyen Forthomme. « Puisque votre nom y figure en dédicace », m’écrivait-il dans sa lettre d’accompagnement. Il l’avait lu et s’en disait impressionné, ajoutant que « dans la mesure où rien n’y heurte la morale de l’Église, libre à moi d’envisager sa publication en temps utiles ».
À l’époque où j’en héritais, je ne voulais pas le parcourir trop rapidement, préférant m’imprégner encore du souvenir de ce que nous avions partagé dans nos rencontres et nos courriers. Je devais d’ailleurs découvrir qu’il en avait repris des extraits dans ses notes.
Et puis, je l’oubliai. Ce journal disparut vingt ans dans un de mes tiroirs. Arrivé au moment de ma vie où les misères du corps indiquent qu’il est temps de mettre de l’ordre dans ses papiers, je l’ai exhumé de mes notes de travail, où il dormait patiemment.
Je l’ai entièrement relu, le cœur noué par l’émotion de tant de souvenirs, un puissant goût de nostalgie en bouche. Un véritable trésor pour l’exploration des profondeurs humaines dormait dans mes tiroirs et je l’avais à peine remarqué. Le père Élisée l’avait titré « Lueurs d’ermitage » et je crois bien que cette dernière période de sa vie fut pour lui une ouverture à la lumière, après les sombres années à la tête de son monastère.
« Ce que tu as reçu, transmets-le ! », disait Don Bosco. Voici donc, grâce aux bons soins d’un éditeur lucide, cette manne sortie du cœur d’un homme qui a su traverser ses propres malheurs et en faire un outil de maturation, dans une quête poursuivie sans relâche, toute sa vie durant.
Puisse le lecteur en recevoir l’essence et bénéficier des indications de marche, pour parvenir à son tour, lors de ses propres pérégrinations, à ce que le père Élisée appelait pudiquement « la Source ».
Philippe Légaut
L’ermite en ses murs
Bernister, le 16 juillet 1983
Ce matin, je suis allé chercher de l’eau à la source. Comme tous les matins. C’est la première chose que je fais, après la récitation des psaumes et un temps de méditation.
L’eau courante n’a jamais été installée dans l’ermitage. C’est un choix des habitants de la région qui estiment qu’un ermite doit aller chercher son eau. Voilà l’idée qu’ils s’en font. D’importants travaux de rénovation sont pourtant envisagés : toiture, électricité, double vitrage… mais l’eau courante, non. Peu importe. Cela m’oblige à un peu de gymnastique matinale.
Je suis arrivé ici il y a un an. J’ai posé mes valises dans ces vieux murs après avoir quitté le monastère de la capitale dont j’étais le prieur. J’avais besoin de temps, de distance et de solitude pour apaiser en moi le chaos et la révolte laissés par la sordide affaire qui a déchiré ma communauté. Je me suis contraint à pratiquer la maxime du Sage : « Laisse les eaux boueuses se reposer et l’eau deviendra claire. » Aujourd’hui, je vais mieux. J’ai pu me défaire de ce passé et l’intégrer à sa juste place, dans mon histoire.
La nature, le chant des oiseaux et le travail de la terre cicatrisent bien des souffrances. Les conflits intérieurs s’apaisent et l’humus redevient fertile pour de nouvelles pousses.
Qu’on ne s’y trompe pas ! Vivre en ermite n’est pas de tout repos ! À bon sol il faut nourriture, plantations, engrais ; et une vigilance constante. Sans quoi rien ne pousse, sauf la mauvaise herbe. Seuls les naïfs et les « promeneurs du dimanche » s’imaginent profiter d’un Éden arborescent sans devoir besogner de la bêche et du sarcloir.
Arrivé en juin, il m’a fallu du temps pour m’accoutumer au pays. On n’y débarque pas impunément de la ville, sans s’écorcher à ses rugosités. L’été s’est révélé sec et lourd. On y baignait dans les effluves d’épicéas, de bruyère et de myrtilles, recuits de soleil. Alors, certains soirs, le ciel s’abandonne à une colère d’orage qui fracasse d’antiques chênes ou s’abat sur le bétail et l’on en mesure la violence lorsque, au matin, se dessinent les brisures d’un vieux tronc séculaire ou les pattes dressées au ciel d’une vache foudroyée.
Le terroir est rude et l’hiver qui a suivi m’a paru interminable. La pierre de schiste, dont on fait les murs par ici, permet de s’en protéger à peu près. Le bâti est costaud, les fenêtres étroites, l’intérieur modeste. Tout prend rapidement des airs de forteresse dans la région et le vent polaire qui s’est soûlé d’espace sur le plateau des Hautes Fagnes, vient gémir de dépit lorsqu’il s’agrippe aux pinèdes des contreforts où l’ermitage a pris racine.
On ne peut vivre au profond d’une forêt inhospitalière que par élection ou par exclusion ! Ma situation tient un peu des deux ! Exclaustré de l’Ordre des Frères de Notre-Dame, j’ai choisi ce lieu parce qu’il a été celui de l’amitié la plus intense qu’il me fut donné de vivre et dont les murs sont encore tout imprégnés.
Étrange bâtisse qui remonte au seizième siècle, l’ermitage a traversé le temps et tenu tête aux rudesses du climat. D’un seul tenant, il abrite une chapelle qui l’occupe aux trois quarts et se prolonge par un modeste logis sur deux niveaux, l’étage s’ouvrant en balcon dans le fond de l’oratoire. Au rez-de-chaussée, une petite cuisine et la pièce à vivre où je me tiens l’essentiel du temps pour lire, écrire, prendre mes repas. À la fois salon, bureau et salle à manger, elle s’éclaire d’une petite fenêtre qui laisse deviner l’épaisseur des murs et découvre au regard l’alignement touffu des épicéas en fond de prairie. Pas de salle de bains ; une toilette sèche emménagée dans un recoin. C’est tout. On s’en accommode finalement assez bien. Les traités d’ascétique ne m’ont jamais appris autant sur le dépouillement que la pratique quotidienne dans mon ermitage. La vie y est tellement plus simple et moins amidonnée que les théories alignées sur les rayons bien nets de nos bibliothèques monastiques…
Je descends en ville deux fois par semaine pour y faire mes emplettes, avec ma vieille bécane dont je bourre les fontes des produits du marché et du nécessaire pour la vie courante. Dans la foulée, je monte jusqu’à la ferme Huppertz, où le facteur dépose quotidiennement le courrier qui m’est destiné. Il lui est en effet impossible de parvenir jusqu’à l’ermitage avec son break ; l’épaisse forêt d’épicéas qui le ceinture constitue une sorte de rempart naturel dont la densité fait penser à ces labyrinthes initiatiques qu’il faut traverser pour parvenir jusqu’à la petite clairière de mon oratoire. Elle m’a souvent fait penser à cette sombre végétation pleine d’inquiétudes, dans laquelle la Blanche-Neige des contes de Perrault vient se perdre pour échapper à ses poursuivants mais qui se révèle, en réalité, lieu d’asile et de paix avec la chaumière des nains. Le laid et le difforme se découvrent terre d’accueil et de protection. « Découvrir que l’abominable est bon ! », disait le philosophe Michel Serres, en parlant du Yéti d’Hergé dans Tintin au Tibet. Avec le temps, l’inhospitalité apparente de la nature m’est devenue compagne protectrice, douce et attentive à ma solitude.
* * *
Bernister, le 21 juillet 1983
Au commissaire Philippe Légaut.
Monsieur le commissaire,
Sans doute serez-vous surpris de recevoir ce courrier, surtout après les événements dont nous avons été témoins, vous et moi, chacun à notre manière. Et Dieu sait combien tout nous y séparait ! Votre travail d’enquête a permis de mener cette affaire à bonne fin, mais à quel prix pour nous tous et pour moi en particulier… Je n’ai pas eu l’occasion de vous rencontrer plus longuement au terme de cette sinistre affaire, mais vous devrez bien avouer que vous avez disparu sans demander votre reste. Peut-être en est-il ainsi dans votre profession ? Une fois la main transmise à l’appareil judiciaire, ne gardez-vous donc jamais de liens avec ceux qui ont été vos partenaires, bien malgré eux ? Sans doute, votre « job » terminé, vaut-il mieux ne pas s’appesantir en relations qui échapperaient alors à votre maîtrise.
Vous ignorez probablement que j’ai été démis de mes fonctions de prieur des frères de Notre-Dame, dès la clôture de cette tragédie. Mes supérieurs m’ont « charitablement » laissé le choix de ma nouvelle affectation, ce qui dit assez clairement combien je les embarrassais ! Dans ces conditions, n’ayant plus grand-chose à espérer de ce côté-là, j’ai décidé de reprendre ma liberté en demandant la dispense de tout attachement à l’Ordre. Pouvez-vous imaginer que je fus le premier surpris par mon audace, me sentant soudain comme l’oisillon qui se pousse hors du nid et découvre, tout excité et craintif, l’ivresse du vent déployant ses jeunes plumes dans le souffle d’un premier vol ?
À vrai dire, je rêvais depuis longtemps de venir m’établir en ce lieu que je connaissais bien pour l’avoir fréquenté durant les années sombres du nazisme, dans mon réseau de résistants. Ce furent les années les plus intenses de mon existence, vécues dans une camaraderie jamais retrouvée. La guerre terminée, j’y retournais régulièrement, comme en pèlerinage, pour visiter le dernier compagnon d’armes qui s’y était établi dès la fin de la guerre. Nous aimions y perpétuer le souvenir de notre chef de réseau, le « commandant François », dont l’histoire ne vous est pas inconnue puisqu’il s’agit d’un Malifaye, le frère de celui-là même qui fut longtemps le père Jean-Berchmans.
Mon vieil ami, prêtre comme moi, vécut ici de nombreuses années en ermite authentique, farouche, excentrique et amoureux de ses bois. Il a choisi d’y mourir, me léguant en quelque sorte la succession de son refuge.
Mais je ne vous ai encore rien dit de ce lieu. Imaginez-vous une vieille bâtisse que l’on fait remonter au quinzième siècle, composée d’un ermitage et de sa chapelle, accrochée à flanc de colline, sur un carré de prairie perdu au beau milieu d’une épaisse forêt d’épicéas. Je vous devine sourire. Comment le digne prieur (ex !) des frères de Notre-Dame, plus habitué aux tapis de ses parloirs qu’à la boue des chemins empierrés, a-t-il pu aller se perdre dans ce coin perdu de l’Ardenne belge, à un jet de pierre du plateau des Hautes Fagnes ? Oserais-je vous avouer que j’en suis le premier surpris ? ! Savez-vous que je vis sans eau courante et que je ne dois pas l’espérer, malgré les aménagements envisagés pour la salubrité du bâtiment ? Les gens du cru estiment sans doute qu’un ermite est plus crédible s’il va s’approvisionner à une petite source qui sourd tout à côté, ce que je me suis habitué à faire sans trop de difficultés. Je bénéficie fort heureusement de l’installation électrique et, luxe suprême, du téléphone.
Je vis de peu, me rends chaque semaine à vélo à la ville voisine de Malmedy, pour y acheter le nécessaire et cultive même, avec un certain succès, un petit coin de potager. Pour le reste, je me consacre sans retenue à mes chers livres de spiritualité, dont j’ai bourré mes valises en émigrant de mon couvent. Le dimanche, quelques rares paysans des environs viennent assister à ma messe, célébrée dès potron-minet. Je les reçois au porche, alors qu’ils montent péniblement de Bévercé par le mauvais chemin de Chaumont, dans leur costume empesé aux relents de naphtaline.
Je me prétends ermite, mais en vérité pas tout à fait. Vous souvenez-vous de cette espèce de chat indocile et sans grâce qu’un de mes confrères avait affublé du sobriquet de « crapule » ? Personne n’en voulait plus en communauté ; il a donc fait partie du voyage. Je crois que nous nous tolérons mutuellement et il a rapidement pris ses aises dans le nouveau décor. Il disparaît chaque matin, après avoir réclamé son bol de lait chaud et je ne le vois revenir qu’à la nuit tombante, le poil tout esquinté de ses traques quotidiennes. Il y a dans son regard quelque chose d’indéfinissable qui m’émeut et lorsqu’il vient se blottir entre mes jambes, alors que je suis occupé à quelque travail d’écriture, je ne résiste pas à cette étonnante « affection ». Je crois bien que je me suis attaché à lui.
Tout ceci ne vous explique pas la raison de mon courrier. Vous me permettrez donc d’entrer dans des considérations plus personnelles. La vie solitaire conduit à bien des réflexions et, dans le silence de mon ermitage, votre visage m’est rapidement revenu en mémoire. Pourtant, durant les semaines tragiques de votre enquête, nous ne nous sommes guère échangé que quelques phrases et l’on ne peut pas dire qu’elles furent des plus cordiales ! Permettez-moi d’être franc, c’est le seul luxe qui me reste. Entre vos injonctions sèches, vos mises en demeure, voire vos sommations, je ne pense pas avoir eu beaucoup la possibilité d’une réelle conversation avec vous, loin s’en faut ! Et que dire de notre « expédition » commune à Caprimont où vous m’avez esquinté sur ce thier détrempé, avant de vous emparer sans vergogne du livre recherché sur le corps encore chaud du pauvre père Gilles, pour lequel vous ne semblez pas avoir eu la moindre pensée compatissante.
Je sais bien ce que vous objecterez : vous n’avez fait que votre métier et vous n’étiez pas là pour entamer des conversations mondaines. Certes ; mais tout de même ! La leçon fut rude pour moi et vous ne m’avez épargné en rien. Peut-être même figurais-je un temps sur la liste de vos suspects ?
Y repensant longuement depuis lors, c’est justement cette rugosité dans nos rapports qui me ramène à vous aujourd’hui. Il me semble qu’elle m’autorise à trouver en vous un interlocuteur intègre dont la parole sera franche et juste. Et dans cette vie de retrait où je me trouve aujourd’hui, sachant qu’elle sera probablement la dernière étape du parcours, je vous avoue avoir besoin de cette fraternité sans détour. Pourquoi vous, justement ? Parce qu’au-delà des contacts « professionnels », j’ai cru percevoir en vous une interrogation profonde et douloureuse, provoquée par la confrontation avec notre vie religieuse. Vous me trouverez sans doute bien sûr de mon fait. Vous excuserez alors cette ingérence de ma part, car rien ne la justifie et je comprendrais fort bien que vous ne donniez aucune suite à ma lettre. Mais un homme dans le doute, s’interrogeant douloureusement sur lui-même, est mon frère à un point que vous ne pouvez probablement pas imaginer.
Accepterez-vous de partager avec moi cette « fraternité » ? N’y cherchez aucun gain, si ce n’est celui qu’offre la rencontre en vérité entre deux hommes qui décident de se parler en toute franchise.
Dans cette nouvelle vie qui est la mienne, il me semble que toutes les sensations se sont décuplées. Comment vous expliquer cela ; c’est un peu comme si le silence et la solitude, en faisant taire tout ce qui a pu me distraire jusqu’ici, me donnaient enfin à percevoir, par tous les pores de mon être, avec une intensité jamais ressentie jusqu’ici, ce qui est à la source de l’humain en moi. Chaque pensée, sentiment, désir est vécu dans une acuité à laquelle il est impossible de me dérober. La vérité de toute chose apparaît dans sa réalité nue. C’est une expérience bouleversante, dérangeante aussi, parfois, lorsqu’elle révèle le néant de choses auxquelles on a pu s’attacher et croire pendant de longues années. Dans ce cas, elle devient véritablement insupportable.
Il me semble qu’une force en moi me pousse vers cette expérience, comme pour y ramasser tout ce que j’ai vécu, pour en nouer la gerbe. Je crois que je ne pourrais terminer mon existence sans avoir fait ce dernier travail de « moisson ». Et cette expérience revêt une urgence et une gravité à laquelle je ne peux me dérober sans me renier moi-même. Mais je comprendrais fort bien que tout cela soit jugé sévèrement ou avec mépris par tous ceux qui n’en vivent pas l’exigence en eux. Comment un homme comme vous, tout entier investi dans son travail social, le reçoit-il ? Là encore, je vous imagine sourire avec condescendance. Quoique… Je ne suis pas certain que vous soyez tout à fait étranger à ceci, même si je ne parviens pas à en comprendre la raison.
Voilà sans doute la raison profonde de ma lettre. Une fois encore, je ne réclame de vous aucune charité, mais je vous serais reconnaissant d’accepter ce dialogue auquel je vous convie. Peut-être même viendrez-vous, à l’occasion, vous perdre dans ce lieu impossible dont la seule excuse est d’être d’une beauté à couper le souffle ?
Je suis donc votre bien attentionné
Élisée de Bernister
Voyage en enfer
Bernister, le 6 août 1983
— Vous êtes le père Élisée ?
Un grand flandrin dégingandé m’interpella tandis que je ferraillais avec mes rosiers.
Il m’avait bien annoncé sa venue par téléphone. Plutôt annoncé que demandé, d’ailleurs. Je l’ai vu arriver à l’ermitage en fin de matinée. Je sarclais le petit parterre entretenu vaille que vaille près de l’entrée et qui ne me donne guère que deux-trois légumes, de la rhubarbe à foison et une poignée de fleurs pour la chapelle. Non pas que le sol soit ingrat, mais le jardinier peu motivé ! On s’imagine un ermite proche de la terre, ayant la main verte et ami des animaux. Je suis tout le contraire ! Citadin dans l’âme, pas vraiment passionné par la binette et ne supportant guère que Crapule, cette espèce de chat relégué avec moi, caractériel, asthmatique et ayant peur de son ombre (peu doué pour la chasse, de surcroît, au vu de l’amoncellement de boîtes de nourriture qu’il me coûte !).
Nous nous sommes installés dans la pièce à vivre, qui me sert tout à la fois de bureau, de salon et de confessionnal à l’occasion. Je l’observais avec curiosité pendant qu’il disposait son matériel d’enregistrement sur le ciré de la table. Pas vraiment l’allure d’un journaliste ! Plutôt un de ces éternels étudiants en droit, propre sur lui, excessivement gauche – il avait déjà failli renverser la tasse de thé brûlant que je venais de lui verser – et s’installant partout comme en pays conquis.
J’avais accepté de le recevoir sur la chaude recommandation du bon doyen de Malmedy et parce que le thème de son interview m’intriguait : « Vivre en ermite aujourd’hui : action ou démission ? ! ». J’ai toujours aimé ces disputes – au sens scolastique du terme – qui nous obligent à rendre compte de nos affirmations, point par point, sous le feu d’un questionnement sans concession. De telles rencontres, si elles sont menées avec intelligence et de bonne foi, vous obligent à délester vos convictions de tout « ornement », de ce qui les alourdit et les encombre, pour vous mener jusqu’au cristal pur de la seule vérité vraie – il y a des vérités fausses ! – à laquelle vous êtes viscéralement attaché. Celui qui vous y mène, à la fois interlocuteur, témoin et avocat du diable, devient alors l’outil providentiel de votre propre discernement. Il est l’autrui indispensable sans lequel vous tourneriez sur vous-même, redondant et autosatisfait, déconnecté d’une réalité humaine qui ne se vit que dans la rencontre.
Mais peut-on prêter de telles qualités à un journaliste ?
Son interpellation de départ avait néanmoins l’intérêt de poser la bonne question : Peut-on se permettre le « luxe » de vivre hors du monde, à l’écart des soucis et des souffrances et se prétendre homme de Dieu, dans le sens chrétien du terme, c’est-à-dire entièrement donné à l’amour du prochain sans lequel il n’y a pas de véritable amour de Dieu ?
À vrai dire, la question n’est pas neuve, mais elle garde toute son acuité en ces temps de « fin de civilisation ». On pourrait l’écarter d’un revers de main en prétextant, les yeux au ciel et la bouche en cœur, que l’on s’est justement retiré afin de « prier pour le monde », offert à l’universel et non à un(e) particulier(e), priant de jour comme de nuit, les bras en croix et la flagellation toujours prête. En ce qui me concerne, les choses ne sont pas aussi simplistes et caricaturales, étant devenu ermite sur le tard et dans des circonstances particulières. Et puis, il ne faudrait pas confondre ermitage et bagne.
Nous avons bataillé ainsi deux heures durant. Je ne saurais dire si l’entretien fut bénéfique. J’ai pu mesurer combien ce jeune homme, et toute sa génération sans doute, sont aux antipodes de ce qui anime les chercheurs de mon espèce. Est-il seulement possible de nous comprendre ? Il m’a quitté en me remerciant chaleureusement pour ma franchise, ménageant sa sortie en m’entretenant vaguement d’un vieil oncle chanoine, il ne savait plus trop où, puis a tourné les talons sans demander son reste. Je pense qu’il avait hâte de retrouver son monde de bruit et d’agitation…
Après son départ, je suis resté un long temps à rêvasser dans mon fauteuil, le cœur lourd et sur un sentiment d’impuissance. Comment communiquer réellement ce que l’on vit ? J’aurais voulu dire tant d’autres choses auxquelles ses questions ne menaient pas parce que sa réalité ne l’y préparait pas.
Cela fait à peine un an que je vis reclus dans mon ermitage, ne voyant personne, et je me sens l’esprit déjà abattu et le corps lourd. Je connais ces périodes d’acédie, pour les avoir longuement traversées dans les années difficiles de ma vie monastique. On en pousse la porte sans y prendre garde et l’on se retrouve plongé dans l’opacité sans forme et sans fin, comme dans une gangue poisseuse. La douloureuse expérience m’en est restée imprimée dans la chair et j’en connais le remède. J’ai enfilé mes bottes, plongé sur ma gabardine, malgré la chaleur d’août et me suis jeté en forêt pour une de ces longues marches salutaires qui exténuent le corps en le forçant à réagir, tout en nettoyant l’esprit des torpeurs qui l’asphyxient. La nature a le don merveilleux de me réconcilier avec mon pire ennemi : moi-même ! Tout m’y parle. L’odeur poivrée des conifères, les répons colorés des chants d’oiseaux, leur silence aussi, lorsque le cri d’un busard déchire l’air. Le murmure de l’eau qui sinue en ru dans les sous-bois, les jeux du soleil dans les futaies où le vent s’amuse à faire danser des ombres dans l’entrelacs de rayons éblouissants.
Ces heures-là comptent parmi les plus étoilées de ma vie d’ermite. J’y parviens au « lâcher-prise » tant professé, rarement atteint. Je laisse les pensées errer librement, ne les bridant en rien, ce qui est contre nature pour le moine occidental, dressé à la « maîtrise des passions et la discipline de l’âme » que je suis resté, envers et contre tout.
J’ai marché, marché, me saoulant d’espace, poussant le corps jusqu’à l’épuisement, jouissant des douleurs musculaires d’un effort inhabituel. La fatigue est un baume. Elle transmue la souffrance tout en la débusquant. Je m’y sens allégé du fardeau des jours portés dans le ressac de vieilles rancunes toujours à vif. Je découvre combien je suinte encore des blessures du passé. La marche me l’apprend en révélant la meurtrissure.
Le jour déclinait. Depuis combien de temps étais-je en route ? Un souffle de fraîcheur humide me parvint au visage. Je me mis à frissonner. Autant de froid que de fatigue. Après la touffeur de l’après-midi, le temps changeait brutalement et j’ai renfilé ma vieille gabardine. J’émergeais du bonheur ivre qui m’avait tenu incandescent de longues heures et sentis monter en moi la main glaçante de l’anxiété. Où me trouvais-je ? La forêt dans laquelle je m’étais profondément lové s’assombrissait, devenait méconnaissable. Je pressais le pas, me réconfortant à la certitude de rencontrer bientôt un indice familier, une croisée de chemins mille fois traversée. Mais j’avais tant marché à travers tout et je ne distinguais plus que des trouées forestières, des lisières entre feuillus et résineux, voire de simples éclaircies en sous-bois, comme repères.
Un grondement lointain et sourd, plaintif comme le gémissement d’une bête, se mit à rouler lourdement avant de faire trembler la terre dans sa chute de titan. L’orage ! L’obscurité n’était pas que de fin du jour, mais également d’un orage approchant à grands pas et les arbres l’avaient bien compris, s’affolant soudain, dans des bourrasques allant crescendo.
Mon cœur se serra malgré l’expérience de la forêt. En août, les soubresauts du temps peuvent être violents et il fallait se mettre à l’abri sans traîner. Mais où trouver un refuge ? Je scrutais désespérément les alentours. Sur ma droite, le terrain s’incurvait en pente et je décidai de la suivre. Des feuilles se mirent à trembler sous le fouet d’abord lent des premières gouttes de pluie, énormes, pesantes. Leur tac-tac s’accéléra, se répondant de partout, puis vint le déluge.
Tout en bas, une clairière enfin. Je débouchais sur la rive d’un étang dont les rideaux de pluie diluvienne lacéraient la surface. Impossible d’en évaluer l’étendue, mais dans le dégagement de ses rives, une petite cabane forestière se devinait, ô miracle, tache sombre et trouble perçant les eaux. Je m’y suis précipité sans demander mon reste. La porte en rondins s’enfonça sous les coups de boutoir de mes épaules. Je découvris un petit espace encombré d’outils. Les éclairs zébrant le ciel furieux me révélèrent un renfoncement occupé d’une table et d’un banc. Les toiles d’araignées qui pendaient à toutes les encoignures, fardées d’une poussière sans âge, apparaissaient dans les éclats blafards ponctués de tonnerre. L’orage était au-dessus de ma tête, s’acharnait. La toiture de planches grossières tenait bon, heureusement, et rejetait aux abords des touffes mousseuses que les pluies lui arrachaient.
La tourmente dura. J’allais devoir passer la nuit dans ce réduit inconfortable mais protecteur. Je me consolais dans le souvenir des années de maquis, où quelques jeunes écervelés comme moi s’adonnaient avec passion à résister aux nazis, dormant n’importe où – lorsque nous dormions – et vivant dans une précarité totale. Les visages complices de mes « vieux » amis, Aymeric et Henri, m’apparurent, réconfortants. Je me suis couché sur la table du mieux possible, me pelotonnant dans ma gabardine, pour m’endormir sur le champ d’un sommeil de brute, malgré la bataille qui se livrait au-dehors.
L’étrange sensation d’une présence me tira du demi-sommeil dans lequel je végétais depuis un temps indéfini. Une nuit d’encre s’était abattue et l’orage roulait maintenant au loin ses états d’âme d’une colère rentrée. La pluie n’avait pas cessé et gargouillait en petits torrents autour du cabanon. Par moments, le ciel s’éclairait encore des derniers feux électriques et c’est à la lueur furtive de l’un d’eux que j’aperçus une silhouette dans l’encadrement de la porte.
D’un bond, je fus sur mes pieds et me pris à balbutier un ridicule « bonjour » pour me donner contenance. Aucune réponse. La forme s’écarta de la baie et disparut. Je sortis. L’homme – c’en était bien un – semblait m’attendre sur la berge et la barque avec laquelle il était probablement arrivé, dansait doucement au bord de l’étang tavelé de pluies. Il me fit signe de le rejoindre et je montai dans l’embarcation, sans même songer à le questionner, tant il émanait de lui une force de persuasion silencieuse. Il poussa la barque sur les eaux noires, s’y engouffrant à son tour, avant d’empoigner la paire de rames avec laquelle il nous fit progresser, à la cadence de gestes puissants, au milieu de nulle part.
Je m’en voulais de ma pitoyable docilité, tout autant que de ma couardise face à son mutisme exaspérant. Qui était-il et où m’emmenait-il ? Il ne semblait nullement se préoccuper de moi ni s’étonner le moins du monde de ma présence, au milieu de la nuit, dans « sa » forêt, puisque je conclus à sa dégaine qu’il devait être garde-chasse ou homme de peine d’un propriétaire du cru, auprès duquel il me conduisait sans doute et à qui je pourrais – enfin – exprimer tout mon dépit et entendre quelques paroles réconfortantes.
Combien de temps avons-nous navigué de la sorte ? L’épuisement nerveux, le froid glacial qui me pénétrait les os, l’inconnaissance où je me trouvais plongé, me faisait perdre tout repère. La pluie avait cessé et de lourdes nappes de brume collaient maintenant à la surface des eaux, obstruant la vue. J’avais la désagréable impression de passer au travers d’une interminable toile d’araignée, visqueuse et oppressante pour la respiration. Tout à mes réflexions angoissées, je ne vis pas arriver la lourde masse qui se dressa subitement devant nous et au pied de laquelle mon guide silencieux vint accoster.
D’une poigne de fer, il m’aida à grimper sur un petit ponton branlant puis, toujours sans un mot, me fit pénétrer par une étroite porte bardée de ferrures, dans les méandres de couloirs bas et voûtés, dont l’odeur pénétrante de moisissure me serrait la gorge.
Je ne connaissais qu’un seul château dans les environs de mon ermitage – puisque tout ce que je voyais alors en donnait l’apparence –, le burg Malifaye, situé à une quinzaine de kilomètres de Bernister. Avais-je parcouru cette distance dans mon vagabondage de la veille ? Mais il n’y a aucun lac autour de ses murailles. Tout au plus un ruisselet chahutant dans les douves.
J’en étais là dans ma perplexité lorsqu’il me fit entrer dans une haute pièce lumineuse, me sortant enfin de l’obscurité depuis mon errance de la veille sous l’orage. « L’homme de peine » s’effaça dès que j’en franchis le seuil et je fus solitaire à nouveau, au milieu d’une sorte de petit salon tapissé à l’ancienne, agréablement meublé, au centre duquel trônait une longue table de bois prolongée de chaises aux extrémités. Rompu de fatigue et dans la seule compagnie de mes questions sans réponses, je me suis affalé sur l’une d’elles puis, laissant ma tête tomber dans le creux des bras, m’abandonnai à une somnolence agitée dont l’anxiété me barrait tout sommeil.
Un léger toussotement se fit entendre qui me redressa d’un bloc. Je n’avais pas entendu venir celui qui me faisait face, assis à l’autre bout de la table.
— Pourriez-vous me dire…, commençai-je aussitôt.
Mon « hôte » me coupa d’une voix impérieuse.
— Ici, c’est moi qui pose les questions et vous prierai d’y répondre !
Je restais complètement interdit. Pas tellement par la manière dont il venait de me rembarrer, mais par le personnage que je découvrais devant moi. J’étais en face du jeune journaliste venu m’interviewer à l’ermitage il y avait quelques jours à peine ! Mais non pas vraiment lui. Ses yeux dansants dont je m’étais amusé avaient perdu leur vivacité, s’étaient figés dans une dureté métallique, menaçante. Tout autour, les chairs s’étaient épaissies, ridées et affichaient des marbrures cireuses. Deux poches disgracieuses et cerclées de noir pendaient aux paupières comme des enveloppes funèbres. Le corps avait perdu cette souplesse un peu gracile d’une jeunesse maintenant disparue dans les bouffissures graisseuses et contenues avec peine par des vêtements sombres, lustrés.
Mon trouble devait être éloquent ; un petit rictus glaçant vint défigurer un peu plus encore « l’apparition ». Il devina mes pensées.
— Je sais, dit-il, dans un sourire péniblement arraché, quand on connaît l’autre modèle, cela surprend. Vous m’excuserez de vous recevoir de nuit, mais je suis allergique à la lumière du jour et j’avoue ne pas supporter l’agitation diurne de vos… « semblables ».