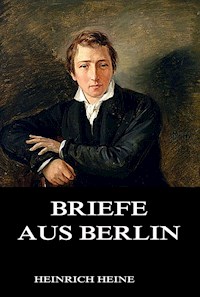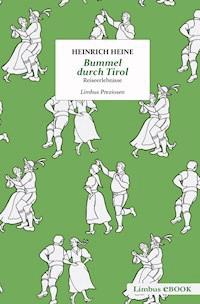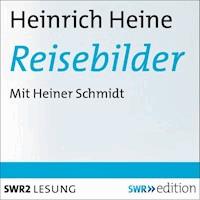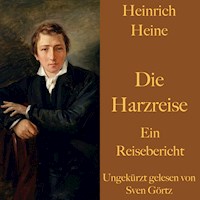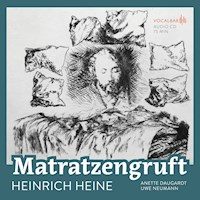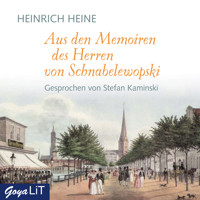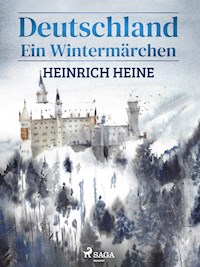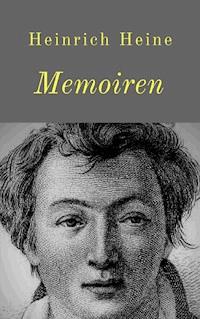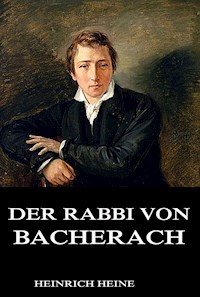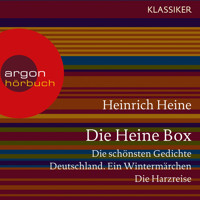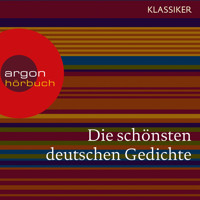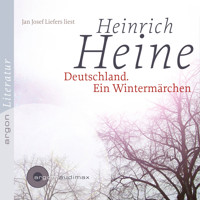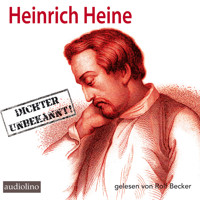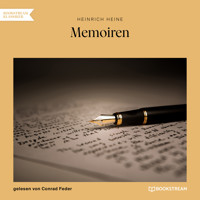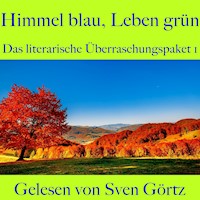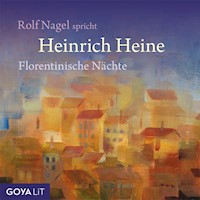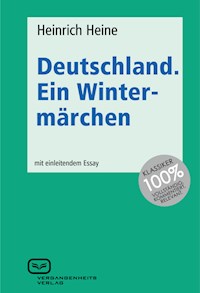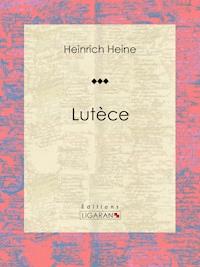
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Ce livre contient une série de lettres que j'écrivis pour la Gazette d'Augsbourg pendant les années de 1840 à 43. Pour des raisons importantes, je les ai fait paraître il y a quelques mois chez MM. Hoffman et Campe à Hambourg comme un livre à part sous le titre de Lucète, et des motifs non moins essentiels me déterminent aujourd'hui à publier ce recueil aussi en langue française. Voici quels sont ces raisons et ces motifs."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335076868
©Ligaran 2015
Paris, 23 février 1840.
Plus on se trouve placé près de la personne du roi, et que de ses propres yeux on voit ce qu’il fait, plus on est aisément trompé sur les motifs de ses actions, sur ses intentions secrètes, sur ses désirs et sa tendance. À l’école des hommes de la révolution, il a appris cette finesse moderne, ce jésuitisme politique, dans lequel les jacobins ont parfois surpassé les disciples de Loyola. À cet acquis d’un apprentissage révolutionnaire se joint en lui un trésor de dissimulation héréditaire, la tradition de ses ancêtres, les rois français, ces fils aînés de l’église, qui furent toujours, bien plus que d’autres princes, assouplis par le saint chrême de Rheims, qui furent toujours plutôt renards que lions et montrèrent un caractère plus ou moins sacerdotal. À cette simulatio et à cette dissimulatio, l’une apprise par de fameux maîtres et l’autre transmise comme patrimoine, s’ajoute encore une disposition naturelle en Louis-Philippe, de sorte qu’il est presque impossible de deviner chez lui les secrètes pensées à travers l’épaisse enveloppe, la chair si souriante et si bienveillante en apparente. Mais si nous réussissions même à jeter un regard jusque dans les profondeurs du cœur royal, nous n’en serions guère plus avancés, car au bout du compte ce n’est jamais une antipathie ou une sympathie à l’égard de telles ou telles personnes, qui détermine les actes de Louis-Philippe ; il n’obéit qu’à la force des choses, la nécessité, il repousse presque avec cruauté toute incitation personnelle, il est dur envers lui-même, et s’il n’est point un souverain autocrate pour les autres, il est au moins le maître absolu de ses propres passions. Il y a donc peu d’importance politique dans la question qui des deux il aime le plus, et qui des deux il aime le moins, ou de M. Guizot ou de M. Thiers ; il se servira de l’un ou de l’autre, selon qu’il aura besoin de celui-ci ou de celui-là, et il ne le fera qu’alors, ni plus tôt ni plus tard. Je ne puis donc réellement pas affirmer avec certitude lequel de ces deux hommes, d’état lui est le plus agréable ou le plus désagréable. Je crois qu’il se sent de l’éloignement pour tous les deux, et cela par envie de métier, parce qu’il est ministre lui-même et qu’après tout il craint la possibilité de leur voir attribuer une capacité politique plus grande que la sienne. On dit que Guizot lui revient plus que Thiers, pour la raison que le premier jouit d’une certaine impopularité qui ne déplaît pas au roi. Mais les allures puritaines de Guizot, son orgueil toujours aux aguets, son ton tranchant de doctrinaire et son extérieur âpre de calviniste ne peuvent pas exercer un effet attrayant sur le roi. Chez Thiers, il rencontre les qualités contraires, une facilité de façons presque légère, une hardiesse d’humeur sans frein et une capricieuse franchise, qui contrastent d’une manière pour ainsi dire offensante avec son propre caractère tortueux et hermétiquement renfermé : de sorte que les qualités de M. Thiers ne peuvent guère non plus être au gré de sa majesté. En outre, le roi aime à parler, il s’abandonne même volontiers à un bavardage intarissable, ce qui doit d’autant plus nous étonner que les natures portées à la dissimulation, sont d’ordinaire avares de leurs paroles. Il faut donc qu’il ait surtout de l’éloignement pour M. Guizot, qui a plutôt l’habitude de disserter que de discourir, et qui, à la fin, quand il a prouvé sa thèse, écoute avec une taciturne sévérité la réponse du roi : il est même capable de faire à son royal interlocuteur un signe d’approbation, comme s’il avait devant lui un écolier qui récite bien sa leçon. Dans sa conversation avec M. Thiers, le roi est encore moins à son aise, car celui-ci ne le laisse pas parier du tout, perdu qu’il est dans le flux de sa propre faconde. Les paroles de M. Thiers coulent sans cesse, comme le vin d’un tonneau dont on aurait laissé ouvert le robinet, mais le vin qu’il donne est toujours exquis. Quand M. Thiers parle, aucun autre homme ne peut placer un mot, et c’est tout au plus, comme on m’a dit, pendant les moments où il fait sa barbe, qu’on peut espérer de trouver chez lui une oreille attentive. Seulement, dans les moments où il a le couteau sur la gorge, il se tait et écoute les paroles des autres.
Il est hors de doute que le roi cédant aux demandes de la chambre, chargera M. Thiers de former un nouveau ministère, et qu’il lui confiera, outre la présidence du conseil, le portefeuille des affaires étrangères. Cela n’est pas difficile à prévoir. Mais on pourrait prédire avec assurance que le nouveau ministère ne sera pas de longue durée, et que M. Thiers donnera lui-même un beau matin au roi l’occasion de le remercier, et d’appeler à sa place M. Guizot. M. Thiers, avec son agilité et sa souplesse, montre toujours un grand talent quand il s’agit de grimper au mât de Cocagne du pouvoir, mais il fait preuve d’un talent encore plus grand, quand il s’agit d’en redescendre, et lorsque nous le croyons perché bien sûrement au sommet du grand mât, il se laisse tout à coup glisser en bas d’une manière si habile ; si spirituelle, si gracieuse et si souriante, que nous sommes tentes d’applaudir à ce nouveau tour d’adresse. M. Guizot n’est pas aussi adroit à se guinder sur le mat glissant de la puissance. Il y monte si lourdement et avec des efforts si pénibles, qu’on croirait voir un ours cherchant à se jucher sur un arbre à miel ; mais quand une fois il est arrivé en haut, il s’y cramponne solidement avec sa patte vigoureuse. Il se maintiendra toujours plus longtemps que son léger rival sur le faîte du pouvoir : nous serions presque tentés de croire que c’est par manque d’habileté qu’il n’en saurait redescendre, et que dans une pareille position use forte secousse sera probablement nécessaire pour lui faciliter la dégringolade. Dans ce moment, on a peut-être déjà expédié les dépêches dans lesquelles Louis-Philippe explique aux cabinets étrangers la nécessité où il se trouve placé par la force des choses de prendre pour ministre ce Thiers qui lui est si désagréable, au lieu de Guizot, qu’il aurait préféré.
Le roi aura maintenant beaucoup de mal à apaiser les antipathies que les puissances étrangères nourrissent contre M. Thiers. La manie de Louis-Philippe de briguer l’approbation de ces puissances, est une folle idiosyncrasie. Il croit que de la paix au dehors dépend aussi la tranquillité intérieure de son pays, et il ne voue à ce dernier qu’une faible attention. Lui qui n’aurait qu’à froncer les sourcils pour faire trembler tous les Trajan, les Titus, les Marc-Aurèle et les Antonin de cette terre, y compris le Grand-Mogol, il s’humilie devant eux comme un écolier, et s’écrie d’un ton suppliant : « Soyez indulgents envers moi ! pardonnez-moi d’être monté pour ainsi dire sur te trône français, et d’avoir été élu roi par le peuple le plus brave et le plus intelligent, je veux dire par 36 millions de révolutionnaires et de mécréants, Pardonnez-moi de m’être laissé séduire au point d’accepter des mains impies des rebelles la couronne avec les joyaux qui y appartiennent. – J’étais une âme candide et inexpérimentée, j’avais reçu une mauvaise éducation dès mon enfance où Mme de Genlis me fit épeler les paroles de la déclaration des droits de l’homme ; – chez les jacobins, qui me confièrent le poste d’honneur de portier, je n’ai pu non plus apprendre grand-chose de bon ; – je fus séduit par la mauvaise compagnie, surtout par le marquis de Lafayette, qui voulait faire de moi la meilleure des républiques ; – mais je me suis amendé depuis, je déplore maintenant les erreurs de ma jeunesse, et je vous prie, pardonnez-moi pour l’amour de Dieu et par charité chrétienne, – et accordez-moi la paix ! » – Non, ce n’est pas ainsi que Louis-Philippe s’est exprimé, car il est fier, noble et prudent ; mais ce fut là pourtant, en résumé, le sens de ses longues et verbeuses épîtres.
J’ai vu dernièrement un autographe du roi, et je fus frappé de sa curieuse écriture.
Comme on appelle certains caractères de lettres pattes de mouche, on pourrait nommer ceux de l’écriture de Louis-Philippe jambes d’araignée ; car ils ressemblent aux jambes ridiculement minces et longues de certaines araignées tapies dans les crevasses des murs, et qu’on nomme chez nous âmes de tailleurs. Ces lettres hautes, élancées, et en même temps très maigres, font une impression fantastique et bizarre.
Même dans l’entourage le plus immédiat du roi, on blâme sa condescendance pour l’étranger ; mais personne n’ose s’élever hautement contre cette faiblesse. Louis-Philippe, ce bonhomme et ce bon père de famille, exige dans le cercle des siens une obéissance aveugle, telle que le plus furieux despote ne l’a peut-être jamais obtenue à force de cruautés. Le respect et l’amour enchaînent la langue de sa famille et de ses amis ; c’est un malheur, et cependant il pourrait bien se présenter des cas où une opposition respectueuse contre la volonté individuelle du roi, serait la chose la plus salutaire. Même le prince royal, le duc d’Orléans, ce jeune homme si sensé, incline en silence la tête devant son père, quoiqu’il comprenne ses fautes et qu’il semble pressentir de tristes conflits, sinon une horrible catastrophe. D’après ce qu’on rapporte, il a dit un jour à un de ses confidents qu’il souhaitait voir arriver une guerre, parce qu’il aimerait mieux perdre la vie dans les flots du Rhin que dans un sale ruisseau de Paris. Ce jeune homme, magnanime et chevaleresque, a des moments mélancoliques dans lesquels il raconte que sa tante, Madame d’Angoulême, la fille non guillotinée de Louis XVI, lui avait, de sa voix rauque de corbeau, prophétisé une mort malheureuse et prématurée ; c’était pendant les journées de juillet, lorsque dans sa fuite, cet oiseau de mauvais augure avait rencontré dans le voisinage de Paris le prince qui retournait tout joyeux à la capitale. Chose singulière ! quelques heures après cette rencontre, le prince fut en danger d’être fusillé par les républicains qui le firent prisonnier, et il n’échappa à cet horrible sort pour ainsi dire que par un miracle. Le prince royal est généralement aimé : il a gagné tous les cœurs, et sa perte serait plus que pernicieuse pour la dynastie actuelle. La popularité du prince est peut-être la seule garantie de la durée de cette dernière. Mais ce prince héritier de la couronne est aussi une des plus nobles et des plus magnifiques fleurs humaines qui se soient épanouies sur le sol de ce beau jardin qu’on nomme la France.
Paris, le 1er mars 1840.
Thiers est aujourd’hui dans tout l’éclat de son jour ; je dis aujourd’hui, je ne garantis rien pour le lendemain. – Que Thiers soit à présent ministre, le seul, le vrai et le tout-puissant ministre, cela est hors de doute, quoique bien des personnes, plutôt par feinte que par conviction, ne veuillent pas y croire avant d’avoir vu les ordonnances imprimées en règle dans le Moniteur. Ils disent qu’avec les hésitations ordinaires du Fabius Cunctator de la royauté, tout est possible ; qu’au mois de mai dentier, l’affaire a manqué au moment même où Thiers saisissait déjà la plume pour signer son acceptation. Mais cette fois-ci, Thiers est ministre, j’en suis convaincu, – « J’en jurerais bien, mais je ne parierai pas, » dit un jour Fox dans une semblable occasion.
Paris, le 9 avril 1840.
Après que les passions se sont un peu attiédies, et que la sage réflexion gagne insensiblement le dessus, chacun avoue que la tranquillité de la France aurait été très gravement compromise, si les soi-disant conservateurs avaient réussi de renverser le ministère actuel. Les membres de ce ministère sont à coup sûr dans ce moment les hommes les plus propres à guider le véhicule de l’État. Le roi et Thiers, l’un au-dedans du carrosse et l’autre sur le siège, doivent rester unis maintenant, car malgré leur position différente ils ont exposés tous les deux aux mêmes dangers de la culbute. Le roi et Thiers ne nourrissent nullement en secret des sentiments de haine l’un pour l’autre, comme on le suppose généralement. Ils s’étaient personnellement réconciliés il y a déjà bien longtemps. La seule différence qui reste, n’est que politique. Cependant, avec toute leur bonne entente actuelle, et malgré la meilleure volonté du roi pour la conservation du ministère, cette différence politique ne pourra jamais entièrement disparaître de son esprit ; car le roi est le représentant de la couronne, dont les intérêts et les droits se trouvent dans un conflit continuel avec les désirs d’usurpation de la chambre. En effet, pour rendre hommage à la vérité, nous sommes forcés de désigner tous les efforts de la chambre du nom de désirs usurpateurs ; c’est de son côté toujours que vint l’attaque, à chaque occasion elle cherchait à amoindrir les droits de la couronne, à en miner les intérêts, et le roi n’exerçait qu’une légitime défense. Par exemple la charte a revêtu le roi de la prérogative de choisir ses ministres, et maintenant ce droit n’est plus qu’une vaine apparence, une formule ironique et offensante pour la royauté, car en réalité c’est la chambre qui élit et congédie les ministres. Aussi, ce qui est très caractéristique, c’est que depuis quelque temps le gouvernement de l’État de France n’est plus appelé un gouvernement constitutionnel, mais un gouvernement parlementaire. Le ministère du premier mars reçut ce nom dès son baptême, et le fait autant que la parole proclamèrent et sanctionnèrent publiquement une spoliation des droits de la couronne en faveur de la chambre.
Thiers est le représentant de la chambre, il est le ministre élu par elle, et en cette qualité il ne pourra jamais agréer complètement au roi. La disgrâce royale n’atteint donc pas la personne du ministre, comme je l’ai déjà dit, mais le principe qui s’est fait valoir dans son élection. – Nous croyons que la chambre ne poursuivra pas plus loin la victoire de ce principe ; car c’est au fond ce même principe d’élection d’où résulte comme dernière conséquence la république. Où elles mènent, ces batailles parlementaires gagnées, c’est ce dont s’aperçoivent maintenant les héros de l’opposition dynastique aussi bien que ces conservateurs qui, par passion personnelle, à l’occasion de la question de dotation, se rendirent coupables des méprises les plus ridicules.
Le rejet de la dotation, et surtout le silence dédaigneux avec lequel on la rejeta, ne furent pas seulement une offense pour la royauté, mais aussi une injuste folie ; – car, en arrachant peu à peu à la couronne toute puissance réelle, il fallait au moins la dédommager par une magnificence extérieure, et rehausser plutôt que rabaisser sa considération morale aux yeux du peuple. Quelle inconséquence ! Vous voulez avoir un monarque, et vous lésinez sur les frais de l’hermine et des joyaux ! Vous reculez d’effroi devant la république, et vous insultez publiquement votre roi, comme vous l’avez fait dans la question de dotation ! Et certes, ils ne veulent pas la république, ces nobles chevaliers de l’argent, ces barons de l’industrie, ces élus de la propriété, ces enthousiastes de la possession paisible, qui forment la majorité du parlement français. Ils ont encore plus horreur de la république que le roi lui-même, ils tremblent devant elle encore plus que Louis-Philippe qui s’y est déjà habitué dans sa jeunesse, lorsqu’il était un petit jacobin.
Le ministère de M. Thiers se maintiendra-t-il longtemps ? Voilà la question. Cet homme joue un rôle dont la seule pensée fait frémir. Il dispose à la fois des forces guerrières du plus puissant royaume et de tout le ban et l’arrière-ban de la révolution, de tout le feu et de toute la démence de notre temps. Ne l’excitez pas à sortir de sa sage jovialité, de son aimable insouciance, pour entrer dans le labyrinthe fatal de la passion, n’encombrez pas son chemin, ni avec des pommes d’or ni avec des bûches grossières !… Tout le parti de la couronne devrait se féliciter de ce que la chambre a justement choisi Thiers, cet homme d’État, qui a révélé dans les derniers débats toute sa grandeur politique. Oui, tandis que les autres ne sont qu’orateurs, ou administrateurs, ou savants, ou diplomates, ou héros de la vertu, Thiers possède au besoin toutes ces qualités ensemble, même la dernière, seulement elles ne se présentent pas en lui comme des spécialités étroites, mais elles sont dominées et absorbées par son génie politique. Thiers est homme d’État, il est un de ces esprits dans lesquels l’art de gouverner est une capacité innée. La nature crée des hommes d’État comme elle crée des poètes, deux espèces de créatures très hétérogènes, mais qui sont également indispensables ; car le monde a besoin d’être enthousiasmé et d’être gouverné. Les hommes en qui la poésie ou l’art de gouverner est un don de la nature, sont aussi poussés par cette même nature à faire valoir leur talent, et nous ne devons nullement confondre ce penchant avec la petite vanité qui pousse les mortels moins avantageusement doués à ennuyer le public par leurs rimailleries élégiaques ou par leurs discours politiques et sentimentals, ou bien par tous les deux à la fois.
J’ai mentionné que Thiers avait justement par son dernier discours montré sa puissance comme homme d’État. M. Berryer a peut-être, avec ses phrases sonores, ses fanfares déclamées, produit un effet plus pompeux sur les oreilles de la multitude ; mais cet orateur est à M. Thiers, l’homme d’État, ce que Cicéron était à Démosthène. Quand Cicéron plaidait au forum, l’auditoire disait que personne ne savait mieux parler que Marcus Tullius ; mais quand Démosthène parlait, les Athéniens criaient : Guerre à Philippe ! Pour tout éloge, après que Thiers eut fini son discours, les députés délièrent leur bourse et lui donnèrent l’argent demandé.
Le point culminant dans ce discours de Thiers fut le mot « transaction » – mot que nos politiques du jour comprirent très peu, mais qui, à mon sens, est de la plus profonde signification. Est-ce que de tout temps la tache des grands hommes d’État fut autre chose qu’une transaction, un accommodement entre des principes et des partis différents ? Quand on a à gouverner, et qu’on se trouve placé entre deux factions qui se combattent, on doit tâcher d’opérer une transaction. Comment le monde pourrait-il progresser, comment pourrait-il seulement se maintenir tranquille, si après de terribles bouleversements ne venaient pas ces hommes dominateurs, qui rétablissent parmi les combattants fatigués et blessés la paix de Dieu, autant dans le domaine de la pensée que dans celui de la réalité ? Oui, aussi dans le domaine de la pensée les transactions sont nécessaires. Qu’est-ce que c’était, sinon une transaction entre ta tradition catholico-romaine et la raison divinement humaine, ce qui, il y a trois siècles, lors de la réforme, s’établit en Allemagne sous le nom d’église protestante ? Qu’est-ce que c’était, sinon une transaction, ce que Napoléon tenta en France, lorsqu’il chercha à réconcilier les hommes et les intérêts de l’ancien régime avec les hommes nouveaux et les nouveaux intérêts de la révolution ? Il donna à cette transaction le nom de « fusion » – mot également très significatif et qui révèle tout un système. – Deux mille ans avant Napoléon, un autre grand homme d’État, Alexandre de Macédoine, avait inventé un semblable système de fusion, lorsqu’il voulut concilier l’Occident avec l’Orient, par des mariages réciproques entre les vainqueurs et les vaincus, par un échange de mœurs et l’assimilation des pensées. – Non, à une telle hauteur Napoléon n’a pas pu élever son système de fusion, il n’a su rapprocher que les personnes et les intérêts, mais non les idées, et ce fut là sa grande faute, comme la cause de sa chute. M. Thiers commettra-t-il la même méprise ? Nous le craignons fort. M. Thiers sait parler infatigablement du matin jusqu’à minuit, faisant jaillir toujours de nouvelles pensées brillantes, de nouveaux éclairs d’esprit, amusant, instruisant, éblouissant son auditoire ; on dirait un feu d’artifice en paroles. Et pourtant il comprend mieux les intérêts matériels que les besoins moraux et intellectuels de l’humanité ; il ne connaît pas le dernier anneau par lequel les choses terrestres se rattachent au ciel : il n’a pas le génie des grandes institutions sociales.
Paris, le 30 avril 1840.
« Raconte-moi ce que tu as semé aujourd’hui, et je te prédirai ce que tu récolteras demain ! » Je pensais ces jours-ci à ce proverbe du brave Sancho Pança, en visitant quelques ateliers du faubourg Saint-Marceau, et en voyant quels livres on répand parmi les ouvriers, cette partie la plus vigoureuse de la basse classe. J’y trouvai plusieurs nouvelles éditions des discours de Robespierre et des pamphlets de Marat, dans des livraisons à deux sous, l’histoire de la révolution par Cabet, le libelle envenimé de Cormenin, la doctrine et la conjuration de Babœuf par Buonarotti, etc., écrits qui avaient comme une odeur de sang ; – et j’entendis chanter des chansons qui semblaient avoir été composées dans l’enfer, et dont les refrains témoignaient d’une fureur, d’une exaspération qui faisaient frémir. Non, dans notre sphère délicate, on ne peut se faire aucune idée du ton démoniaque qui domine dans ces couplets horribles ; il faut les avoir entendus de ses propres oreilles, surtout dans ces immenses usines où l’on travaille les métaux, et où, pendant leurs chants, ces figures d’hommes demi-nus et sombres battent la mesure avec leurs grands marteaux de fer sur l’enclume cyclopéenne. Un tel accompagnement est du plus grand effet ; de même que l’illumination de ces étranges salles de concert, quand les étincelles en furie jaillissent de la fournaise. Rien que passion et flamme, flamme et passion !
Comme un fruit de cette semence, la république menace de sortir tôt ou tard du sol français. Nous devons, en effet, concevoir cette crainte ; mais nous sommes en même temps convaincus que le règne républicain ne pourra jamais être de longue durée en France, cette patrie de la coquetterie et de la vanité. Même en supposant que le caractère national des Français soit compatible avec le républicanisme, nous n’en sommes pas moins en droit d’affirmer que la république, telle que nos radicaux la rêvent, ne pourra pas se maintenir longtemps. Dans le principe de vie même d’une telle république se trouve déjà le germe de sa mort prématurée ; elle est condamnée à mourir dans sa fleur. Quelle que soit la constitution d’un État, il ne se maintient pas uniquement par l’esprit national et le patriotisme de la niasse du peuple, comme on le croit d’ordinaire, mais il se maintient surtout par la puissance intellectuelle des grandes individualités qui le dirigent. Or, nous savons que, dans une république de l’espèce désignée, règne un esprit d’égalité extrêmement jaloux, qui repousse toujours toutes les individualités distinguées et les rend même impossibles ; de sorte que dans des temps de calamité et de péril il n’y aura que des épiciers vertueux, d’honnêtes bonnetiers, et autres braves gens de la même farine, pour se mettre à la tête de la chose publique. Par ce vice fondamental de leur nature, ces républiques périront toujours misérablement, aussitôt qu’elles entreront dans un combat décisif avec des oligarchies ou des aristocraties énergiques, représentées par de grandes individualités. Et c’est ce qui aurait lieu inévitablement, du moment que la république serait déclarée en France.
Tandis que le temps de paix dont nous jouissons maintenant est très favorable à la propagation des doctrines républicaines, il dissout parmi les républicains eux-mêmes tous les liens d’union ; l’esprit soupçonneux et mesquinement envieux de ces gens a besoin d’être occupé par l’action, sans cela il se perd dans de subtiles discussions et d’aigres disputes de jalousie, qui dégénèrent en inimitiés mortelles. Ils ont peu d’amour pour leurs amis, et beaucoup de haine pour ceux qui, par la force d’une pensée progressive, penchent vers une conviction opposée à la leur. Ils se montrent alors très libéraux en accusations d’ambition, et même de corruptibilité. Avec leur esprit borné, ils ne comprennent jamais que leurs anciens alliés sont quelquefois, par divergence d’opinion, forcés à s’éloigner d’eux. Incapables d’entrevoir les motifs rationnels d’un pareil éloignement, ils se récrient tout de suite contre des motifs pécuniaires supposés. Ces cris sont caractéristiques. Les républicains se sont, une fois pour toutes, brouillés complètement avec l’argent, et tout ce qui peut leur arriver de mal est attribué par eux à l’influence de ce métal. En effet, l’argent sert à leurs adversaires de barricade, de bouclier et d’arme contre eux ; l’argent est peut-être même leur véritable adversaire, le Pitt et le Cobourg d’aujourd’hui, et ils déblatèrent contre cet ennemi, selon la façon des anciens sans-culottes. Au fond, il faut l’avouer, ils sont guidés par un juste instinct. Quant à la doctrine nouvelle qui envisage toutes les questions sociales d’un point de vue plus élevé, et qui se distingue du républicanisme banal aussi avantageusement qu’un manteau de pourpre impérial se distingue d’une blouse de grisâtre égalité ; quant à cette doctrine, les républicains n’ont pas grand-chose à en redouter, car la grande masse du peuple en est encore aussi éloignée qu’eux-mêmes. La grande masse, la haute et la basse plèbe, la noble bourgeoisie et la noblesse bourgeoise, tous les notables de l’honnête médiocrité, qui sont encore si loin des grandes idées sociales et humanitaires, comprennent très bien le républicanisme, ils comprennent à merveille cette doctrine, qui n’exige pas beaucoup de connaissances préliminaires, qui convient à la fois à tous leurs petits sentiments et à toutes leurs étroites pensées, et qu’ils professeraient même publiquement, s’ils ne risquaient par là d’entrer en conflit avec l’argent. Chaque écu est un valeureux combattant contre le républicanisme, et chaque napoléon est un Achille. Un républicain hait donc l’argent à juste titre, et quand il s’empare de cet ennemi, hélas ! alors la victoire est pire que la défaite : le républicain qui s’est emparé de l’argent a cessé d’être républicain ! Il ressemble alors à ce soldat autrichien qui criait : « Mon caporal, j’ai fait un prisonnier ! » mais qui, lorsque le caporal lui dit d’amener son prisonnier, répondit : « Je ne peux pas, car il me retient. »
De même que les républicains, les légitimistes sont occupés à mettre à profit le temps de paix actuel pour semer, et c’est surtout dans le sol paisible de la province qu’ils répandent la semence dont ils espèrent voir naître et fleurir leur salut. Ils se promettent les plus grands fruits de l’œuvre d’une propagande qui tâche de rétablir l’autorité de l’Église, en fondant des établissements d’instruction et en subjuguant l’esprit de la population campagnarde. Ils se flattent qu’avec la foi du bon vieux temps, leurs privilèges du bon vieux temps reprendront aussi le dessus. C’est pourquoi on voit des femmes de la plus haute naissance devenir, pour ainsi dire, les dames patronesses de la religion ; elles font parade de leurs sentiments dévots et cherchent à gagner des âmes pour le ciel, en attirant par leur exemple tout le beau monde dans les églises. Aussi les églises ne furent-elles jamais plus fréquentées et remplies qu’aux Pâques de cette année. Surtout à Saint-Roch et à Notre-Dame-de-Lorrette se pressait en foule la dévotion élégante ; là, brillaient les toilettes les plus saintement magnifiques ; là, le pieux dandy présentait aux belles fidèles l’eau bénite de sa main revêtue de gants blancs glacés ; là, priaient les grâces les mieux huppées. Cela durera-t-il longtemps ? Cette piété gagnant la vogue de la mode, ne sera-t-elle pas aussi soumise au changement rapide de la mode ? Ce rouge sur les joues de la religion, est-ce un signe de santé ou de phtisie ? « Le bon Dieu reçoit aujourd’hui beaucoup de visites », dis-je dimanche dernier à un de mes amis, en voyant le grand concours de monde qui se dirigeait vers les églises. – « Ce sont des visites d’adieu », répondit l’incrédule.
Les dents de dragon que sèment les républicains et les légitimistes nous sont connues maintenant, et nous ne serons pas surpris de les voir un jour éclore et surgir du sol en combattants armés, et s’égorger les uns les autres, ou bien fraterniser ensemble. Oui, cette dernière chose est possible ; n’y a-t-il pas ici un prêtre effroyable qui, par ses sanguinaires paroles de croyant, espère consacrer l’alliance des hommes du bûcher et des hommes de la guillotine ?
Dans l’intervalle, tous les yeux sont dirigés vers le spectacle qui, à la surface de la France, est exécuté par des acteurs plus ou moins superficiels. Je parle de la chambre et du ministère. La tendance de la première, ainsi que la conservation de ce dernier, est certainement de la plus grande importance ; car les disputes dans la chambre pourraient hâter une catastrophe qui semble tantôt s’approcher, tantôt s’éloigner, mais qui est inévitable. Retarder son explosion aussi longtemps que possible, voilà la tâche des hommes d’État qui dirigent les affaires dans ce moment. On reconnaît d’ailleurs dans tous leurs actes, dans toutes leurs paroles, qu’ils ne veulent que cela et n’espèrent que cela, convaincus qu’ils sont de voir arriver tôt ou tard l’inévitable conflagration universelle. Avec une sincérité presque naïve, Thiers a avoué dans un de ses derniers discours, combien peu de confiance il avait dans l’avenir le plus prochain, et combien on était forcé de chercher à subsister, à se maintenir d’un jour à l’autre ; il a l’oreille fine, et il entend déjà, pour parler le langage de l’Edda scandinave, le hurlement lointain du loup Fenris, qui annonce l’arrivée du règne d’Héla.
Paris, le 30 avril 1840.
Hier soir, après une attente infinie, après un retard prolongé de jour en jour depuis presque deux mois, par lequel la curiosité du public, mais aussi sa patience, furent surexcitées, hier soir enfin eut lieu au Théâtre-Français la représentation de Cosima, le drame de George Sand. On ne saurait se faire une idée quelles peines, pour pouvoir assister à cette première représentation, s’étaient données depuis des semaines toutes les notabilités de la capitale, tout ce qui se fait remarquer ici par le rang, la naissance, le talent, le vice, la richesse, le ridicule, enfin par une distinction quelconque. La renommée de l’auteur est si grande, que la curiosité était excitée au plus haut degré ; mais outre la curiosité, de tout autres intérêts et de tout autres passions étaient encore en jeu. On connaissait d’avance les cabales, les intrigues, les méchancetés, les turpitudes de toute sorte qui s’étaient conjurées contre la pièce, et qui faisaient cause commune avec la plus basse envie de métier. On voulait faire expier à l’auteur hardi, qui par ses romans avait causé un égal déplaisir à l’aristocratie et à la bourgeoisie, on voulait lui faire expier publiquement ses « maximes irréligieuses et immorales », à l’occasion d’un début dramatique ; car, comme je vous l’ai écrit ces jours-ci, l’aristocratie nobiliaire, en France, regarde la religion comme un boulevard contre les dangers imminents du républicanisme, et elle daigne lui accorder sa haute protection pour assurer sa propre considération et pour protéger ses nobles têtes, tandis que la bourgeoisie voit ses têtes roturières également menacées par les doctrines antimatrimoniales de George Sand, menacées d’une certaine décoration au front, dont un garde national marié aime autant à se passer qu’il est désireux de voir orner sa poitrine de la croix de la Légion d’honneur.
L’auteur avait très bien compris sa position difficile, et il avait évité dans sa pièce tout ce qui aurait pu réveiller la colère des nobles chevaliers de la religion et des écuyers bourgeois de la morale, des légitimistes de la royauté et des légitimistes du mariage quand même. Le champion de la révolution sociale, ce génie ardent qui avait osé dans ses écrits les choses les plus extrêmes, s’était imposé pour la scène les bornes de la plus grande modération, car son but était avant tout, non pas de proclamer ses principes sur la scène, mais de prendre possession des tréteaux du théâtre. La possibilité de sa réussite excita une grande crainte chez certaines petites gens, auxquels les différends religieux, politiques et moraux, dont je viens de parler, sont tout à fait étrangers, et qui ne poursuivent que les plus vulgaires intérêts du métier. Ce sont les soi-disant auteurs dramatiques par excellence, qui, en France aussi bien que chez nous en Allemagne, forment une classe tout à fait à part, et qui n’ont rien de commun ni avec la véritable littérature ni avec les écrivains distingués dont se glorifie la nation. Ces derniers, à peu d’exceptions près, sont complètement étrangers au théâtre, avec cette différence qu’en Allemagne les grands écrivains se détournent volontairement et dédaigneusement du monde des planches, tandis qu’en France ils aimeraient beaucoup à pouvoir s’y produire, mais se voient repoussés de ce terrain par les machinations des prétendus auteurs dramatiques par excellence. Et, dans le fond, on ne peut pas trop en vouloir à ces infiniment petits, s’ils se défendent autant que possible contre l’invasion des grands, « Que voulez-vous faire chez nous ? s’écrient-ils ; restez dans votre littérature, et ne cherchez pas à vous introduire auprès de nos humbles marmites ! Pour vous la gloire, pour nous l’argent ! pour vous les longs articles remplis d’admiration et de louanges, pour vous les hommages des esprits supérieurs et la haute critique qui nous ignore entièrement, nous autres pauvres diables ! Pour vous les lauriers, pour nous le rôti ! Pour vous l’ivresse de la poésie, pour nous la mousse du vin de Champagne que nous humons en bons enfants et en société des chefs de la claque ou des dames les plus honnêtes possible. Nous mangeons, nous buvons, on nous applaudit, nous siffle et nous oublie ; tandis que vous, tout en mourant de faim, vous allez à la rencontre de la plus sublime immortalité ! »
En effet, le théâtre procure à ses auteurs dramatiques la plus parfaite aisance ; la plupart d’entre eux deviennent riches et vivent dans l’abondance, tandis que les plus grands écrivains français, ruinés par la contrefaçon belge et l’état misérable de la librairie, languissent dans une désolante pauvreté. Il est donc bien naturel qu’eux aussi ils soupirent parfois après ces fruits dorés qui mûrissent derrière la rampe scénique, et que, pour les saisir, ils allongent la main, comme le fit dernièrement mon pauvre ami Balzac à qui cette tentative coûta si cher ! Comme il existe secrètement en Allemagne une alliance défensive et offensive entre les médiocrités qui exploitent le théâtre, il en est de même à Paris, et le mal y est plus grand que chez nous, parce qu’ici toute cette misère est centralisée. Et avec cela les petites gens sont ici très actifs, très habiles, et tout à fait infatigables dans leur combat contre les grands, et tout particulièrement dans leur combat contre le génie qui vit toujours Isolé, qui est même quelque peu gauche, et qui de plus, soit dit entre nous, s’abandonne un peu trop à sa rêverie paresseuse.
Eh bien, quel accueil a trouvé le drame de George Sand, le plus grand écrivain que la France ait produit depuis la révolution de Juillet, ce génie audacieux et solitaire qui a été apprécié et célébré aussi chez nous en Allemagne ? Fut-ce un accueil définitivement mauvais ou douteusement bon ? Pour l’avouer avec sincérité, je ne saurais répondre à cette question. Le respect qu’on porte à ce grand nom a peut-être paralysé plus d’un mauvais dessein. Je m’attendais aux choses les plus fâcheuses. Tous les antagonistes de l’auteur s’étaient donné rendez-vous dans l’immense salle du Théâtre-Français, qui peut contenir plus de deux mille personnes. L’administration avait mis environ cent quarante billets à la disposition de l’auteur pour les distribuer à ses amis ; mais je crois que la plupart de ces billets ont été gaspillés par des caprices de femme, et que peu seulement sont tombés dans de bonnes mains, c’est-à-dire dans des mains applaudissantes. Quant à une claque organisée, il n’en a été rien du tout ; le chef ordinaire des claqueurs avait offert ses services, mais son assistance fut refusée par l’orgueilleux auteur de Lélia. Les nobles chevaliers du lustre, qui applaudissent si vaillamment dans le centre du parterre quand on représente un chef-d’œuvre de Scribe ou d’Ancelot, furent tout à fait invisibles hier au Théâtre-Français.
Quant à la représentation du drame, l’exécution par les soi-disant artistes, je n’en puis dire, à mon regret, que le plus grand mal. Outre la célèbre madame Dorval, qui n’a joué hier ni pis ni mieux qu’à l’ordinaire, tous les acteurs ont fait parade de leur monotone médiocrité. Le principal héros de la pièce, un certain M. Beauvallet, a joué, pour me servir d’une expression biblique, « comme un cochon avec un anneau d’or au museau. » George Sand semble avoir prévu combien peu son drame, malgré toutes ses concessions faites aux caprices des acteurs, serait favorisé par leurs efforts mimiques, et, dans une conversation qu’elle eut avec un de ses amis d’outre-Rhin, elle dit en plaisantant : « Voyez-vous, les Français sont tous comédiens de leur nature, et chacun joue son rôle dans le monde d’une manière plus ou moins brillante ; mais ceux d’entre mes compatriotes qui possèdent le moins de talent pour le noble art dramatique, se vouent au théâtre et deviennent acteurs. »
J’ai dit moi-même à une autre occasion, que la vie politique en France, le système représentatif et parlementaire, absorbe les meilleurs comédiens d’entre les Français, et qu’en conséquence on ne trouve sur le véritable théâtre que ceux d’un talent médiocre. Mais cette appréciation n’est juste qu’à l’endroit des hommes et n’atteint pas les femmes ; les scènes françaises sont riches en actrices du plus grand mérite, et la génération actuelle surpasse peut-être la précédente. Nous admirons parmi ces actrices des talents hors ligne, qui ont pu se développer sur ce terrain en d’autant plus grand nombre, que les femmes, par une législation injuste, par l’usurpation des hommes, sont exclues de toutes les fonctions et dignités politiques, et ne peuvent donc pas faire valoir leurs capacités sur les planches du Palais-Bourbon et du Luxembourg. Il n’y a que les maisons publiques de l’art et de la galanterie où elles puissent donner carrière à l’exubérance de leurs talents mimiques, et elles se font alors ou actrices ou lorettes, ou bien l’un et l’autre à la fois. Car ici en France ces deux industries ne sont pas aussi distinctes l’une de l’autre que chez nous en Allemagne, où les acteurs sont souvent regardés à l’égal des personnes les mieux famées, et se distinguent fréquemment par une très bonne conduite : aussi ne sont-ils pas chez nous vilipendés par l’opinion publique, et repoussés de la société comme des parias ; au contraire, nos acteurs trouvent parfois l’accueil le plus prévenant dans les salons de la noblesse allemande, dans les soirées des banquiers Israélites les plus riches et les plus tolérants, et même dans quelques honnêtes maisons bourgeoises. Mais ici en France, où tant de préjugés ont cependant été extirpés, l’anathème de l’Église reste toujours en force à l’égard des acteurs, qu’elle a toujours considérés comme des réprouvés ; et puisque les hommes deviennent toujours mauvais quand on les traite mal, les acteurs persévèrent ici, à peu d’exceptions près, dans leur vieille vie de bohémiens, aussi sale que brillante. Thalie et la vertu couchent ici rarement dans le même lit, et même notre plus célèbre Melpomène descend quelquefois de son cothurne pour l’échanger contre les provocantes mules dont Goethe chaussait la gentille coquine de Philine dans son roman « Wilhelm Meister. »
Toutes les belles actrices ont ici leur prix fixe, et celles dont le prix n’est pas fixé sont certainement les plus chères. La plupart des jeunes actrices sont entretenues par des dissipateurs ou de riches parvenus. En revanche, les véritables femmes entretenues et celles qu’on nomme Lorettes, ont d’ordinaire la plus grande envie de se montrer sur le théâtre, manie dans laquelle entre autant de calcul que de vanité, parce que sur la scène elles peuvent le mieux mettre en évidence leurs charmes corporels, se faire remarquer par les illustrations de la haute débauche, et en même temps se faire admirer de la masse du public. Ces personnes, qu’on voit surtout jouer sur les petits théâtres, ne touchent généralement pas de gages ; au contraire, elles paient encore par mois une certaine somme aux directeurs pour la faveur qu’ils leur accordent en leur permettant de se produire sur la scène. On connaît donc rarement ici le point précis où l’actrice et la courtisane échangent leur rôle, où la comédie cesse pour céder le pas à la nature, et où le pathétique alexandrin de six pieds se perd dans la débauche quadrupède. Les femmes de cette espèce, les amphibies de l’art et du vice, ces Mélusines des bords de la Seine, forment à coup sûr la partie la plus dangereuse de la galante Lutèce, où tant de ravissants monstres exercent leurs séductions irrésistibles.
Malheur à l’adolescent inexpérimenté qui tombe dans leurs filets ! Malheur aussi à l’homme expérimenté qui sait très bien que la jolie sirène se termine par une affreuse queue de poisson, mais qui néanmoins ne peut se défendre de céder à ses enchantements. Peut-être même à cause de la volupté secrète attachée aux frissons de la peur, le malheureux est-il d’autant plus sûrement ensorcelé par le charme fatal, et entraîné dans l’attrayant abîme, dans sa ruine délicieuse.
Les femmes dont je parle ne sont pas méchantes ou fausses, elles ont même ordinairement très bon cœur, et au lieu d’être aussi trompeuses et avides qu’on les croit, elles sont parfois les créatures les plus dévouées et les plus généreuses ; toutes leurs actions impures ne proviennent que du besoin momentané, de la gêne ou de la vanité ; elles ne sont après tout pas pires que d’autres filles d’Ève, qui dès leur enfance, par l’aisance et la surveillance de leur famille ou par d’autres faveurs du sort, ont été préservées de la chute et des rechutes morales qui s’ensuivent.
Ce qui est caractéristique en elles, c’est une certaine manie de destruction dont elles sont possédées, non seulement au préjudice d’un galant, mais aussi au préjudice de l’homme qu’elles aiment réellement, et surtout au détriment de leur propre personne. Cette manie de destruction est intimement liée à un désir effréné ou plutôt une fureur de jouissance, de la jouissance la plus immédiate, qui ne laisse pas un jour de répit, ne songe jamais au lendemain et se moque de toute espèce de réflexions ou de scrupules. Elles arrachent à leur amoureux son dernier sou, elles le poussent à engager aussi son avenir, seulement pour satisfaire à la joie du moment ; elles le forcent encore à compromettre et à gaspiller les ressources dont elles pourraient elles-mêmes profiter plus tard, elles sont même cause parfois qu’il escompte son honneur, – bref, elles ruinent leur amoureux à fond et avec une rapidité qui fait frémir. Montesquieu, dans un passage de son « Esprit des Lois », a cherché à nous donner une idée nette du despotisme en comparant les despotes à ces sauvages qui, lorsqu’ils veulent se régaler des fruits d’un arbre, saisissent aussitôt la hache et abattent l’arbre même, puis s’asseyent commodément à côté du tronc et mangent les fruits avec une précipitation gourmande. Je serais tenté d’appliquer cette comparaison aux dames dont je viens de parler. Après Shakespeare qui, dans sa Cléopâtre que j’ai appelée un jour une « reine entretenue », nous a donné un profond modèle de ces sortes de femmes, après le grand William, c’est certainement notre ami Honoré de Balzac qui les a dépeintes avec la plus effrayante fidélité. Il les décrit comme un naturaliste décrit une espèce d’animaux quelconques, ou comme un pathologiste décrit une maladie, c’est-à-dire sans but de moralisation, sans prédilection ni répugnance. Jamais assurément il ne lui est venu à l’idée de vouloir embellir ou réhabiliter ces phénomènes de la nature, ce qui serait aussi contraire à l’art qu’à la morale…
J’allais dire que le procédé de son collègue George Sand est tout autre, que cet écrivain a un but arrêté qu’il poursuit dans toutes ses œuvres ; j’allais même dire que je n’approuve pas ce but – mais je m’aperçois à temps que de pareilles observations seraient très malencontreuses dans ce moment où tous les ennemis de l’auteur de Lélia font chorus contre elle au Théâtre-Français. Mais que diable allait-elle faire dans cette galère ! Ne sait-elle donc pas qu’on peut acheter un sifflet pour un sou, que le plus pauvre niais est un virtuose sur cet instrument ? Nous en avons vu qui sifflaient comme s’ils étaient des Paganini….
NOTICE POSTÉRIEURE
Des articles de journaux sur la première représentation d’une œuvre dramatique, surtout quand la curiosité est excitée par le nom illustre de l’auteur, doivent forcément être écrits et expédiés avec la plus grande hâte, pour ne pas laisser prendra une dangereuse avance à des jugements malveillants et à des cancans calomnieux. Voilà pourquoi, dans les pages qui précèdent, je n’ai point parlé spécialement du poète qui venait de tenter son premier essai sur la scène. Par malheur, cet essai manqua complètement, de manière que le front de l’auteur habitué aux lauriers, se vit cette fois couronné d’épines, et d’épines très aiguës. Pour compenser en quelque sorte aujourd’hui la lacune laissée dans ma lettre d’alors, je communiquerai ici quelques remarques sur la personne de George Sand, remarques fugitives et puisées au hasard dans une monographie que j’ai écrite il y a plusieurs années.
Les voici :
« Comme tout le monde sait, George Sand est un pseudonyme, le nom de guerre d’une belle amazone littéraire. Ce qui l’a portée à choisir ce nom, ce ne fut aucunement le souvenir du malheureux Sand, assassin de Kotzebue, du seul auteur dramatique de l’Allemagne qui ait su écrire des comédies. Notre héroïne prit ce nom parce que c’était la première syllabe de Sandeau, son premier cavaliere servente. C’est un écrivain très honorable, mais qui avec son nom entier n’a pu se rendre aussi célèbre que son illustre maîtresse avec la moitié, qu’elle emporta en riant lorsqu’elle se sépara de lui.
Le vrai nom de George Sand est Aurore Dudevant, comme s’appelait son époux légitime, qui n’est pas un mythe, comme on pourrait le croire, mois un gentilhomme en chair et en os de la province du Bercy, et que j’ai une fois eu le plaisir de voir de mes propres yeux. C’est même chez son épouse que je le vis, chez sa légitime épouse, qui avait déjà de fait divorcé avec lui à cette époque, et vivait dans un petit logement sur le quai Voltaire. Que j’aie vu M. Dudevant justement en cet endroit, c’est une circonstance curieuse, pour laquelle, comme dirait Chamisso, je pourrais me faire voir moi-même pour de l’argent. Je lui trouvai une figure d’épicier parfaitement insignifiante, et il me sembla n’être ni méchant ni brutal, mais je compris aisément que cette tiède vulgarité, cette nullité banale, ce regard de porcelaine, ces mouvements monotones de pagode chinoise, qui auraient, il est vrai, pu être assez amusants pour une femme ordinaire, devaient nécessairement à la longue devenir insupportables pour un cœur de femme profondément sensible, et ne pouvaient manquer de la remplir à la fin d’horreur et d’épouvante, au point de la faire se sauver à tout prix de cet enfer matrimonial.
Le nom de famille de George Sand est Dupin. Elle est la fille d’un militaire dont la mère était la fille naturelle d’une danseuse, jadis célèbre, mais oubliée aujourd’hui. Le père de cette grand-mère de George Sand était, à ce qu’on, dit, le maréchal Maurice de Saxe, fameux par sa bravoure guerrière et sa nombreuse progéniture illégitime ; lui-même fut un des quatre cents bâtards qu’avait laissés le prince électeur Auguste le Fort, roi de Pologne. La mère de Maurice de Saxe fut Aurore de Kœnigsmark ; et Aurore Dudevant, qui avait reçu le nom de son aïeule, donna également à son fils le nom de Maurice. Ce fils et une fille, appelée Solange, et mariée au sculpteur Clésinger, sont les deux seuls enfants de George Sand. Elle fut toujours une excellente mère, et souvent j’ai eu l’honneur d’assister, pendant des heures entières, aux leçons de langue française qu’elle donnait à ses enfants. Ce qui est à regretter, c’est que toute l’Académie française n’ait pas assisté à ces leçons, car elle aurait pu certainement en profiter beaucoup.
George Sand, le plus grand écrivain de France, est en même temps une femme d’une beauté remarquable. Comme le génie qui se montre dans ses œuvres, son visage peut être nommé plutôt beau qu’intéressant ; l’intéressant est toujours une déviation gracieuse ou spirituelle du véritable type du beau, et la figure de George Sand porte justement le caractère d’une régularité grecque. La coupe de ses traits n’est cependant pas tout à fait d’une sévérité antique, mais adoucie par la sentimentalité moderne, qui se répand sur eux comme un voile de tristesse. Son front n’est pas haut, et sa riche chevelure du plus beau châtain tombe des deux côtés de la tête jusque sur ses épaules. Ses yeux sont un peu ternes, du moins ils ne sont pas brillants : leur feu s’est peut-être éteint par des larmes fréquentes, ou peut-être a-t-il passé dans ses ouvrages, qui ont répandu leurs flammes brûlantes par tout l’univers et embrasé tant de têtes de femmes : on les accuse d’avoir causé de terribles incendies. L’auteur de Lélia a des yeux doux et tranquilles, qui ne rappellent ni Sodome, ni Gomorrhe. Elle n’a pas un nez aquilin et émancipé, ni un spirituel petit nez camus ; son nez est simplement un nez droit et ordinaire. Autour de sa bouche se joue habituellement un sourire plein de bonhomie, mais qui n’est pas très attrayant ; sa lèvre inférieure, quelque peu pendante, semble révéler la fatigue des sens. Son menton est charnu, mais de très belle forme. Aussi ses épaules sont belles, et même magnifiques ; pareillement ses bras et ses mains, qui sont extrêmement petites, ainsi que ses pieds. Quant aux charmes de son sein, je laisse à d’autres contemporains l’outrecuidance de les décrire ; j’avoue humblement n’être pas compétent à cet égard. La conformation générale de son corps a d’ailleurs l’air d’être un peu trop grosse, ou du moins trop courte. Seulement la tête porte le cachet de l’idéal, elle rappelle les plus nobles restes de l’art antique, et, sous ce rapport, un de nos amis a eu parfaitement raison de comparer la charmante femme à la statue de marbre de la Vénus de Milo, qui se trouve placée dans une des salles du rez-de-chaussée du Louvre. Oui, George Sand est belle comme la Vénus de Milo ; elle surpasse même celle-ci par bien des qualités ! elle est par exemple beaucoup plus jeune. Les physionomistes qui prétendent que c’est la voix de l’homme qui fait le mieux deviner son caractère, seraient fort embarrassés s’ils devaient reconnaître la profonde sensibilité de George Sand dans le son de sa voix. Sa voix est mate et voilée, sans aucun timbre sonore, mais douce, et agréable. Le ton naturel de son langage lui prête un charme particulier. Quant à des dispositions pour le chant, il n’y en a pas du tout chez George Sand ; elle chante tout au plus avec la bravoure d’une belle grisette qui n’a pas encore déjeuné, ou qui, pour toute autre raison, n’est pas en voix pour le moment.
Aussi peu que par son organe, George Sand brille par sa conversation. Elle n’a absolument rien de l’esprit pétillant des Françaises, ses compatriotes, mais rien non plus de leur babil intarissable. Cette sobriété de paroles n’a cependant pas pour cause la modestie, ni un intérêt sympathique et profond pour son interlocuteur. Elle est taciturne plutôt par orgueil, parce qu’elle ne vous croit pas dignes de la faveur de vous prodiguer son esprit : ou bien même elle l’est, par égoïsme, parce qu’elle cherche à absorber en elle-même les meilleures de vos paroles, afin de les laisser fructifier dans son âme et de les employer plus tard dans ses écrits. Cette particularité, chez George Sand, de savoir, par avarice, ne rien donner dans la conversation, et y recueillir toujours quelque chose, est un trait sur lequel M. Alfred de Musset appela un jour mon attention. « Elle a par là un grand avantage sur nous autres, » dit Musset, qui, pendant de longues années d’intimité, a eu les meilleures occasions de connaître à fond le caractère de l’auteur de Lélia.
Oui, jamais George Sand ne dit un mot brillant d’esprit, et elle ne ressemble guère à ses compatriotes sous ce rapport. Avec un sourire aimable et parfois singulier, elle écoute quand d’autres parlent, et les pensées étrangères qu’elle a reçues et travaillées en elle, sortent de l’alambic de son intelligence sous une forme bien plus riche et précieuse. Elle a l’oreille extrêmement fine. Elle accepte volontiers aussi les conseils de ses amis.
On comprend qu’à cause de la direction peu canonique de son esprit, elle n’ait pas de confesseur ; mais comme les femmes même les plus enthousiastes d’émancipation ont toujours besoin d’un guide masculin, d’une autorité masculine, George Sand a pour ainsi dire un directeur de conscience littéraire, une espèce de capucin philosophe nommé Pierre Leroux. Cet excellent homme exerce malheureusement sur le talent de sa pénitente une influence peu favorable, car il l’entraîne dans d’obscures dissertations sur des idées à moitié écloses ; il l’engagea entre dans des abstractions stériles, au lieu de s’abandonner à la joie sereine de créer des formes vivantes et colorées, et d’exercer l’art pour l’art. George Sand avait investi d’une dignité plus mondaine auprès de sa personne notre bien-aimé ami Frédéric Chopin. Ce grand compositeur et pianiste fut pendant quinze ans son cavaliere servente le plus féal et le plus chevaleresque ; quelque temps avant sa mort, il fut remercié pour des raisons qui me sont inconnues.
Je ne sais comment mon ami Henri Laubé a pu un jour, dans la Gazette d’Augsbourg, m’attribuer une expression qui semblait dire que, lors de son séjour à Paris, l’incomparable Franz Liszt avait été l’amant de George Sand. L’erreur de Laubé est venue sans doute d’une association d’idées : il aura confondu les noms de deux pianistes également célèbres. En rectifiant cette erreur, je m’empresse de rendre un service plus sérieux à la bonne réputation, ou plutôt à la réputation de bon goût de notre célèbre contemporaine, en donnant à mes compatriotes de Vienne et de Prague l’assurance formelle qu’ils ont été dupes d’une calomnie des plus stupides, en croyant sur parole un des plus misérables compositeurs de romances de là-bas, un certain insecte rampant et sans nom, qui s’est vanté d’avoir entretenu avec George Sand une liaison intime. Les femmes ont à la vérité toutes sortes d’étranges appétits, et il s’en trouve même qui mangent des araignées ; mais je n’ai jamais rencontré une femme qui ait avalé des punaises. Non, Lélia n’a jamais eu de goût pour un pareil insecte, et elle ne l’a toléré quelquefois dans sa maison que parce qu’elle en était trop importunée.
Pendant longtemps, comme je l’ai dit tout à l’heure, Alfred de Musset fui l’adorateur de George Sand. Quel singulier effet du hasard, que justement le plus grand poète en prose que possèdent les Français, et le plus grand de leurs poètes en vers qui vivent actuellement (en exceptant l’incomparable et divin Béranger) aient pendant longtemps brûlé l’un pour l’autre d’un amour passionné. Ces deux têtes couronnées de lauriers formaient un bien beau couple.
George Sand pour la prose et Alfred de Musset pour les vers, surpassent en effet leurs contemporains français, et dans tous les cas ils sont supérieurs à M. Victor Hugo, cet auteur si vanté, qui, avec une persévérance opiniâtre et presque insensée, a fait accroire à ses compatriotes, et à la fin à lui-même, qu’il était le plus grand poète de la France. Est-ce réellement son idée fixe ? En tout cas, ce n’est pas la nôtre. Chose bizarre ! la qualité qui lui manque surtout, est justement celle que les Français estiment le plus, et dont ils sont particulièrement doués eux-mêmes. Je veux dire le goût. Comme ils avaient rencontré cette qualité chez tous les écrivains de leur pays, l’absence de goût complète chez Victor Hugo leur parut peut-être justement de l’originalité. Ce que nous regrettons surtout de ne pas trouver en lui, c’est ce que nous Allemands appelons le naturel. Victor Hugo est forcé et faux, et souvent dans le même vers l’un des hémistiches est en contradiction avec l’autre ; il est essentiellement froid, comme l’est le diable d’après les assertions des sorcières, froid et glacial, même dans ses effusions les plus passionnées ; son enthousiasme n’est qu’une fantasmagorie, un calcul sans amour, ou plutôt il n’aime que lui-même ; il est égoïste, et pour dire quelque chose de pire, il est Hugoïste. Il y a en lui plus de dureté que de force, et son front est de l’airain le plus effronté. Malgré tous ses moyens d’imagination et d’esprit, nous voyons chez lui la gaucherie d’un parvenu ou d’un sauvage, qui se rend ridicule en s’affublant d’oripeaux bigarrés, en se surchargeant d’or et de pierreries, ou en les employant mal à propos : en un mot, tout chez lui est barbarie baroque, dissonance criante et horrible difformité ! Quelqu’un a dit du génie de Victor Hugo : C’est un beau bossu. Ce mot est plus profond que ne le suppose peut-être celui qui l’a inventé.
En répétant ce mot, je n’ai pas seulement en vue la manie de M. Victor Hugo, de charger, dans ses romans et ses drames, le dos de ses héros principaux d’une bosse matérielle, mais je veux surtout insinuer ici qu’il est lui-même affligé d’une bosse morale qu’il porte dans l’esprit. J’irai même plus loin, en disant que d’après la théorie de notre philosophie moderne, nommée la doctrine de l’identité, c’est une loi de la nature que le caractère extérieur et corporel de l’homme répond à son caractère intérieur et intellectuel. – Je ruminais encore cette donnée philosophique dans ma tête, lorsque je vins en France, et j’avouai un jour à mon libraire Eugène Renduel, qui était aussi l’éditeur de Victor Hugo, que d’après l’idée que je m’étais faite de ce dernier, j’avais été fort étonné de ne pas trouver en M. Hugo un homme gratifié d’une bosse, « Oui, on ne lui voit pas sa difformité, » dit M. Renduel par distraction. – Comment, m’écriai-je, il n’en est donc pas tout à fait exempt ? – « Non, pas tout à fait, » répondit Renduel avec embarras, et sur mes vives instances il finit par m’avouer qu’il avait un beau matin, surpris M. Hugo au moment où il changeait de chemise, et qu’alors il avait remarqué un vice de conformation dans une de ses hanches, la droite, si je ne me trompe, qui avançait un peu trop, comme chez les personnes dont le peuple a l’habitude de dire qu’elles ont une bosse, sans qu’on sache où. Le peuple, dans sa naïveté sagace, nomme ces gens aussi des bossus manqués, de faux bossus, comme il appelle les albinos des nègres blancs. Chose aussi amusante que significative ! ce fut justement à l’éditeur du poète que cette difformité ne resta pas cachée. Personne n’est un héros aux yeux de son valet de chambre, dit le proverbe, et de même le plus grand écrivain finira par perdre à la longue son prestige héroïque aux yeux de son éditeur, l’attentif valet de chambre de son esprit ; ils nous voient trop souvent dans notre négligé humain. Quoi qu’il en soit, je m’amusai beaucoup de cette découverte de Renduel ; elle sauve la synthèse de ma philosophie allemande, qui affirme que le corps est l’esprit visible, et que nos défauts spirituels se manifestent aussi dans notre conformation corporelle. Mais il faut que je fasse mes réserves expresses contre une conclusion erronée qu’on pourrait tirer de là, en pensant que le contraire doit avoir lieu également, c’est-à-dire que le corps de l’homme doit toujours être en même temps son esprit visible, et que la difformité extérieure donne le droit de supposer aussi une difformité intérieure, une difformité morale. Non, nous avons trouvé bien des fois dans des enveloppes rabougries et laides, les âmes les plus droites et les plus belles, ce qui s’explique facilement parce que les difformités corporelles sont causées d’ordinaire par quelque accident physique, si elles ne sont pas la suite d’une négligence ou d’une maladie survenue après la naissance. Au contraire, la difformité de l’âme vient au monde avec nous ; et c’est ainsi que le poète français, en qui tout est faux, se trouve être aussi un faux bossu.
Nous nous rendrons le jugement des œuvres de George Sand plus facile en disant qu’elles forment un contraste absolu avec les productions de Victor Hugo. George Sand a tout ce qui manque à ce dernier : elle a du naturel, du goût, la vérité, la beauté, l’enthousiasme, et toutes ces qualités sont reliées entre elles par l’harmonie la plus parfaite et la plus sévère à la fois. Le génie de George Sand a les hanches les mieux arrondies et les plus suavement belles ; tout ce qu’elle sent et pense respire la grâce et fait deviner des profondeurs immenses. Son style est une révélation en fait de forme pure et mélodieuse. Mais pour les héros de ses livres, les sujets qu’elle représente, et qu’on pourrait souvent appeler des mauvais sujets, je m’abstiens ici de toute observation à cet égard, et je laisse ce thème à la discussion de ses ennemis vertueux et quelque peu jaloux de ses succès immoraux.
Paris, 7 mai 1840.