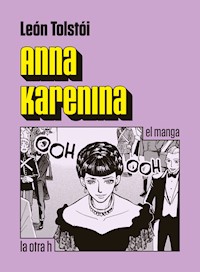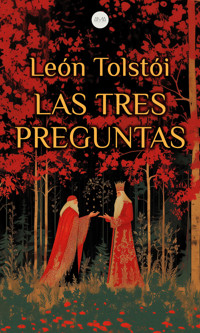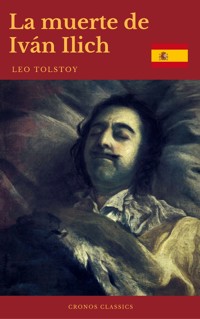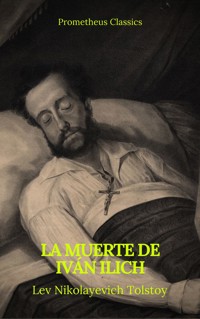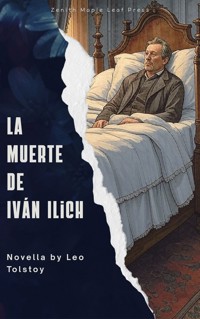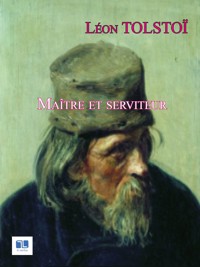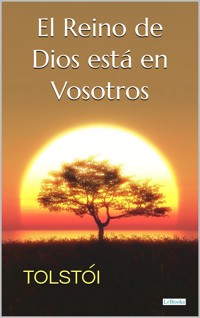Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Par un rigoureux après-midi d'hiver, le riche marchand Brekhounov décide d'aller négocier l'achat d'une forêt chez un propriétaire de la région. Il part en traîneau avec son serviteur. En cours de chemin, ils sont surpris par une violente tempête de neige. Ne pouvant laisser passer une bonne affaire, Brekhounov s'acharne à vouloir continuer sa route...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 87
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Maître et Serviteur
Maître et ServiteurIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXPage de copyrightMaître et Serviteur
Léon Tolstoï
I
C’était en 1870, le surlendemain de la Saint-Nicolas, qui était la fête de la paroisse. Vassili Andréitch Brekhounov[1], marchand de deuxième ghilde[2], n’avait pu s’absenter pendant ces deux jours, parce qu’il devait se trouver à l’église, étant marguillier, et qu’il avait dû, en outre, recevoir et fêter chez lui des parents et des amis. Mais sitôt le dernier de ses hôtes parti, Vassili Andréitch se hâta de faire ses préparatifs pour se rendre à Goriatschkino, chez un pomiestchik[3], avec qui il voulait conclure l’achat d’un petit bois qu’il lui marchandait déjà depuis longtemps.
Vassili Andréitch avait grande hâte, car il craignait maintenant de se voir souffler cette bonne affaire par les marchands de la ville. Le jeune pomiestchik voulait dix mille roubles, tout simplement parce que Vassili Andréitch en offrait sept mille, et ces sept mille roubles, à vrai dire, ne représentaient pas le tiers de la véritable valeur du bois. Vassili Andréitch avait même eu l’espoir de rabattre encore sur ce prix, ce bois se trouvant dans un rayon où les autres marchands du district s’étaient engagés, par réciprocité, à ne pas surenchérir sur ses offres. Mais, ayant appris que les marchands de bois du gouvernement avaient l’intention d’acheter les arbres de Goriatschkino, il s’était décidé à partir immédiatement pour terminer l’affaire avec le pomiestchik.
Aussitôt donc que la fête fut finie, il tira de sa caisse sept cents roubles, compléta la somme de trois mille en y ajoutant deux mille trois cents roubles appartenant à l’église et dont il était dépositaire, et après les avoir soigneusement comptés et serrés dans son portefeuille, il se disposa à partir.
Nikita, le seul des serviteurs de Vassili Andréitch qui, ce jour-là, ne fût pas ivre, courut pour atteler.
Nikita n’était pas ivre, non qu’il ne fût pas ivrogne, mais parce que, ayant bu son kaftan et ses bottes pendant les derniers jours de carnaval, il avait fait vœu de ne plus boire et tenait parole depuis plus d’un mois. Ainsi, même en ce jour, il n’avait pas bu, malgré la tentation de l’eau-de-vie qui coulait à flots à l’occasion de la fête.
Nikita était un moujik de cinquante ans, natif du village voisin, sans foyer, comme on disait de lui, et ayant passé la majeure partie de sa vie au service des autres. Tout le monde faisait cas de lui pour son amour du travail, son habileté, sa vigueur, et surtout pour sa bonté et son heureux caractère. Mais il n’était resté longtemps nulle part parce que deux fois par an, plus souvent même quelquefois, il s’enivrait, et alors, non seulement il buvait tout ce qu’il possédait, mais encore il devenait turbulent et querelleur.
Vassili Andréitch lui-même n’était pas sans l’avoir chassé plusieurs fois, mais il le reprenait toujours ensuite à cause de son honnêteté, de sa douceur pour les animaux et surtout parce qu’il coûtait peu. Au lieu des quatre-vingts roubles par an qu’un travailleur comme lui valait bien, il ne lui en donnait que quarante, et encore irrégulièrement payés, par menus acomptes, et non pas en argent pour la plupart du temps, mais en marchandises estimées bien au-dessus de leur valeur.
La femme de Nikita, Marpha, jadis une belle luronne, gardait la maison avec son jeune fils et deux grandes filles. Elle ne faisait rien pour ramener son mari parce que, d’abord, depuis vingt ans, elle vivait avec un tonnelier, moujik d’un village éloigné et qui logeait chez elle ; ensuite parce que, bien qu’elle fît de Nikita ce qu’elle voulait lorsqu’il était à jeun, elle le craignait comme le feu quand il avait bu.
Un jour, par exemple, qu’il s’était enivré chez lui, Nikita, pour se venger probablement de sa soumission habituelle, avait brisé le coffre de sa femme, en avait retiré ses plus beaux habits, s’était saisi d’une hache et les avait mis en mille pièces.
C’est pourtant à sa femme que tout ce qu’il gagnait était payé par son maître, sans que jamais il s’y fût opposé. Ainsi, en ce moment, deux jours avant la fête, Marpha s’était rendue chez Vassili Andréitch et y avait pris de la farine de froment, du thé, du sucre, une bouteille d’eau-de-vie, en tout pour trois roubles de marchandises, plus cinq roubles en espèces, et avait remercié le patron comme d’une faveur quand, en comptant au plus bas, Vassili Andréitch devait encore à Nikita au moins vingt roubles.
— Est-ce qu’il y a des conventions entre nous ? disait-il à Nikita. Tu as besoin, prends. Tu payeras par ton travail. Chez moi, ce n’est pas comme chez les autres : attendre qu’on fasse les comptes, et par là-dessus les amendes !... Moi, je vais tout bonnement et honnêtement. Tu me sers, je ne t’abandonne pas. Tu es dans le besoin, je te viens en aide.
Et, en parlant ainsi, Vassili Andréitch croyait fermement qu’il était le bienfaiteur de Nikita, tant l’accent de sa parole était sincère, et cette conviction était affermie par les approbations de son entourage, à commencer par celles de Nikita lui-même.
— Mais je comprends bien, Vassili Andréitch, aussi je vous sers comme mon propre père ; je comprends bien, répondait Nikita, comprenant non moins bien que Vassili Andréitch le trompait, mais sachant aussi qu’il était inutile de tenter d’éclaircir ses comptes et qu’il fallait vivre en prenant ce qu’on lui donnait tant qu’il n’aurait pas une autre place.
Ayant reçu l’ordre d’atteler, Nikita, gai comme toujours, du pas leste et dispos de ses jambes cagneuses, se dirigea vers la remise, y décrocha le lourd harnais de cuir orné d’un gland, et, faisant sonner les barantschiks[4] du mors, il entra dans l’écurie où était le cheval que Vassili Andréitch ordonnait d’atteler.
— Eh quoi ! Tu t’ennuies, tu t’ennuies, petite bête ? dit Nikita, en réponse au léger hennissement de plaisir par lequel l’accueillit un petit étalon bai brun au chanfrein blanc, de moyenne taille, avec la croupe basse, qui se trouvait seul dans l’écurie.
— Hue ! hue ! ne te presse pas, petite bête ; il faut d’abord te faire boire, disait-il au cheval comme s’il eût parlé à son semblable ; et, du pan de son vêtement, il époussetait le dos vigoureux de la bête, où le poil manquait par places, où les muscles marquaient leur double sillon ; puis il passa le harnais sur la jeune et belle tête de l’étalon, en dégagea les oreilles et le toupet, et, ramenant à soi la bride, il le conduisit boire.
Moukhorty[5] sortit avec précaution de l’écurie à travers les tas de fumier, piaffa et rua joyeusement, faisant semblant de vouloir atteindre Nikita, qui courait à ses côtés vers le puits.
— Fais l’espiègle, fais l’espiègle, coquin, lui criait Nikita, connaissant fort bien la prudence avec laquelle Moukhorty jetait en l’air un de ses pieds de derrière, adroitement, pour effleurer seulement la pelisse de mouton de Nikita qui aimait ce jeu.
Après avoir bu l’eau froide, le cheval demeura un moment immobile. souffla en remuant ses grosses lèvres mouillées d’où retombaient des gouttes transparentes dans l’abreuvoir, et s’ébroua.
— Tu n’en veux plus ? soit, c’est entendu. Mais n’en demande plus, dit Nikita, d’un air très sérieux et comme pour expliquer sa conduite à Moukhorty. Puis, il courut vers la remise en tirant par la bride le jeune et pétulant cheval, qui ruait et faisait retentir les pavés de la cour.
Tous les serviteurs étaient sortis, il n’y avait au logis qu’un étranger, mari de la cuisinière, venu pour la fête.
— Va donc demander, mon brave, lui dit Nikita, quel traîneau il faut atteler, si c’est le grand ou le petit.
L’homme entra dans la maison et revint bientôt, rapportant l’ordre d’atteler le petit traîneau.
Pendant ce temps, Nikita avait déjà mis le collier au cheval, attaché la sellette à clous brillants, et, portant d’une main une légère douga[6] peinte en couleur, de l’autre, conduisant le cheval, il s’approcha de deux traîneaux rangés dans la remise.
— Le petit ? Va pour le petit ! dit-il, en faisant entrer dans les brancards le malicieux animal, qui tout le temps feignait de vouloir le mordre. Puis, aidé du mari de la cuisinière, il procéda à l’attelage.
Quand tout fut presque prêt et qu’il ne resta plus qu’à passer les rênes, Nikita envoya le mari de la cuisinière chercher dans le hangar de la paille et une toile de sac à grains.
— Voilà qui est bien. Ho là ! Ho ! reste tranquille, dit Nikita en étalant dans le traîneau la paille d’avoine que son compagnon venait de lui apporter.
— Et à présent, mettons la toile d’étoupe et le sac par-dessus. C’est ça ; comme cela on sera bien assis.
Et il faisait comme il disait, bordant la toile de sac tout autour du siège.
— Eh bien, merci, mon bon, dit-il alors. À deux, cela va plus vite.
Puis il démêla les rênes réunies par un anneau, monta sur son siège et fit marcher le cheval, qui ne demandait que cela, sur le fumier glacé de la cour en le dirigeant vers la porte cochère.
— Oncle Nikita, petit oncle, eh ! petit oncle ! criait derrière lui un gamin de sept ans, vêtu d’une petite pelisse noire, chaussé de valenkis[7] blancs, tout neufs, et coiffé d’un bonnet fourré, qui s’était précipité dans la cour en faisant claquer le loquet de la porte.
— Laisse-moi monter, demandait-il d’une voix fluette, et boutonnant sa pelisse tout en courant.
— Eh bien, viens, viens, ma colombe, dit Nikita qui s’arrêta et fit monter l’enfant du maître ; le visage du petit s’illumina ; puis Nikita franchit la porte cochère.
Il était deux heures de l’après-midi. Il gelait : il y avait environ 12 degrés ; le ciel était couvert, et il ventait. Dans la cour, on ne sentait pas le vent, mais il soufflait fortement au dehors : il avait chassé la neige du toit d’un hangar voisin et en faisait un tourbillon au coin de la rue, près de l’établissement de bains.
À peine Nikita était-il sorti de la cour et avait-il arrêté le cheval devant la porte de la maison que Vassili Andréitch, la cigarette aux lèvres, un touloupe de peau de mouton fortement serré à la taille par une large ceinture, parut sur le perron couvert de neige, qu’il faisait craquer de ses valenkis, et s’arrêta en rabattant des deux côtés de son visage rubicond, barré seulement par les moustaches, les coins de son col fourré, afin que la fourrure ne se couvrît pas de la buée glacée de son haleine.
— Voyez-vous le dégourdi ? Le voilà déjà dans le traîneau, fit-il à la vue de son fils, en riant et en montrant ses dents blanches.
Vassili Andréitch était animé par l’eau-de-vie qu’il avait bue avec ses invités ; aussi se montrait-il encore plus content qu’à l’ordinaire de tout ce qui lui appartenait et de tout ce qu’il faisait.
La tête et les épaules enveloppées d’un châle de laine à tel point qu’on ne lui voyait que les yeux, la femme de Vassili Andréitch, enceinte, pâle et maigre, conduisant son mari jusqu’au seuil, se tenait derrière lui dans le vestibule.
— Vraiment, tu ferais bien de te faire accompagner par Nikita, dit-elle, en s’avançant timidement de derrière la porte.
Vassili Andréitch ne répondit rien. Il cracha seulement d’un air dédaigneux.
— Tu emportes de l’argent, continua-t-elle du même ton pleurard, — et puis une bourrasque peut s’élever. Non, vraiment, par Dieu !...