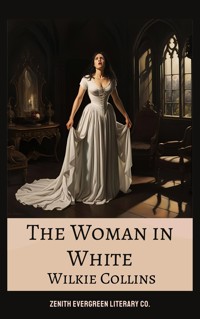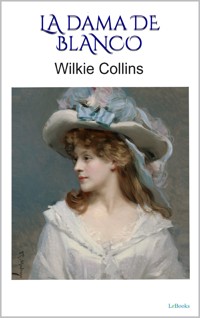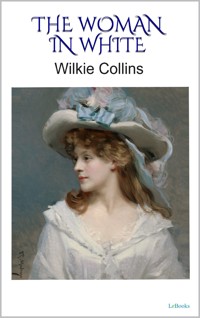Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
La jeune Anne Sylvester est la fille de l'épouse déchue d'un gentleman anglais. Anne est recueillie par la meilleure amie de sa mère quand celle-ci décède, et devient la préceptrice de sa fille, Blanche. Une amitié très forte lie les deux jeunes femmes. Mais alors que le bonheur semble promis à toutes deux, le destin s'acharne sur Anne: elle s'est éprise d'un jeune homme de bonne famille qui, pour la séduire lui promet le mariage alors qu'il ne pense qu'à une jeune et riche veuve... Ce roman plein d'humour et riche en rebondissements, est l'occasion pour Wilkie Collins de dénoncer les lois du mariage dans le Royaume-Uni en cette fin du XIXe siècle, qui n'accordent aucun droit aux femmes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 549
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mari et Femme
Mari et FemmeSIXIÈME SCÈNE LES CYGNESSEPTIÈME SCÈNE L’HERMITAGEHUITIÈME SCÈNE L’OFFICENEUVIÈME SCÈNE LE SALON DE MUSIQUEDIXIÈME SCÈNE LA CHAMBRE À COUCHERONZIÈME SCÈNE LA MAISON DE SIR PATRICKDOUZIÈME SCÈNE DRURY LANETREIZIÈME SCÈNE FULHAMQUATORZIÈME SCÈNE PORTLAND PLACEQUINZIÈME SCÈNE HOLCHESTER HOUSEDERNIÈRE SCÈNE BLOC DE SELÉPILOGUE UNE VISITE MATINALEAPPENDICEPage de copyrightMari et Femme
Wilkie Collins
SIXIÈME SCÈNE LES CYGNES
35 SEMENCES DE L’AVENIR (1re SEMENCE)
– Pas si grand que Windygates. Mais… dirons-nous que c’est mignon, Jones ?
– Et confortable, Smith. Je suis complètement d’accord avec vous.
Tel fut le jugement prononcé par les deux gentlemen du Chœur, sur la maison de Julius Delamayn en Écosse.
Smith et Jones étaient, jusqu’à un certain point, doués d’un jugement sain. Les Cygnes, c’était le nom de cette habitation, n’avaient pas la moitié de la grandeur de Windygates mais ils étaient habités depuis deux cents ans, et ils possédaient les avantages de leur ancienneté. Une vieille habitation s’adapte au caractère humain, comme un vieux chapeau s’adapte à la tête humaine.
Le visiteur quittant les Cygnes s’en allait avec le même sentiment de regret qu’on éprouve en quittant son chez-soi. C’était une des rares maisons étrangères qui s’emparent vivement de nos sympathies.
Les jardins d’agrément étaient de beaucoup inférieurs comme étendue et comme splendeur à ceux de Windygates. Mais le parc était beau et moins monotone que les parcs anglais. Le lac, sur la limite septentrionale du domaine, fameux par la race des beaux cygnes qu’on y entretenait, était la curiosité des environs. C’était à eux que le domaine devait son nom. La maison avait une histoire qui s’associait au souvenir de plus d’un personnage célèbre de l’Écosse.
Cette histoire avait été écrite et illustrée par Julius Delamayn lui-même. Les visiteurs qui se présentaient aux Cygnes recevaient un exemplaire du volume imprimé aux frais de l’auteur comme édition privée. Un sur vingt le lisait, tous paraissaient charmés et regardaient au moins les gravures.
On était au dernier jour d’août, date fixée pour la fête donnée par Mr et Mrs Delamayn dans leurs jardins.
Smith et Jones, qui avaient suivi les hôtes de Windygates à la remorque de lady Lundie, échangeaient leurs observations sur une terrasse, derrière la maison, près des marches d’un escalier qui descendait dans le jardin. Ils formaient l’avant-garde des visiteurs sortant par deux ou par trois des salons de réception, tous poussés par l’envie d’aller voir les cygnes.
Julius sortit avec le premier détachement, recruta Smith et Jones et d’autres gentlemen qui se promenaient çà et là et se dirigea vers le lac.
Pendant un intervalle d’une ou deux minutes, la terrasse demeura solitaire.
Puis deux dames, à la tête d’un second détachement de visiteurs, apparurent sous le porche de pierre qui abritait l’entrée de ce côté de la maison.
L’une de ces dames était une modeste et agréable petite personne, très simplement habillée. L’autre était le grand et formidable type des belles femmes, dans une éblouissante toilette. La première était Mrs Julius Delamayn, la seconde était lady Lundie.
– Exquis ! s’écria Sa Seigneurie, en contemplant les vieux vitraux sertis d’étain des fenêtres de la maison, avec leur encadrement de plantes grimpantes et les grands contreforts de pierre faisant saillie par intervalles sur les murailles et dont la base était ornée de magnifiques fleurs. Je suis réellement chagrine que sir Patrick ait manqué cela.
– Vous m’avez dit, je crois, lady Lundie, que sir Patrick avait été appelé à Édimbourg pour une affaire de famille.
– Une affaire, Mrs Delamayn, qui n’a rien d’agréable pour moi. Elle a dérangé toutes les dispositions que j’avais prises pour l’automne. Ma belle-fille doit se marier la semaine prochaine.
– Est-ce si proche ?… Puis-je vous demander quel est le gentleman ?…
– Mr Arnold Brinkworth.
– Bien certainement ce nom s’associe pour moi à quelque souvenir.
– Vous avez probablement entendu parler de lui, comme l’héritier des propriétés de miss Brinkworth, en Écosse.
– C’est cela même. Avez-vous amené Mr Brinkworth ici, aujourd’hui ?
– Je vous apporte ses excuses, en même temps que celles de sir Patrick. Ils sont partis ensemble pour Édimbourg avant-hier. Les hommes de loi s’engagent à avoir préparé les contrats sous trois ou quatre jours au plus s’ils peuvent causer directement avec les parties. Il s’agit d’une question de forme, je crois, concernant les titres de propriété. Sir Patrick a pensé que la voie la plus sûre et la plus expéditive était d’emmener Mr Brinkworth avec lui à Édimbourg, pour avoir terminé l’affaire aujourd’hui. Il attendra que nous les rejoignions demain, sur notre route vers le sud.
– Vous quittez Windygates par ce beau temps ?
– Bien contre mon gré ! La vérité, madame, c’est que je suis à la merci de ma belle-fille. Son oncle a l’autorité, comme tuteur, et l’usage qu’il en fait est de la laisser maîtresse de ses volontés en toutes choses. Ce n’est que vendredi dernier qu’elle a consenti à ce que le jour du mariage fût fixé, et même alors, elle a mis comme condition expresse à ce consentement, que le mariage n’aurait pas lieu en Écosse. Pure folie ! Mais que pouvais-je faire ? Sir Patrick se soumet. Mr Brinkworth se soumet. Si je dois être présente au mariage, il me faut suivre leur exemple. Or, je sens qu’il est de mon devoir d’être présente… et naturellement je me sacrifie. Nous partons pour Londres demain.
– Miss Lundie doit-elle se marier à Londres à cette époque de l’année ?
– Non. Nous ne ferons que passer à Londres, pour nous rendre à la résidence de sir Patrick, dans le comté de Kent… résidence qui lui est échue avec le titre…, résidence qui s’associe avec les derniers jours de mon bien-aimé mari… Autre épreuve pour moi ! Le mariage doit être célébré au lieu témoin de mon veuvage. Mon ancienne blessure sera rouverte lundi prochain… et cela parce que ma belle-fille n’aime plus Windygates.
– D’aujourd’hui en huit. C’est donc le jour du mariage ?
– Oui, d’aujourd’hui en huit. Il y avait pour presser ce mariage des raisons dont il n’est pas besoin que je vous ennuie. Non, on ne saurait dire combien je voudrais que tout fût fini. Mais, chère Mrs Delamayn, comme je suis folle de vous assaillir ainsi avec mes tourments de famille ! Vous êtes si pleine de sympathie ! C’est ma seule excuse. Que je ne vous enlève pas à vos hôtes, je me plairais toujours dans cet endroit charmant. Où est Mrs Glenarm ?
– Je ne sais, en vérité. Je l’ai cherchée quand nous sommes venues sur la terrasse. Elle nous rejoindra probablement au lac. Désirez-vous voir le lac, lady Lundie ?
– J’adore les beautés de la nature, madame, surtout les lacs.
– Nous avons quelque chose à vous y montrer. C’est une race de cygnes particulière à ce beau pays. Mon mari est déjà parti avec quelques-uns de vos amis, et il s’attend à ce que nous le suivions, dès que le reste de la compagnie, sous la conduite de ma sœur, aura visité la maison.
– Et quelle maison, madame ! Dans tous les coins, des souvenirs historiques ! C’est un si grand soulagement pour mon esprit de chercher un refuge dans le passé ! Quand je serai loin de cette délicieuse résidence, je pourrai peupler les Cygnes des figures qui s’y sont succédé jadis et partager les joies et les douleurs des siècles écoulés.
Au moment où lady Lundie exprimait la joie qu’elle trouvait à faire revivre les anciennes générations, les derniers hôtes qui venaient de visiter l’antique maison apparurent sous le porche. Parmi eux étaient Blanche et une amie de son âge qu’elle avait retrouvée aux Cygnes.
Les deux jeunes filles se tenaient en arrière, causant confidentiellement et se donnant le bras ; le sujet de leur entretien, ai-je besoin de le dire ? c’était le futur mariage.
– Mais, chère Blanche, pourquoi ne vous mariez-vous pas à Windygates ?
– Je déteste Windygates, Janet. Les plus douloureux souvenirs s’associent pour moi à cette demeure. Ne me demandez pas quels souvenirs. L’effort de ma vie doit tendre maintenant à n’y plus penser. Je voudrais dire un dernier adieu à Windygates. Quant à célébrer là mon mariage, j’ai mis pour condition expresse de ne pas me marier en Écosse.
– Qu’est-ce que notre pauvre Écosse a donc fait pour déchoir dans votre bonne opinion, ma chère ?
– La pauvre Écosse, Janet, est une contrée où les gens ne savent pas s’ils sont mariés ou non. Je tiens cela de mon oncle, et je connais une personne qui est la victime… la victime innocente… d’un mariage écossais.
– C’est absurde, Blanche ! Vous pensez à des mariages clandestins, et vous rendez l’Écosse responsable des embarras qu’éprouvent toujours ceux qui n’osent pas avouer la vérité.
– Je ne suis nullement absurde. Je pense à l’amie la plus chère que j’aie au monde. Si vous la connaissiez…
– Ma chère, je suis écossaise, ne l’oubliez pas. Vous pouvez être tout aussi bien mariée, j’insiste sur ce point, en Écosse qu’en Angleterre.
– Je hais l’Écosse !
– Blanche !
– Je n’ai jamais été aussi malheureuse de ma vie que depuis que je suis en Écosse. Je ne veux pas m’exposer à une nouvelle épreuve. Je suis résolue à être mariée en Angleterre… dans la chère vieille maison que j’habitais quand j’étais petite fille. Mon oncle y donne son consentement. Il me comprend ! lui, et il a de l’amitié pour moi.
– Cela équivaut-il à dire que je ne vous comprends pas et que je n’ai pas d’amitié pour vous ! Peut-être ferais-je mieux de vous délivrer de ma compagnie, Blanche ?
– Si vous devez me parler sur ce ton, peut-être ferez-vous mieux, en effet !
– Dois-je entendre calomnier mon pays natal et ne pas dire un mot pour sa défense ?
– Oh ! vous autres Écossais, vous faites tant de tapage avec votre pays natal !
– Nous autres Écossais ? Mais vous êtes vous-même d’origine écossaise, et vous devriez avoir honte de parler comme vous le faites. Je vous souhaite le bonjour !
– Je vous souhaite un meilleur caractère !
Depuis une minute, les deux jeunes filles étaient comme deux boutons de rose sur une même branche. Maintenant, elles se séparaient le visage rouge, des sentiments hostiles au cœur, de dures paroles à la bouche. Quelle ardeur dans les scènes de la jeunesse ! Quelle indicible fragilité dans l’amitié des femmes !
Le troupeau de visiteurs suivit Mrs Delamayn sur les bords du lac. Peu de minutes après, la terrasse était complètement solitaire. Alors apparut, sous le porche, un homme seul qui s’avançait d’un air insouciant, une fleur à la bouche et les mains dans ses poches. C’était l’homme le plus fort des Cygnes, autrement dit Geoffrey Delamayn.
Un moment après, une dame se fit voir derrière lui marchant doucement, de manière à ne pas être entendue. Elle était richement habillée, à la dernière mode de Paris. La broche attachée sur sa poitrine était ornée d’un solitaire de la plus belle eau et remarquable comme grosseur. L’éventail qu’elle tenait à la main était un chef-d’œuvre de l’art indien. La dame avait bien l’air de ce qu’elle était, une personne qui a de l’argent à ne savoir qu’en faire mais qui est un peu moins riche en intelligence.
C’était la veuve sans enfants du grand marchand de fer, autrement dit Mrs Glenarm.
L’opulente veuve frappa coquettement l’épaule de l’homme fort du plat de son éventail.
– Ah ! mauvais sujet, dit-elle avec un ton et des façons légèrement étudiés, je vous trouve enfin !
Geoffrey sauta du porche sur la terrasse, laissant la dame derrière lui. On reconnaissait dans ce mouvement la supériorité d’un sauvage étranger à toute soumission envers le beau sexe. Il consulta sa montre.
– J’ai dit que je viendrai ici quand j’aurai une demi-heure à moi, murmura-t-il en mâchonnant la fleur qu’il avait entre ses dents. J’ai cette demi-heure de liberté et me voici.
– Êtes-vous venu pour le plaisir de rencontrer les visiteurs ou pour me voir ?
Geoffrey sourit gracieusement.
– Pour vous voir, comme de raison.
La veuve du marchand de fer prit son bras et leva les yeux sur lui. Une jeune fille n’aurait point osé cela. Le soleil donnait en plein sur le visage de Mrs Glenarm.
Réduite à sa plus simple expression et à sa véritable valeur, l’idée commune des Anglais sur la beauté des femmes se résume en trois mots : jeunesse, santé, rondeurs.
Le charme de l’esprit, de l’intelligence, de la vivacité, l’attrait plus subtil de la délicatesse des lignes et de la finesse des détails sont rarement appréciés par la masse de nos insulaires. Il est impossible d’expliquer autrement l’aveuglement qui fait que neuf Anglais sur dix, en revenant d’outremer, déclarent n’avoir pas vu une seule jolie Française, soit à Paris, soit dans tout le reste de la France.
Notre type populaire de beauté se proclame lui-même en son complet développement matériel, dans toutes les boutiques où se vendent les publications illustrées. La même face pleine, avec un vague sourire sans la moindre expression, voilà ce qui se voit sous toutes les formes dans les journaux illustrés chaque semaine. Ceux qui désirent savoir ce qu’était Mrs Glenarm n’ont qu’à s’arrêter devant une boutique de libraire ou de marchand de gravures, et à regarder le premier portrait de jeune femme dans les vitrines.
La seule particularité dans la beauté prosaïque et purement matérielle de la riche veuve qui pût frapper un homme cultivé était quelque chose d’enfantin dans l’air et dans les manières. Un étranger s’adressant à cette femme, qui avait été mariée à 20 ans et qui était maintenant veuve à 24, l’aurait appelée… mademoiselle.
– Est-ce là l’usage à faire d’une fleur que je vous ai donnée ? dit-elle à Geoffrey… La mâcher entre vos dents, vilain que vous êtes, comme si vous étiez un cheval.
– Bon, répliqua Geoffrey. Je suis plus un cheval qu’un homme. Puisque je suis engagé pour une course et que le public parie sur moi. Oh ! oh ! cinq contre quatre !
– Cinq contre quatre. Je crois qu’il ne pense à rien qu’aux paris. Allons, lourde créature, je ne pourrai donc pas vous remuer. Ne voyez-vous pas que je veux rejoindre le reste de la société au lac ? Vous n’allez pas me refuser votre bras ? Vous allez m’y conduire, et tout de suite.
– Je ne puis pas. Il faut que je rejoigne Perry dans une demi-heure.
Perry, c’était l’entraîneur de Londres. Il était arrivé plus tôt qu’on ne l’attendait, et était entré en fonctions depuis trois jours.
– Ne me parlez pas de votre Perry, être vulgaire ! Mettez-le de côté un moment… ne le voulez-vous pas ?… Avez-vous l’intention de me faire croire que vous êtes assez sauvage pour préférer la société de Perry à la mienne ?
– Et les paris à cinq contre quatre, ma chère !… Et la course qui a lieu dans un mois !
– Oh ! allez rejoindre votre bien-aimé Perry ! Je vous hais. J’espère que vous serez battu dans la course. Restez dans votre cottage. Ne revenez plus à la maison, je vous prie ; et rappelez-vous bien ceci : n’ayez plus la présomption de m’appeler « ma chère ».
– Si ce n’est pas pousser la présomption moitié assez loin, je vous prierai d’attendre un peu. Accordez-moi jusqu’à ce que la course soit passée. Et alors… Oui… alors j’aurai la présomption de vous épouser.
– Vous ! vous atteindrez l’âge de Mathusalem si vous attendez jusqu’à ce que je sois votre femme ! Je crois que Perry a une sœur ; si vous la lui demandiez ? Ce serait juste la personne qui vous conviendrait.
Geoffrey fit faire à la fleur un nouveau tour dans sa bouche et parut réfléchir à une idée qui méritait considération.
– Très bien, dit-il. Tout, pour vous être agréable. Je ferai ma demande à Perry.
Il tourna sur lui-même, comme s’il allait courir vers Perry. Mrs Glenarm avança sa petite main, recouverte d’un ravissant gant d’une couleur rosée et la posa sur le bras puissant de Geoffrey. Elle pinça doucement les muscles de fer, la gloire et l’orgueil de la Grande-Bretagne.
– Quel homme vous êtes ! dit-elle. Jamais je n’ai rencontré personne qui vous ressemblât !
Tout le secret de l’empire que Geoffrey avait acquis sur elle était dans ces quelques mots.
Ils étaient ensemble aux Cygnes depuis un peu moins de dix jours, et il avait royalement fait la conquête de Mrs Glenarm. La veille même de ce jour, durant un des intervalles de loisir que lui accordait Perry, il l’avait surprise seule, l’avait saisie par le bras et lui avait demandé, sans autre préambule, si elle voulait l’épouser.
Les exemples de femmes conquises après une cour encore plus brève, cela soit dit avec tout le respect possible, ne sont pas rares.
La veuve du marchand de fer avait pourtant exigé une promesse de secret avant de s’engager. Quand Geoffrey eut donné sa parole de retenir sa langue en public jusqu’au moment où elle l’autoriserait à parler, Mrs Glenarm, sans plus d’hésitation, avait dit oui. Après avoir, qu’on le remarque, dit non, pendant deux ans et repoussé une demi-douzaine au moins d’hommes supérieurs à Geoffrey sous tous les rapports, excepté la beauté et la force corporelle.
Et encore une fois cette raison disait tout.
Quelque persistance que les hypocrites de l’un et l’autre sexe des temps modernes mettent à le nier, il n’en est pas moins certain que la condition naturelle de la femme est de trouver son maître dans un homme.
Regardez en face une femme qui n’est sous la dépendance directe d’aucun homme, et sûrement vous verrez une femme qui n’est pas heureuse. L’absence d’un maître est leur grande souffrance inconnue, la présence d’un maître est, sans qu’elles en aient conscience elles-mêmes, le seul complément possible de leur vie.
Dans 99 cas sur 100, cet instinct primitif est au fond de la faiblesse inexplicable d’une femme qui se donne à un homme indigne d’elle.
Cet instinct primitif était incontestablement au fond de la facilité avec laquelle Mrs Glenarm s’était rendue.
Jusqu’à l’époque de sa rencontre avec Geoffrey, la jeune veuve n’avait fait qu’une expérience dans la vie, celle de la soumission des autres. Sa tyrannie était acceptée. Dans le court espace de six mois qu’avait duré son existence de femme mariée à un homme dont elle aurait pu être la petite-fille, elle n’avait eu qu’à lever un doigt pour être toujours obéie.
L’idolâtre vieux mari était l’esclave volontaire des moindres caprices de sa jeune et pétulante femme. Plus tard, quand la société paya un triple hommage à sa naissance, à sa beauté et à sa richesse, quelle qu’en fût la source, elle se vit l’objet de la même admiration servile de la part des prétendants qui se disputaient sa main.
Pour la première fois, elle rencontrait un homme ayant une volonté quand elle fit connaissance avec Geoffrey aux Cygnes.
L’occupation athlétique, qui absorbait alors Geoffrey, favorisa fort particulièrement ce conflit entre l’affirmation de l’influence de la femme et la volonté de l’homme.
Durant les jours qui s’étaient écoulés entre son retour à la maison de son frère et l’arrivée de son entraîneur, Geoffrey s’était soumis à tous les préliminaires de discipline physique qui devaient le préparer pour la course. Il savait, par une expérience antérieure, quels exercices il fallait prendre, quel nombre d’heures y consacrer, à quelles tentations résister à table. Maintes et maintes fois Mrs Glenarm avait essayé de l’entraîner à commettre des infractions à son régime, et chaque fois l’influence de la belle veuve sur les hommes, qui ne lui avait jamais failli, s’était vue impuissante et méprisée.
Rien de ce qu’elle pouvait dire, rien de ce qu’elle pouvait faire n’avait d’action sur Geoffrey. Perry arriva, et la résistance de Geoffrey à toutes les tentatives et à tous les moyens de tyrannie féminine devint plus outrageante et plus obstinée.
Mrs Glenarm était aussi jalouse de Perry que si celui-ci eût été une femme. Elle se mit en colère, elle fondit en larmes, elle fit la coquette avec d’autres hommes, elle menaça de quitter la maison. Tout cela en vain.
Jamais Geoffrey ne manquait un rendez-vous avec Perry.
Jamais il ne touchait à rien de ce qu’elle lui offrait au lunch, si cela lui était défendu par Perry.
Ah ! rien n’est plus dommageable à l’influence du beau sexe que les exercices athlétiques !
Pas d’hommes plus inaccessibles au pouvoir des femmes que ceux dont la vie se passe à développer leur force physique. Geoffrey résista à Mr Glenarm sans le plus léger effort.
Par moments, il arrachait son admiration et la forçait au respect. Elle s’attachait à lui comme à un héros ; elle se reculait loin de lui comme d’un animal ; elle luttait avec lui, elle se soumettait à lui, elle le méprisait et l’adorait tout à la fois.
L’explication de tout ce mélange de sentiments, quelque confus et contradictoire qu’il paraisse, gît dans ce seul mot : Mrs Glenarm avait trouvé son maître.
– Conduisez-moi au lac, Geoffrey, dit-elle avec une légère pression de sa main gantée de rose.
Geoffrey consulta de nouveau sa montre.
– Perry m’attend dans vingt minutes, dit-il.
– Encore Perry ?
– Oui.
Mrs Glenarm leva son éventail avec une explosion soudaine de fureur et le brisa d’un coup vigoureux sur le visage de Geoffrey.
– Là ! s’écria-t-elle en frappant la terre du pied. Mon pauvre éventail est en pièces, monstre, et c’est vous qui en êtes cause.
Geoffrey ramassa froidement les morceaux de l’éventail brisé et les mit dans sa poche.
– J’écrirai à Londres, dit-il, pour en avoir un autre. Allons ! un baiser et ne pensez plus à cela.
Il regarda autour de lui pour s’assurer qu’ils étaient seuls ; puis, la soulevant de terre, et elle était assez pesante, il la tint en l’air comme un bébé et lui donna un vigoureux baiser sur chaque joue.
– Avec mes meilleurs compliments, de tout cœur, dit-il. Il partit d’un éclat de rire et la reposa par terre.
– Comment osez-vous faire une chose pareille ? s’écria Mrs Glenarm ; je réclamerai la protection de Mr et Mrs Delamayn si je dois être insultée de la sorte. Je ne vous pardonnerai jamais, monsieur !
En disant cela, elle lui lança un regard qui était en flagrante contradiction avec ses paroles. Un moment après, elle était appuyée sur son bras et le regardait, avec surprise et pour la millième fois, comme une variété nouvelle qui bouleversait décidément l’expérience qu’elle avait des hommes.
– Comme vous êtes rude, Geoffrey ! dit-elle avec douceur.
Il sourit pour reconnaître cet hommage sans fard rendu à la mâle vertu de son caractère.
Elle vit le sourire et fit immédiatement un nouvel effort pour disputer à Perry son odieuse suprématie.
– Laissez-le de côté, murmura la fille d’Ève décidée à obtenir d’Adam qu’il mordît à la pomme. Allons, Geoffrey, cher Geoffrey, oubliez Perry cette fois ; conduisez-moi au lac.
Geoffrey, pour la troisième fois, consulta sa montre.
– Perry m’attend dans un quart d’heure, dit-il.
L’indignation de Mrs Glenarm revêtit une forme nouvelle. Elle fondit en larmes. Geoffrey la regarda pendant un moment, avec une expression de surprise, puis il la prit par les deux bras et la secoua.
– Réfléchissez ! Pouvez-vous me diriger dans mon entraînement ?
– Je voudrais le pouvoir.
– Ce n’est pas une réponse. Pouvez-vous me mettre en état de gagner cette course, oui ou non ?
– Non !
– Alors essuyez vos yeux et laissez faire Perry.
Mrs Glenarm essuya ses yeux et tenta un nouvel effort.
– Je ne suis plus en état de me montrer, dit-elle. Je suis si agitée… je ne sais que faire… Rentrons dans la maison et prenons une tasse de thé.
Geoffrey secoua la tête.
– Perry me défend le thé dans le milieu de la journée.
– Quelle brute ! s’écria Mrs Glenarm.
– Voulez-vous que je perde la course ? répliqua Geoffrey.
– Oui !
Sur cette réponse, elle le quitta et s’enfuit dans la maison.
Geoffrey fit un tour sur la terrasse, réfléchit un peu, s’arrêta et regarda le porche sous lequel la veuve irritée avait disparu à ses yeux.
« Dix mille livres de revenu, dit-il, en pensant aux avantages matrimoniaux qu’il mettait en péril. Et diablement bien gagnées », ajouta-t-il en rentrant dans la maison, en protestant pour apaiser Mrs Glenarm.
La dame offensée était sur un sofa, dans le salon solitaire. Geoffrey s’assit auprès d’elle. Elle refusa de le regarder.
– Ne soyez pas folle, dit Geoffrey de son ton le plus persuasif.
Mrs Glenarm porta son mouchoir à ses yeux. Geoffrey l’écarta sans cérémonie. Mrs Glenarm se leva pour quitter le salon ; Geoffrey l’arrêta de vive force. Mrs Glenarm menaça d’appeler les domestiques. Geoffrey répondit :
– Peu m’importe que toute la maison sache que je suis amoureux de vous.
Mrs Glenarm tourna les yeux vers la porte et murmura :
– Taisez-vous, pour l’amour de Dieu !
Geoffrey passa son bras sous le sien.
– Venez avec moi, dit-il, j’ai quelque chose à vous dire.
Mrs Glenarm recula et secoua la tête.
Geoffrey alors passa le bras autour de sa taille et l’entraîna. Une fois hors la maison, il prit la direction, non de la terrasse, mais d’une plantation de pins qui se trouvait de l’autre côté des jardins. Arrivé sous les arbres, il s’arrêta et, caressant le visage de la dame offensée, il lui dit :
– Vous avez juste la nature de femme que j’aime. Il n’y a pas un homme au monde qui puisse être de moitié aussi épris de vous que je le suis. Ne vous tourmentez pas au sujet de Perry et je vous permettrai de me voir faire un sprint.
Il recula d’un pas et fixa ses grands yeux bleus sur elle avec un regard qui semblait lui dire :
– Vous êtes une femme plus favorisée qu’aucune femme d’Angleterre.
À l’instant la curiosité prit la première place parmi les émotions de Mrs Glenarm.
– Qu’est-ce qu’un sprint, Geoffrey ? demanda-t-elle.
– Une sorte de course, pour essayer mon maximum de vitesse. Je ne laisserais pas une âme vivante, en Angleterre, assister à cela, excepté vous : maintenant suis-je encore une brute ?
Mrs Glenarm était reconquise. Elle dit avec douceur :
– Oh ! Geoffrey, si seulement vous étiez toujours comme cela !
Ses yeux se levèrent avec admiration sur ceux de l’athlète. Il reprit son bras, avec son consentement cette fois, et le pressa avec amour. Geoffrey sentait déjà les 10 000 livres de revenu dans sa poche.
– M’aimez-vous réellement ? murmura Mrs Glenarm.
– Qu’est-ce donc que d’aimer, si je ne vous aime pas ? répondit le héros.
La paix était faite et tous deux se remirent en marche.
Ils traversèrent la plantation et sortirent sur un petit terrain découvert et doucement accidenté. Puis à de légers monticules succédait une plaine unie, abritée, et bordée d’arbres qui cachaient un petit cottage.
Devant ce cottage, un petit homme trapu se promenait les mains derrière le dos. La plaine unie était le terrain d’exercice du héros, le cottage était la retraite du héros et le petit homme trapu était l’entraîneur du héros.
Si Mrs Glenarm haïssait Perry, Perry, à en juger sur les apparences, n’était pas en voie d’aimer Mrs Glenarm. Comme Geoffrey approchait avec sa compagne, l’entraîneur suspendit sa promenade et regarda la dame en silence.
La dame, au contraire, ne voulait point paraître remarquer que l’entraîneur existât et fût présent à cette scène.
– Combien ai-je encore de temps ? dit Geoffrey.
Perry consulta sa montre, fabriquée de façon à marquer les cinquièmes de seconde, et répondit à Geoffrey, sans détacher ses yeux de Mrs Glenarm.
– Vous avez encore cinq minutes.
– Montrez-moi votre course. Je meurs d’envie de voir cela, dit l’impatiente veuve, en pesant des deux mains sur le bras de Geoffrey.
Geoffrey la fit reculer jusqu’à une place marquée par un jeune arbre, auquel était attaché un drapeau, à une faible distance du cottage. Elle glissait à côté de lui avec une molle ondulation de mouvement qui paraissait exaspérer Perry. Il attendit qu’elle fût hors de la portée de sa voix. Alors il appela les foudres du ciel sur la tête de la fashionable Mrs Glenarm.
– Mettez-vous là, dit Geoffrey, en la plaçant près du petit arbre. Quand je passerai devant vous… ce sera, comme si j’étais un cheval, au grand galop. Ne m’interrompez pas, je n’ai pas fini. Vous devez me regarder, quand je vous quitterai, à l’endroit où le coin du mur de clôture du cottage coupe la ligne des arbres. Quand vous ne m’apercevrez plus derrière le mur, vous m’aurez vu courir la longueur de 3 miles, à partir de ce drapeau. Vous avez de la chance ! Perry m’essaie dans un long sprint, aujourd’hui. Vous comprenez bien… vous devez rester ici. Très bien ! Maintenant, permettez-moi de vous quitter et d’aller revêtir mon costume.
– Ne vous reverrai-je pas encore, Geoffrey ?
– Je viens de vous dire que vous me verrez courir.
– Oui, mais après ?
– Après, on m’épongera, on me frictionnera, et je me reposerai dans le cottage.
– Mais, nous vous verrons ce soir ?
Il fit de la tête un signe affirmatif et la quitta. Le visage de Perry avait une indicible expression quand Geoffrey et lui se rencontrèrent à la porte du cottage.
– J’ai une question à vous poser, Mr Delamayn, dit l’entraîneur. Avez-vous besoin de moi, oui ou non ?
– Comme de raison, j’ai besoin de vous.
– Que vous ai-je dit, quand je suis venu ici ? continua Perry d’un ton sévère. Je vous ai dit… que je voulais que personne ne vît un homme que j’entraînais. Ces dames et ces messieurs qui sont ici ont mis dans leur tête de vous voir. Moi, j’ai mis dans ma tête de n’avoir pas de spectateurs. Je veux que votre travail ne soit contrôlé que par moi. Je n’entends pas que chaque bienheureux yard que vous parcourez soit noté dans les journaux. Pas une âme ne doit savoir ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Vous ai-je dit cela, Mr Delamayn, ou ne vous l’ai-je pas dit ?
– Très bien !
– L’ai-je dit ou ne l’ai-je pas dit ?
– Vous l’avez dit.
– Alors, n’amenez plus de femme ici. C’est manifestement contraire à nos conventions, je ne veux pas de cela.
Toute autre créature vivante, le prenant sur un semblable ton, aurait eu probablement à s’en repentir. Mais Geoffrey avait peur de montrer son caractère en présence de Perry. Le premier entre tous les entraîneurs anglais n’était pas un personnage que pût traiter légèrement même le premier athlète de l’Angleterre.
– Elle ne reviendra plus, dit Geoffrey, elle quitte les Cygnes dans deux jours.
– J’ai mis tout ce que je possède, jusqu’au dernier shilling, sur vous, poursuivit Perry d’un ton plus doux. Cela me brise le cœur, quand je vous vois arriver avec une femme sur vos talons. C’est une trahison envers ceux qui vous soutiennent. Oui, monsieur, c’est une trahison envers ceux qui parient pour vous.
– Ne parlons plus de cela, dit Geoffrey, et venez m’aider à vous gagner votre argent.
Il ouvrit la porte du cottage d’un coup de poing, et l’athlète et l’entraîneur disparurent.
Après une attente de quelques minutes, Mrs Glenarm vit les deux hommes s’avancer vers elle. Vêtu d’un costume collant, léger, élastique, s’adaptant à tous les mouvements et répondant aux exigences de l’exercice auquel il allait se livrer, les avantages physiques de Geoffrey s’offraient sous leur aspect le plus beau.
Sa tête était bien posée sur son cou d’une blancheur éclatante, sa puissante poitrine aspirait l’air embaumé de l’été, et ses jambes musculeuses, d’une admirable forme, étaient le triomphe même de la beauté mâle, dans son type le plus parfait.
Mrs Glenarm le dévorait des yeux dans une muette admiration. Elle croyait voir un demi-dieu de la fable, une statue antique animée, avec la couleur et la vie.
– Oh ! Geoffrey !… s’écria-t-elle tout bas quand il arriva près elle.
Il ne lui répondit ni ne la regarda ; il avait bien autre chose à faire que d’écouter de niaises fadeurs.
Il se rassemblait pour l’effort qu’il avait à accomplir, ses lèvres étaient serrées, ses poings légèrement contractés. Perry le mit à sa place, en silence, le visage sévère, la montre à la main.
Geoffrey fit quelques pas au-delà du drapeau pour se donner plus d’élan. Il voulait avoir atteint la plus grande vitesse de sa course quand il passerait devant la veuve.
– Partez ! dit Perry.
Un instant après, il passait devant Mrs Glenarm comme une flèche lancée par une arbalète. Son action était parfaite. Son allure, à ce haut degré de vitesse, conservait des éléments constitutifs de force et de fermeté.
Il courait et devenait plus petit pour les yeux qui le suivaient, toujours franchissant l’espace avec légèreté, toujours gardant la ligne droite. Un moment encore, et le beau coureur s’évanouit derrière le mur du cottage. La montre de l’entraîneur alla reprendre sa place dans son gousset.
Dans son impatience de savoir le résultat de cette course, Mrs Glenarm oublia sa jalousie contre Perry.
– Combien a-t-il mis de temps ? demanda-t-elle.
– Bien d’autres que vous seraient heureux de le savoir, riposta Perry.
– Mr Delamayn me le dira, homme grossier !
– Cela dépend de la question de savoir si je le lui dirai à lui-même.
Sur cette réponse, Perry se hâta de rentrer au cottage.
Pas un mot ne fut échangé pendant que l’entraîneur donnait ses soins à son homme et pendant que l’homme reprenait son haleine. Quand Geoffrey fut bien et dûment frictionné et qu’il eut repris ses vêtements habituels, Perry avança un fauteuil. Geoffrey y tomba plutôt qu’il ne s’y assit.
Perry fit un soubresaut et le regarda attentivement.
– Eh bien, dit Geoffrey, et la question de temps : long, court, ou moyen ?
– Très bon temps, dit Perry.
– Combien ?
– Quand m’avez-vous dit que partait cette dame, Mr Delamayn ?
– Dans deux jours.
– Très bien, monsieur. Je vous dirai combien vous avez mis de temps quand la dame sera partie.
Geoffrey n’insista pas pour obtenir une réponse immédiate. Il sourit. Après un intervalle de moins de dix minutes, il étendit ses jambes, et ses yeux se fermèrent.
– Vous allez dormir ? dit Perry.
Geoffrey rouvrit les yeux avec effort.
– Non, dit-il.
À peine le mot était-il sorti de ses lèvres que ses yeux se fermèrent de nouveau.
– Holà ! dit Perry en l’observant. Je n’aime pas cela.
Il se rapprocha du fauteuil. Il n’y avait pas de doute possible, l’homme était endormi.
Perry sifflota entre ses dents, se baissa et posa doucement deux doigts sur le pouls de Geoffrey. Les battements étaient lents, lourds, pénibles ; c’était évidemment le pouls d’un homme épuisé.
L’entraîneur changea de couleur et fit un tour dans la chambre. Il ouvrit une armoire et y prit son journal de l’année précédente.
Les notes relatives à la dernière préparation à laquelle il avait soumis Geoffrey pour une course à pied entraient dans les plus grands détails. Il se reporta à la première épreuve d’une course de 300 yards à toute vitesse.
Quant au temps, il s’en fallait de quelques secondes que cette épreuve eût été aussi bonne que cette fois. Mais les résultats ultérieurs étaient bien différents. Perry avait alors écrit de sa main :
« Pouls bon. L’homme en parfaite disposition. Prêt, si j’avais voulu le lui permettre, à courir une seconde fois. »
Perry regarda le même homme, épuisé au bout d’un an et profondément endormi dans ce fauteuil.
Il prit dans l’armoire une plume, de l’encre et du papier, et écrivit deux lettres. Toutes deux portaient la mention : Particulière.
La première était pour un médecin jouissant d’une grande autorité parmi les entraîneurs.
La seconde était pour son agent à Londres.
Cette seconde lettre recommandait à l’agent le plus strict secret et contenait pour instruction de parier contre Geoffrey pour une somme égale à celle qu’il avait pariée pour lui.
« Si vous avez mis personnellement de l’argent sur lui, disait la lettre en concluant, faites ce que je fais, couvrez-vous et retenez votre langue. »
« Encore un d’usé, dit l’entraîneur en se retournant une dernière fois pour regarder l’homme endormi. Il perdra la course ! »
36 SEMENCES DE L’AVENIR (2e SEMENCE)
Qu’est-ce que les visiteurs dirent des cygnes ?
Ils dirent :
– Oh ! quelle quantité de cygnes !
Que pouvaient trouver de mieux des personnes ignorant l’histoire naturelle et les mœurs des oiseaux aquatiques ? Qu’est-ce que les visiteurs dirent du lac ? Quelques-uns d’entre eux s’écrièrent :
– Comme c’est solennel !
D’autres dirent :
– Que c’est romantique !
La plupart ne dirent rien, mais pensèrent que c’était un spectacle assez ennuyeux.
Or, le lac était encaissé dans un bois de sapins. L’eau était noire et immobile sous l’ombrage épais des arbres. La seule percée qui existât dans le bois de sapins se trouvait à l’extrémité du lac. Le seul signe de mouvement et de vie était le sillon tracé par le passage des cygnes glissant à la surface de l’eau. C’était solennel, c’était romantique, comme on l’avait dit ; c’était ennuyeux aussi, comme on l’avait pensé. Des pages entières de descriptions n’en diraient pas davantage. Laissons donc les descriptions briller ici par leur absence.
Après s’être rassasiée des cygnes et du lac, la curiosité générale en revint à la percée dans les arbres, et remarqua au loin un objet artificiel qui s’introduisait en scène sous la forme d’un grand rideau rouge suspendu entre deux des plus grands pins et interceptant la vue.
On demanda des explications à Julius Delamayn ; il répondit que le mystère serait dévoilé à l’arrivée de sa femme avec le reste de la compagnie attardée dans la visite de la maison.
Dès l’apparition de Mrs Delamayn et des retardataires, toute la société se trouvant réunie suivit le bord du lac et vint s’arrêter en face du rideau. Désignant les cordons de soie qui pendaient des deux côtés du rideau, Julius Delamayn envoya deux petites filles (enfants de la sœur de sa femme) pour tirer ces cordons bienheureux. Les enfants s’acquittèrent de cette mission avec un empressement curieux ; le rideau s’ouvrit ; un cri de surprise et de ravissement salua le tableau qui s’offrait aux regards.
Au bout d’une large avenue de pins, une pelouse étendait son vert tapis de gazon environné de grands arbres. À l’extrémité de la pelouse, le terrain s’élevait ; du pied de la première colline une source d’eau vive s’échappait en bouillonnant entre des roches de granit.
Au bord de la pelouse, à gauche, une rangée de tables, couvertes de nappes blanches et de rafraîchissements de toute espèce étaient dressées pour les hôtes. Sur le côté opposé, un orchestre fit éclater l’harmonie dès que le rideau se fut ouvert.
En regardant en arrière dans l’avenue des pins, on apercevait au loin le lac, dont les eaux étaient maintenant éclairées par le soleil, et l’on voyait resplendir le plumage blanc des cygnes.
Telle était la charmante surprise que Julius Delamayn avait ménagée à ses hôtes. Ce n’était que dans des occasions semblables, ou bien lorsque, avec sa femme, il jouait des sonates dans le modeste salon de musique des Cygnes, que le fils aîné de lord Holchester se trouvait réellement heureux.
Il gémissait secrètement des devoirs que sa position de grand propriétaire lui imposait ; il souffrait des hauts privilèges de son rang ; c’était un martyr social.
– Nous dînerons d’abord, dit-il ; nous danserons après. Voilà le programme.
Il ouvrit la marche vers les tables, menant les deux dames qui se trouvaient le plus près de lui, sans s’inquiéter si elles étaient ou n’étaient pas de la condition la plus élevée parmi les personnes présentes. Au grand étonnement de lady Lundie, il prit les premiers sièges qui se présentèrent sans paraître s’occuper de la place qu’il devait occuper lui-même à sa propre table. Les hôtes suivirent son exemple et s’assirent aux places qui leur plurent, sans tenir compte des questions de préséance et de rang.
Mrs Delamayn, qui se sentait un attrait tout particulier pour la jeune personne qui allait devenir une femme, prit le bras de Blanche ; lady Lundie s’attacha résolument à son hôtesse.
Toutes trois s’assirent côte à côte. Mrs Delamayn fit de son mieux pour encourager Blanche à parler ; Blanche fit de son mieux pour répondre à ces gracieuses avances. L’expérience réussit médiocrement des deux parts. Mrs Delamayn y renonça en désespoir de cause et se retourna du côté de lady Lundie.
Elle soupçonnait que quelque sujet de réflexion désagréable obsédait en ce moment l’esprit de la jeune fiancée. En quoi elle jugeait sainement. Le petit emportement de Blanche contre son amie sur la terrasse, et le manque de gaieté et d’entrain de miss Lundie devaient être attribués à la même cause.
Blanche le cachait à son oncle, elle le cachait à Arnold, mais elle était aussi inquiète que jamais au sujet d’Anne ; et elle ne cessait point d’épier, quoique pût dire ou faire sir Patrick, la première occasion de se remettre à la recherche de son amie.
Cependant, on buvait, on mangeait, on causait gaiement. L’orchestre exécutait ses plus vives mélodies. Les domestiques tenaient les verres toujours pleins ; la bonne humeur et la liberté régnaient autour de la table.
La seule conversation qui se poursuivît péniblement était celle qui avait lieu près de Blanche, entre sa belle-mère et Mrs Delamayn.
Parmi les qualités qui distinguaient lady Lundie, la faculté de faire de désagréables découvertes tenait la première place. Or, au dîner, sur la pelouse, elle avait réfléchi que personne ne remarquait l’absence du beau-frère de la maîtresse de la maison, ni, chose plus surprenante encore, la disparition d’une dame qui résidait actuellement dans la maison, en un mot, de Mrs Glenarm.
– Me suis-je trompée ? dit Sa Seigneurie, en portant son lorgnon à ses yeux et en promenant son regard tout autour de la table. Bien certainement quelqu’un nous manque… je ne vois pas Mr Geoffrey Delamayn.
– Geoffrey avait promis de venir, mais il n’est pas très exact à tenir les engagements de ce genre. Tout est sacrifié à son entraînement. Nous ne le voyons plus qu’à de rares intervalles.
Sur cette réponse, Mrs Delamayn essaya de changer de sujet. Lady Lundie reprit son lorgnon.
– Pardonnez-moi, insista Sa Seigneurie, mais je crois avoir découvert une autre absence. Je ne vois pas Mrs Glenarm. Pourtant, elle devrait être ici ! Mrs Glenarm ne se fait pas entraîner pour une course. La voyez-vous ? Pour moi, je ne la vois pas.
– Je l’ai perdue de vue quand nous sommes sortis sur la terrasse, et je ne l’ai pas aperçue depuis.
– N’est-ce pas fort étrange, chère Mrs Delamayn ?
– Nos hôtes aux Cygnes, lady Lundie, ont l’entière liberté de faire ce qui leur plaît.
Sur ces mots, Mrs Delamayn se figura follement avoir coupé court sur ce sujet.
Mais la robuste curiosité de lady Lundie ne se rendait pas aux indications de cette nature. La gaieté de ceux qui entouraient Sa Seigneurie la gagna probablement et la fit sortir de sa réserve accoutumée. Vous vous refuserez peut-être à y croire, mais il n’en est pas moins vrai que cette femme majestueuse sourit.
– Essaierons-nous de faire un rapprochement ? dit lady Lundie, avec une rare lourdeur de badinage. D’un côté nous avons Mr Geoffrey Delamayn… un jeune homme. De l’autre, Mrs Glenarm… une jeune veuve. Le rang du côté du jeune homme, la fortune, du côté de la veuve… Tous deux sont mystérieusement absents, au même moment, d’une agréable partie. Ah ! Mrs Delamayn ! Est-ce que je ne devinerais pas juste, si je prédisais qu’il y aura bientôt, aussi, un mariage dans votre famille ?
Mrs Delamayn parut un peu contrariée. Elle était entrée de tout cœur dans la conspiration qui devait amener un mariage entre Geoffrey et Mrs Glenarm. Mais elle n’était pas du tout préparée à avouer que la facilité de la dame avait fait réussir la conspiration dans le court espace de dix jours.
– Je ne suis pas dans la confidence de la dame et du gentleman dont vous parlez, répliqua-t-elle sèchement.
Un corps pesant est toujours lent à se mouvoir, mais une fois le mouvement imprimé, on ne peut plus l’arrêter. La gaieté de lady Lundie, étant essentiellement pesante, subissait la même loi. Elle persista dans sa plaisanterie.
– Quelle réponse diplomatique ! s’écria Sa Seigneurie. Je crois néanmoins en avoir trouvé l’interprétation. Un petit oiseau m’a dit que je verrais une Mrs Delamayn à Londres, à la saison prochaine. Et quant à moi je ne serais pas surprise d’avoir à adresser mes félicitations à Mrs Glenarm.
– Si vous persistez à donner carrière à votre imagination, lady Lundie, je n’y puis rien. Je ne puis que vous demander la permission de tenir la mienne en réserve.
Cette fois, lady Lundie comprit qu’il serait mieux de n’en pas dire davantage ; elle sourit et inclina la tête en signe d’assentiment. Si on lui avait demandé en ce moment quelle était la dame la plus remarquable de l’Angleterre, elle aurait demandé un miroir pour y voir se réfléchir le visage de lady Lundie, de Windygates.
Au moment où la conversation s’engageait auprès d’elle sur Geoffrey Delamayn et Mrs Glenarm, Blanche sentit une forte odeur de liqueurs spiritueuses qui l’enveloppait, qui paraissait souffler derrière elle, et qui passait par-dessus sa tête. L’odeur devenant de plus en plus intolérable, elle se retourna pour voir si l’on ne fabriquait point des grogs derrière sa chaise.
Deux mains tremblantes et goutteuses s’avancèrent, lui offrant d’un pâté de grouses abondamment garni de truffes…
– Eh ! ma charmante demoiselle, murmura à son oreille une voix persuasive, vous vous laissez mourir de faim en pays de cocagne. Acceptez mon conseil et prenez ce qu’il y a de meilleur sur la table. Une tranche de ce pâté de grouses aux truffes.
Blanche leva les yeux.
Près d’elle était l’homme aux yeux clignotants, aux manières paternelles, au nez énorme…, Bishopriggs enfin, conservé dans l’alcool, et prêtant son ministère à la fête des Cygnes.
Blanche ne l’avait vu qu’un moment pendant la nuit mémorable où elle était venue surprendre Anne à l’auberge. Mais quelques instants passés dans la société de Bishopriggs valaient bien des heures passées dans la société d’un homme moins remarquable. Blanche le reconnut à l’instant.
Et à l’instant aussi lui vint à l’esprit l’opinion de sir Patrick, à savoir que Bishopriggs était en possession de la lettre perdue par Anne. Elle arriva donc aussitôt à cette conclusion, qu’en découvrant Bishopriggs elle avait découvert une chance de retrouver la trace d’Anne.
Son premier mouvement fut de lui montrer sur l’heure qu’elle le reconnaissait, mais les yeux de ses voisins, fixés sur elle, lui firent comprendre qu’il valait mieux attendre. Elle prit un peu de pâté et regarda fixement Bishopriggs. Il la salua respectueusement et continua de faire le tour de la table.
– A-t-il la lettre sur lui ? se demandait Blanche.
Non seulement il avait la lettre sur lui, mais bien plus, il était en ce moment en quête des moyens de tirer de cette lettre un bon profit.
L’établissement des Cygnes ne comportait pas une nombreuse domesticité. Quand Mrs Delamayn avait beaucoup de monde, elle demandait l’assistance dont elle avait besoin, partie en mettant ses amis à contribution, partie à la principale auberge de Kirkandrew.
Justement Bishopriggs, qui servait momentanément et dans l’attente d’un meilleur emploi, comme surnuméraire à l’auberge de Kirkandrew, lui avait été envoyé avec d’autres garçons dont le service n’était pas indispensable à l’auberge.
Le nom du gentleman chez lequel il devait servir le frappa comme un nom qui lui était familier. Il s’était renseigné ; il avait demandé un supplément d’informations à la lettre ramassée sur le plancher dans le petit salon de Craig Fernie.
La feuille perdue par Anne contenait, on doit se le rappeler, deux lettres, l’une signée par Anne elle-même, l’autre signée par Geoffrey. L’une et l’autre devaient suggérer à l’étranger sous les yeux duquel elles passaient l’idée de relations entre les deux personnes qui les avaient écrites, relations qu’ils avaient intérêt à cacher tous les deux.
Pensant qu’il était possible, s’il gardait ses oreilles et ses yeux bien ouverts aux Cygnes, de trouver une occasion de tirer parti de la correspondance volée, Bishopriggs avait mis la lettre dans sa poche en partant de Kirkandrew.
Il avait reconnu Blanche, comme une amie de la dame de l’auberge et comme une personne qui, en cette qualité, pouvait lui faire gagner plus d’une livre. De plus, il n’avait pas perdu un mot de la conversation entre lady Lundie et Mrs Delamayn, au sujet de Geoffrey et de Mrs Glenarm.
Plusieurs heures encore devaient s’écouler avant que les hôtes se retirassent et que les domestiques pris en supplément fussent congédiés. Bishopriggs ne doutait point qu’il aurait tout lieu de se féliciter de la chance qui l’avait associé aux fêtes données aux Cygnes.
Il était encore de bonne heure dans l’après-midi, et la gaieté qui régnait autour de la table menaçait déjà de se lasser.
Les plus jeunes membres de la société, les dames spécialement, commençaient à paraître impatients de ne point voir le dessert. Elles jetaient des regards d’envie vers le terrain uni et favorable qui s’étendait au milieu de la clairière. Elles battaient distraitement la mesure quand il arrivait aux musiciens d’exécuter une valse.
Mrs Delamayn, remarquant ces symptômes, donna l’exemple en se levant de table, et son mari envoya un message au chef d’orchestre. Dix minutes après, le premier quadrille était en danse.
Les spectateurs, groupés d’une façon pittoresque, regardaient les danseurs ; et les domestiques dont le service n’était plus nécessaire s’étaient retirés pour collationner à leur tour.
Le dernier qui abandonna les tables désertées fut le vénérable Bishopriggs.
Seul, parmi les hommes de service, il avait voulu se donner un air de zèle qui s’arrangeait avec la satisfaction clandestine de ses projets. Au lieu de se précipiter vers le dîner avec les autres domestiques, il resta sous le prétexte d’enlever les miettes de pain qui remplissaient les verres.
Absorbé par cette occupation intéressante, il tressaillit à la voix d’une dame qui parlait derrière lui, et en se retournant aussi vivement que cela lui était possible, il se trouva en face de miss Lundie.
– Je voudrais un verre d’eau froide, dit Blanche. Soyez assez bon pour m’en aller emplir un à la source.
Elle montrait du doigt le petit ruisseau qui sortait en bouillonnant des rochers, à l’extrémité de la clairière.
Bishopriggs laissa voir une horreur qui n’avait rien de simulé.
– Pour l’amour du ciel, mademoiselle, s’écria-t-il, voulez-vous réellement offenser votre estomac avec de l’eau froide, quand pour avoir de bon vin, il n’y a ici qu’à demander ?
Blanche lui lança un coup d’œil. La lenteur à comprendre n’était pas précisément le défaut de Bishopriggs. Il prit un verre, cligna, lui aussi, de son bon œil, et ouvrit la marche vers la source.
En vérité, il était bien naturel de voir une jeune personne désirant un verre d’eau et un domestique allant le lui chercher. Personne donc ne fut surpris ; le bruit de l’orchestre empêchait que personne n’entendît ce qui allait se dire près de la source.
– Vous rappelez-vous de m’avoir vue à l’auberge le soir de l’orage ? demanda Blanche.
Bishopriggs avait ses raisons soigneusement renfermées dans son portefeuille pour ne pas montrer une mémoire trop prompte.
– Je ne dis pas non, répondit-il. On ne doit se rappeler que trop aisément votre personne, mademoiselle. Quel est l’homme qui pourrait faire une autre réponse à une charmante jeune dame comme vous ? Cependant…
Afin d’aider ses souvenirs, Blanche tira sa bourse. Bishopriggs s’absorba dans la contemplation du paysage. Il regarda couler l’eau de l’air d’un homme qui entretient une invincible méfiance contre ce liquide aimé des méchants.
– Vous voilà parti, dit-il, en s’adressant à ce ruisseau ; vous coulez en murmurant jusqu’à ce que vous alliez vous perdre dans le lac. On dit que vous êtes l’image de la vie humaine. Je porte témoignage contre cette pensée. Vous n’êtes l’image de rien du tout ; vous ne valez rien ; jusqu’à ce que vous ayez été chauffé, adouci avec du sucre et renforcé avec du whisky, alors vous êtes changé en grog, etc.
– J’ai bien plus entendu parler de vous depuis le jour où je suis allée à l’auberge que vous ne pouvez supposer, reprit Blanche en ouvrant sa bourse, et Bishopriggs devint tout attention. Vous avez été bon, très bon pour une dame qui s’était arrêtée à l’auberge de Craig Fernie. Je sais que vous avez perdu votre place à cause des attentions que vous aviez eues pour cette dame. Elle est ma meilleure amie, Mr Bishopriggs. J’éprouve le besoin de vous remercier et je vous remercie. Je vous en prie, acceptez cela.
Tout le cœur de la jeune fille avait passé dans ses yeux et dans sa voix, quand elle vida sa bourse dans les vieilles mains goutteuses de Bishopriggs. Une jeune fille ayant sur elle une bourse bien garnie, quelque riche qu’elle puisse être, est une chose qui se voit rarement dans toutes les contrées du monde civilisé ; soit que l’argent ait été dépensé, soit qu’on l’ait oublié à la maison sur la table de toilette. La bourse de Blanche contenait un souverain et six ou sept shillings.
Comme argent de poche d’une héritière, c’était misérable ; mais comme gratification offerte à Bishopriggs, c’était magnifique. Le vieux drôle empocha l’argent d’une main, et de l’autre essuya une larme absente.
– Jetez votre pain à l’eau, s’écria Bishopriggs, en levant son bon œil vers les cieux d’un air dévot, et vous le retrouverez après de longs jours. Oh ! ne me suis-je pas dit, la première fois que j’ai jeté les yeux sur cette pauvre dame, que je me sentais pour elle les sentiments d’un père ? C’est merveilleux comme les bonnes actions se découvrent toujours dans ce bas monde. Si jamais la voix de l’affection a parlé à mon cœur, poursuivit Bishopriggs, les yeux fixés sur Blanche, c’est lorsque cette infortunée créature a levé son premier regard sur moi. Serait-il possible qu’elle vous ait dit les petits services que j’ai été à même de lui rendre, quand j’étais dans cet hôtel ?
– Oui. C’est elle-même qui m’a dit tout cela.
– Puis-je pousser la hardiesse jusqu’à vous demander où elle est à présent ?
– Je ne le sais pas, Mr Bishopriggs. C’est ce qui me rend malheureuse. Elle est partie, et je ne sais où elle est allée.
– Oh ! oh ! C’est mal ! Et son petit mari, qui est resté pendu à son cou tout un soir et qui s’est évanoui dès le point du jour le lendemain matin, sont-ils partis ensemble tous deux ?
– Je ne sais rien de lui ; je ne l’ai jamais vu. Mais vous, qui l’avez vu, dites-moi, comment est-il ?
– Eh ! c’était une pauvre faible créature, incapable d’apprécier un bon verre de sherry qu’on lui offrait, mais la main ouverte pour l’argent. Oh ! oui, vous pouvez dire de lui qu’il n’est pas avare !
Blanche jugea qu’il serait impossible de tirer de Bishopriggs une description plus claire de l’homme qui était demeuré une nuit avec Anne à l’auberge. Elle en arriva tout de suite au principal objet de l’entretien. Trop impatiente pour perdre du temps en circonlocutions, elle allait amener à l’instant la conversation sur le sujet délicat de la lettre.
– J’ai encore quelque chose à vous dire, reprit-elle. Mon amie a perdu quelque chose pendant son séjour à l’auberge.
Les derniers doutes s’évanouirent dans l’esprit de Bishopriggs. L’amie de la dame connaissait l’histoire de la lettre perdue, et bien mieux encore, elle paraissait souhaiter d’avoir cette lettre.
– Aïe, aie ! dit-il avec une apparente insouciance ; c’est assez probable ! La maîtresse de l’auberge de là-bas a fait des histoires, depuis que je l’ai quittée. Que pouvait bien avoir perdu la dame ?
– Une lettre.
Un air d’inquiétude reparut dans les yeux de Bishopriggs. C’était une question et une question sérieuse, à son point de vue, que de savoir si quelque soupçon de vol s’attachait à la perte de la lettre.
– Quand vous dites perdue, demanda-t-il, ne voulez-vous pas dire volée ?
Blanche comprit bien vite la nécessité de le rassurer sur ce point.
– Oh ! non, répondit-elle, pas volée, seulement perdue. Qu’avez-vous entendu dire à ce sujet ?
– Pourquoi aurais-je entendu dire quelque chose ?
Il regardait Blanche bien en face et remarqua un moment d’hésitation sur son visage.
– Dites-le-moi, ma jeune dame, reprit-il, en avançant prudemment vers le point difficile. Quand vous cherchez des nouvelles de cette lettre, qui vous engage à vous adresser à moi ?
Ces mots étaient décisifs. On peut dire que l’avenir de Blanche dépendait de la réponse qu’elle allait faire.
Si elle avait eu de l’argent et si elle avait répondu hardiment : « Vous avez la lettre, Mr Bishopriggs ; je vous donne ma parole qu’aucune question ne vous sera faite à ce sujet, et je vous offre dix livres sterling », il est probable que le marché eût été conclu sur l’heure. Le cours des événements en eût été changé.
Mais il ne lui restait plus une obole, elle n’avait pas d’amis, dans le cercle réuni aux Cygnes, à qui elle pût s’adresser, sans crainte d’une fausse interprétation, pour demander de lui prêter dix livres, sous le sceau du secret.
Sous la contrainte de la dure nécessité, Blanche abandonna donc tout espoir de faire utilement appel à la confiance de Bishopriggs.
Un autre moyen d’arriver à son but, qui se présenta à son esprit, fut de se faire une arme du nom de sir Patrick.
Un homme placé dans la position où elle était n’aurait pas commis cette folie ; mais Blanche, qui avait déjà sur la conscience un premier acte imprudent, fit comme toutes les femmes exaltées, et rien ne l’empêcha d’en commettre un autre.
La même impatience d’arriver à son but, qui l’avait déjà poussée à questionner Geoffrey, avant son départ de Windygates, la conduisit, avec aussi peu de réflexion, à mettre Bishopriggs en garde contre l’habileté de sir Patrick.
Elle n’écouta que son ardent amour fraternel, qui la rendait avide de retrouver la trace d’Anne. Son cœur lui disait d’en courir le risque ; elle le fit.
– Sir Patrick m’a donné l’idée de m’adresser à vous, dit-elle.
Les mains de Bishopriggs, qui s’ouvraient déjà pour lâcher la lettre et recevoir sa récompense, se refermèrent à l’instant même.
– Sir Patrick ? répéta-t-il. Ah ! ah ! vous avez déjà parlé de cela à sir Patrick, n’est-ce pas ? C’est un homme qui a sur les épaules une tête bien organisée, s’il en fût jamais. Que peut vous avoir dit sir Patrick ?
Blanche remarqua ce changement dans le ton de Bishopriggs. Blanche prit le plus grand soin, mais il était trop tard, de veiller sur les termes de sa réponse.
– Sir Patrick a pensé que vous pouviez avoir trouvé la lettre et ne vous l’être rappelé qu’après avoir quitté l’auberge.
Bishopriggs évoqua l’expérience qu’il avait de son ancien patron et arriva aisément à une exacte conclusion. Sir Patrick soupçonnait qu’il était l’auteur de la disparition de cette lettre.
« Le vieux diable, se dit-il, me connaît bien ! »
– Dites-moi, demanda Blanche avec impatience, sir Patrick a-t-il deviné juste ?
– Juste ! répliqua vivement Bishopriggs. Il est aussi loin de la vérité qu’Édimbourg l’est de Jéricho.
– Vous ne savez rien qui concerne la lettre ?
– Absolument rien. Les premiers mots que j’ai entendus à ce sujet sont ceux que vous me dites en ce moment.
Le cœur de Blanche cessa de battre dans sa poitrine. Avait-elle fait une fausse manœuvre et coupé le terrain sous les pieds de sir Patrick, pour la seconde fois ?
Certainement non !
Il y avait encore une chance pour que cet homme consentît à révéler à son oncle ce qu’il était trop prudent pour confier à une jeune personne comme elle, qui lui était étrangère.
La seule bonne chose à faire en ce moment était de préparer les voies à l’influence et à l’astuce de sir Patrick. Elle reprit la conversation.
– Je suis désolée que mon oncle n’ait pas deviné juste, dit-elle, mon amie était bien préoccupée du désir de retrouver sa lettre, quand je la vis pour la dernière fois, et j’espérais que vous m’en donneriez des nouvelles. Quoi qu’il en soit, qu’il ait bien ou mal deviné, sir Patrick a le désir de vous voir et je profite de l’occasion pour vous l’apprendre. Il a même laissé une lettre pour vous à l’auberge de Craig Fernie.
– Cette lettre pourra rester longtemps à l’auberge, si elle attend que j’y retourne pour la chercher.
– En ce cas, dit Blanche vivement, ce que vous avez de mieux à faire, c’est de m’indiquer une adresse à laquelle sir Patrick puisse vous écrire. Vous ne voudriez pas, je suppose, que je lui dise vous avoir vu ici, et lui donner lieu de penser que vous refusez de le voir.
– Oh ! non ! non ! s’écria Bishopriggs avec chaleur. S’il existe une chose au monde à laquelle je tiens entre toutes, c’est à garder le respect que je dois à sir Patrick. J’oserai prendre la liberté, mademoiselle, de vous charger de cette carte. Je n’ai pas encore de place fixe. Triste chose à mon âge ! Mais sir Patrick aura toujours à cette adresse des nouvelles de moi, si cela lui est nécessaire.
Il tendit à Blanche une petite carte crasseuse où étaient inscrits le nom et l’adresse d’un boucher d’Édimbourg.
– Samuel Bishopriggs, lut-il vivement, aux soins de O’Davie, boucher, Cowgate, Édimbourg.
Blanche reçut cette carte avec un invincible sentiment de soulagement. Si elle s’était encore une fois aventurée à prendre la place de sir Patrick, et si sa témérité n’avait pas été justifiée par le résultat, elle avait du moins obtenu un avantage, celui d’ouvrir les moyens de communication entre son oncle et Bishopriggs.
– Vous entendrez parler de sir Patrick, dit-elle.
Puis elle le salua avec bonté et alla reprendre sa place parmi les hôtes.
« J’entendrai parler de sir Patrick ? répéta Bishopriggs quand il fut seul. Sir Patrick fera un grand miracle s’il trouve Samuel Bishopriggs. »
Il sourit à son habileté et se retira dans un endroit écarté, au milieu des arbres, où il pouvait consulter la correspondance volée, sans crainte d’être observé par âme qui vive.
Une fois encore la vérité avait essayé de venir au jour, avant le mariage, et une fois encore, Blanche l’avait innocemment replongée dans les ténèbres.
37 SEMENCES DE L’AVENIR (3e SEMENCE)
Après une nouvelle lecture attentive de la lettre d’Anne à Geoffrey et de celle de Geoffrey à Anne, Bishopriggs s’étendit confortablement sous un arbre et se donna la tâche d’envisager nettement sa position.
Tirer profit de la correspondance en en disposant en faveur de Blanche n’était plus chose possible.
Quant à traiter avec sir Patrick, Bishopriggs se détermina à rester invisible aussi bien à Cowgate, dans Édimbourg, qu’à l’auberge de Mrs Inchbare, tant qu’il aurait les plus faibles chances de sauvegarder ses intérêts en s’adressant ailleurs.
Personne au monde n’était, en effet, plus capable de lui soutirer cette précieuse correspondance, dans des conditions d’un marché ruineux, que son ancien patron.
« Je ne me mettrai pas dans les pattes de sir Patrick, pensa Bishopriggs, avant d’avoir fait ma tournée dans d’autres quartiers. »
Ce qui revenait à dire que sa résolution était de ne se mettre en communication avec sir Patrick qu’après avoir essayé d’entrer en négociations avec d’autres personnes également intéressées à être mises en possession de la lettre et plus disposées à la bien payer.
Quelles étaient ces autres personnes ?
Il n’avait qu’à se rappeler la conversation qu’il venait d’entendre entre lady Lundie et Mrs Delamayn, pour arriver à la découverte de l’une d’elles.
Mr Geoffrey Delamayn était sur le point d’épouser une dame nommée Mrs Glenarm. Et ce même Geoffrey Delamayn était en correspondance matrimoniale, il n’y avait guère plus de quinze jours, avec une autre dame qui signait du nom d’Anne Sylvestre.
Quelle que pût être la position de ce jeune homme entre ces deux femmes, son intérêt à être nanti de la correspondance était évident. Il était également clair que la première chose à faire, pour Bishopriggs, était de trouver les moyens d’avoir un entretien particulier avec Geoffrey.
Si cet entretien n’amenait pas d’autre résultat, il déciderait au moins une importante question qui était encore à résoudre. La dame que Bishopriggs avait servie à Craig Fernie devait bien être Anne Sylvestre. Dans ce cas, Mr Geoffrey Delamayn était-il le gentleman qui s’était fait passer pour son mari à l’auberge ?
Bishopriggs se remit sur ses pieds goutteux avec toute la vivacité dont il était susceptible, et partit pour prendre les renseignements qui lui étaient nécessaires. Pour cela, il s’adressa non aux domestiques mâles qui avaient servi à table, mais aux femmes qui étaient restées à la besogne dans la maison.
Il obtint facilement les indications nécessaires pour trouver le cottage. Mais on le prévint en même temps que l’entraîneur ne permettait à personne d’être présent à ses exercices, et que probablement il recevrait l’ordre de s’éloigner dès qu’il se ferait voir.
C’est pourquoi Bishopriggs fit un circuit afin d’éviter le terrain découvert et d’approcher du cottage, à l’abri des arbres qui s’élevaient derrière la maison. Un coup d’œil jeté sur Mr Geoffrey Delamayn, était ce dont il avait besoin pour le moment. On pouvait bien le chasser après cela, le premier point étant gagné.
Il hésitait encore à l’extrême limite du bois, quand il entendit une voix forte et impérative sortant du cottage, crier :
– Maintenant, Mr Geoffrey, le temps est venu !
Une autre voix répondit :
– C’est bien !
Et après un court intervalle, Geoffrey Delamayn parut dans la partie découverte, se dirigeant vers le lieu où il avait coutume de parcourir la distance mesurée d’un mile.
Mais ayant voulu s’avancer de quelques pas pour regarder son homme de plus près, Bishopriggs fut à l’instant découvert par l’œil vigilant de l’entraîneur.
– Holà ! cria Perry, que venez-vous faire ici ?
Bishopriggs ouvrait la bouche pour s’excuser.
– Qui diable êtes-vous ? demanda Geoffrey d’une voix tonnante.
L’entraîneur répondit à la question avec les lumières de l’expérience :
– Un espion, monsieur, venu pour calculer la vitesse de votre course, pendant vos exercices.
Geoffrey leva son poing formidable et fit un pas en avant.
Perry retint son élève.
– Ne frappez pas, monsieur, l’homme est trop vieux. Pas de danger qu’il y revienne, car vous l’avez terrifié.
C’était la pure vérité. La terreur de Bishopriggs à la vue du poing de Geoffrey lui avait rendu l’activité de la jeunesse. Il courut, pour la première fois depuis vingt ans, et ne s’arrêta pour songer à ses infirmités et pour reprendre haleine que lorsqu’il fut hors de vue du cottage, à l’abri des arbres.
Il s’assit pour se reposer et se remettre, avec la consolante conviction que, d’une façon au moins, il avait atteint son but. Le sauvage en fureur, dont les yeux lançaient du feu et dont le poing l’avait menacé d’une destruction certaine, lui était complètement étranger. En d’autres termes, ce n’était pas là l’homme qui se faisait passer à l’auberge pour le mari de la jeune dame.
D’un autre côté, il était également certain que c’était bien l’homme compromis dans la correspondance volée.
Mais comment en appeler désormais à l’intérêt qu’il avait à obtenir la lettre ? Une telle démarche était entièrement incompatible, après l’exhibition que l’athlète venait de faire de son poing, avec l’estime profonde que Bishopriggs sentait pour sa sécurité personnelle.
Le bonhomme n’avait pas d’autre possibilité maintenant que d’ouvrir les négociations avec l’autre personne intéressée dans la question, une personne appartenant heureusement, cette fois, au beau sexe, et qu’il avait à sa portée.
Mrs Glenarm était aux Cygnes.
Elle tiendrait sûrement à éclaircir la question des droits antérieurs d’une autre femme sur Mr Geoffrey Delamayn, et elle ne pouvait arriver à cet éclaircissement que par la remise entre ses mains de la pièce à conviction.
« Gloire à la Providence pour ses bontés ! se dit Bishopriggs en se remettant de nouveau sur ses pieds. J’ai, comme on dit, deux cordes à mon arc. Je crois que la femme est la corde la plus agréable des deux. Essayons donc de la faire vibrer. »
Il revint sur ses pas, pour chercher Mrs Glenarm parmi la compagnie réunie auprès du lac.
La danse était dans toute son animation, quand Bishopriggs vint reprendre son service. Pendant son absence la société avait vu reparaître dans ses rangs la personne brillante qu’il se proposait actuellement de joindre.