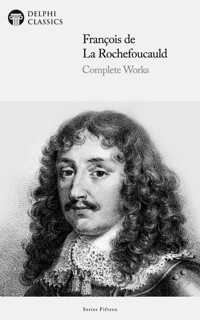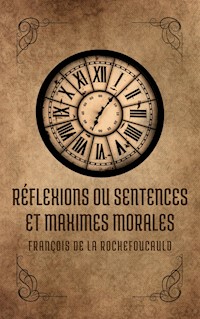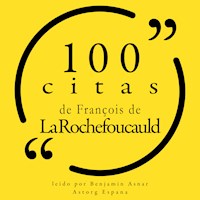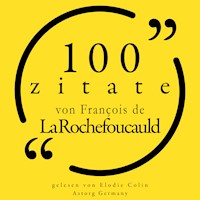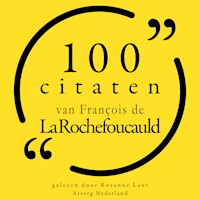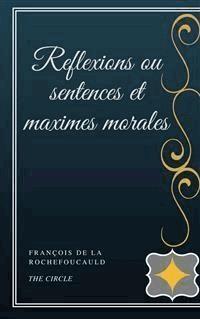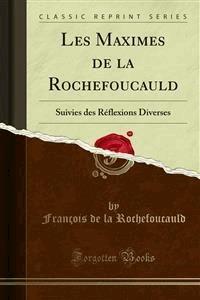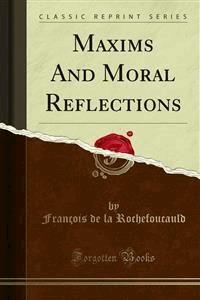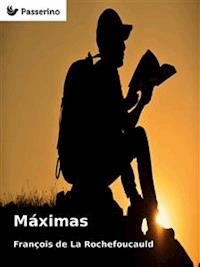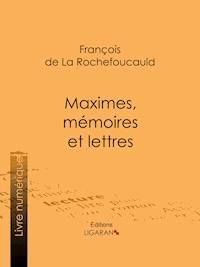Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
La Rochefoucauld a eu l'idée de composer un grand nombre de maximes, et surtout de les publier, dans le salon de Madeleine de Sablé où a été lancé le genre littéraire des maximes. On trouve d'ailleurs une certaine proximité de préoccupations dans les maximes de celle-ci et celles de La Rochefoucauld. Les maximes étaient discutées par Madeleine de Sablé ainsi que Jacques Esprit, la princesse de Guéméné, la duchesse de Schomberg, la comtesse de Maure ou Eléonore de Rohan. Les transformations effectuées à la version de l'édition de 1665 doivent beaucoup à ces amis influents. Les Maximes ont été souvent réimprimées depuis les cinq éditions originales données du vivant de l'auteur. Voltaire dira de cet ouvrage : « C'est un des ouvrages qui contribuèrent le plus à former le goût de la nation, et à lui donner un esprit de justesse et de précision... Il accoutuma à penser et à renfermer des pensées dans un tour vif, précis et délicat » - Voltaire, Le Siècle de Louis XIV, chapitre 32
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
Notice sur le duc de Larochefoucauld et le caractère de ses écrits
Portrait du duc de Larochefoucauld
Fait par lui-même, imprimé en 1658
Portrait du duc de Larochefoucauld
Par le Cardinal de Retz
Avis au lecteur
De l’édition de 1665
Avis au lecteur
De l’édition de 1666
Réflexions ou sentences et maximes morales
Pensées
Tirées des premières éditions ; supprimées par l’auteur dans les éditions postérieures, et replacées dans l’ordre où elles s’y trouvent
Réflexions diverses
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VII
Mémoires de Larochefoucauld
Première partie
Deuxième partie
Troisième partie
Quatrième partie
Articles et conditions
Dont Son Altesse Royale et M. le Prince sont convenus pour l’expulsion du cardinal Mazarin, en conséquence des déclarations du roi et des arrêts des parlements de France
Portrait de Paul de Gondy, cardinal de Retz
Par le duc de La Rochefoucauld.
Lettres
Notice sur le duc de Larochefoucauld et le caractère de ses écrits
François, duc de Larochefoucauld, connu d’abord sous le nom de Prince de Marsillac, naquit à Paris en 1613.
Son éducation fut négligée, et Madame de Maintenon nous apprend qu’il avait beaucoup d’esprit et peu de savoir. Il laissa des Mémoires, comme la plupart des grands personnages de cette époque, mais il est surtout célèbre, dans l’histoire des lettres, par ses Réflexions ou Sentences et Maximes morales, sortes de paradoxes incisifs, spirituels, mais où il est à regretter que l’expression toujours élégante, juste et concise, recouvre si souvent des pensées fausses.
Pour bien juger ce livre, il faut, croyons-nous, se mettre au point de vue où l’auteur s’est placé, et certes ce point de vue n’est pas beau.
La Fronde venait de se terminer ; il s’était jeté lui-même dans cette guerre d’intrigues, captivé par la duchesse de Longueville, comme il l’avoue, et l’on sait qu’il s’appliquait ces vers de l’Alcyonée de Leuryer :
Pour mériter son cœur, pour plaire à ses beaux yeux. J’ai fait la guerre aux rois, je l’aurais faite aux dieux.
Plus tard, quand il se brouilla avec elle, il parodia ces vers à propos d’une blessure qu’il reçut au fameux combat du faubourg Saint-Antoine, et qui lui avait fait perdre momentanément la vue :
Pour ce cœur inconstant qu’enfin je connais mieux. J’ai fait la guerre aux rois, j’en ai perdu les yeux.
Madame de Longueville était plus encore que son frère, le prince de Condé, l’inspiratrice de cette misérable guerre, dont quelques mémoires, au XVIIe siècle, ont essayé de déguiser l’importance pour excuser quelquesuns des chefs du parti. Mais quand on songe aux conséquences désastreuses qu’elle eut, et aux conséquences plus désastreuses encore qu’elle aurait pu avoir, on serait tenté de plaider les circonstances atténuantes en faveur de l’auteur des Maximes.
En effet, quel était l’état de la France ? Un roi encore enfant, neveu de cet infortuné Charles Ier que le Parlement anglais venait de décapiter, obligé de quitter Paris, avec sa mère, et d’errer dans son royaume ; et en face, deux femmes, surtout Madame de Longueville et Mademoiselle de Montpensier, que l’histoire appelle aussi la grande Mademoiselle, attiraient par galanterie, à leur suite, les Coudé, les Turenne, tous les plus beaux noms de la noblesse française, et le Parlement lui-même pendant quelque temps, jaloux, ce semble, de la triste victoire du Parlement anglais. Toutes les passions démagogiques soulevées à Bordeaux et à Paris, et à la tête de ces précurseurs de 93 et de la Commune, un prince du sang, Condé, le vainqueur de Rocroi, allié aux Espagnols, et s’abaissant jusqu’à féliciter Cromwell, et à lui offrir ses services. En vérité, quand on songe que le duc de Larochefoucauld a vu tout cela, et qu’il en a fait partie, on l’excuse, jusqu’à un certain point, d’avoir confondu l’humanité en général avec la triste humanité qu’il avait sous les yeux. Quel égoïsme en effet de bouleverser un royaume, d’ébranler un trône, de chasser un roi pour des ambitions déçues ou un orgueil à assouvir ! Nous ne disons pas cela, encore une fois, pour excuser l’auteur des Maximes, mais nous croyons que c’est le point de vue où il faut se placer pour bien le juger.
Ce sont moins des Maximes, surtout des Maximes morales, que des portraits ou plutôt des critiques du certains personnages qu’il faut avoir sous les yeux, pour juger de la ressemblance : Mazarin, par exemple, Anne d’Autriche, le cardinal de Retz, la duchesse de Longueville et l’auteur même.
Cette observation générale est nécessaire, autant que la connaissance de la guerre de la Fronde, pour bien comprendre l’élégant et spirituel écrivain. Mais son tort a été de conclure du particulier au général, ce qui est un défaut de logique et de jugement, et de nous présenter l’humanité tout entière, comme il l’a vue dans les ambitieux ou les courtisans ; car chacun sait que si le cœur humain n’est pas beau à voir, c’est surtout à la cour, auprès des grands. Au reste, si la pensée mère de ces Réflexions ou sentences était vraie, à savoir que l’amour-propre est le mobile de tout, elle ne tendrait à rien moins qu’à nier la vertu, pour mettre toujours et partout à sa place un vil égoïsme. Le pauvre cœur humain, on ne peut pourtant le nier, à sa gloire, n’est pas incapable de vertu, mais s’il n’en est pas riche, c’est une raison de plus pour ne pas l’en dépouiller entièrement. Ce livre pèche donc par la base, si on le prend pour un traité de morale, mais le but de l’auteur a plutôt été d’écrire ries critiques que des principes.
Après la première Fronde, Mademoiselle de Montpensier, rappelée de l’exil, réunit dans son hôtel, au Luxembourg, les esprits les plus distingués, et continua de jouer un rôle heureusement plus glorieux pour elle et pour la France que celui qu’elle avait joué dans la guerre. – C’est là que Larochefoucauld se rencontrait habituellement avec Madame de Sévigné, Madame de Lafayette et les beaux esprits du temps, et perfectionna ses Réflexions ou sentences et maximes morales, qu’il avait longtemps élaborées chez Madame de Sablé, à Port-Royal, ce qui ne contribua pas à lui faire voir la nature humaine par le beau côté.
Cet ouvrage parut d’abord anonyme, à l’insu de l’auteur. Il fut naturellement trouvé neuf et curieux, lu avec empressement, loué et critiqué à l’excès. Plus tard, l’auteur en donna lui-même plusieurs éditions, où il supprima plusieurs maximes pour les remplacer par d’autres.
Il ne sera pas sans intérêt de lire le jugement que porta, à l’apparition de ce livre, Madame de Lafayette, pourtant si sympathique à l’auteur. Elle écrit à Madame de Sablé :
« Voilà un billet que je vous supplie de vouloir lire, il vous instruira de ce que l’on demande de vous. Je n’ai rien à y adjouster, sinon que l’homme qui l’escrit est un des hommes du monde que j’ayme autant, et qu’ainsi c’est une des plus grandes obligations que je vous puisse avoir, que de luy accorder ce qu’il souhaite pour son amy… Nous avons lu les maximes de Larochefoucauld : ha ! Madame, quelle corruption il faut avoir dans l’esprit et dans le cœur pour estre capable d’imaginer tout cela ! J’en suis si espouvantée, que je vous assure que si les plaisanteries estaient des choses sérieuses, de telles maximes gasteraient plus ses affaires que tous les potages qu’il mangea l’autre jour chez vous. »
Heureusement l’homme valait mieux que l’écrivain, et il pratiquait la plupart des vertus naturelles qu’il critique, ou semble même nier dans ses Maximes ; autrement il faudrait lui appliquer ces paroles de Montaigne :
« De tant d’âmes et esprits qu’il juge, de tant de mouvements et conseils, il n’en rapporte jamais un à la vertu, religion et conscience ; comme si ces parties-là estaient de tout esteinctes au monde ; et de toutes les actions, pour belles par apparence qu’elles soient d’elles-mêmes, il en rejecte la cause à quelque occasion vicieuse ou à quelque proufit. Il est impossible d’imaginer que parmy cet infiny nombre d’actions de quoy il juge, il n’y en ayt eu quelqu’une produicte par la voye de la raison. Nulle corruption ne peult avoir saisi les hommes si universellement que quelqu’une n’échappe à la contagion. Cela me fait craindre qu’il y aye un peu de vite de son goust, et peult-estre advenu qu’il ayt estimé d’aultres selon soy. »
Madame de Sévigné, qui parle constamment de Larochefoucauld et qui était liée avec lui de la plus grande familiarité, comme on le voit dans ses lettres, nous apprend qu’il recevait chez lui tout ce qu’il y avait de remarquable à la cour et à la ville par le nom, l’esprit et le talent.
Il eut une vieillesse bien éprouvée. L’un de ses fils fut tué et l’autre blessé au passage du Rhin, et depuis ce temps, selon la remarque de Châteaubriand, « la guerre a cédé les Larochefoucauld aux lettres. » Il supporta ces terribles épreuves avec beaucoup de courage et de résignation.
« J’ai vu son cœur à découvert, dans cette cruelle aventure, dit Mme de Sévigné ; il est au premier rang de tout ce que je connais de courage, de mérite, de tendresse et de raison : je compte pour rien son esprit et ses agréments. »
Il mourut en 1080 de la goutte, qui le fit horriblement souffrir les dernières années de sa vie. Sur son lit de mort, il fit heureusement des réflexions autrement sérieuses et profitables que celles qu’il nous a laissées. Il mourut noblement en chrétien, comme tous les écrivains du grand siècle.
« Son état, dit encore Madame de Sévigné, car on ne saurait mieux citer, est une chose digne d’admiration. Il est fortement disposé pour sa conscience : voilà qui est fait ; mais du reste, c’est la maladie et la mort de son voisin dont il est question ; il n’en est pas effleuré… Ce n’est pas inutilement qu’il a fait des réflexions toute sa vie ; il s’est approche de telle sorte de ses derniers moments, qu’ils n’ont rien de nouveau ni d’étrange pour lui. »
A.S.
Portrait du duc de Larochefoucauld
Fait par lui-même, imprimé en 1658.
Je suis d’une taille médiocre, libre et bien proportionnée. J’ai le teint brun, mais assez uni ; le front élevé et d’une raisonnable grandeur ; les yeux noirs, petits et enfoncés, et les sourcils noirs et épais, mais bien tournés. Je serais fort empêché de dire de quelle sorte j’ai le nez fait, car il n’est ni camus, ni aquilin, ni gros, ni pointu, au moins à ce que je crois ; tout ce que je sais, c’est qu’il est plutôt grand que petit et qu’il descend un peu trop bas. J’ai la bouche grande, et les lèvres assez rouges d’ordinaire et ni bien ni mal taillées. J’ai les dents blanches et passablement rangées. On m’a dit autrefois que j’avais un peu trop de menton : je viens de me regarder dans le miroir pour savoir ce qui en est, et je ne sais pas trop bien qu’en juger. Pour le tour du visage, je l’ai ou carré ou en ovale : lequel des deux, il me serait fort difficile de le dire. J’ai les cheveux noirs, naturellement frisés, et avec cela assez épais et assez longs pour pouvoir prétendre en belle tête.
J’ai quelque chose de chagrin et de fier dans la mine : cela fait croire à la plupart des gens que je suis méprisant, quoique je ne le sois point du tout. J’ai l’action fort aisée, et même un peu trop, et jusqu’à faire beaucoup de gestes en parlant. Voilà naïvement comme je pense que je suis fait au dehors, et l’on trouvera, je crois, que ce que je pense de moi là-dessus n’est pas fort éloigné de ce qui en est. J’en userai avec la même fidélité dans ce qui me reste à faire de mon portrait : car je me suis assez étudié pour me bien connaître, et je ne manquerai ni d’assurance pour dire librement ce que je puis avoir de bonnes qualités, ni de sincérité pour avouer franchement ce que j’ai de défauts.
Premièrement, pour parler de mon humeur, je suis mélancolique, et je le suis à un point que, depuis trois ou quatre ans, à peine m’a-t-on vu rire trois ou quatre fois. J’aurais pourtant, ce me semble, une mélancolie assez supportable et assez douce, si je n’en avais point d’autre que celle qui me vient de mon tempérament ; mais il m’en vient tant d’ailleurs, et ce qui m’en vient me remplit de telle sorte l’imagination et m’occupe si fort l’esprit, que la plupart du temps, ou je rêve sans dire mot, nu je n’ai presque point d’attache à ce que je dis. Je suis fort resserré avec ceux que je ne connais pas, et je ne suis pas même extrêmement ouvert avec la plupart de ceux que je connais. C’est un défaut, je le sais bien, et je ne négligerai rien pour m’en corriger ; mais comme un certain air sombre que j’ai dans le visage contribue à me faire paraître encore plus réservé que je ne le suis, et qu’il n’est pas en notre pouvoir de nous défaire d’un méchant air qui nous vient de la disposition naturelle des traits, je pense qu’après m’être corrigé au dedans, il ne laissera pas de me demeurer toujours de mauvaises marques au dehors.
J’ai de l’esprit, et je ne fais point de difficulté de le dire : car à quoi bon façonner là-dessus ? Tant biaiser et tant apporter d’adoucissement pour dire les avantages que l’on a, c’est, ce me semble, cacher un peu de vanité sous une modestie apparente, et se servir d’une manière bien adroite pour faire croire de soi beaucoup plus de bien que l’on n’en dit. Pour moi, je suis content qu’on ne me croie ni plus beau que je me fais, ni de meilleure humeur que je me dépeins, ni plus spirituel et plus raisonnable que je le suis. J’ai donc de l’esprit, encore une luis, mais un esprit que la mélancolie gâte : car, encore que je possède assez bien ma langue, que j’aie la mémoire heureuse, et que je ne pense pas les choses fort confusément, j’ai pourtant une si forte application à mon chagrin, que souvent exprime assez mal ce que je veux dire.
La conversation des honnêtes gens est un des plaisirs qui me touchent le plus. J’aime qu’elle soit sérieuse et que la morale en fasse la plus grande partie. Cependant je sais la goûter aussi lorsqu’elle, est enjouée ; et si je ne dis pas beaucoup de petites choses pour rire, ce n’est pas du moins que je ne connaisse pas ce que valent les bagatelles bien dites, et que je ne trouve fort divertissante cette manière de badiner, où il y certains esprits prompts et aisés qui réussissent si bien. J’écris bien en prose, je fais bien en vers ; et si j’étais sensible à la gloire qui vient de ce côté-là, je pense qu’avec peu de travail je pourrais m’acquérir assez de réputation.
J’aime la lecture, en général ; celle où il se trouve quelque chose qui peut façonner l’esprit et fortifier l’âme est celle que j’aime le plus. Surtout j’ai une extrême satisfaction à lire avec une personne d’esprit : car, de cette sorte, on réfléchit à tout moment sur ce qu’on lit ; et des réflexions que l’on fait, il se forme une conversation la plus agréable du monde et la plus utile.
Je juge assez bien des ouvrages de vers et de prose que l’on me montre ; mais j’en dis peut-être mon sentiment avec un peu trop de liberté. Ce qu’il y a encore de mal en moi, c’est que j’ai quelquefois une délicatesse trop scrupuleuse et une critique trop sévère. Je ne liais pas entendre disputer, et souvent aussi je me mêle assez volontiers dans la dispute : mais je soutiens d’ordinaire mon opinion avec trop de chaleur ; et lorsqu’on défend un parti injuste contre moi, quelquefois, à force de me passionner pour la raison, je deviens moi-même fort peu raisonnable.
J’ai les sentiments vertueux, les inclinations belles, et une si forte envie d’être tout à fait honnête homme, que mes amis ne me sauraient faire un plus grand plaisir que de m’avertir sincèrement de mes défauts. Ceux qui me connaissent un peu particulièrement, et qui ont eu la bonté de me donner quelquefois des avis là-dessus, savent que je les ai toujours reçus avec toute la joie imaginable et toute la soumission d’esprit que l’on saurait désirer.
J’ai toutes les passions assez douces et assez réglées : on ne m’a presque jamais vu en colère, et je n’ai jamais eu de haine pour personne. Je ne suis pas pourtant incapable de me venger si l’on m’avait offensé, et qu’il y allât de mon honneur à me ressentir de l’injure qu’on m’aurait faite. Au contraire, je suis assuré que le devoir ferait si bien en moi l’office de la haine, que je poursuivrais ma vengeance avec encore plus de vigueur qu’un autre.
L’ambition ne me travaille point. Je ne crains guère de choses, et ne crains aucunement la mort. Je suis peu sensible à la pitié, et je voudrais ne l’y être point du tout. Cependant il n’est rien que je ne tisse pour le soulagement d’une personne affligée ; et je crois effectivement que l’on doit tout faire, jusqu’à lui témoigner même beaucoup de compassion de son mal : car les misérables sont si sots, que cela leur fait le plus grand bien du monde. Mais je tiens aussi qu’il faut se contenter d’en témoigner, et se garder soigneusement d’en avoir. C’est une passion qui n’est bonne à rien au dedans d’une âme bien faite, qui ne sert qu’à affaiblir le cœur, et qu’on doit laisser au peuple, qui, n’exécutant jamais rien par raison, a besoin de passions pour le porter à faire les choses.
J’aime mes amis, et je les aime d’une façon que je ne balancerais pas un moment à sacrifier mes intérêts aux leurs. J’ai de la condescendance pour eux ; je souffre patiemment leur mauvaise humeur ; seulement je ne leur fais pas beaucoup de caresses, et je n’ai pas non plus de grandes inquiétudes en leur absence.
J’ai naturellement fort peu de curiosité pour la plus grande partie de tout ce qui en donne aux autres gens. Je suis fort secret, et j’ai moins difficulté que personne à taire ce qu’on m’a dit en confidence. Je suis extrêmement régulier à ma parole ; je n’y manque jamais, de quelque conséquence que puisse être ce que j’ai promis, et je m’en suis fait toute ma vie une loi indispensable. J’ai une civilité fort exacte parmi les femmes ; et je ne crois pas avoir jamais rien dit devant elles qui leur ait pu faire de la peine. Quand elles ont l’esprit bien fait, j’aime mieux leur conversation que celle des hommes ; on y trouve une certaine douceur qui ne se rencontre point parmi nous ; et il me semble, outre cela, qu’elles s’expliquent avec plus de netteté, et qu’elles donnent un tour plus agréable aux choses qu’elles disent. Pour galant, je l’ai été un peu autrefois, présentement je ne le suis plus, quelque jeune que je sois. J’ai renoncé aux fleurettes, et je m’étonne seulement de ce qu’il y a encore tant d’honnêtes gens qui s’occupent à en débiter.
Portrait du duc de Larochefoucauld
Par le Cardinal de Retz
Il y a toujours eu du je ne sais quoi en M. de Larochefoucauld. Il a voulu se mêler d’intrigues dès son enfance, et en un temps où il ne sentait pas les petits intérêts, qui n’ont jamais été son faible, et où il ne connaissait pas les grands, qui, d’un autre sens, n’ont pas été son fort. Il n’a jamais été capable d’aucunes affaires, et je ne sais pourquoi ; car il avait des qualités qui eussent suppléé, en tout autre, celles qu’il n’avait pas. Sa vue n’était pas assez étendue, et il ne voyait pas même tout ensemble ce qui était à sa portée ; mais son bon sens, très bon dans la spéculation, joint à sa douceur, à son insinuation, et à sa facilité de mœurs, qui est admirable, devait récompenser, plus qu’il n’a fait, le défaut de sa pénétration. Il a toujours eu une irrésolution habituelle ; mais je ne sais même à quoi attribuer cette irrésolution. Elle n’a pu venir en lui de la fécondité de son imagination, qui n’est rien moins que rien. Je ne la puis donner à la stérilité de son jugement ; car, quoiqu’il ne l’ait pas exquis dans l’action, il a un bon fonds de raison. Nous voyons les effets de cette irrésolution, quoique nous n’en connaissions pas la cause. Il n’a jamais été guerrier, quoiqu’il fût très soldat. Il n’a jamais été par lui-même bon courtisan, quoiqu’il eût toujours bonne intention de l’être. Il n’a jamais été bon homme de parti, quoique toute sa vie il y ait été engagé. Cet air de honte et de timidité que vous lui voyez dans la vie civile, s’était tourné dans les affaires en air d’apologie. Il croyait toujours en avoir besoin ; ce qui, joint à ses Maximes, qui ne marquent pas assez de bonne foi à la vertu, et à sa pratique qui a toujours été de sortir des affaires avec autant d’impatience qu’il y était entré, me fait conclure qu’il eût beaucoup mieux fait de se connaître, et de se réduire à passer, comme il eût pu, pour le courtisan le plus poli et le plus honnête homme, à l’égard de la vie commune, qui eût paru dans son siècle.
Avis au lecteur
De l’édition de 1665.
Voici un portrait du cœur de l’homme que je donne au public, sous le nom de Réflexions ou Maximes momies. Il court fortune de ne plaire pas à tout le monde, parce qu’on trouvera peut-être qu’il ressemble trop, et qu’il ne flatte pas assez. Il y a apparence que l’intention du peintre n’a jamais été de faire paraître cet ouvrage, et qu’il serait encore renfermé dans son cabinet, si une méchante copie qui en a couru, et qui a passé même depuis quelque temps en Hollande, n’avait obligé un de ses amis de m’en donner une autre, qu’il dit être tout à fait conforme à l’original ; mais toute correcte qu’elle est, possible n’évitera-t-elle pas la censure de certaines personnes qui ne peuvent souffrir que l’on se mêle de pénétrer dans le fond de leur cœur, et qui croient être en droit d’empêcher que les autres les connaissent, parce qu’elles ne veulent pas se connaître elles-mêmes. Il est vrai que, comme ces Maximes sont remplies de ces sortes de vérités dont l’orgueil humain ne se peut accommoder, il est presque impossible qu’il ne se soulève contre elles et qu’elles ne s’attirent des censeurs. Aussi, est-ce pour eux que je mets ici une Lettre que l’on m’a donnée, et qui a été faite depuis que le manuscrit a paru, et dans le temps que chacun se mêlait d’en dire son avis. Elle m’a semblé assez propre pour répondre aux principales difficultés que l’on peut opposer aux Réflexions, et pour expliquer les sentiments de leur auteur ; elle suffit pour faire voir que ce qu’elles contiennent n’est autre chose que l’abrégé d’une morale conforme aux pensées de plusieurs Pères de l’Église, et que celui qui les a écrites a eu beaucoup de raison de croire qu’il ne pouvait s’égarer en suivant de si bons guides, et qu’il lui était permis de parler de l’homme comme les Pères en ont parlé. Mais si le respect qui leur est dû n’est pas capable de retenir le chagrin des critiques, s’ils ne font point de scrupule de condamner l’opinion de ces grands hommes en condamnant ce livre, je prie le lecteur de ne les pas imiter, de ne laisser point entraîner son esprit au premier mouvement de son cœur, et de donner ordre, s’il est possible, que l’amour-propre ne se mêle point dans le jugement qu’il en fera ; car, s’il le consulte, il ne faut pas s’attendre qu’il puisse être favorable à ces Maximes comme elles traitent l’amour-propre de corrupteur de la raison, il ne manquera pas de prévenir l’esprit contre elles. Il faut donc prendre garde que cette prévention ne la justifie, et se persuader qu’il n’y a rien de plus propre à établir la vérité de ces Réflexions que la chaleur et la subtilité que l’on témoignera pour les combattre. En effet, il sera difficile de faire croire à tout homme de bon sens que l’on les condamne par d’autres motifs que par celui de l’intérêt caché, de l’orgueil et de l’amour-propre. En un mot, le meilleur parti que le lecteur ait à prendre est de se mettre d’abord dans l’esprit qu’il n’y a aucune de ces Maximes qui le regarde en particulier, et qu’il est seul excepté, bien qu’elles paraissent générales. Après cela, je lui réponds qu’il sera le premier à y souscrire, et qu’il croira qu’elles font encore grâce au cœur humain. Voilà ce que j’avais à dire sur cet écrit en général. Pour ce qui est de la méthode que l’on y eût pu observer, je crois qu’il eût été à désirer que chaque Maxime eût un titre du sujet qu’elle traite, et qu’elles eussent été mises dans un plus grand ordre ; mais je ne l’ai pu faire sans renverser entièrement celui de la copie qu’on m’a donnée, et comme il y a plusieurs Maximes sur une même matière, ceux à qui j’en ai demandé avis ont jugé qu’il était plus expédient de faire une Table à laquelle on aura recours pour trouver celles qui traitent d’une même chose.
Avis au lecteur
De l’édition de 1666.
MON CHER LECTEUR,
Voici une seconde édition des Réflexions morales que vous trouverez sans doute plus correcte et plus exacte en toutes façons que n’a été la première. Ainsi vous pouvez maintenant en faire tel jugement que vous voudrez sans que je me mette en peine de tâcher à vous prévenir en leur laveur, puisque, si elles sont telles que je le crois, on ne pourrait leur faire plus de tort que de s’imaginer qu’elles eussent besoin d’apologie. Je me contenterai de vous avertir de deux choses : l’une, que par le mot d’intérêt ou n’entend pas toujours un intérêt de bien, mais le plus souvent un intérêt d’honneur ou de gloire ; et l’autre, qui est la principale et comme le fondement de toutes ces Réflexions est que celui qui les a faites n’a considéré les hommes que dans cet état déplorable de la nature corrompue par le péché ; et qu’ainsi la manière dont il parle de ce nombre infini de défauts qui se rencontrent dans leurs vertus apparentes ne regarde point ceux que Dieu en préserve par une grâce particulière.
Pour ce qui est de l’ordre de ces Réflexions, vous n’aurez pas peine à juger, mon cher lecteur, que, comme elles sont toutes sur des matières différentes, il était difficile d’y en observer ; et bien qu’il y en ait plusieurs sur un même sujet, on n’a pas cru les devoir toujours mettre de suite, de crainte d’ennuyer le lecteur, mais on les trouvera dans la Table.
Réflexions ou sentences et maximes morales
Nos vertus ne sont, le plus souvent, que des vices déguisés.
I.
Ce que nous prenons pour des vertus, n’est souvent qu’un, assemblage de diverses actions et de divers intérêts, que la fortune et notre industrie savent arranger.
II.
L’amour-propre est le plus grand de tous les flatteurs.
III.
Quelque découverte que l’on ait faite dans le pays de l’amour-propre, il y reste encore bien des terres inconnues.
IV.
L’amour-propre est plus habile que le plus habile homme du monde.
V.
La passion fait souvent un fou du plus habile homme, et rend souvent les plus sots habiles.
VI.
Ces grandes et éclatantes actions qui éblouissent les yeux sont représentées par les politiques comme les effets des grands desseins, au lieu que ce sont d’ordinaire les effets de l’humeur et des passions. Ainsi la guerre d’Auguste et d’Antoine, qu’on rapporte à l’ambition qu’ils avaient de se rendre maîtres du monde, n’était peut-être qu’un effet de jalousie.
VII.
Les passions sont les seuls orateurs qui persuadent toujours. Elles sont comme un art de la nature dont les règles sont infaillibles ; et l’homme le plus simple, qui a de la passion, persuade mieux que le plus éloquent qui n’en a point.
VIII.
Les passions ont une injustice et un propre intérêt qui fait qu’il est dangereux de les suivre, et qu’on s’en doit défier, lors même qu’elles paraissent les plus raisonnables.
IX.
Il y a dans le cœur humain une génération perpétuelle de passions, en sorte que la ruine de l’une est presque toujours l’établissement d’une autre.
X.
Les passions en engendrent souvent qui leur sont contraires : l’avarice produit quelquefois la prodigalité, et la prodigalité l’avarice ; on est souvent ferme par faiblesse, et audacieux par timidité.
XI.
Quelque soin que l’on prenne de couvrir ses passions par des apparences de piété et d’honneur, elles paraissent toujours au travers de ces voiles.
XII.
Notre amour-propre souffre plus impatiemment la condamnation de nos goûts que de nos opinions.
XIII.
Les hommes ne sont pas seulement sujets à perdre le souvenir des bienfaits et des injures ; ils haïssent même ceux qui les ont obligés, et cessent de haïr ceux qui leur ont fait des outrages. L’application à récompenser le bien et à se venger du mal, leur paraît une servitude à laquelle ils ont peine de se soumettre.
XIV.
La clémence des princes n’est souvent qu’une politique pour gagner l’affection des peuples.
XV.
Cette clémence, dont on fait une vertu, se pratique tantôt par vanité, quelquefois par paresse, souvent par crainte, et presque toujours par tous les trois ensemble.
XVI.
La modération des personnes heureuses vient du calme que la bonne fortune donne à leur humeur.
XVII.
La modération est une crainte de tomber dans l’envie et dans le mépris que méritent ceux qui s’enivrent de leur bonheur ; c’est une vaine ostentation de la force de notre esprit ; et enfin, la modération des hommes dans leur plus haute élévation est un désir de paraître plus grands que leur fortune.
XVIII.
Nous avons tous assez de force pour supporter les maux d’autrui.
XIX.
La constance des sages n’est que l’art de renfermer leur agitation dans leur cœur.
XX.
Ceux qu’on condamne au supplice affectent quelquefois une constance et un mépris de la mort qui n’est en effet que la crainte de l’envisager ; de sorte qu’on peut dire que cette constance et ce mépris sont à leur esprit ce que le bandeau est à leurs yeux.
XXI.
La philosophie triomphe aisément des maux passés et des maux à venir, mais les maux présents triomphent d’elle.
XXII.
Peu de gens connaissent la mort ; on ne la souffre pas ordinairement par résolution, mais par stupidité et par coutume ; et la plupart des hommes meurent parce qu’on ne peut s’empêcher de mourir.
XXIII.
Lorsque les grands hommes se laissent abattre par la longueur de leurs infortunes, ils font voir qu’ils ne les soutenaient que par la force de leur ambition, et non par celle de leur âme ; et qu’à une grande vanité près, les héros sont faits comme les autres hommes.
XXIV.
Il faut de plus grandes vertus pour soutenir la bonne fortune que la mauvaise.
XXV.
Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement.
XXVI.
On fait souvent vanité des passions, même les plus criminelles ; mais l’envie est une passion timide et honteuse que l’on n’ose jamais avouer.
XXVII.
La jalousie est, en quelque manière, juste et raisonnable, puisqu’elle ne tend qu’à conserver un bien qui nous appartient, ou que nous croyons nous appartenir : au lieu que l’envie est une fureur qui ne peut souffrir le bien des autres.
XXVIII.
Le mal que nous faisons ne nous attire pas tant de persécution et de haine que nos bonnes qualités.
XXIX.
Nous avons plus de force que de volonté ; et c’est souvent pour nous excuser à nous-mêmes, que nous nous imaginons que les choses sont impossibles.
XXX.
Si nous n’avions point de défauts, nous ne prendrions pas tant de plaisir à en remarquer dans les autres.
XXXI.
La jalousie se nourrit dans les doutes ; et elle devient fureur, ou elle finit, sitôt qu’on passe du doute à la certitude.
XXXII.
L’orgueil se dédommage toujours et ne perd rien, lors même qu’il renonce à la vanité.
XXXIII.
Si nous n’avions point d’orgueil, nous ne nous plaindrions point de celui des autres.
XXXIV.
L’orgueil est égal dans tous les hommes et il n’y a de différence qu’aux moyens et à la manière de le mettre au jour.
XXXV.
Il semble que la nature, qui a si sagement disposé les organes de notre corps pour nous rendre heureux, nous ait aussi donné l’orgueil pour nous épargner la douleur de connaître nos imperfections.
XXXVI.
L’orgueil a plus de part que la bonté aux remontrances que nous faisons à ceux qui commettent des fautes ; et nous ne les reprenons pas tant pour les en corriger, que pour leur persuader que nous en sommes exempts.
XXXVII.
Nous promettons selon nos espérances, nous tenons selon nos craintes.
XXXVIII.
L’intérêt parle toutes sortes de langues, et joue toutes sortes de personnages, même celui de désintéressé.
XXXIX.
L’intérêt, qui aveugle les uns, fait la lumière des autres.
XL.
Ceux qui s’appliquent trop aux petites choses deviennent ordinairement incapables des grandes.
XLI.
Nous n’avons pas assez de force pour suivre toute notre raison.
XLII.
L’homme croit souvent se conduire lorsqu’il est conduit ; et pendant que, par son esprit, il tend à un but, son cœur l’entraîne insensiblement à un autre.
XLIII.
Le caprice de notre humeur est encore plus bizarre que celui de la fortune.
XLIV.
L’attachement ou l’indifférence que les philosophes avaient pour la vie, n’était qu’un goût de leur amour-propre, dont on ne doit non plus disputer que du goût de la langue ou du choix des couleurs.
XLV.
Notre humeur met le prix à tout ce qui nous vient de la fortune.
XLVI.
La félicité est dans le goût, et non pas dans les choses ; et c’est par avoir ce qu’on aime qu’on est heureux, non par avoir ce que les autres trouvent aimable.
XLVII.
On n’est jamais si heureux ni si malheureux qu’on s’imagine.
XLVIII.
Ceux qui croient avoir du mérite se font un honneur d’être malheureux, pour persuader aux autres et à eux-mêmes qu’ils sont dignes d’être en butte à la fortune.
XLIX.
Rien ne doit tant diminuer la satisfaction que nous avons de nous-mêmes, que de voir que nous désapprouvons dans un temps ce que nous approuvions dans un autre.
L.
Quelque différence qui paraisse entre les fortunes, il y a néanmoins une certaine compensation de biens et de maux qui les rend égales.
LI.
Quelque grands avantages que la nature donne, ce n’est pas elle seule, mais la fortune avec elle qui fait les héros.
LII.
Le mépris des richesses était, dans les philosophes, un désir caché de venger leur mérite de l’injustice de la fortune, par le mépris des mêmes biens dont elle les privait : c’était un secret pour se garantir de l’avilissement de la pauvreté ; c’était un chemin détourné pour aller à la considération qu’ils ne pouvaient avoir par les richesses.
LIII.
La haine pour les favoris n’est autre chose que l’amour de la faveur. Le dépit de ne la pas posséder se console et s’adoucit par le mépris que l’on témoigne de ceux qui la possèdent ; et nous leur refusons nos hommages, ne pouvant pas leur ôter ce qui leur attire ceux de tout le monde.
LIV.
Pour s’établir dans le monde, on fait tout ce que l’on peut pour y paraître établi.
LV.
Quoique les hommes se flattent de leurs grandes actions, elles ne sont pas souvent les effets d’un grand dessein, mais des effets du hasard.
LVI.
Il semble que nos actions aient des étoiles heureuses ou malheureuses, à qui elles doivent une grande partie de la louange et du blâme qu’on leur donne.
LVII.
Il n’y a point d’accidents si malheureux dont les habiles gens ne tirent quelque avantage, ni de si heureux que les imprudents ne puissent tourner à leur préjudice.
LVIII.
La fortune tourne tout à l’avantage de ceux qu’elle favorise.
LIX.
Le bonheur et le malheur des hommes ne dépend pas moins de leur humeur que de leur fortune.
LX.
La sincérité est une ouverture de cœur : on la trouve en fort peu de gens ; et celle que l’on voit d’ordinaire, n’est qu’une fine dissimulation pour attirer la confiance des autres.
LXI.
L’aversion du mensonge est souvent une imperceptible ambition de rendre nos témoignages considérables et d’attirer à nos paroles un respect de religion.
LXII.
La vérité ne fait pas tant de bien dans le monde, que ses apparences y font de mal.
LXIII.
Il n’y a point d’éloges qu’on ne donne à la prudence ; cependant elle ne saurait nous assurer du moindre évènement.
LXIV.
Un habile homme doit régler le rang de ses intérêts, et les conduire chacun dans son ordre. Notre avidité se trouble souvent, en nous faisant courir à tant de choses à la fois, que pour désirer trop les moins importantes, on manque les plus considérables.
LXV.
La bonne grâce est au corps ce que le bon sens est à l’esprit.
LXVI.
S’il y a un amour pur et exempt du mélange de nos autres passions, c’est celui qui est caché au fond du cœur, et que nous ignorons nous-mêmes.
LXVII.
Il n’y a point de déguisement qui puisse longtemps cacher l’amour où il est, ni le feindre ou il n’est pas.
LXVIII.
Il n’y a guère de gens qui ne soient honteux de s’être aimés, quand ils ne s’aiment plus.
LXIX.
Il en est du véritable amour comme de l’apparition des esprits : tout le monde en parle, mais peu de gens en ont vu.
LXX.
L’amour prête son nom à un nombre infini de commerces qu’on lui attribue, et où il n’a non plus de part que le doge à ce qui se fait à Venise.
LXXI.
L’amour de la justice n’est, en la plupart des hommes, que la crainte de souffrir l’injustice.
LXXII.
Le silence est le parti le plus sûr pour celui qui se défie de soi-même.
LXXIII.
Ce qui nous rend si changeants dans nos amitiés, c’est qu’il est difficile de connaître les qualités de l’âme, et facile de connaître celles de l’esprit.
LXXIV.
Nous ne pouvons rien aimer que par rapport à nous, et nous ne faisons que suivre notre goût et notre plaisir, quand nous préférons nos amis à nousmêmes ; c’est néanmoins par cette préférence seule que l’amitié peut être vraie et parfaite.
LXXV.
La réconciliation avec nos ennemis n’est qu’un désir de rendre notre condition meilleure, une lassitude de la guerre, et une crainte de quelque mauvais évènement.
LXXVI.
Ce que les hommes ont nommé amitié, n’est qu’une société, qu’un ménagement réciproque d’intérêts, et qu’un échange de bons offices ; ce n’est enfin qu’un commerce, où l’amour-propre se propose toujours quelque chose à gagner.
LXXVII.
Il est plus honteux de se délier de ses amis que d’en être trompé.
LXXVIII.
Nous nous persuadons souvent d’aimer les gens plus puissants que nous, et néanmoins c’est l’intérêt seul qui produit notre amitié ; nous ne nous donnons pas à eux pour le bien que nous leur voulons faire, mais pour celui que nous en voulons recevoir.
LXXIX.
Les hommes ne vivraient pas longtemps en société s’ils n’étaient les dupes les uns des autres.
LXXX.
L’amour-propre nous augmente ou nous diminue les bonnes qualités de nos amis, à proportion de la satisfaction que nous avons d’eux, et nous jugeons de leur mérite par la manière dont ils vivent avec nous.
LXXXI.
Tout le monde se plaint de sa mémoire, et personne ne se plaint de son jugement.
LXXXII.
Nous plaisons plus souvent, dans le commerce de la vie, par nos défauts que par nos bonnes qualités.
LXXXIII.
La plus grande ambition n’en a pas la moindre apparence, lorsqu’elle se rencontre dans une impossibilité absolue d’arriver où elle aspire.
LXXXIV.
Détromper un homme préoccupé de son mérite, c’est lui rendre un aussi mauvais office que celui que l’on rendit à ce fou d’Athènes, qui croyait que tous les vaisseaux qui arrivaient dans le port étaient à lui.
LXXXV.
Les vieillards aiment à donner de bons préceptes, pour se consoler de n’être plus en état de donner de mauvais exemples.
LXXXVI.
Les grands noms abaissent au lieu d’élever ceux qui ne les savent pas soutenir !
LXXXVII.
La marque d’un mérite extraordinaire est de voir que ceux qui l’envient le plus sont contraints de le louer.
LXXXVIII.
Tel homme est ingrat qui est moins coupable de son ingratitude que celui qui lui a fait du bien.
LXXXIX.
On s’est trompé lorsqu’on a cru que l’esprit et le jugement étaient deux choses différentes : le jugement n’est que la grandeur de la lumière de l’esprit. Cette lumière pénètre le fond des choses ; elle y remarque tout ce qu’il faut remarquer, et aperçoit celles qui semblent imperceptibles. Ainsi il faut demeurer d’accord que c’est l’étendue de la lumière de l’esprit qui produit tous les effets qu’on attribue au jugement.
XC.
Chacun dit du bien de son cœur, et personne n’en ose dire de son esprit.
XCI.
La politesse de l’esprit consiste à penser des choses honnêtes et délicates.
XCII.
La galanterie de l’esprit est de dire des choses flatteuses et d’une manière agréable.
XCIII.
Il arrive souvent que des choses se présentent plus achevées à notre esprit qu’il ne les pourrait faire avec beaucoup d’art.
XCIV.
L’esprit est toujours la dupe du cœur.
XCV.
Tous ceux qui connaissent leur esprit, ne connaissent pas leur cœur.
XCVI.
Les hommes et les affaires ont leur point de perspective. Il y en a qu’il faut voir de près pour en bien juger, et d’autres dont on ne juge jamais si bien que quand on en est éloigné.
XCVII.
Celui-là n’est pas raisonnable à qui le hasard fait trouver la raison, mais celui qui la connaît, qui la discerne et qui la goûte.
XCVIII.
Pour bien savoir les choses, il en faut savoir le détail ; et, comme il est presque infini, nos connaissances sont toujours superficielles et imparfaites.
XCIX.
C’est une espèce de coquetterie de faire remarquer qu’on n’en fait jamais.
C.
L’esprit ne saurait jouer longtemps le personnage du cœur.
CI.
La jeunesse change ses goûts par l’ardeur du sang, et la vieillesse conserve les siens par l’accoutumance.
CII.
On ne donne rien si libéralement que ses conseils.
CIII.
Les défauts de l’esprit augmentent en vieillissant, comme ceux du visage.
CIV.
Il y a de bons mariages, mais il n’y en a point de délicieux.
CV.
On ne se peut consoler d’être trompé par ses ennemis et trahi par ses amis, et l’on est souvent satisfait de l’être par soi-même.
CVI.
Il est aussi facile de se tromper soi-même sans s’en apercevoir, qu’il est difficile de tromper les autres sans qu’ils s’en aperçoivent.
CVII.
Rien n’est moins sincère que la manière de demander et de donner des conseils. Celui qui en demande paraît avoir une déférence respectueuse pour les sentiments de son ami, bien qu’il ne pense qu’à lui faire approuver les siens, et à le rendre garant de sa conduite ; et celui qui conseille paie la confiance qu’on lui témoigne d’un zèle ardent et désintéressé, quoiqu’il ne cherche le plus souvent, dans les conseils qu’il donne, que son propre intérêt ou sa gloire.
CVIII.
La plus subtile de toutes les finesses est de savoir bien feindre de tomber dans les pièges qu’on nous tend ; et l’on n’est jamais si aisément trompé que quand on songe à tromper les autres.
CIX.
L’intention de ne jamais tromper nous expose à être souvent trompés.
CX.
Nous sommes si accoutumés à nous déguiser aux autres, qu’enfin nous nous déguisons à nous-mêmes.
CXI.
L’on fait plus souvent des trahisons par faiblesse que par dessein formé de trahir.
CXII.
On fait souvent du bien pour pouvoir impunément faire du mal.
CXIII.
Si nous résistons à nos passions, c’est plus par leur faiblesse que par notre force.
CXIV.
On n’aurait guère de plaisir, si on ne se flattait jamais.
CXV.
Les plus habiles affectent toute leur vie de blâmer les finesses, pour s’en servir en quelque occasion, et pour quelque grand intérêt.
CXVI.
L’usage ordinaire de la finesse est la marque d’un petit esprit ; et il arrive presque toujours que celui qui s’en sert pour se couvrir en un endroit se découvre en un autre.
CXVII.
Les finesses et les trahisons ne viennent que du manque d’habileté.
CXVIII.
Le vrai moyen d’être trompé, c’est de se croire plus fin que les autres.
CXIX.
La trop grande subtilité est une fausse délicatesse, et la véritable délicatesse est une solide subtilité.
CXX.
Il suffit quelquefois d’être grossier pour n’être pas trompé par un habile homme.
CXXI.
La faiblesse est le seul défaut que l’on ne saurait corriger.
CXXII.
Il est plus aisé d’être sage pour les autres que de l’être pour soi-même.
CXXIII.
Les seules bonnes copies sont celles qui nous font voir le ridicule des méchants originaux.
CXXIV.
On n’est jamais si ridicule par les qualités que l’on a, que par celles que l’on affecte d’avoir.
CXXV.
On est quelquefois aussi différent de soi-même que des autres.
CXXVI.
On parle peu quand la vanité ne fait pas parler.
CXXVII.
On aime mieux dire du mal de soi-même que de n’en point parler.
CXXVIII.
Une des choses qui fait que l’on trouve si peu de gens qui paraissent raisonnables et agréables dans la conversation, c’est qu’il n’y a presque personne qui ne pense plutôt à ce qu’il veut dire, qu’à répondre précisément à ce qu’on lui dit. Les plus habiles et les plus complaisants se contentent de montrer seulement une mine attentive, au même temps que l’on voit dans leurs yeux et leur esprit un égarement pour ce qu’on leur dit, et une précipitation pour retourner à ce qu’ils veulent dire ; au lieu de considérerquec’est un mauvais moyen de plaire aux autres, ou de les persuader, que de chercher si fort à se plaire à soi-même, et que bien écouler et bien répondre est une des plus grandes perfections qu’on puisse avoir dans la conversation.
CXXIX.
Un homme d’esprit serait souvent bien embarrassé sans la compagnie des sots.
CXXX.
Nous nous vantons souvent de ne nous point ennuyer ; et nous sommes si glorieux, que nous ne voulons pas nous trouver de mauvaise compagnie.
CXXXI.
Comme c’est le caractère des grands esprits de faire entendre en peu de paroles beaucoup de choses, les petits esprits, au contraire, ont le don de beaucoup parler, et de ne rien dire.
CXXXII.
C’est plutôt par l’estime de nos propres sentiments que nous exagérons les bonnes qualités des autres, que par l’estime de leur mérite ; et nous voulons nous attirer des louanges, lorsqu’il semble que nous leur en donnons.
CXXXIII.
On n’aime point à louer, et on ne loue jamais personne sans intérêt. La louange est une flatterie habile, cachée et délicate, qui satisfait différemment celui qui la donne et celui qui la reçoit : l’un la prend comme une récompense de son mérite ; l’autre la donne pour faire remarquer son équité et son discernement.
CXXXIV.
Nous choisissons souvent des louanges empoisonnées, qui font voir par contrecoup, en ceux que nous louons, des défauts que nous n’osons découvrir d’une autre sorte.
CXXXV.
On ne loue d’ordinaire que pour être loué.
CXXXVI.
Peu de gens sont assez sages pour préférer le blâme qui leur est utile à la louange qui les trahit.
CXXXVII.
Il y a des reproches qui louent, et des louanges qui médisent.
CXXXVIII.
Le refus des louanges est un désir d’être loué deux fois.
CXXXIX.
Le désir de mériter les louanges qu’on nous donne fortifie notre vertu ; et celles que l’on donne à l’esprit, à la valeur et à la beauté, contribuent à les augmenter.
CXL.
Il est plus difficile de s’empêcher d’être gouverné que de gouverner les autres.
CXLI.
Si nous ne nous flattions pas nous-mêmes, la flatterie des autres ne nous pourrait nuire.
CXLII.
La nature fait le mérite, et la fortune le met en œuvre.
CXLIII.
La fortune nous corrige de plusieurs défauts que la raison ne saurait corriger.
CXLIV.
Il y a des gens dégoûtants avec du mérite, et d’autres qui plaisent avec des défauts.
CXLV.
Il y a des gens dont tout le mérite consiste à dire et à faire des sottises utilement, et qui gâteraient tout s’ils changeaient de conduite.
CXLVI.
La gloire des grands hommes se doit toujours mesurer aux moyens dont ils se sont servis pour l’acquérir.
CXLVII.
La flatterie est une fausse monnaie qui n’a de cours que par notre vanité.
CXLVIII.
Ce n’est pas assez d’avoir de grandes qualités, il en faut avoir l’économie.
CXLIX.
Quelque éclatante que soit une action, elle ne doit pas passer pour grande, lorsqu’elle n’est pas l’effet d’un grand dessein.
CL.
Il doit y avoir une certaine proportion entre les actions et les desseins, si on en veut tirer tous les effets qu’elles peuvent produire.
CLI.
L’art de savoir bien mettre en œuvre de médiocres qualités, dérobe l’estime, et donne souvent plus de réputation que le véritable mérite.
CLII.
Il y a une infinité de conduites qui paraissent ridicules, et dont les raisons cachées sont très sages et très solides.
CLIII.
Il est plus facile de paraître digne des emplois qu’on n’a pas, que de ceux que l’on exerce.
CLIV.
Notre mérite nous attire l’estime des honnêtes gens, et notre étoile celle du public.
CLV.
Le monde récompense plus souvent les apparences du mérite que le mérite même.
CLVI.
L’avarice est plus opposée à l’économie que la libéralité.
CLVII.
L’espérance, toute trompeuse qu’elle est, sert au moins à nous mener à la fin de la vie par un chemin agréable.
CLVIII.
Pendant que la paresse et la timidité nous retiennent dans notre devoir, notre vertu en a souvent tout l’honneur.
CLIX.
Il est difficile de juger si un procédé net, sincère et honnête, est un effet de probité ou d’habileté.
CLX.
Les vertus se perdent dans l’intérêt, comme les fleuves se perdent dans la mer.
CLXI.
Si on examine bien les divers effets de l’ennui, on trouvera qu’il fait manquer à plus de devoirs que l’intérêt.
CLXII.
Il y a diverses sortes de curiosité : l’une d’intérêt, qui nous porte à désirer d’apprendre ce qui nous peut être utile ; et l’autre d’orgueil, qui vient du désir de savoir ce que les autres ignorent.
CLXIII.
Il vaut mieux employer notre esprit à supporter les infortunes qui nous arrivent, qu’à prévoir celles qui nous peuvent arriver.
CLXIV.
Ce qui nous fait aimer les nouvelles connaissances, n’est pas tant la lassitude que nous avons des vieilles, ou le plaisir de changer, que le dégoût de n’être pas assez admirés de ceux qui nous connaissent trop, et l’espérance de l’être davantage de ceux qui ne nous connaissent pas tant.
CLXV.
Nous nous plaignons quelquefois légèrement de nos amis, pour justifier par avance notre légèreté.
CLXVI.
Notre repentir n’est pas tant un regret du mal que nous avons fait qu’une crainte de celui qui nous en peut arriver.
CLXVII.
Il y a une inconstance qui vient de la légèreté de l’esprit, ou de sa faiblesse, qui lui fait recevoir toutes les opinions d’autrui ; et il y en a une autre, qui est plus excusable, qui vient du dégoût des choses.
CLXVIII.
Les vices entrent dans la composition des vertus, comme les poisons entrent dans la composition des remèdes. La prudence les assemble et les tempère, et elle s’en sert utilement contre les maux de la vie.
CLXIX.
Il faut demeurer d’accord, à l’honneur de la vertu, que les plus grands malheurs des hommes sont ceux où ils tombent par les crimes.
CLXX.
Nous avouons nos défauts pour réparer par notre sincérité le tort qu’ils nous font dans l’esprit des autres.
CLXXI.
Il y a des héros en mal comme en bien.
CLXXII.
On ne méprise pas tous ceux qui ont des vices, mais on méprise tous ceux qui n’ont aucune vertu.
CLXXIII.
Le nom de la vertu sert à l’intérêt aussi utilement que les vices.
CLXXIV.
La santé de l’âme n’est pas plus assurée que celle du corps, et quoique l’on paraisse éloigné des passions, on n’est pas moins en danger de s’y laisser emporter que de tomber malade quand on se porte bien.
CLXXV.
Il n’appartient qu’aux grands hommes d’avoir de grands défauts.
CLXXVI.
Quand les vices nous quittent, nous nous flattons de la créance que c’est nous qui les quittons.
CLXXVII.
Il y a des rechutes dans les maladies de l’âme comme dans celles du corps. Ce que nous prenons pour notre guérison, n’est le plus souvent qu’un relâche ou un changement de mal.
CLXXVIII.
Les défauts de l’âme sont comme les blessures du corps : quelque soin qu’on prenne de les guérir, la cicatrice paraît toujours, et elles sont à tout moment en danger de se rouvrir.
CLXXIX.
Nous oublions aisément nos fautes lorsqu’elles ne sont sues que de nous.
CLXXX.
Il y a des gens de qui l’on ne peut jamais croire du mal sans l’avoir vu ; mais il n’y en a point en qui il nous doive surprendre en le voyant.
CLXXXI.
Nous élevons la gloire des uns pour abaisser celle des autres : et quelquefois on louerait moins M. le Prince et M. de Turenne, si on ne les voulait point blâmer tous les deux.
CLXXXII.
Le désir de paraître habile empêche souvent de le devenir.
CLXXXIII.
Celui qui croit pouvoir trouver en soi-même de quoi se passer de tout le monde, se trompe fort ; mais celui qui croit qu’on ne peut se passer de lui, se trompe encore davantage.
CLXXXIV.
Les faux honnêtes gens sont ceux qui déguisent leurs défauts aux autres et à eux-mêmes ; les vrais honnêtes gens sont ceux qui les connaissent parfaitement et qui les confessent.
CLXXXV.
Le vrai honnête homme est celui qui ne se pique de rien.
CXXXVI.
La sévérité des femmes est un ajustement et un fard qu’elles ajoutent à leur beauté.
CLXXXVII.
C’est être véritablement honnête homme que de vouloir être toujours exposé à la vue des honnêtes gens.
CLXXXVIII.
La folie nous suit dans tous les temps de la vie. Si quelqu’un paraît sage, c’est seulement parce que ses folies sont proportionnées à son âge et à sa fortune.
CLXXXIX.
Il y a des gens niais qui se connaissent et qui emploient habilement leur niaiserie.
CXC.
Qui vit sans folie, n’est pas si sage qu’il croit.
CXCI.
En vieillissant, on devient plus fou et plus sage.
CXCII.
Il y a des gens qui ressemblent aux vaudevilles, qu’on ne chante qu’un certain temps.
CXCIII.
La plupart des gens ne jugent des hommes que par la vogue qu’ils ont, ou par leur fortune.
CXCIV.
L’amour de la gloire, la crainte de la honte, le dessein de faire fortune, le désir de rendre notre vie commode et agréable, et l’envie d’abaisser les autres, sont souvent les causes de cette valeur, si célèbre parmi les hommes.
CXCV.
La valeur est dans les simples soldats un métier périlleux qu’ils ont pris pour gagner leur vie.
CXCVI.
La parfaite valeur et la poltronnerie sont deux extrémités où l’on arrive rarement. L’espace qui est entre elles deux est vaste et contient toutes les autres espèces de courage. Il n’y pas moins de différence entre elles qu’entre les visages et les humeurs. Il y a des hommes qui s’exposent volontiers au commencement d’une action, et qui se relâchent et se rebutent aisément par sa durée. Il y en a qui sont contents quand ils ont satisfait à l’honneur du monde, et qui font fort peu de chose au-delà. On en voit qui ne sont pas toujours également maîtres de leur peur. D’autres se laissent quelquefois entraîner à des terreurs générales ; d’autres vont à la charge, parce qu’ils n’osent demeurer dans leurs postes. Il s’en trouve à qui l’habitude des moindres périls affermit le courage, et les prépare à s’exposer à de plus grands. Il y en a qui sont braves à coups d’épée, et qui craignent les coups de mousquet ; d’autres sont assurés aux coups de mousquet, et appréhendent de se battre à coups d’épée. Tous ces courages de différentes espèces conviennent, en ce que la nuit augmentant la crainte et cachant les bonnes et les mauvaises actions, elle donne la liberté de se ménager. Il y a encore un autre ménagement plus général : car on ne voit point d’homme qui fasse tout ce qu’il serait capable de faire dans une occasion, s’il était assuré d’en revenir ; de sorte qu’il est visible que la crainte de la mort ôte quelque chose de la valeur.
CXCVII.
La parfaite valeur est de faire sans témoins ce qu’on serait capable de faire devant tout le monde.
CXCVIII.
L’intrépidité est une force extraordinaire de l’âme qui l’élève au-dessus des troubles, des désordres et des émotions que la vue des grands périls pourrait exciter en elle ; et c’est par cette force que les héros se maintiennent en un état paisible, et conservent l’usage libre de leur raison dans les accidents les plus surprenants et les plus terribles.
CXCIX.
L’hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu.
CC.
La plupart des hommes s’exposent assez dans la guerre pour sauver leur honneur ; mais peu se veulent toujours exposer autant qu’il est nécessaire pour faire réussir le dessein pour lequel ils s’exposent.
CCI.
On ne veut point perdre la vie, et on veut acquérir de la gloire : ce qui fait que les braves ont plus d’adresse et d’esprit pour éviter la mort, que les gens de chicane n’en ont pour conserver leur bien.
CCII.
Il n’y a guère de personnes qui, dans le premier penchant de l’âge, ne fassent connaître par où leur corps et leur esprit doivent défaillir.
CCIII.
Il est de la reconnaissance comme de la bonne foi des marchands : elle entretient le commerce ; et nous ne payons pas parce qu’il est juste de nous acquitter, mais pour trouver plus facilement des gens qui nous prêtent.
CCIV.
Tous ceux qui s’acquittent des devoirs de la reconnaissance, ne peuvent pas pour cela se flatter d’être reconnaissants.
CCV.
Ce qui fait le mécompte dans la reconnaissance qu’on attend des grâces que l’on a faites, c’est que l’orgueil de celui qui donne, et l’orgueil de celui qui reçoit, ne peuvent convenir du prix du bienfait.
CCVI.