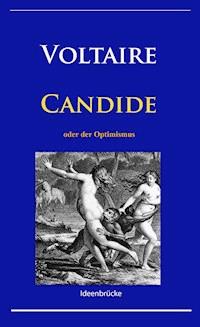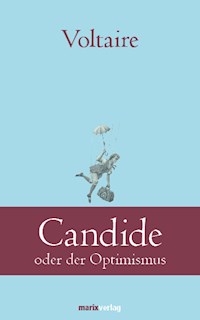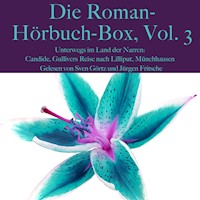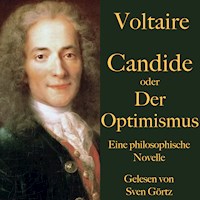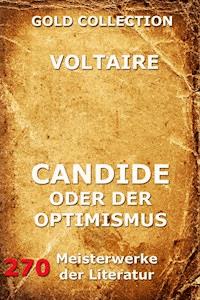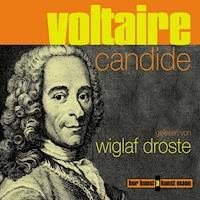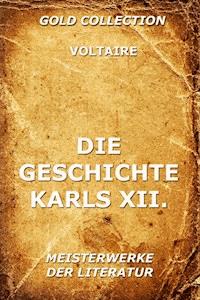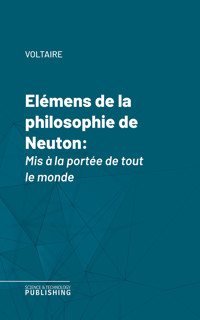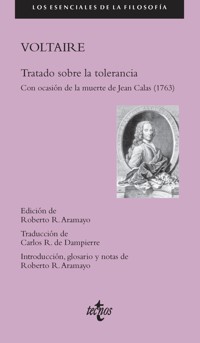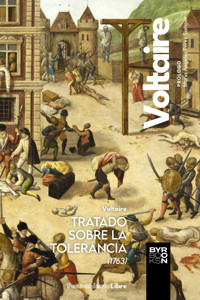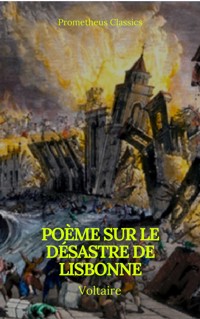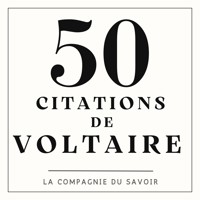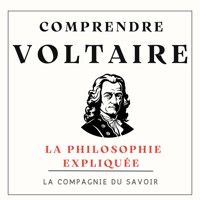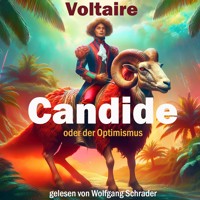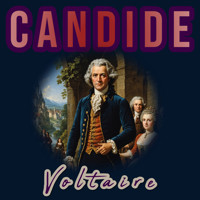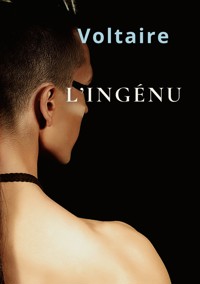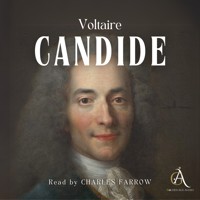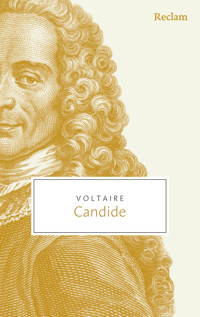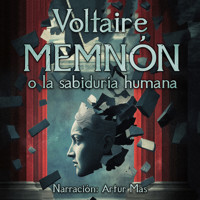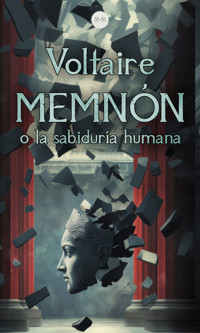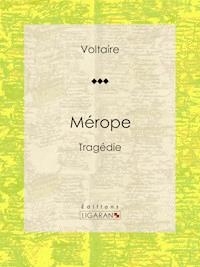
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Extrait : "ISMÉNIE : Grande reine, écartez ces horribles images ; Goûtez des jours sereins, nés du sein des orages. Les dieux nous ont donné la victoire et la paix : Ainsi que leur courroux ressentez leurs bienfaits. Messène, après quinze ans de guerres intestines, Lève un front moins timide, et sort de ses ruines. Vos yeux ne verront plus tous ces chefs ennemis Divisés d'intérêts, et pour le crime unis, Par les saccagements, le sang, et le ravage, Du meilleur de nos rois..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 114
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335067385
©Ligaran 2015
Mérope fut-elle refusée par les comédiens français ? L’auteur de la biographie de l’abbé de Voisenon, qui est en tête des Œuvres complètes de cet écrivain, édition 1781, l’affirme. Mérope, si l’on s’en rapporte à ce biographe, aurait été refusée parce que Messieurs du tripot, comme les désigne Voltaire, n’admettaient point une tragédie sans amour. À quelque temps de là, Voltaire lut sa tragédie à l’abbé de Voisenon. Voisenon, transporté, se jette au cou du poète, en lui jurant que c’est son chef-d’œuvre. « Eh bien ! dit Voltaire, les comédiens l’ont refusé ! » Voisenon court au théâtre, obtient pour Mérope une nouvelle lecture ; le premier jugement est révisé, et la pièce reçue au contraire avec acclamation. Cette anecdote est fort suspecte. La harpe, dans la Correspondance littéraire, nie absolument que Mérope ait jamais éprouvé un refus. On a prétendu aussi que Mérope avait dû céder la place à Amasis de Lagrange-Chancel, dont le sujet était le même. Amasis avait été représentée pour la première fois le 13 décembre 1701 ; elle fut reprise le 29 janvier 1731, et eut alors seize représentations, pendant lesquelles elle attira de nombreuses assemblées. Il ne semble pas que huit ou dix ans après, ce souvenir pût être cause des retards que la tragédie de Voltaire éprouva. Bien loin d’être arrêtée par une œuvre rivale, la Mérope de Voltaire barra le passage, au contraire, à une autre Mérope, et c’est peut-être ce qui est arrivé à celle-ci, qui a fait raconter ce qu’on a dit de celle-là.
Frappé des beautés de la tragédie italienne (de Maffei), Clément (de Genève), alors âgé de vingt-six ans, résolut d’accommoder ce sujet pour notre théâtre. Il touchait à la fin du troisième acte, lorsque le marquis de Maffei vint à Paris, en 1733. Clément se présenta chez lui, et prit la liberté de lui demander son avis. L’auteur de la Mérope italienne parut désirer qu’il se bornât à une simple traduction ; mais Clément ne suivit pas ce conseil, et s’empressa de mettre la dernière main à son ouvrage ; dès qu’il fut achevé, il l’offrit aux comédiens, qui exigèrent des changements. Dans l’intervalle, Voltaire présenta sa Mérope, qui fut jugée ce qu’elle est en effet : un chef-d’œuvre. Elle fut donc acceptée, et, lorsque Clément rapporta la sienne avec les changements qu’on lui avait demandés, les comédiens la refusèrent à cause de sa ressemblance avec celle de Voltaire. Cette Mérope, de P. Clément, fut imprimée en 1749, et c’est l’auteur qui nous instruit de ces circonstances dans son Avertissement.
Mérope est un des grands sujets dramatiques que la tradition grecque nous a légués. Cette donnée célèbre a eu chez toutes les nations modernes, et particulièrement chez nous, des destinées que Voltaire a indiquées dans sa lettre au marquis de Maffei.
Ce qui importe le plus, à notre avis, c’est de jeter un regard sur les faits historiques ou mythologiques qui ont servi de fondement au drame. Maffei les résume de la manière suivante dans la dédicace de sa pièce :
« Quelque temps après la prise de Troie, les Héraclides, c’est-à-dire les descendants d’Hercule, ayant rétabli leur domination dans le Péloponèse, le sort assigna à Cresphonte le territoire de la Messénie. L’épouse de ce Cresphonte s’appelait Mérope. Cresphonte, s’étant montré trop favorable au peuple, fut assassiné par l’aristocratie, ainsi que ses fils, à l’exception du plus jeune, qui était élevé hors du pays chez un parent de sa mère. Ce dernier fils, nommé Œpytus, lorsqu’il fut devenu grand, se remit en possession du royaume de son père avec des Arcadiens et des Doriens, et vengea la mort de son père sur ses meurtriers. » – Voilà ce que raconte Pausanias.
« Lorsque Cresphonte eut été assassiné avec ses deux fils, Polyphonte, qui était aussi du sang des Héraclides, s’empara du gouvernement ; il contraignit Mérope à l’épouser. Mais le troisième fils de Cresphonte, que sa mère avait fait mettre en sûreté, tua plus tard le tyran et reprit la royauté. » – Voilà ce que rapporte Apollodore.
« Mérope fut sur le point de tuer, sans le connaître, ce fils échappé au massacre ; mais elle en fut empêchée à temps par un vieux serviteur, qui lui découvrit que c’était son propre fils qu’elle prenait pour le meurtrier de ce même fils. Celui-ci, enfin reconnu, trouva, dans un sacrifice, l’occasion de tuer Polyphonte. » – Voilà ce que nous apprend Hygin, chez qui Œpytus porte le nom de Téléphonte.
« Il serait surprenant, ajoute Lessing, qu’une aventure qui présente des péripéties et des reconnaissances si singulières n’eut pas été déjà mise à profit par les tragiques de l’antiquité. Comment ne l’aurait-elle pas été ? Aristote, dans sa Poétique, parle d’un Cresphonte, où Mérope reconnaît son fils à l’instant même où elle allait le tuer, le prenant pour le meurtrier de ce même fils ; et Plutarque, dans son second livre sur l’Usage des viandes, fait sans aucun doute allusion à cette même pièce lorsqu’il rappelle l’émotion qui s’emparait de tout l’amphithéâtre au moment où Mérope levait la hache sur son fils : tous les spectateurs, dit-il, tremblaient de peur que le coup ne fût porté avant que le vieux serviteur arrivât. Aristote mentionne, il est vrai, ce Cresphonte sans nom d’auteur ; mais, comme nous trouvons un Cresphonte d’Euripide cité chez Cicéron et chez plusieurs écrivains de l’antiquité, il ne peut guère avoir eu en vue que l’ouvrage de ce poète. »
Maffei croyait avoir trouvé le plan de ce Cresphonte dans la CLXXXIVe fable d’Hygin, et la découverte n’est pas invraisemblable. Voici dans tous ses détails le récit d’Hygin :
« Cresphonte, roi de Messénie, eut de son épouse Mérope trois fils. Polyphonte excita un soulèvement contre lui : Cresphonte y perdit la vie avec les deux aînés de ses fils. Ensuite Polyphonte s’empara du trône et de la main de Mérope. Celle-ci avait trouvé moyen, pendant le soulèvement, de sauver son troisième fils, nommé Téléphonte, et de le faire parvenir en lieu de sûreté, chez un hôte qu’elle avait en Étolie. À mesure que Téléphonte grandissait, les inquiétudes de Polyphonte augmentaient. Il n’avait rien de bon à attendre de ce jeune homme : il promit donc une grande récompense à qui le débarrasserait de lui. Téléphonte en fut instruit, et se sentant capable d’entreprendre sa vengeance, il partit secrètement d’Étolie, passa en Messénie, vint trouver le tyran, lui dit qu’il avait tué Téléphonte, et réclama le salaire promis pour ce meurtre.
Polyphonte l’accueillit, et ordonna qu’on lui donnât l’hospitalité dans le palais jusqu’à ce qu’il pût l’interroger à loisir. Téléphonte fut donc conduit dans la chambre des hôtes, où il s’endormit de fatigue. Pendant ce temps, le vieux serviteur dont la mère et le fils s’étaient servis jusqu’alors pour correspondre ensemble vint tout en larmes trouver Mérope, et lui annonça que Téléphonte était sorti d’Étolie sans qu’on sût où il était allé. Aussitôt Mérope, qui n’ignorait pas de quoi l’étranger s’était vanté, court, une hache à la main, dans la chambre des hôtes : elle allait infailliblement le tuer dans son sommeil si le vieillard, qui l’avait suivie, n’avait reconnu à temps le fils et empêché la mère d’accomplir l’attentat.
Tous deux aussitôt font cause commune. Mérope feignit de s’apaiser et de se réconcilier avec Polyphonte. Celui-ci se crut arrivé au terme de tous ses vœux, et voulut en témoigner sa reconnaissance aux dieux par un sacrifice solennel. Mais, au moment où tout le monde était rassemblé autour de l’autel, Téléphonte dirigea sur le roi le coup dont il feignait de vouloir immoler la victime ; le tyran tomba, et Téléphonte rentra en possession du trône paternel. »
Telles sont les sources anciennes. Voltaire les connut par son prédécesseur italien ; il n’a pas dissimulé d’où l’inspiration lui était directement venue. Lorsqu’on veut se rendre compte de la part d’invention et d’arrangement qui revient au poète français, c’est la tragédie italienne qu’il faut prendre simplement, et comparer à celle qui en est sortie. La Mérope de Maffei fut représentée à Modène en 1714. Elle obtint en peu d’années soixante éditions dans la seule Italie. La Mérope a été traduite en français par Fréret, en 1728 ; elle le fut aussi par du Bourg en 1743, l’année même où fut représentée la tragédie de Voltaire.
Le succès de Mérope fut plus éclatant que celui de Zaïre. Il alla jusqu’à l’enthousiasme. La cabale fut réduite à l’impuissance. Le public demanda l’auteur avec mille cris. Voltaire, dans le Commentaire historique qu’il écrivit plus de trente ans après cet évènement, nous dit : « On m’est venu prendre dans une cache où je m’étais tapi ; on m’a mené de force dans la loge de Mme la maréchale de Villars, où était sa belle-fille. Le parterre était fou : il a crié à la duchesse de Villars de me baiser, et il a tant fait de bruit qu’elle a été obligée d’en passer par là, par l’ordre de sa belle-mère. J’ai été baisé publiquement, comme Alain Chartier par la princesse Marguerite d’Écosse ; mais il dormait, et j’étais fort éveillé. »
Ce récit, fait par Voltaire lui-même, ne paraît pas à M. G. Desnoiresterres à l’abri de toute contestation. « Il se pourrait bien, dit-il, qu’il ait embelli et confondu. Le Journal de police, que nous avons sous les yeux, cite d’autres noms, et, tout en constatant le délire général, se tait absolument sur l’épisode du baiser : « Le parterre, nous dit-il, a non seulement applaudi à tout rompre, mais même a demandé mille fois que Voltaire parût sur le théâtre pour lui marquer sa joie et son contentement. Mmes de Boufflers et de Luxembourg ont fait tout ce qu’elles ont pu pour engager ce poète à satisfaire l’empressement du public, mais il s’est retiré de leur loge avec un air soumis, après avoir baisé la main de Mme de Luxembourg. » Et sans doute, voilà le vrai ; un baiser sur la main de Mme de Luxembourg, au lieu d’un baiser de la jeune duchesse de Villars ; car l’observateur à gages n’avait nul motif de changer les faits et les personnes ; d’ailleurs, alors et depuis de longues années, la maréchale était en pleine réforme et n’allait sûrement plus au spectacle. Mais, dira-t-on, tout cela est extrait d’une lettre à d’Aigueberre, écrite six semaines au plus après cet incomparable triomphe. La réponse est aussi aisée qu’étrange : cette lettre, tout en constatant le grand succès de Mérope dans les mêmes termes que le Commentaire, garde le silence à l’égard du baiser de la duchesse, et le nom de Mme de Villars ne s’y trouve même point. »
Le talent des interprètes contribua au succès de la tragédie. Mlle Dumesnil eut dans le rôle de Mérope un succès personnel qui a laissé des traces dans les annales du théâtre. On lui adressa une pièce de vers qui se termine ainsi ;
Cette actrice avait innové sur un point dans cette pièce : elle osa, pour la première fois, courir sur la scène, jusque-là on croyait que courir blessait la dignité tragique. Les ennemis de Voltaire tirèrent, bien entendu, parti de la supériorité de l’interprétation pour essayer de rabaisser le mérite de son œuvre. On prête à Fontenelle le mot suivant, quand Mérope parut imprimée : « Les représentations de Mérope, dit-il, ont fait beaucoup d’honneur à M. de Voltaire ; et la lecture en fait encore plus à Mlle Dumesnil. » Fontenelle n’aurait pas même eu le mérite de l’invention, car cette facile épigramme avait été faite plus d’une fois au dix-septième siècle.
Mérope fut proscrite pendant la Révolution. Le 31 mars 1793, un membre de la Convention, Génissieux, dénonça Mérope à l’Assemblée. Il avait entendu cette pièce au théâtre Montansier. Tous les patriotes avaient été indignés de voir représenter une œuvre dans laquelle une reine en deuil pleure son mari et désire ardemment le retour de ses deux frères absents. La Convention, sur la proposition de Boissy-d’Anglas, adopta un décret qui ordonnait au comité de l’instruction publique de présenter une loi sur la surveillance des spectacles, et qui chargeait le maire de prendre les mesures nécessaires pour empêcher de jouer Mérope.
La Mérope de Voltaire fut commencée en 1736, terminée en 1737, refusée en 1738 par les comédiens français parce que, disaient-ils, la pièce ressemblait à l’Amasis de Lagrange ; corrigée en 1738, et jouée en 1743. Voltaire donne, sur son succès extraordinaire, des détails dans sa lettre à d’Aigueberre du 4 avril 1743, et dans le Commentaire historique. La première édition, 1744, in-8° et in-12, était suivie de Quelques Petites Pièces de littérature. Ces pièces étaient : 1°Lettre sur l’esprit, corrigée depuis par l’auteur, et qui a été refondue dans le Dictionnaire philosophique ; 2°Nouvelles Considérations sur l’histoire, qui sont en tête de l’Histoire de Chartes XII.
Les parodies de Mérope sont Javotte, par Valois d’Orville ; et Marotte, par Panard, Gallet et Pontau ; elles avaient été jouées sur le théâtre de la Foire, et ne sont point imprimées. Marotte, représentée le 16 mars 1743, fut reprise le 26 février 1744, sous le titre de l’Enfant retrouvé. C’est Antoine Fabio Sticotti qui est auteur de la Mérope travestie, 1759, in-8°, anonyme. – À l’occasion de Mérope parurent : 1° Lettre à M. le marquis