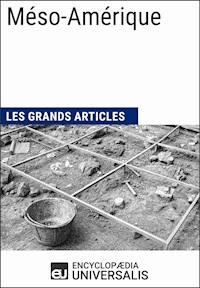
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Partez à la découverte de la Méso-Amérique avec ce Grand Article Universalis !
L'Amérique moyenne a fait l'objet, sous le nom de Mesoamerica, d'une proposition de définition de la part de l'ethno-historien Paul Kirchhoff en 1943. Cette proposition s'appuie sur les similitudes d'un ensemble de traits culturels, répartis sur un vaste territoire et identifiés depuis la Conquête ...
Un ouvrage spécialement conçu pour le numérique afin d’en savoir plus sur la Méso-Amérique
À PROPOS DES GRANDS ARTICLES D’UNIVERSALIS
La collection des Grands Articles d’Universalis rassemble, dans tous les domaines du savoir, des articles écrits par des spécialistes reconnus mondialement et édités selon les critères professionnels les plus exigeants.
Une sélection thématique, effectuée parmi les nombreux articles qui composent l’Encyclopaedia Universalis, permet au lecteur curieux d'en savoir plus sur un sujet précis et d’en faire le tour grâce à des ouvrages conçus pour une lecture en numérique.
À PROPOS DE L’ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS
Écrite par plus de 7 400 auteurs spécialistes de renommée internationale et riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins…), Encyclopaedia Universalis offre des réponses d’une grande qualité dans toutes les disciplines et sur tous les grands domaines de la connaissance. Elle est la référence encyclopédique du monde francophone.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 81
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782341007146
© Encyclopædia Universalis France, 2019. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Marques/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Bienvenue dans ce Grand Article publié par Encyclopædia Universalis.
La collection des Grands Articles rassemble, dans tous les domaines du savoir, des articles : · écrits par des spécialistes reconnus ; · édités selon les critères professionnels les plus exigeants.
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
Méso-Amérique
L’Amérique moyenne a fait l’objet, sous le nom de Mesoamerica, d’une proposition de définition de la part de l’ethno-historien Paul Kirchhoff en 1943. Cette proposition s’appuie sur les similitudes d’un ensemble de traits culturels, répartis sur un vaste territoire et identifiés depuis la Conquête. Au centre et au sud du Mexique, une grande partie de l’Amérique centrale, jusqu’au sud du Costa Rica, la Méso-Amérique représente une vaste aire culturelle homogène.
E.U.
1. L’Amérique moyenne précéramique
L’histoire de l’Amérique moyenne à l’époque précéramique reste encore en grande partie à écrire. Après des débuts prometteurs dans les années 1950 et 1960, l’archéologie de cette partie du monde s’est avant tout consacrée à l’étude des vestiges appartenant aux civilisations précolombiennes majeures, notamment celles ayant laissé des structures architecturales monumentales. La part croissante du tourisme dans les choix guidant la politique de l’archéologie, en particulier au Mexique et au Guatemala, explique, au moins en partie, que les sites moins spectaculaires aient été délaissés. Il est vrai que les conditions de la recherche sur ces périodes reculées posent aussi de nombreux problèmes : les vestiges sont discrets et donc vulnérables, en particulier les grottes et abris-sous-roche qui ont souvent été occupés comme habitation temporaire ou comme étable pendant de longues périodes et parfois même jusqu’à aujourd’hui. Par ailleurs, les sites précéramiques les mieux conservés, et qui présentent également les meilleures possibilités de fournir des vestiges végétaux identifiables, se trouvent dans les vastes zones arides du nord du Mexique, encore trop peu étudiées. Néanmoins, depuis le milieu des années 1990, on assiste à un regain d’intérêt et les recherches portant sur les périodes les plus anciennes ont repris. De nouvelles données sont peu à peu publiées sur le début du peuplement et sur la période précédant l’apparition des premiers villages, en particulier dans la portion septentrionale du Mexique.
• L’évolution des recherches
Pour évoquer le début des recherches, il faut revenir sur les travaux pionniers de Richard S. MacNeish et de son équipe dans l’État de Tamaulipas, à partir des années 1950, et sur ceux, à peu près contemporains, menés par José Luis Lorenzo dans le cadre du département de Préhistoire, alors nouvellement créé au sein de l’Institut national d’anthropologie et d’histoire (I.N.A.H.). Soutenu par la National Science Foundation, MacNeish publie en 1958 les premiers résultats de ses travaux dans la sierra du Tamaulipas, avec une proposition préliminaire concernant la sédentarisation. La séquence chronologique débute vers 10 000 avant J.-C. avec la phase Diablo et se poursuit durant l’Holocène, couvrant la séquence de la domestication des plantes. Le postulat initial consistait à chercher à démontrer que la première plante domestiquée était le maïs, qui constituera par la suite la base de l’alimentation des populations de l’Amérique moyenne. Pourtant, dès les travaux au Tamaulipas, il apparaît que d’autres cultigènes surgissent antérieurement. Ces premiers résultats demandaient néanmoins à être confortés par un nouveau projet, qui fut entrepris dans la vallée de Tehuacán, située dans l’état de Puebla (MacNeish, 1967). À une époque où sont formulés les principes théoriques de la New Archaeology, MacNeish conçoit un projet régional de grande envergure, résolument pluridisciplinaire, qui aboutit à la proposition d’un véritable modèle sur les processus de néolithisation dans les régions semi-arides. Dans ce modèle, la proportion et la variété des plantes cultivées dans la diète croît de façon régulière au cours de la chronologie. La pratique de l’horticulture, puis d’une véritable agriculture va permettre une amélioration des conditions de vie, une croissance démographique et enfin l’apparition des premiers établissements sédentaires et de la céramique. De son côté, J. L. Lorenzo débute les travaux sur le site de Tlapacoya, dans le Bassin de Mexico, qui aboutiront, eux aussi, à la proposition d’une séquence comprenant le passage de l’économie de chasse-cueillette à l’agriculture. Bien que publiés de manière moins exhaustive que ceux de MacNeish, c’est à partir des travaux de ces deux équipes que seront proposés les découpages chronologiques toujours utilisés aujourd’hui.
Depuis un certain nombre d’années cependant, et surtout grâce à l’obtention de données provenant de régions distinctes sur le plan écologique, les chercheurs formulent des hypothèses plus nuancées sur les processus de sédentarisation, mettant en avant la variabilité des trajectoires selon les régions. Par ailleurs, on privilégie aujourd’hui une perspective moins strictement évolutionniste qu’auparavant, en soulignant la complexité des différents phénomènes d’adaptation.
Dans les années 1980, les travaux de Kent Flannery et de son équipe à Guilá Naquitz (Oaxaca) ou de Christine Niederberger à Zohapilco (bassin de Mexico) avaient déjà contribué à nuancer le modèle proposé par MacNeish, et c’est aujourd’hui des régions arides du nord du Mexique, en particulier de Basse-Californie et de Nuevo Léon, que des connaissances nouvelles nous parviennent, mettant en relief les variabilités régionales du peuplement. En revanche, les fouilles continuent à se heurter au manque de données concernant l’apparition de la céramique qui demeure l’un des évènements les moins bien documentés ; les rares informations récentes disponibles ne faisant même que remettre en question certains acquis antérieurs.
Enfin, d’importantes transformations dans les connaissances ont été générées par l’utilisation de techniques plus performantes, notamment pour l’obtention des datations : l’utilisation de l’accélérateur de particules, qui permet désormais de dater directement les vestiges végétaux ou osseux, et non plus simplement leur contexte, est à l’origine de changements majeurs qui concernent, en particulier, les dates de la domestication du maïs et d’autres cultigènes. De même, les datations par A.M.S. (ou en français S.M.A., spectrométrie de masse avec accélérateur, est une méthode de datation par radiocarbone [14C]) effectuées sur certains ossements humains, antérieurement considérés comme provenant de contextes précéramiques, ou tout simplement mal datés, ont suscité quelques surprises. Parmi les ossements des 41 individus nouvellement datés, figuraient notamment ceux du célèbre homme de Tepexpan, dont un crâne mésocéphale très caractéristique, découverts en 1947 dans des niveaux du Pléistocène final. Ces restes étaient ainsi considérés comme ceux d’une figure emblématique, celle du plus ancien mexicain. Une nouvelle étude anthropologique et les datations directes ont permis de déterminer qu’il s’agissait en réalité très probablement d’un individu de sexe féminin qui, pour comble, avait vécu à l’époque préclassique, soit au début de notre ère approximativement.
• Les divisions temporelles
Pour les chercheurs défendant l’hypothèse d’un peuplement ancien, la première période où se manifeste la présence humaine en Amérique moyenne est appelée Archéolithique (Lorenzo, 1975) ou Stade lithique, sous-stade 1 et 2 (MacNeish et Nelken Terner, 1983) et se développe entre 40 000-30 000 avant J.-C. et 12 000 avant J.-C. C’est une période appartenant au Pléistocène supérieur, caractérisée par un climat globalement très froid, le dernier maximum glaciaire ayant lieu entre 20 000 et 12 000 avant J.-C.
La fonte des glaces débute vers 13 000 ou 12 000 avant J.-C. et aboutit, vers 7000 avant J.-C. à la fin du Pléistocène et à la transition vers l’Holocène. Au cours de cet intervalle, les sites deviennent alors beaucoup plus nombreux et de fortes mutations interviennent dans l’équipement des groupes humains avec l’apparition des pointes de projectile, d’où le nom donné parfois à cette période caractérisée par une « culture des pointes ». D’autres auteurs qualifient cette période de Stade Lithique, sous stade 3, ou encore de Cénolithique inférieur.
La première période postglaciaire à proprement parler s’ouvre avec l’Holocène ancien ou Cénolithique supérieur, qui débute vers 7000 avant J.-C. pour se poursuivre jusqu’à 5000 avant J.-C. et marque l’entrée dans la période dite « archaïque ». C’est une période au cours de laquelle les écosystèmes se modifient considérablement. Dès le début, les grands mammifères, mammouths, bisons, camélidés et équidés, disparaissent pour laisser la place à des espèces de taille plus réduite, les cervidés (Odocoïleus virginianus et Odocoïleus hemonius) devenant les animaux les plus intéressants à chasser. L’outillage s’adapte à ces nouvelles contingences, avec une réduction de la taille des pointes de projectile et une diversification des artéfacts, tandis qu’apparaissent les premières pierres à moudre qui témoignent d’une proportion plus importante dans la diète des produits végétaux. Cet intérêt déclenche progressivement des modifications au sein de la structure des plantes les plus utiles à l’homme et marque ainsi le début des phénomènes de domestication.
L’Holocène moyen ou Protonéolithique, entre 5000 à 2500 avant J.-C., voit l’aboutissement de ce processus. Dans les zones arides du centre du Mexique, l’apprentissage de l’agriculture va déboucher sur l’apparition des premières habitations permanentes. Néanmoins, une sédentarisation précoce est aussi identifiée dans certains secteurs écologiques, au bord des lacs ou dans les zones côtières, sans pratique de l’agriculture.
Outils de pierre taillée du site de Progreso (Belize). Assemblage d'outils de pierre taillée du site de Progreso (Belize), 3300-2500 avant J.-C. (d'après R.S. Mac Neish, J.K. Wilkerson et Antoinette Nelken-Terner, 1980).
Par ailleurs, on constate une particularité dans cette région du monde : non seulement la sédentarisation va emprunter des schémas très différents selon les régions, mais elle ne constitue pas non plus une évolution inéluctable et uniforme. En effet, les modes de vie nomades ou semi-nomades vont persister dans les secteurs septentrionaux du Mexique et dans certaines régions des États-Unis jusqu’au XIXe





























